Après avoir fêté en grandes pompes ses vingt ans d’existence l’année dernière, l’Étrange Festival était attendue cette année pour savoir s’il aurait la capacité de se renouveler, de relancer la machine pour continuer à nous surprendre avec des films toujours plus cinglés. Le programme pouvait sembler alléchant, assez foisonnant et toujours aussi hétéroclite. Toutefois, force est de reconnaître que cette première semaine n’est pas réellement à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre, sous réserve de pépites que nous aurions ratés. Assez peu d’objets étranges, beaucoup de films d’horreur ou fantastiques plutôt de bonne facture mais sans grandes surprises. Agréable donc, mais un brin décevant. Il ferait un peu plus froid et les routes seraient blanchies de neige que nous pourrions nous croire à Gérardmer. Compte-rendu des trois premiers jours.
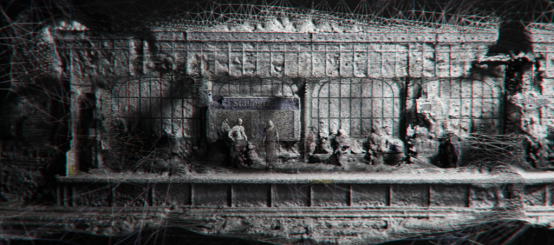
Ghost Cell d’Antoine Delacharlery (France, 2015)
Ce court métrage, projeté en ouverture du festival avant le film de Simon Plummell, se veut une plongée dans Paris vu comme une cellule à travers un microscope virtuel. Si le rendu est particulièrement élégant, si les images sont simplement magnifiques, on s’étonne tout de même du peu d’intérêt du résultat. Pourquoi pas un petit bout de scénario, un embryon d’histoire, un petit quelque chose à raconter ? Parce que, finalement, des gens qui marchent, des transports qui circulent, des immeubles qui se construisent, des structures qui se dupliquent ne sont pas à la hauteur de l’extraordinaire prouesse technique de l’équipe qui a réalisé ce court métrage.

Brand New-U de Simon Pummell (Grande-Bretagne, Irlande, 2015)
On attend toujours beaucoup d’un film d’ouverture de festival, on s’imagine que les programmateurs ont décidé de frapper un grand coup, de donner le ton de ce qui va suivre pendant dix jours. Espérons sincèrement que tel n’est pas le cas ici, pour cette XXIe édition de l’Étrange Festival. En effet, Brand New-U, premier film du réalisateur britannique Simon Pummell, est pour le moins décevant. L’idée de départ n’est pas forcément mauvaise : dans un Londres futuriste, Slater (interprété par Lachlan Nieboer) voit sa femme Nadia (Nora-Jane Noone, inoubliable Holly de The Descent) se faire enlever devant lui pour un groupe d’assaut, l’un des hommes de ce groupe mourant lors de l’opération. Slater découvre, lorsqu’il retourne l’homme mort, que c’est en fait Nadia qui se cache sous la cagoule noire. Et donc, commence pour Slater une plongée en apnée dans un monde qui lui échappe perpétuellement, avec des clones, une vie meilleure, un ailleurs, quelqu’un d’autre, un homme qui cherche indéfiniment son amour perdu et au final, une histoire qui se perd un peu, qui se complexifie pour n’accoucher de rien et qui finit par lasser le spectateur. On ne pourra cependant pas dénier à Pummell une certaine élégance formelle. On pourrait y voir une volonté d’offrir des images léchées et une ambiance étrange à la manière de Lynch ou d’un Bienvenue à Gattaca pour sa dimension futuriste froide, mais malheureusement, cela ne fonctionne qu’à moitié. Le film devient un brin poseur et la forme finit par prendre le pas sur le fond. À ce jeu de miroirs infini, les protagonistes finissent par se perdre, et nous avec, dans une sorte de labyrinthe psychologique aussi vain que lassant.
S tung de Benni Diez (États-Unis, Allemagne, 2015)
tung de Benni Diez (États-Unis, Allemagne, 2015)
Premier long-métrage de Benni Diez (le type en charge des effets spéciaux de Melancholia de Lars Von Trier tout de même), Stung est un bonne claque horrifique, bien drôle et bien gore, une vraie réussite pour le genre. Le film est présenté ici en première française dans le catégorie Nouveaux Talents. Le scénario est aussi mince que la taille des guêpes au début du film, qui vont naturellement grandir et tuer presque tout le monde. Ainsi, alors qu’ils s’occupent de l’organisation d’une garden-party, Paul et Julia se retrouvent confrontés à une attaque de guêpes mutantes, mutation due à l’ingestion d’un engrais illégal et aux effets inattendus. Produit par XYZ (à l’origine d’un paquet de films plutôt sympathiques), le film part avec ce scénario minimaliste mais s’emballe assez vite et laisse le champ libre aux acteurs pour partir dans un grand n’importe quoi assez jouissif. De la simple piqûre à la destruction pur et simple du manoir dans lequel se déroule la fête, les guêpes prennent le pouvoir au milieu de personnages qui partent un peu en vrille grâce notamment à quelques très bonnes bouteilles de Bordeaux (Lance Henriksen, en vieux maire alcoolique, est absolument parfait) et quelques mutations sanguinolentes (Clifton Collins Jr, un bossu malmené par sa mère, devient le serviteur involontaire de la reine des guêpes). On retiendra également les magnifiques effets spéciaux, la reine de ce nouveau genre d’essaim de guêpes étant aussi belle que terrifiante. Rien à reprocher à ce bon film d’horreur, mêlant astucieusement humour et gore, hormis le fait, peut-être, que c’est seulement un sympathique film d’horreur.
 Tag de Sono Sion (Japon, 2015)
Tag de Sono Sion (Japon, 2015)
Mais comment Sono Sion fait-il pour être aussi prolifique sans pour autant bâcler ses films c’est une question qu’on ne cessera de se reposer, et la réussite de Tag nous incite à nous la reposer à nouveau. Avec 7 films en 2015, Sono est rentré dans une phase de boulimie créatrice inouïe, comme un courant, un vent de folie qu’il ne semble même plus maitriser, un besoin de tourner s’apparentant à celui de respirer. Le cinéma est son sang. Et ce flux circule plus que jamais dans Tag, hymne insolent et trivial à la liberté, porté lui même par une liberté totale joignant les farces d’un gosse mal élevé à la forme la plus élégante. Adapté d’un célèbre manga, Tag est donc l’un des 7 qui semble nous entrainer dans un terrain connu pour mieux nous égarer. Pour tout dire, cet accident de car scolaire qui ouvre Tag et rappellerait presque la série des Destination finale – un massacre collectif, une héroïne rescapée, une malédiction – ne laisse absolument rien présager de ce maelstrom dans lequel nous entraine Sono Sion. Dès le départ, il se joue pourtant des archétypes, avec son héroïne marginale qui écrit des poésies, que ses camarades regardent étrangement, mais sans s’adonner à la moquerie, à la tentation de l’humiliation. Sono ne cède pas aux clichés et décrit des relations pleine de bienveillance – presque d’amour – entre collégiennes. Et quand un peu plus tard une séquence nous les montrera s’enfuir du collège, c’est pour mieux illustrer cette incroyable solidarité féminine, magnifique échappée, seule capable de lutter contre la peur du vide et le désespoir. Lorsqu’intervient l’accident, d’une violence incroyable, mais presque comique dans ses effets gore CGI dignes d’un Sushi Typhoon, comme un écho trivial et cartoonesque à la séquence d’ouverture de Suicide Club c’est à nouveau pour mieux nous induire en erreur, au sein d’une oeuvre qui ne cesse de changer de ton et d’esthétique, entre le mauvais goût assumé, l’effet gag et une beauté apocalyptique inégalée. La découverte par Mitsuko de ces corps coupés en deux au bord du lac, troncs d’un côté, jambes de l’autre, toujours dans leur uniforme est à ce titre une vision oxymorique qui tient du sublime, atroce, sensuelle, surréaliste. Ce tableau de beauté morbide, de cette jeune fille au milieu du charnel et du sang dispersés dans l’eau tient peut-être plus encore aux peintures d’un Henry Darger, qu’aux mangas de Maruo. Les aventures de Mitsuko transportée de monde parallèle en monde parallèle sans pouvoir s’en échapper, font de Tag un enchainement de cauchemars, sans réveil. En cet engrenage de visions oniriques, on pense à Nightmare on Elm Street et par cela même on se souviendra de tout l’aspect symbolique et social que revêtait le film de Craven dans son portrait d’une jeunesse perdue et laisse seule aux prises avec le Mal. Sono, sous un aspect parfois très léger, jouant sur les stéréotypes et les codes du film de collégienne, détourne les conventions et conçoit rapidement son film comme un appel à l’insoumission sociale et sexuelle. Quel plaisir que de voir ce refus des institutions, du mariage aux règles imposées du lycée, d’une place de la femme qui serait « réduite » à être le jouet de l’homme. Mitsuko perdue, change d’identité et de visage, d’univers en univers, puissante image d’une quête sans fin de son « moi » et de lutte contre la dépossession effrénée de son individualité. Derrière le divertissement Tag est un parfait miroir teenager de Guilty of Romance, un Guilty of Romance fantasque, plus drôle, frémissant de cette fougue juvénile, n’hésitant pas à kick-boxer où à emprunter au jeu vidéo, mais bercé d’une sacrée mélancolie.
Car la tentation de la mort est toujours là, Tag respirant à la fois l’énergie de vie la plus intense et la tentation suicidaire. Après Tokyo Tribe et Why don’t you play in Hell ?, Sono poursuit donc son éloge de la jeunesse. Tag est un étonnant film vertige, insaisissable, qui avance de surprise en surprise et dont il faudra écouler les visions pour en saisir toute la complexité. Entre le rire et l’émotion la plus folle, entre le film le plus bourrin et l’insidieuse douceur, entre la blancheur et le sang, c’est toujours la même énergie qui explose.
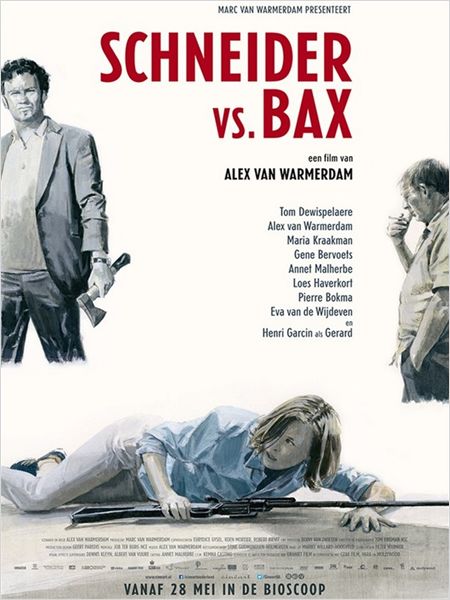 La peau de Bax d’Alex van Warmerdan (Pays-Bas, 2015)
La peau de Bax d’Alex van Warmerdan (Pays-Bas, 2015)
Nouveau long-métrage du hollandais Alex van Warmerdam, La peau de Bax (Schneider vs Bax pour le titre original) fait côtoyer, selon sa bonne habitude, l’absurdité et le non sens le plus complet et une grande violence, aussi bien morale que physique. Le jour de son anniversaire, Schneider, un tueur à gages, doit aller se débarrasser d’un écrivain ermite du nom de Bax. Ce dernier, lui aussi tueur à gages, a également pour mission d’éliminer Schneider. L’unité joue un rôle essentiel dans le film, d’une part avec une unité de temps (le film se déroule sur une journée) et d’autre part, avec une quasi unité de lieu (la maison de Bax, les marais et les marécages qui l’entourent). On pourrait même aller jusqu’à une unité d’émotion chez les différents protagonistes de cette satire : Schneider déterminé à finir sa mission quoi qu’il lui en coûte, Bax flegmatique face à la tournure que prend sa journée, Francisca, la fille de Bax, dépressive jusqu’au bout de la journée ou encore le père de Bax, tripoteur de jeunes filles que (presque)-rien ne peut arrêter. Bref, des personnages cintrés mais si humains qu’ils en deviennent profondément touchants. C’est justement dans cette démarche propre au cinéma d’Alex van Warmerdan, pousser l’absurde jusqu’à ses derniers retranchements, que l’humanité de ses personnages se fait jour, une inquiétante étrangeté qui fait plaisir à voir. La peau de Bax est l’une des bonnes trouvailles de ce début de festival.

Cooties de Jonathan Milott & Cary Murnion (États-Unis, 1014)
Cooties, premier film du duo de réalisateurs, est en fait une rencontre entre plusieurs univers. En effet, les deux scénaristes viennent d’univers radicalement opposés. D’une part, Leigh Whannell a écrit les premiers Saw et les trois Insidious (il réalisera même le troisième opus) alors que Ian Brennan est le scénariste de la série Glee. Ajoutons à cela que Cooties est produit et interprété par Elijah Wood (grand fanatique de films d’horreur) et on aura compris que le film est le résultat d’un cocktail qui avait toutes les chances d’avoir un goût bizarre. L’histoire tient dans un mouchoir de poche ou un nugget de poulet, puisque ce dernier est l’hôte du virus qui va infester une école, transformant les élèves en zombies plutôt agressifs. Les professeurs, dont le nouveau remplaçant interprété par Elijah Wood (plutôt sympathique en écrivain raté), vont tenter de lutter contre cette épidémie qui n’affecte, une chance pour certains, que les enfants pré-pubères. La confrontation monde des adultes / monde des enfants est un grand classique du cinéma et est repris ici dans une version gore, où la raison n’a plus lieu d’être, les adultes devan
t juste massacrer nos chères têtes blondes pour pouvoir survivre. Un peu à l’instar de Stung (chronique ci-avant), Cooties allie gentiment humour et horreur dans des proportions qui fonctionnent plutôt bien. Mais encore une fois, on reste un peu sur sa faim d’un film d’horreur qui assumerait ce qu’il est, d’un film étrange dans un sens plein et on peut s’étonner de voir ce si gentil film programmé à l’Étrange Festival.
 Yakuza Apocalypse de Takashi Miike (Japon, 2015)
Yakuza Apocalypse de Takashi Miike (Japon, 2015)
Très attendu lors de 21e édition, le nouvel opus du japonais fou Takashi Miike, Yakuza Apocalypse (sous-titré The Great War of the Underworld, chouette programme !) a, sans l’ombre d’un doute, largement répondu à cette attente. Alors, bien sûr, on pourra ergoter sur le fait que ce n’est pas le meilleur film de Miike, loin derrière la brutalité de Ichi The Killer ou la force d’Audition, mais il n’en reste pas moins que Yakuza Apocalypse est un bon Miike, bien déglingué, particulièrement efficace, drôle quand il le faut et sanglant à souhait. Un peu à l’image du délire foutraque d’un Zebraman L’histoire tient en peu de mot. Kamiura, chef respecté d’un clan Yakuza, est en réalité un vampire. Lors de sa mort, il mord son jeune protégé, Kageyama. Ce dernier va malencontreusement mordre, outre d’autres yakuzas, des citoyens lambda et ainsi semer un foutoir sans nom. De plus, il va tenter de venger la mort de son maître, en combattant une grenouille géante (en peluche attention hein !), plus grand combattant du monde aux dires de certains (notamment un type à bec d’oiseau dont l’une des armes est son odeur putride). L’aspect parfaitement farfelu de la plusieurs des scènes de ce film (et plus spécifiquement les scènes avec la grenouille géante) lui offre toute sa place au sein de l’Etrange Festival. Sans doute pas le meilleur film de la programmation, mais certainement l’un des plus réjouissants. Les rumeurs voudraient que c’est, selon les dires même de Miike, son dernier film violent. Naturellement, nous ne le croyons pas, mais tel était le cas, ce serait une bien belle sortie.
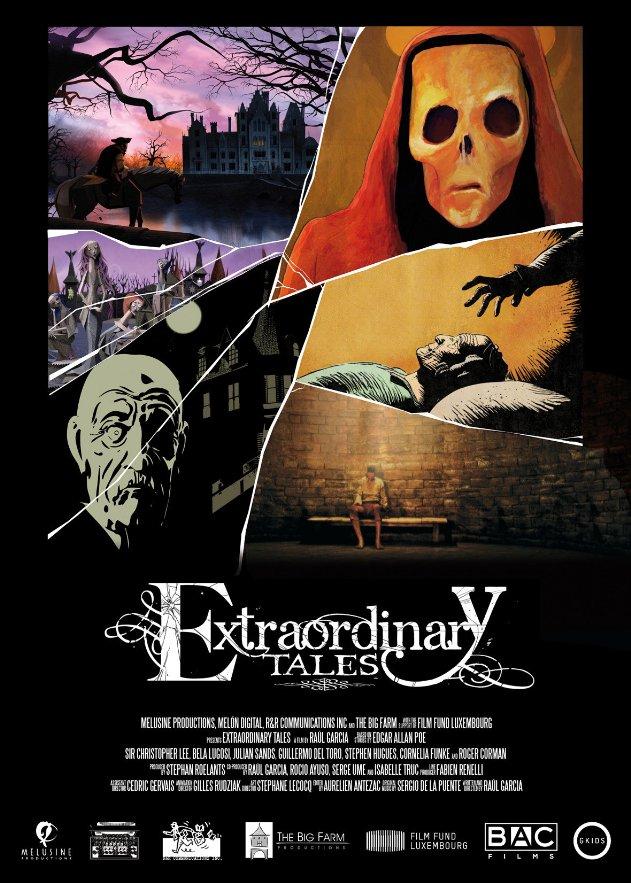 Extraordinary Tales (Luxembourg, Belgique, Espagne, Etats-Unis, 2015) de Raul Garcia
Extraordinary Tales (Luxembourg, Belgique, Espagne, Etats-Unis, 2015) de Raul Garcia
Le parti-pris de rendre hommage à Poe en revenant aux sources de son écriture était une entreprise on ne peu plus louable lorsqu’on sait combien malgré la splendeur de certaines adaptations on s’est éloigné du matériau d’origine. Poe a été, souvent magnifiquement (Ulmer, Epstein, Corman), quelque fois paresseusement (Romero, Argento) trahi et il était temps de rappeler combien ses mots sont si particulier. Le parti pris de Raul Garcia – un peu pédagogique, il est vrai – de faire raconter les histoires par différents narrateurs en conservant le texte original est plutôt enthousiasmant. Comme lors d’une veillée de contes, sont convoqués d’illustres narrateurs et admirateurs (Christopher Lee, Julian Sands, Guillermo Del Toro) qui modulent à merveille leur voix lorsqu’il s’agit de changer de personnage. C’est avec un grand plaisir que l’on réapprend à écouter la beauté du Cœur révélateur, de La Chute de la Maison Usher ou de La Vérité sur le cas de M. Valdemar. Autre bonne idée, l’utilisation du document d’archive de Bela Lugosi lisant Le Cœur révélateur avec fougue. Encore aurait-il fallu que l’univers visuel suive, ce qui n’est hélas pas le cas dans Extraordinary Tales qui, compte tenu de sa facture esthétique très scolaire, aurait plus eu sa place en diffusion télé qu’en projection salles. On imagine parfaitement Extraordinary Tales comme les cinq premiers épisodes d’une série diffusée chaque jour sur Arte à 19h30, ce qui n’est pas honteux, mais donne une idée de l’ambition de l’ensemble. On est en effet très étonné par l’absence de mise en scène et son absence de prise de risque et la banalité d’une animation par ordinateur extrêmement gênante. L’esthétique a beau être différente pour chaque conte, elle se rapproche parfois plus d’une cinématique de jeu vidéo que de ce qu’on pourrait attendre du cinéma d’animation, ce qui est d’autant plus gênant lorsqu’on prive un tel auteur de son ombre, de son mystère, de ses ténèbres, en lui ajoutant des contours, au profit d’une facture 3D si lisse. C’est tout particulièrement le cas pour Le puits et le pendule, le segment le plus laid de tous, avec ses gestes et expressions de personnages, le regard vide, tout droit sortis d’Assassin’s Creed, pour lequel on s’attendrait volontiers à poursuivre avec un joystick dans les mains. Il reste malgré tout de belles choses, comme cet hommage au génial dessinateur de bd Alberto Breccia qui voit ses dessins s’animer à l’occasion du Cœur révélateur. Au mieux effectivement, Extraordinary Tales ressemble à un livre dont les illustrations s’animent un peu maladroitement. Le plus réussi reste probablement Le masque de la mort rouge plongé dans de très vives aquarelles, et une confrérie carnavalesque, quelque part entre Ensor et Mattotti. De même, l’idée d’avoir adapté Valdemar dans l’esprit des comics, en donnant à son protagoniste les traits de Vincent Price est plutôt séduisante et très agréable à suivre. Si Extraordinary Tales rate un peu son pari et déconcerte par sa texture digitale, à contresens du vertige que procure Poe, il resterait peut-être une bonne entrée en matière avec l’écrivain, l’expérience étant à l’arrivée nettement plus auditive que visuelle.
 Upstream Colors (USA, 2013) de Shane Carruth
Upstream Colors (USA, 2013) de Shane Carruth
Pour peu qu’on soit adepte de l’égarement au sein d’un mouvement d’images qui en appelle plus à l’instinct qu’à l’intellect, Upstream Color se révèle une très belle expérience qui suggère symboliquement des pistes plus qu’il n’offre de réponses, ne révélant jamais son vrai visage, ou ceux de ses protagonistes. Comme ces Kris et Jeff, les deux amoureux réunis par la présence d’un Mal, d’une contamination commune qui les fait communier, le spectateur ne cesse d’avancer à tâtons dans l’élaboration du sens, s’éveillant progressivement à l’étrangeté d’une forme qui procède par correspondances, assemblage d’éléments disparates, de couleurs et de sons. Que voit-on ? Que signifient ces séquences et ces regards ? Pourquoi les personnages semblent-ils avoir compris sans nous et quel est la motivation, la signification de leur comportement ? On est rapidement intrigué par l’odyssée de Kris – et aussi perdu qu’elle – à qui on fait ingurgiter un mystérieux ver la rendant dépendante. Ce pourrait-être le début d’un film de genre nostalgique à la Body Snatchers ou trash à la Brain Damage ; mais Upstream Color invite à une appréhension sensorielle du monde qui met en éveil l’ouïe et le regard, tout en exploitant à satiété l’univers du toucher. Kris ne cesse d’avoir des révélations au contact des choses. De la maladie naît une extra sensorialité, comme une osmose avec les éléments : les mains se tendent, la peau affleure, les doigts effleurent. Ce grand sens du geste, du mouvement confine au rite secret dont l’interprétation n’appartient qu’aux héros… et au réalisateur. Il y a dans Upstream Color, des moments de fascinations cellulaires, de microscopie gracieuse et sibylline. En cette fusion des sons et des couleurs, les images ne font sens que par leur profond mystère. Certains parleront de film prétentieux, là où nous préférons voir un objet précieux et exigeant, ouvert au spectateur car l’invitant à s’y frayer un chemin, à y flotter – entre inquiétude et apaisement – aidé par la très belle musique composée par Shane Carruth lui-même. Il n’est pas si courant qu’une œuvre appartienne aussi intégralement à son réalisateur : tout comme son excellent premier long métrage Primer, Shane Carruth ne se contente pas d’écrire son film. Il en assure la photo et en est l’un des interprètes principaux ; son très beau montage procède par associations et sauts inattendus, mirages poétiques qu’il convient de décrypter ou tout simplement d’apprécier comme une mélodie particulière, à la manière d’une odeur qui nous attire. Régulièrement la piste sonore de la scène précédente vient empiéter sur la suivante, la voix des héros poursuivant le discours sur leurs bouches muettes. Le procédé pourrait être agaçant ou arty, il est juste beau et émouvant. Car au-delà de sa simple intrigue, Upstream Color, avec sa végétation mutante et son agriculture sacrilège évoque la douleur de notre propre univers. Shane Carruth nous invite à reprendre contact avec lui, à réécouter les battements de cœur de la terre. Si Upstream Color donne finalement l’impression d’avoir obtenu quelques clés, c’est que son héroïne semble avoir réappris l’essence de la vie, avoir en quelque sorte repris contact avec son humanité. Upstream Color évoque le passage d’une dépossession à une réappropriation. La construction de couple – deux êtres contaminés – passant par toutes les étapes du vide et de la peur, ne tend-il pas finalement un portrait fidèle de l’individu moderne ? C’est ce que capte si bien Upstream Color dans son abstraction même. Deux âmes dessinent à nouveau leurs contours et reprennent forme humaine. Comme si dès lors, désormais, le film pouvait commencer à perdre son flou et à raconter une histoire, leur histoire. La fin est un début.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).









