Après l’onde de choc positive de Spectre: Sanity, Madness & th Family, premier long-métrage de Jean-Baptiste de Laubier, j’ai voulu m’entretenir avec cet artiste singulier, également compositeur de musiques de films et DJ international sous le nom de Para One.
Si comme le reconnait de Laubier « dans la musique électronique, c’est un classique d’avancer un peu masqué », avec Spectre, en revisitant entre réel et imaginaire une histoire familiale tourmentée, il se dévoile. Et surtout, se révèle grand cinéaste.(cf, la critique du film, là ). Voici ce qu’il dit de Spectre : « C’est un film qui se fait bousculer par le réel et qui bouscule aussi le réel. C’est une contamination ». Let’s spread the virus ! -pour paraphraser le groupe de musique industrielle, Cabaret Voltaire.

Copyright Caroline Deloffre.
Si je te dis que pour moi, Spectre : Sanity, Madness & th Family est un film intrinsèquement psychédélique au sens étymologique du terme, c’est à dire qui rend l‘âme visible, est-ce que ça ta va comme définition ?
Oui, ça me va très bien !
Comment, toi, définirais-tu ton film ?
Pour moi, c’est une enquête qui déteint entre le réel et l’imaginaire, c’est à dire que le film impacte la vie, la vie impacte le film. C’est une enquête que je comptais pouvoir circonscrire au cinéma. Elle a complètement vampirisé la réalité, en fait. Du coup, c’est un film qui se fait bousculer par le réel et qui bouscule aussi le réel. C’est une contamination !
Oui, dès le début, on se balade entre la fiction et la réalité. J’ai l’impression que la voix off de Jean qui annonce « La mémoire n’est pas la vérité. Surtout quand on vous ment », te donne une plus grande latitude, une plus grande liberté, j’imagine pour pouvoir raconter ton histoire ?
Bien sûr ! C’est un acte de liberté du personnage et du réalisateur qui est posé dès le début. J’avais besoin d’établir ce contrat avec le spectateur, la spectatrice immédiatement. C’est un contrat avec moi-même comme auteur, de dire : de toute façon toute mémoire est une reconstitution. Le réel n’est visible qu’à travers un prisme, donc allons-y ! Assumons le prisme et puis, assumons la reconstitution.
Le choix de l’auto-production, c’était pour avoir une plus grande liberté? Ou parce que le sujet très personnel ou bien ?
C’est parce que c’est un film qui ne se vend pas à priori. C’est un film qu’il faut faire pour qu’il existe. Ca n’est pas un plan. C’est un film qui se fait au cours de la vie et il doit être fait ainsi. Il fallait que je me lance, que j’investisse. C’est une co-production, j’ai été rejoint. Je ne suis pas tout seul. On a eu des moyens pour le terminer correctement. On a embauché des gens pour le faire avec moi. C’est au final, une aventure collective comme tout film. Mais ça a quand même commencé comme un solipsisme total où je devais me prouver à moi-même et peut-être que j’embarque des gens dans ma croyance, que c’était possible de faire un film. L’autre raison pour laquelle ça s’est fait comme ça, c’est que j’étais en train d’écrire un film qui se produisait dans des moyens plus traditionnels- dans le bon ordre, on va dire- que j’écrivais avec Céline Sciamma depuis très longtemps.
Or, au cours de l’écriture de ce film, la réalité m’a dépassé. Il y a eu l’irruption du réel, l’irruption d’un secret et le début d’une enquête. Et donc, je me suis dit : eh bien, mon film est là, il est en train de se faire sous mes yeux. Je n’ai pas besoin de passer par d’autres artifices. J’ai besoin de me mettre en scène en train de le vivre.
Par rapport à la distribution, est-ce UFO qui a eu l’idée de coupler vos deux films ?
Oui, c’est une idée assez heureuse d’UFO car je pense que les deux films se regardent ensemble. Comme un miroir car ils sont à la fois, contraires, semblables, traiter des mêmes choses, de manière très différente. C’est aussi un hasard assez heureux parce que je connaissais très bien Naïla, la réalisatrice de Dustin. Je la connaissais par la musique et le cinéma aussi. Ca a été très organique. Je trouve que c’est une belle proposition de faire une sorte de double-ticket comme ça, avec un court et un long, c’est assez rare. C’est aussi l’opportunité d’exploiter un court-métrage en salles aussi.
J’ai cru comprendre que Spectre est un triple projet. Avais-tu d’abord en tête le film ou le live ?
C’est d’abord le film. Pourtant, il sort en dernier, j’ai déjà joué le live une fois ou deux Et au moment où je te parle, le film sort en salles la semaine prochaine.
L’album est déjà sorti, il était terminé depuis un moment. Mais c’est le film qui a déclenché la nécessité de faire cette trilogie. Comme je fais plusieurs métiers depuis longtemps, je souffre un peu du mal français du touche-à-tout (rires). Il n’était pas question que je fasse un film autour de ma pratique musicale, de ma pratique sur scène. Non. Il fallait que ça soit un film de cinéma, un album de musique, un live qui soit vraiment un spectacle, qu’on regarde dans une salle. Donc, je voulais que ch forme d’expression garde -je ne dirai pas sa pureté- mais, de sa force. Il ne fallait pas faire un demi-film et un demi-album. C’est un projet un peu fou, c’est sûr. Cette trilogie propose sur trois supports artistiques différents une lecture triangulée sur le même thème. Le disque évidemment travaille beaucoup sur l’inconscient puisqu’il n’y a aucun texte en réalité. Le film est beaucoup plus directement narratif. Le live, c’est encore autre chose. Mais c’est en écrivant le film que j’ai commencé à composer la musique. Et c’est en enregistrant la musique que j‘ai commencé à tourner comme on peut le constater dans le film, etc… Donc, il y a un tressage qui a pris sept ans. C’est une longue aventure qui prend fin.
Tu projetterais des images de ton film pendant les lives?
C’est déjà fait. On a travaillé avec une scénographe très brillante Camille Duchemin pour proposer quelque chose qui soit une troisième voie. Il y a des images du film, il y la musique du disque, mais c’est jamais tout à fait la même chose. Encore une fois, ça occupe un autre territoire presque. A cause de la pandémie, on a peu joué live.
 .
.
Pour évoquer ta musique, dans une interview, tu dis faire de la sculpture sonore, comment as-tu sculpté ton film ? Je pense notamment aux différentes textures, matières…
Oui, il est question de matières, c’est assez juste comme terme et surtout j’utilise beaucoup le terme « texture » en musique électronique. Les outils qu’on a aujourd’hui, nous permettent de sculpter. Quand j’essaie de visualiser ma musique, je vois des sculptures sonores. Par exemple, sur les pochettes d’Autechre, il y a souvent des objets 3D qui correspondent à leur musique. Il y a une interaction entre ces deux choses-là. Dans ce film-là, aussi bien à l‘image dont je co-signe une partie (même si, ensuite, je n’ai plus travaillé seul) qu’au son et à la musique, il y a cette idée de tout texturiser et d’enrichir à chaque fois, dès qu’il y a de l’acoustique pour e son par exemple ou, dès qu’il y a du réel, pour l’image. Je rajoute une couche de faux. C’est pour ça qu’il y a ces images synthétisées où l’on part du réel et où l’on arrive à quelque chose de plus électronique. On rentre dans l‘hybride humain-machine. Le son c’est pareil : il n’y a jamais un son qui soit totalement pur. Tout est hybridé avec d’autres matières.
Oui, les images contaminent le son et inversement. Au deux-tiers du film quand on voit des ruines des pays de l’Est, la musique passe de la psalmodie à des sons plus industriels. Je suppose que tu as beaucoup travaillé le film comme ça ?
Oui, le film s’est beaucoup fait à la table de montage pendant un an. Nous avons fonctionné par associations avec Julien Lacheray qui est le monteur du film. Des associations d’idées, des assemblages logiques. C’est des volontés de rupture. C’est presque un travail d’écriture musicale, mais avec des images aussi. Il y a des envies, aussi. Par exemple, d’un coup, on est devant des bâtiments de béton brut, on a envie d’être sur une plage sauvage d’un seul coup. On a envie d’être 20 ans plus tôt ou 20 ans plus tard, dans une scène de science-fiction, d’un raccord à l’autre. Il y a une logique du rêve aussi. C’est encore une fois l’idée psychédélique que tu évoquais au début. L’idée de se demander parfois où l‘on est. Waow ! On est au même endroit, mais vingt ans plus tard. C’est cette logique-là de film-cerveau, pas dans le sens que c’est un film cérébral. J’espère que c’est un film sensitif, sensuel presque, d’une certaine façon. Ces raccords sont une logique du rêve pas du scénario. C’est le propre d’un film qu’on fait à la table de montage et devant la matière. On modifie, on texturise cette matière. On part d’elle pour raconter l’histoire et ce n’est pas l’inverse. On ne va pas à la pèche au bon moment après avoir écrit des dialogues. D’une certaine façon, c’est du « rétro-engineering » du cinéma. Quand j’écrivais avec Céline Sciamma, c’était une autre forme de structure. C’est une architecture, un scénario et c’est beaucoup plus rationnel.
Au Cinéma du Panthéon, tu as présenté ton film comme un hommage à Chris Marker. D’ailleurs le gourou du film se nomme Chris…
J’ai correspondu par mail pendant des années avec Chris Marker. A la fin de sa vie, i était très débranché du monde réel, beaucoup dans le virtuel. C’est quelqu’un qui m’a énormément influencé, qui m’a donné envie de faire des films et qui a été mon directeur de fin d‘études. Donc, forcément, j’étais très affecté par sa disparition.
Ce n’est pas qu’il y ait une filiation -je ne veux pas revendiquer un truc pareil, c’est un monde en soi, Chris Marker. C’était un peu une blague d’appeler mon gourou comme lui. Finalement, c’est resté et ça me plait bien. Je continue de développer des obsessions à lui, comme la zone des images qui est dans Sans Soleil par ex. J’assume complètement cette référence parce qu’elle me définit pas mal. Je ne sais pas si c’est vraiment un hommage à Chris Marker ? Disons que ça s’inscrit dans une logique qui est cohérente avec ses films.

Est-ce que tu as pensé ou pas du tout que la version courte de Out One de Rivette s’appelle spectre ?
Oui, c’est ça la raison pour laquelle mon film s’appelle Spectre ! Bravo ! Je suis content que tu me parles de ça et pas de James Bond ! Out One c’était tellement l’obsession d’un ami à moi qu’il s’est appelé comme ça, comme nom d’artiste, de DJ. Il m’a fait découvrir ce film très jeune. Avec des amis, on avait ce terme de « spectre » comme une référence d’un film un peu maudit, impossible à finir…Un jour, un des amis de cette bande-là, m’a dit « Mais, où en est ton spectre ? », comme une Arlésienne, un truc qu’on ne finit jamais, qui est infaisable et interminable. En fait, je me suis dit : « Mais, ce mot est parfait ! ».
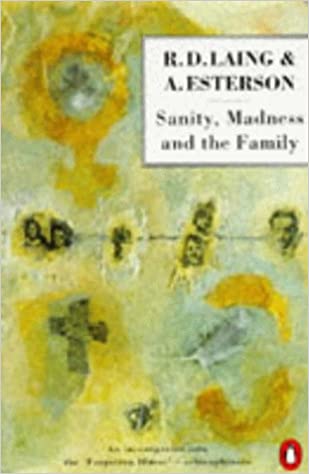
Toujours sur les titres, le deuxième c’est celui d’un ouvrage de R.D Laing ? Chris s’en serait inspiré …
C’est un bouquin qui a largement débordé du cadre de la psychiatrie et de la psychologie. Il est devenu important dans les sciences humaines. Même si sa thèse a été décriée des années plus tard, notamment par son auteur. C’est un peu l’idée de l’enfant-symptôme. Quand on pose un diagnostic de maladie mentale sur un enfant dans une famille, l’idée est que ça serait bien de se renseigner sur cette famille, les rapports entre ses membres. S’intéresser à ce qui se passe autour de cet enfant, plutôt que directement à lui, pourrait remettre en cause ce diagnostic. Sanity, Madness.. est un livre d’antipsychiatrie un peu préhistorique, bien avant Deleuze et Guattari. C’est un livre que j’ai découvert sur le tard qui m’a beaucoup servi. Il m’a permis d’irriguer la fiction et d’épaissir mon personnage de Chris qui était une chimère entre un personnage ayant réellement existé et un fantasme. Cette proposition que la sœur du personnage n’est pas malade, n’hallucine pas- que ce qu’elle voit c’est une autre forme de réalité- est un retournement qui m’a beaucoup séduit.
Dans une émission sur Nova, tu évoques la dimension de guérison par la musique, son aspect spirituel…
Oui, c’était dans la Potion !
Je me suis intéressé à des pratiques rituelles musicales qui ne sont pas toutes systématiquement dans cet axe-là. Le point de départ de mon enquête c’était quand même la confusion entre santé mentale, spiritualité, etc…On sait bien qu’aujourd’hui, c’est une nouvelle ligne de front entre les tenants de la médecine traditionnelle et les médecines traditionnelles. Il y a plein de dichotomies comme ça. On le voit bien avec la pandémie encore plus. Je me suis rendu compte qu’il y avait plein de musiciens qui estimaient que leur musique faisait office de guérison. Ils n’avaient pas besoin de le prouver scientifiquement, ils le pratiquaient souvent depuis très longtemps. C’est revenu dans énormément d’entretiens que j’avais avec des musiciens. Ma quête avait un aspect ethnographique. J’en profitais pour interviewer en longueur les gens avec Ilan Rosenblatt qui était le co-réalisateur de cette partie. Ils nous ont beaucoup parlé de ça. Déjà, le rapport tellurique, ce que disent les japonais à la fin quand ils disent qu’ils ont l’impression de déclencher la pluie avec leurs tambours. Aussi ce qu’ils disent à propos du jekog, l’instrument indonésien, c’est un bain d’énergie qui fait du bien aux gens. C’est pas forcément écrit noir sur blanc, ni un dogme pour eux ; c’est une pratique quotidienne.
Tu crois que le fait d’écouter éventuellement enfant beaucoup de musique répétitive, t’a forgé une oreille musicale ?
Ahaha ! pas besoin d’aller très loin pour entendre ça. La première musique répétitive qu’on peut entendre, elle est à l’église. Concrètement, les chants, le fait de psalmodier, de base c’est une répétition. Les chants grégoriens. J’ai beaucoup grandi avec une approche cultuelle et de musique sacrée. J’ai baigné dans la musique sacrée de plein de façons différentes. Tout impacte tout de toute façon, mais oui, je pense que ça a dû me forger mon oreille (rires).
Tu dis à propos de l’album Spectre : » J’avais besoin de sortir de patterns et de systématismes liés aux formats et de prendre des virages inattendus. Pour cela il a fallu avant tout m’autoriser « . Tu as eu du mal à t’autoriser à passer à la réalisation ? Tu avais un saboteur un peu puissant ?
Oui, oui, j’avais un gros saboteur. Le syndrome de l’imposteur, c’est un classique de toute manière. On a beau cherché à se légitimer, on a beau faire la FEMIS et se dire « Non, mais c’est bon, moi j’ai ma place ». Je ne suis pas un enfant de la balle, j’avais pas de réseaux du tout. Je n’avais pas l’impression de naître là-dedans et d‘être fait pour ça. Pour faire ce film, m’autoriser, c’était notamment aller autant dans l’intime et parler de choses aussi sensibles. C’était un sacré truc parce que dans la musique électronique, c’est un classique d’avancer un peu masqué, caché. C’est pas un monde où l’on montre vraiment son visage ou dans lequel on montre spécialement sa sensibilité. On n’écrit pas de textes, pas de poésie. C’est très instrumental et mutique. Et là, pour la première fois, c’était une vraie prise de parole. Il y avait un côté prise de risques et il fallait l’assumer. Donc, ça m’a pris aussi du temps.
______
Merci à Cilia Gonzalez .
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).








