Débarqué au cinéma sur le tard, l’approche du québécois Martin Bureau tranche avec le documentaire classique. La présentation de plusieurs de ses films au festival 48 images seconde de Florac, accompagnés d’une conférence sur ses tableaux et installations, constituait l’un des temps forts de cette programmation 2017. Le tout dernier monté, Bonfires est même une déflagration cinématographique qui laisse sur le cul, tout comme les précédents et, désormais dans l’attente fébrile des futurs films du bonhomme. D’un ton décomplexé ( sans langue de bois, virulent), il ne s’embarrasse pas non plus des codes audiovisuels traditionnels. D’où contre toute-attente, l’accueil enthousiaste des festivals et de ses pairs. Car ni catastrophiste, ni prévisible, son travail jette un éclairage singulier sur toutes ces questions qui agitent notre petite planète pour le meilleur et pour le pire. Rencontre dans la fraîcheur de la nuit lozérienne avec un homme heureux de partager le fruit de ses réflexions.
Tu es à la base un artiste transdisciplinaire. Ton premier champs de création, c’est la peinture ?
Tout à fait. Ensuite la vidéo, ensuite le cinéma. Je dis la vidéo parce qu’il y a l’installation qui est importante là dedans. J’ai appris à maîtriser, pas à maîtriser mais à vivre tous ces milieux là au long des années.
Le programme du festival nous indique que tu as développé une vision originale entre Art et Géopolitique. C’est vrai que c’est très présent dans les toiles que l’on a pu voir lors de ta conférence…
Je pense que les problèmes géopolitiques sont au cœur de mon travail. Pour moi, faire de la peinture ou faire du cinéma, je me dis en vieillissant que c’était des vecteurs d’une chose très en amont, qui était la possibilité de réfléchir. Je suis peintre mais je ne suis pas un peintre passionné, possédé. Je ne me lève pas le matin en ayant l’obligation de peindre ou de dessiner, mais pas non plus en me sentant obligé de tourner ou de filmer quelque chose. Ce qui m’arrive le matin, c’est de lire Courrier international et puis de comprendre les enjeux du monde. C’est ce qui m’anime le plus. Il faut que je me l’avoue à moi-même parce qu’en tant que peintre ou que cinéaste, si la passion de filmer ou de dessiner ou de peindre est plus belle et paraît importante, celle de réfléchir ne le paraît pas tellement. Ma plus grande ambition aujourd’hui, c’est de savoir réfléchir mieux.

Vidéo appartenant à l’installation Roasted globalization (2014) de Martin Bureau
L’entropie régit le désordre, le chaos apparent du monde ?
Non, c’est un désordre qui n’est pas réglé. L’entropie, c’est simplement la mesure de ce désordre. Ce n’est pas trouver une solution ou une issue, c’est de la voir et de l’analyser. Je trouve ce terme très beau. Conceptuellement, par rapport au métier de cinéaste ou de peintre, je trouvais que c’était une belle avenue pour moi. Comme une issue sans fin… Où j’avais du travail pour le restant de mes jours.
Quand tu dis « théorie des catastrophes », tu te sens proche de Virilio ?
Ah , merci de parler de Virilio ! C’est le personnage numéro un de mes théories de catastrophe. Il parle beaucoup de l’eschatologie ( finitude du monde dans les religions monothéistes ). Sa théorie des catastrophes découle d’un point de vue chrétien. C’est aussi la « tempête parfaite », mais d’un point de vue scientifique. La théorie des sciences complexes, c’est qu’on peut analyser le monde de ce point de vue là, dans son désordre et sans nécessairement lui accoler une croyance. Ce que Virilio, mon préféré, a beaucoup fait dans son analyse. C’est un grand dramaturge finalement ! J’aime comment la science est investie par la « romance des mots » ainsi nommée par Virilio. Je me suis senti très proche de cela et j’ai voulu savoir comment on pouvait parler de la catastrophe. Par exemple, la tempête parfaite ( voir Stephen Gardiner ) est une notion scientifique qui dit que le battement d’ailes d’un papillon sur la mer vierge peut causer une catastrophe écologique dans un pays extérieur. C’est une théorie un peu farfelue, une image mais qui a une base scientifique et qui explique qu’un phénomène géologique ou climatique peut évoluer de manière à causer une catastrophe inattendue à l’autre bout du monde. C’est le genre d’analyse que j’ai fait mienne pour, à travers cette situation là, réfléchir sur les catastrophes en les prenant de toutes les manières : à travers les croyances et les faits scientifiquement avérés.

Installation du Parlement en feu ( Martin Bureau à droite ). photo: Thierry Arcand-Bossé 2014
Au sujet de ton tableau sur l’incendie du Parlement, dans la démarche de son installation, il y a un côté visionnaire. C’est une mise en garde. Tu parlais d’une dénonciation de la corruption, mais c’est une métaphore de sa propre fin, de l’effondrement de notre système…
Ce tableau de l’incendie de l’assemblée nationale du Québec, je voulais leur offrir en don tout en présumant qu’ils allaient évidemment refuser. Je voulais narguer l’institution et voir comment ils allaient me répondre. J’ai eu la surprise au final de voir que le processus de don avait été accepté. Auparavant, j’avais demandé conseil à l’ancien ministre de la justice du Québec, grand collectionneur d’Art par ailleurs et initiateur de la commission Bastarache. Elle a voulu révéler les scandales politiques qui ont eu lieu au Québec au cours des années 2000 et qui ont conduit à la démission de ce ministre, Marc Bellemare. Il n’était pas d’accord sur la manière dont son gouvernement fonctionnait. Fidèle à ses valeurs, il a démissionné, ce qui est très louable. En faisant le tableau, j’ai pris contact avec lui sachant qu’il connaissait très bien l’appareil gouvernemental et pensant qu’en tant qu’amateur d’art, il pouvait être sensible à la démarche. Et ce qu’il a fait, c’est qu’il a d’emblée acheté le tableau. Une heure après que je lui ai eu parlé, mon galeriste m’a appelé pour me dire que l’ancien ministre de la Justice du Québec, celui qui avait des comptes à rendre au gouvernement en place, qu’il condamnait pour énormément d’actes malveillants, venait d’acheter le tableau du Parlement en feu ( 2013-2015 ) pour le donner à l’Assemblée nationale, ce qui était mon but. Ne comprenant pas ce qui se passait, je l’ai donc appelé, puisqu’il m’avait dit l’après-midi même vouloir s’occuper du don du tableau. Je lui ai dit « Monsieur Bellemare… » – c’est devenu un ami par la suite – « je vous ai approché pour que vous m’expliquiez à qui parler de manière officielle et en seulement une heure vous achetez le tableau ! C’est quoi l’histoire ? » Il m’a répondu : « Martin, veux tu le donner ou pas ce tableau ? » « Ben oui ! » « Alors on va le donner… » Donc finalement, ce n’était plus moi qui le donnait mais Marc Bellemare ! Là, on parle pas d’un ancien fonctionnaire mais d’un Ministre de la Justice ! C’est devenu un geste politique de sa part, quelque chose d’autrement plus fort que ce que moi je voulais faire. Incroyable ! Et c’est ce qu’on a fait, et on a réussi ! Par diverses tractations que je vous épargne, on l’a fait accepter par l’entremise du Secrétaire général de l’Assemblée nationale, qui comprenait le geste et était excédé de se voir assimilé aux politiciens. Parce que les travailleurs et les fonctionnaires de l’Assemblée, eux ne sont pas élus, mais on les a balancés dans le même sac que ces élus corrompus. ( Interruption. Plusieurs invités québécois du festival viennent féliciter Martin et prendre congé )

Une tente sur Mars de Martin Bureau et Luc Renaud (2008)
Une tente sur Mars, ton premier film ( 2008 ), touchait à un autre de tes thèmes majeurs : la colonisation, le rapport colonisé-colonisateur et la résistance face à ce processus. L’intérêt vient aussi du côté ethnographique puisque tu fais le tour de ce territoire en analysant un peu tous ses aspects : les habitants, le visiteur occasionnel, l’avant et l’après. C’est un film qui est assez représentatif de ta manière de créer…
J’ai réalisé ça au moment de la trentaine, il y a presque dix ans. Je l’ai coréalisé avec le géographe Luc Renaud avec lequel j’ai eu d’énormes conversations pour pouvoir développer ce projet entre 2004 et 2008. Donc ça a beaucoup influencé ma vie, parce qu’on se trouve en territoire Innu, dans le Nord du Québec et pourtant je n’ai jamais autant eu cette impression de choc culturel en voyage ( long silence ) qu’au Nord de mon propre pays !
En dehors du temps nécessaire à la documentation, le temps d’immersion était-il ici important ?
Oui, on a passé… un certain temps. Personnellement, j’y ai séjourné cinq fois deux semaines. C’était assez pour réaliser le projet. Mais ce n’est jamais assez quand tu te confrontes à une culture – j’emploie bien le mot confronter parce qu’ici cette confrontation est bien réelle, c’est comme ça que l’on se sent l’un envers l’autre. Je pense que je pourrais passer cinq ans dans le Nord que je n’arriverais pas encore à me faire accepter. Car c’est difficile de se faire accepter quand on est québécois blanc francophone dans le territoire des autochtones Innus.
Mais là, tu avais déjà réfléchis à ces questions non ? Tu y allais en connaissance de cause, sachant que la question indienne au Québec est quand même mise sous chape. Est-ce que tu avais dans l’idée d’inverser le discours dominant ?
Oui en effet. La prémisse de base du projet, c’était : nous les québécois francophones, qui nous disons facilement colonisés par la communauté anglophone du même pays, qui revendiquons la souveraineté de notre territoire, est-ce qu’avant cela, on ne devrait pas accorder cette souveraineté à ceux qui étaient là avant nous ? Une fois cela réalisé, j’ai gardé cette question là en tête durant tous mes séjours dans le Nord. Pour autant, les autochtones n’étaient pas forcément là pour me recevoir favorablement. À part certains individus ou intellectuels rompus à cette idée… Malgré tout, j’ai affronté tous les vents contraires et j’ai continué à aller dans le Nord. Parce que quand tu traites du sujet autochtone, eux ils te voient arriver et du coup ne veulent rien savoir de toi. C’est le vent contraire le plus violent que j’aie jamais vécu durant tous mes voyages. Aucune culture n’était plus antagoniste dans les pays où j’ai pu aller que celle des autochtones de mon propre pays…

Une tente sur Mars (2008) de Martin Bureau et Luc Renaud
Peut-être… parce que c’est justement ton pays ?
Mais avec raison ! Je les comprends énormément. Mais c’était très difficile d’avancer face à tout ça.
Comment l’anthropologue qui apparaît dans le film porteur de cette ambiguïté a-t-il perçu son propre discours une fois la scène montée ?
En fait, c’est un personnage rencontré au hasard. Il faut savoir que dans le Nord du Québec, il y a beaucoup de ces analystes, anthropologues, ethnologues qui débarquent là-bas avec une espèce de mission. Mais lui on ne l’a jamais revu… Il était très authentique, très calé dans son domaine…
Oui, mais un peu comme tombé de la Lune, en rupture avec la population et ce pays…
Totalement. En plus, lui c’était un canadien anglais. Au Canada, il y a deux cultures majeures et officielles au niveau gouvernemental : la francophone et l’anglophone. Avec les autochtones de la zone francophone, il était doublement perdu. Il arrive dans un territoire colonisé. Dans un milieu Innu, nation autochtone qui a appris le français. Lui, anglophone, comprend ce qu’il peut à travers ça, grâce à ses connaissances en anthropologie. Mais il était comme parachuté là. Je ne sais pas comment il a reçu le film. On a voulu rendre honneur à sa forme de naïveté, parce que c’est ça qui ressort de son témoignage à l’écran…
Renforcée par la menace des ours en arrière-plan… ( rires ) Par rapport au traitement visuel, les effets sont plus ou moins importants. J’ai l’impression que parfois c’est en rapport avec la parole portée par la personne à l’image que tu choisis justement de ne pas en mettre. À d’autres moments, je me suis posé la question. Par exemple, la scène à l’église où on voit les conversions…
La sœur et les religieuses…

Une tente sur Mars (2008) de Martin Bureau et Luc Renaud
Là tu aurais pu appliquer un effet stroboscopique similaire au plan des enfants. Dans le cas de cette dernière scène que l’on voit souvent ailleurs ( à Florac dans À peau d’homme de Marie-Ève Nadeau ), cette transformation s’avérait pertinente en apportant ainsi un nouveau point de vue. Quand et comment as-tu opéré tous ces choix ?
La sœur, une belge si je me souviens bien et qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle dans le Nord du Québec, avait signé une décharge de participation au film. Mais pas les enfants, ceux qu’on a brouillé à l’image ! Moi je ne l’aurais sans doute pas fait, mais comme on est dans un système où on doit demander la permission… Ils nous ont littéralement sauté dessus pour nous invectiver, nous engueuler, nous faire des doigts. Une scène tellement violente et représentative du climat local ( même si à vrai dire le spectateur français lui ne la vit pas tout à fait comme telle…) que je l’aurais laissée telle quelle. Mais bon, on était obligés par rapport aux producteurs et aux assureurs liés au film, parce qu’on n’a pas pu courir après chaque enfant pour demander l’autorisation de les filmer à leurs parents.
Donc ici c’est le hasard… Mais sur les célèbres images d’archive d’Oka, celles du caillassage des femmes et des enfants que l’ont fait sortir en convoi pendant le blocus, le point de vue n’est pas tout à fait le même…
Ah ? Ben tout ce qu’on a fait, c’est de les mettre en noir et blanc ! Pour uniformiser et les identifier, parce qu’on était dans un bloc « archives ». Mais non, pas d’autres manipulations. Jamais je n’aurais brouillé ou manipulé ces archives ! C’est si précieux. Parlons-en : le problème est que ça coûte tellement cher pour en acquérir les droits qu’on tue notre Histoire ! Les films qu’on fait, on les porte à bout de bras, avec peu de budget. Et quand on veut des archives pour exprimer ou appuyer un point de vue, déjà étoffé et réfléchi, une fois les droits obtenus, c’est si compliqué quand on découvre le montant sur la facture… On en arrive au moment fatidique du choix, où on est obligés de couper les archives qui exprimeraient si bien ce que l’on voudrait développer, tout en rappelant aux gens notre Histoire. C’est tellement coûteux qu’on fait des choix très serrés.

Une tente sur Mars (2008) de Martin Bureau et Luc Renaud
Mais finalement, cela sert le projet artistique et permet ici de s’éloigner du documentaire classique…
Oui, mais je jure que si j’avais eu plus de sous, ou moins d’argent demandé pour l’acquisition de ces droits – et le paradoxe c’est que les institutions qui nous financent sont les même que celles qui demandent ces droits, c’est ça qui est fou ! – on aurait pu étoffer notre problématique en accédant à l’Histoire. Quand on fait des films historiques avec des problématiques géopolitiques, on arrive avec quelque chose qui était là avant nous. Il y a eu des gens auparavant qui ont tourné, ont documenté une situation. Or, si on n’y a pas accès, cette mémoire disparaît. Le budget d’Une tente sur Mars était d’environ 60 000 euros. Ce n’est pas une grosse somme, mais de la façon où nous travaillons en documentaire, ça allait quand même. Mais les archives, elles, ont coûté 8000 euros, alors qu’à côté des gens ont travaillé à l’arrache sur ce film ! Voilà, on aurait aimer honorer notre Histoire d’une meilleure manière que ce que nous avons fait.
Mais déjà le film suscite des réactions… J’imagine que de dire les choses assez brutalement, dans un langage visuel nouveau et déstabilisante ce n’est pas passé au Québec comme une lettre à la poste. Et au niveau des Innus, comment l’ont ils reçu ?
Assez mal ! Ça les fragilise que l’on porte un regard sur eux et leur Histoire. Ils ont l’impression que depuis 400 ans et la colonisation française en Amérique, ils se sont faits avoir. Donc pourquoi nous on viendrait leur rendre service ? Eux, ils n’en ont rien à cirer de nous ! Pour utiliser le langage d’un sport américain, le base-ball, on part avec deux prises. à moins deux ! Si tu veux être neutre et accepté, tu as deux situations à surmonter pour arriver à zéro. Mais ils ont raison de faire ça, parce qu’ils se sont faits avoir. La succession des mesures gouvernementales et la politique de notre pays ont fait qu’ils sont devenus, à raison, méfiants. Nous, on arrive dans ce contexte là. Individuellement, c’est difficile. Mais collectivement, ils ont raison de faire ça.
Au niveau des institutions québécoises, est-ce que le film peut avoir des répercutions ? Tu parlais d’une projection dans un centre…
Oui, le film est programmé chaque année dans un collège attikamek au Québec, – il y a onze nations et nous au Québec, je ne saurais pas les nommer toutes de tête : Innus, Inuits, Attikameks, Hurons-Wendats… ( la carte exacte ici ) Mais en tout cas, les problématiques face au gouvernement sont toutes les mêmes. Le film sert donc au niveau éducatif et c’est bien sa plus belle vie. Mais en même temps, ce qui est dramatique, c’est qu’il est toujours d’actualité – merci à Daniel Racine et au festival de le programmer ! – Pourquoi ? Parce que les problèmes n’ont pas évolué, n’ont pas été résolus.
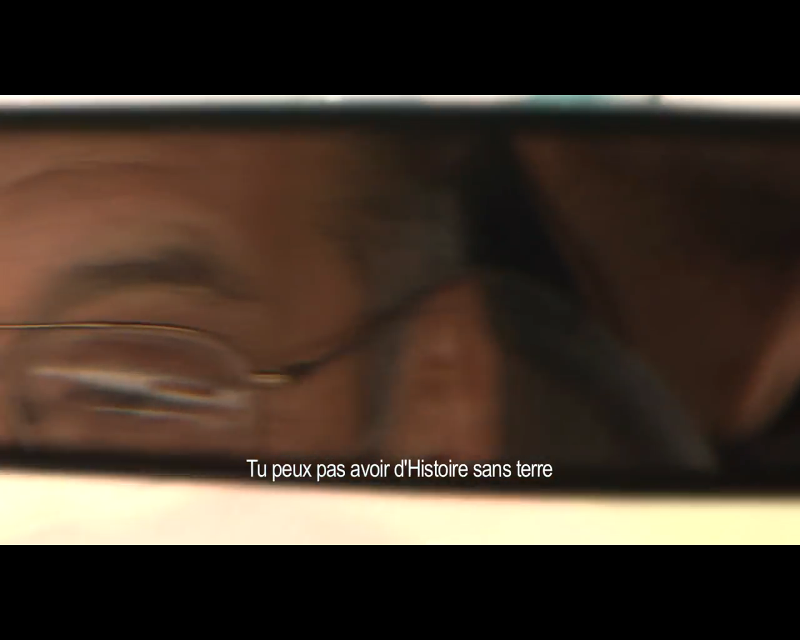
Une tente sur Mars (2008) de Martin Bureau et Luc Renaud
Pour revenir sur L’enfer marche au gaz, peux-tu nous dire comment on parvient à filmer de l’intérieur, au plan technique, un derby de Démolition ?
Pour commencer, on avait la contrainte de la caméra. Une course de démolition se passe dans une arène, sur un anneau de course, donc c’était très difficile de planifier les choses. On s’est lancé là-dedans en se disant : « Bon, on le fait mais on fait ce qu’on peut. On tourne toute la journée mais dans la bonne humeur ! » J’ai dit aux gars : « C’est le plaisir, c’est le gros fun ! Tournez, filmez, enregistrez du son ». Moi, j’étais au milieu de tout ça. Contrairement à mes autres films où je m’occupe beaucoup de la caméra et du montage, on avait ici un budget étatique, de L’Office National du Film, qui permettait d’engager des gens. Alors j’ai voulu me faire plaisir et engager le directeur photo et la monteuse de mes rêves. Pour apprendre… Ce qui a fait que je me trouvais sur le terrain comme réalisateur, libre de tout appareil. Pas de caméra sur l’épaule… On fonce là-dedans, on filme. Tout le monde était heureux de se faire filmer, donc c’était un tournage hyper facile ! Et même, le plus agréable de ma vie pour moi qui ai l’habitude de tourner dans des situations géopolitiques tendues, en Irlande du Nord ou en Palestine, dans le Nord du Québec…
Mais ça aurait pu tout aussi bien tourner à la tragédie comme dans La démolition familiale de Patrick Damien… (documentaire également présenté à Florac )
Oui, tu as tout à fait raison. Dans le cas de La démolition familiale, c’est un long-métrage et donc un long processus. Les liens avec les personnages ont été beaucoup plus approfondis. Nous, c’était un événement, donc une journée de tournage !

Installation Roasted globalization – Photo Renaud Philippe 2014
Dans cette captation, il y a beaucoup d’effets cinétiques, ce que l’on retrouve souvent dans ton travail… Le mouvement c’est quelque chose qui t’inspire au cinéma par rapport à ton travail en peinture ?
Oui, aussi. Dans ma formation, j’ai été au départ fasciné par le cinéma documentaire, le cinéma Direct ou le cinéma Vérité. Candid eye. Tous ces termes qui veulent dire à peu près la même chose du point de vue de la France, des États-Unis ou du Québec. Mais ma vie professionnelle s’est construite d’abord dans l’Art contemporain et dans la vidéo expérimentale. Finalement, j’ai développé des manières de voir les choses, d’entendre, qui n’étaient pas tellement en lien avec la réalité. Mes tableaux sont des fictions, ou au moins des interprétations de la réalité et puis mes documentaires…- parce que je ne suis pas un cinéaste de fiction, ni non plus un très bon documentariste. Donc tout est manipulé : les sons, les émotions… Je ne dis pas ça avec ironie. J’aime faire des films mais documentaires ou fictions sont devenues des catégories pareilles à la droite et la gauche en politique. À un moment donné, on fait juste des films et moi je les manipule pour en faire ressentir l’émotion. L’enfer en est le meilleur exemple. Tout ça est un mensonge documentaire total, même si c’est filmé de manière documentaire en vue de vous faire vivre une situation, une réalité documentaire, elle, bien réelle. Mon but était seulement de rendre palpable l’émotion vécue à cet instant T. Et pour ça il fallait que je mente, que je rajoute des sons, que je trafique le montage pour faire ressentir ce que moi j’avais vécu en filmant cet événement là. Je ne veux pas dire « menteur » de façon négative. Du tout. Mais quand vous voyez L’enfer marche au gaz, et ça doit être réussi puisqu’il tourne en festivals depuis deux ans, il restitue juste ce vécu là, tout simplement.

Bonfires (2017) de Martin Bureau – Production Spira
Pour Bonfires ( 2017 ), tourné en Irlande du Nord, c’est encore une autre approche. On est très près du réel mais aussi de la fiction, voire du teen movie… On ne sait jamais où ça va nous mener – ces palettes qui ressemblent à une installation d’Art contemporain ( rire ) – et ce, jusqu’à la chute finale… Tu avais une idée précise ou c’est venu en filmant, en accumulant des images ?
J’avais la connaissance et la volonté de filmer cette soirée des bonfires, un terme qui signifie « Feu de camp » en Irlande du Nord. L’idée était assez précise : la célébration de la parade des orangistes. Les bonfires précèdent ce défilé. Ils sont allumés à minuit le douze juillet et la parade a lieu le lendemain matin pour commémorer la victoire des protestants sur les catholiques à cette bataille. L’idée, c’était de filmer la préparation et puis le feu, mais je ne savais évidemment pas que les bonfires allaient mettre le feu à leurs propres maisons. Une chance finalement inouïe car les bonfires, ce sont une cinquantaine de feux, immenses, dans la ville de Belfast. Et on est tombés sur celui qui a embrasé leurs maisons ! Ce qui était une honte pour eux, une débandade. Le commentaire politique métaphorique est apparu juste après avoir traversé ça. Ce feu fait pour narguer les voisins catholiques se retourne contre eux. Voilà un de ces hasards de la vie en faveur de l’artistique…
Tu t’étais intéressé à la Palestine, à la construction des murs qui devient un phénomène planétaire actuellement et tu as aussi parodié Trump dans un tableau intitulé America great again. Qu’est-ce qui te fait le plus réagir en ce moment dans le journal du jour ? Sur quoi vas-tu embrayer ?
Sur les murs, il me reste encore beaucoup de travail à faire là dessus… Israël et Palestine, Belfast et l’Irlande du Nord, États-Unis / Mexique. Ces trois murs là résument à eux seuls l’ensemble des problématiques des murs dans le monde entier. Actuellement, on parle de 70 murs existant sur la planète depuis la chute de celui de Berlin, alors que le monde devait s’ouvrir. C’était la création d’internet et de la globalisation et on s’est de plus en plus enfermés. Ouverture des marchés, fermeture des frontières, c’est une équation assez forte. Sinon, j’essaie de penser à un autre film, drôle et positif, un peu à l’image de L’enfer marche au gaz. Pour moi, c’était un exutoire, parce qu’ailleurs, dans ces situations là, les gens ne veulent pas te parler, ne veulent pas te voir. Tu fais toujours face à un ennemi. Mais pour moi, L’enfer n’était pas un aparté puisque j’ai fait une maîtrise sur les théories de la catastrophe dont on a parlé et je me suis servi de ce court-métrage pour défaire la notion de catastrophe d’un point de vue théorique, qui dit que la catastrophe est par essence imprédictible. Le chaos lui est prédictible, toutes ses théories sont nommées. Dans L’enfer, on a une situation catastrophique par excellence, dont l’issue est prédictible. Une fin qui va mal finir mais où les règles sont données d’avance. Je me suis donc servi de ce film pour renverser les théories de mes professeurs d’université. « Vous avez essayé de me faire croire le contraire ? Moi je vous présente une catastrophe prédictible. Et voilà mon master ! » ( rire )

Ils n’ont demandé à personne ( 2014 ) de Martin Bureau
Remerciements : Martin Bureau, Festival 48 images seconde : Guillaume Sapin, Dominique Caron et Jimmy Grandadam ( association la Nouvelle dimension ).
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).










