Une fois encore nous revenons sur le travail unique et singulier d’un des plus farouche cinéaste indépendant et pour couvrir plus d’une décennie de tournages entre la France, la Belgique et le Liban. Plus que jamais habité par la conviction que ce cinéma est aussi politique que nécessaire et en attendant qu’il puisse être montré à un plus grand nombre, j’espère que ces entretiens fleuves susciteront au moins le désir de cette attente. L’œuvre de Karabache s’inscrit aussi dans le contexte chaotique de la guerre menée par le régime d’extrême droite israélien en Palestine et au Liban, mais aussi dans celui oppressant des dernières élections législatives en France. Rien n’est réglé, et en plus d’être en danger en tant que créateur et artiste dans un monde où la Culture n’est plus considérée comme un besoin essentiel et un commun, Christophe Karabache est aujourd’hui physiquement menacé, comme tous les cinéastes libanais et palestiniens victimes de la brutalité et de la folie d’un régime colonial et génocidaire. À la majeure partie d’un entretien fait en visio en juin, il a été nécessaire d’ajouter un point sur la dramatique situation actuelle, étant entendu que pour le bonhomme, il est hors de question d’arrêter de tourner, surtout pas au cœur de la tempête. Le cinéma au service de la vie, une vie de cinéma, que grâce à lui nous abordons dans ses détails les plus concrets. Puissent ces anecdotes nourrir la curiosité de toustes, y compris de ceusses qui n’y avaient d’abord rien compris ou rien vu.
C’est un grand honneur que d’avoir pu recueillir ce témoignage et nous remercions Christophe pour tout ce temps en sa compagnie à remuer le passé. Merci aussi à Culturopoing de recevoir cette parole essentielle et de rester ce lieu ouvert où la culture résistera aussi longtemps que possible à la bêtise fasciste.
En 2011, tu tournes un curieux court, All is good for Jesus…
Ali ! C’est Ali comme Ali le prophète chiite.
Ah OK… Ali is good for Jesus, dont je n’ai vu que quelques extraits dont un plan à 360° autour d’une femme que l’on questionne, un plan qui m’évoque un peu une théâtralité assumée à la Straub et Huillet et un plan sur un genre de charnier de corps nus où tu prends plaisir à filmer les sexes masculins généralement moins souvent représentés. Quel était le concept du film ?
En fait, c’est un long-métrage. Officiellement, c’est mon premier long-métrage mais qui n’est pas sorti en salle. Donc c’est 1h23 minutes et il a été tourné en quatre jours en région parisienne, dont la première partie dans la cave de l’ETNA. On a vidé cette cave de toute les pellicules qui s’y trouvaient et je l’ai transformée en espèce de cave bordel, avec le mac et les prostituées. Comme beaucoup de mes films, il est coupé en deux. La première partie, c’est ce huis-clos, effectivement très théâtral. La deuxième, c’est aussi un huis-clos mais celui-ci dans un hôpital en région parisienne. Un hôpital désaffecté, en ruines. Je ne me souviens pas où il se trouvait exactement car c’était mon assistant et ami Benoît Foucher qui avait repéré l’endroit. Je ne sais plus dans quelle ville mais c’était en région parisienne. Ce second huis-clos est plutôt opératique. Donc, première partie théâtre, deuxième opéra. C’est un film test. Je n’étais pas complètement satisfait. Je pense que c’est raté. En plus tourné en quatre jours, je pense qu’il rentrera dans le Guiness book ! (rire) Je voulais donc passer du format court et moyen au long. Je n’avais pas le temps et moins que les moyens du bord ! Rien du tout, juste le casting. Même pas un chef opérateur. J’étais donc aussi chef opérateur pour ce film. Il y avait juste un ingénieur du son, un assistant généraliste et moi à l’image. C’était aussi une période « apprenti Fassbinder » et dans cette fascination là, j’ai fait l’erreur, pas de vouloir copier mais d’être trop dedans. Même si j’y ai mis des aspirations personnelles, mes obsessions – au-delà de l’histoire il y a quand même des choses de moi, des choix stylistiques, je trouve quand même que c’était un peu trop Fassbinder dans la tête ! Sans trop de distance… Je ne peux pas parler de film hommage car je n’aime pas trop ça et même s’il y a des références. Mais je n’avais pas assez de recul et c’est pour cette raison que je n’en étais pas trop content. De toutes façons, je n’avais pas trouvé de distribution pour ce film. Même pas en festivals. C’est un film qui n’a pas été montré, seulement aux amis. C’est donc pour moi un film exercice, même s’il y a quelques passages intéressants, notamment pour tester des caméras en mouvements cycliques ou la direction d’acteurs avec tout un groupe, alors que jusqu’à présent je dirigeais, une, deux ou jusqu’à trois personnes. Là, dans la seconde partie, je me retrouvais à diriger une quinzaine de personnes. Il s’agit aussi d’un film composé de tableaux. Si je peux en retenir quelque chose, c’est le plan final où j’ai crucifié une femme, la prostituée, Dimona, qui est une référence à la ville israélienne où ils fabriquent les bombes nucléaires. Voilà pour la métaphore et la critique politique en arrière plan. Ici la croix est soutenue par deux hommes, deux vieilles personnes complètement nues. Au premier plan, il y a un milicien avec la kalachnikov et la croix chrétienne qui est une référence aux phalangistes libanais. C’était un essai.

Ali is good for Jesus (Capture d’écran)
En 2012, tu romps assez brutalement avec tes travaux précédents, et poursuivant l’expérimentation de Tout va mieux, tu te lances dans la fiction avec des acteurs. Too much love will kill you ne facilite évidemment pas la démarche aux spectateurs. Comment tes fans de la période « etnique » ont-ils accueilli cette nouvelle démarche ?
Très mal, dans le sens où même un peu avant, dès que j’ai commencé à faire de la fiction, ça titillait les gens radicaux et je le comprends. Les tenants de l’expérimental et de l’avant-garde refusent toute tendance narrative et ça se respecte, il n’y a pas de problème. Il y avait déjà des scissions, des frictions avant même ce film-ci. Quand je l’ai réalisé, je n’étais plus adhérent. Le dernier film période ETNA, c’est Beirut kamikaze. Depuis que je sors mes films en salle, ça a créé… je ne dirais pas de la jalousie mais bon, c’est compliqué la vie associative ! (rire) Ça a créé quelques conflits et une fois au cours d’une assemblée, on a fait mon autocritique. Il fallait se positionner et identifier mon travail. Je trouvais ça très sévère, (rire) très disciplinaire. Donc je suis parti après onze ans d’adhésion, onze années magnifiques. C’était déjà un tournant. Et Too much love will kill you, même au niveau de mes amis, pour le public du milieu du cinéma expérimental qui n’appartenait pas forcément à l’ETNA, la plupart des spectateurs demandaient « Mais qu’est-ce que tu es en train de faire ? » etc.
Il n’y a pas que ça. C’est un film qui m’a vraiment posé problème un peu partout. Les spectateurs de fiction l’ont carrément rejeté, mais pour des questions morales, pas que pour un positionnement esthétique. Dans les gens qui me suivaient depuis ma période expérimentale, il y a peut-être quelques personnes comme Michel Amarger, Frédérique Deveaux qui m’ont plutôt apporté un soutien parce qu‘eux ont vu au-delà de la dimension personnelle et subversive. Dans ma période expérimentale, j’étais plutôt dans les décadrages, le décentrement, les caméras tremblées et là, ils étaient plutôt intéressés par le côté composition, parfois hyper cadré. Ils commençaient à voir autre chose, une autre approche. Mon ami Johnny Karlitch m’a dit « Ah ben tiens, tu sais cadrer ! » (rire) Je n’oublierai jamais cette réflexion. Parce que pour lui, les autres films ne relevaient pas du cadrage ! (rires)
Puisqu’on parle de composition, ici le décor est le plus souvent nu. En plus, le son est approximatif et le jeu des comédiens carrément particulier. Quelles indications de jeu leur donnais-tu ? À partir de quelles émotions travaillaient-ils ?
Si Ali is good for Jesus était un film test, je peux dire que Too much love will kill you est un film brouillon. Officiellement, c’est mon premier long-métrage sorti en salles, mais en réalité c’est mon deuxième. Je l’ai fait sans calculs. J’avais une discussion avec une personne de l’entourage parisien qui fait lui aussi du cinéma et il m’a dit « Tu es complètement fou ! On ne commence pas comme ça, tu es vraiment en train de bousiller ta carrière. Il faut calculer, surtout les deux premiers longs-métrages sont très importants pour un cinéaste car c’est là que tu vas former ta carrière et que les gens vont te suivre ». Moi je n’étais pas dans ce calcul. Je savais que j’allais continuer à faire des films, ce n’est pas « je balance juste comme ça, par hasard », mais je l’ai fait sans conscience du formatage du milieu cinématographique et de la standardisation professionnelle. C’est donc un film brouillon, brut, également très hétérogène par la technique. J’ai utilisé deux caméras différentes : Mini Dv donc avec une qualité médiocre, avec une HDV mais ça reste des cassettes mini DV, ce n’était pas encore le HD. Le premier film en HD, c’est le suivant, Dodgem. Si je n’ai pas calculé la standardisation professionnelle, j’étais par contre très conscient de la technique et de l’esthétique de ce que j’étais en train de faire, et même avec des références cinématographiques. C’est la suite logique de tout un parcours de cinéma car j’étais déjà réalisateur et cinéaste, je faisais déjà des films. Donc je voulais ce film brut et brouillon, pas mal fait mais avec une qualité mauvaise dans la texture de l’image, même s’il y a de la composition dans les cadrages.
Quant à ta deuxième question sur le jeu d’acteurs, je joue moi-même dans ce film, ce personnage qui est quasiment le même dans ma première trilogie libanaise, ce libanais brut et parfois caricatural mais très violent. J’incarne la violence libanaise. De toutes façons, moi je ne suis pas acteur donc quand je joue, ça va sortir de façon violente et sans émotions. C’est facile, mais je pense que dans cette violence là, c’est réussi. Concernant les autres, ce sont aussi des non acteurs, même Marina Kitaeva, la russe qui joue le rôle principal. C’est une chanteuse d’opéra mais pas une actrice. Pour l’entourage libanais, ce sont mes voisines, une collègue, une ex et mon cousin avec ses amis. C’est donc effectivement un jeu particulier ! Ils ne jouent pas parce qu’il n’y avait pas d’indications. Je ne me comporte pas avec les acteurs comme avec les non acteurs, ce sont d’autres directives et sans répétitions. C’est en fait très spontané.

Le cinéaste et son actrice principale sur le tournage de Too much love will kill you – Photo Thomas Villemant, Droits réservés
Le film fonctionne par blocs attaché à un ou deux personnages dans des séquences qui ne communiquent que très peu entre-elles. Toujours pour traduire la fragmentation de la société libanaise liée au communautarisme, aux traumas, l’incommunicabilité entre les gens… ?
Absolument, c’est tout ça ! Pour moi, il n’y avait pas de possibilités de raccordements et d’harmonie. Il n’y avait pas moyen d’arriver à faire des raccords fluides ou des transitions de montage qui s’enchaînent bien, il fallait donc procéder par blocs, très durs, parce que quelque part on essaie de traduire le contenu par le langage du cinéma, ce qui n’est pas toujours évident. Ce choix de montage par blocs traduit justement cette incommunicabilité et toutes ces questions précises que je me pose sur la société libanaise de l’après-guerre, les conséquences directes de la violence que je ressentais, la consommation, le confessionnalisme et surtout les conséquences du retour de cette menace de la guerre, déjà exprimée dans Beirut Kamikaze et que je ressens toujours jusqu’à cet instant où je te parle. Outre l’instabilité permanente il y a cette menace du retour de la guerre et c’est hallucinant. Voilà, je voulais traduire tout ça dans ce film qui est je pense, le plus radical et le plus subversif que j’aie fait.
Tout à fait ! Avant tu arpentais les rues et les terrains vagues. Là, la fiction te permet de rentrer dans les intérieurs et le cœur et l’esprit des personnages. L’aliénation y est générale.
(perplexe) Ouais… Alors les personnages… La brute proxénète n’était pas dans le scénario de départ, il y avait un autre homme violent. J’ai eu cette idée en rencontrant Marina Kitaeva au moment du casting. Je l’ai choisie et elle m’a inspiré ce personnage là en répétant un peu avec elle à Paris. De même, au moment du casting, je n’étais pas parti pour prendre une russe, le personnage était une française qui arrivait au Liban. Et pas non plus forcément une prostituée. C’est Marina qui m’a inspirée ce rôle là (rire) et voilà. Ça s’est transformé car c’est aussi un film en train de se faire et ce jusqu’au dernier jour de tournage, on changeait des choses, on rajoutait… Les autres sont des gens de la ville, d’un quartier difficile, même s’il y a quelque part des clichés : la fille qui est frustrée, la jeune libanaise qui a ses fantasmes… Les jeunes qui manifestent, entre la caresse et la rixe. D’ailleurs cette scène a été jouée d’une manière très improvisée. Quand ils sont à l’extérieur, ils se battent. Là, la direction c’était « Insultez vous ! »
D’ailleurs, on peut presque penser que cette scène est documentaire, enfin on ne sait pas trop où se placer en tant que spectateur.
Voilà, effectivement. J’ai aussi inséré des scènes documentaires. Une fois, chez moi, il y a eu un accident. On voit un groupe de personnes avec une voiture et un type allongé, on dirait un cadavre, c’est en fait une captation brute. Il n’y a pas de mise en scène à part choisir mon axe et comment filmer ça, le point de vue. J’étais chez moi, sur mon balcon et c’est purement documentaire. Ce que j’ai demandé, vu que c’est fait avec mon cousin, qui habite presque la même maison, l’appartement à côté, je lui ai demandé de descendre et de s’insérer dans le groupe. Vu qu’il joue dans le film, ici la fiction intègre le réel.
Tu travailles logiquement en longs plans séquence qui accompagnent les performances des non acteurs. Était-ce toujours aussi préparé précisément que pour tes films précédents ou que tous tes tournages futurs ? Est-ce que tu improvisais plus ?
Concernant ce film, c’est moins préparé que les autres et donc un film en train de se faire, et que ce qui est venu après. À partir de Dodgem, c’est plus préparé. Too much love will kill you, c’est encore cette sortie du cinéma expérimental documentaire basé sur le direct, l’improvisation, le spontané mais quand même je conçois et je prépare mes cadrages sans forcément repérer à l’avance mais je connaissais ces lieux là. Normalement, je prends beaucoup de temps pour les repérages. Là on arrivait et je repérais et je filmais directement. Vu que j’étais à Paris, je ne suis venu que pour le tournage qui a duré trois semaines donc un peu plus long que les dizaines de jours que je fais en ce moment, mais avec moins de préparation même si j’avais quelques plans en tête. C’est sur le vif que les choses se faisaient. L’errance de Marina à travers les ruines à la fin du film, c’est par hasard. J’allais sur un autre lieu et j’avais vu ce magnifique chantier. Il y avait une contrainte de batterie parce que c’était la fin de la journée. Il n’était pas prévu de tourner dans ce lieu et il restait très peu de batteries et ça donc été vite fait et improvisé sur le moment.

L’ingénieur du son Nicolas Magnon et Christophe Karabache au travail (Too much love will kill you) – Photo Thomas Villemant, droits réservés.
Dans un décor réduit au maximum, le rôle de la lumière est vital, ne serait-ce que pour délimiter des espèces d’espaces mentaux…
Pour la lumière, c’est ma première collaboration avec Johnny Karlitch qui est intervenu dans quelques intérieurs, ceux où il y avait le plus besoin d’éclairages notamment pour ses hallucinations, ses rêves. Pour le reste, c’était encore moi qui faisais la lumière basique si j’ose dire car je ne suis pas chef opérateur. Je l’ai fait avec les chose simples que je connaissais. Encore une fois, j’expérimentais, sans en savoir le résultat, sans garantir même un résultat. En effet, l’indication que j’ai donné à Johnny pour la lumière, c’est qu’il fallait qu’elle soit terrible, terrible dans le sens de la terreur. On avait juste trois projecteurs, un Kino flo, une mandarine et un Mizar et avec ces trois, essayons de faire ressentir la terreur mentale, à la fois celle des lieux et celle des personnages.
Le film est structuré par une séquence rythmique hypnotique d’un homme cagoulé qui démembre des corps dans la neige. Une scène qui catalyse toutes les poussées de violence de la société libanaise. D’où ça vient ?
De ma tête, c’est quelque part, il n’y a pas de référence picturale ou cinématographique comme on pourrait l’imaginer. On tournait en mars et c’était encore la période de neige en montagne. C’est donc une idée un peu surréaliste que j’ai eue en posant quelques cadavres dont un qui vit encore et avec des cris pareils au meuglement d’une vache et ce mec cagoulé qui est la métaphore d’un milicien, d’un tueur de la guerre civile. L’image mentale d’un cauchemar pour dire et prouver que pour moi, l’obsession de la guerre est encore là.
C’est une séquence qui marche bien à l’instar des séquences de snuff movie dans Vidéodrome, le truc qui te hante, qui hante le personnage lui même dans le film de Cronenberg et qui revient inlassablement…
Trop fort ! Juste pour préciser les caractéristiques du montage du film : il n’y a pas les conventions habituelles pour dire « là c’est du rêve, là c’est la réalité », que ce soient par les changements de couleurs ou par les fondus enchaînés, par des surimpressions ou par une image différente pour dire que c’est un rêve. Évidemment, on va deviner mais j’ai filmé les scènes de cauchemar comme si c’était du réel.
On ne peut pas dire du film qu’il soit de la non fiction ni qu’il soit totalement anti narratif puisque tu te concentres sur cette danseuse russe perdue à Beyrouth dans l’objectif d’y travailler. Mais par la suite c’est plutôt son errance, ses attentes insatisfaites qui vont contaminer l’ensemble du film.
Absolument et si on veut résumer le film en un mot, c’est un film d’errance. À part la première partie parisienne qui montre un peu le passé, à tort… Je regrette cette partie. Il fallait commencer directement le film à son arrivée à Beyrouth. En tout cas, ça montre son errance jusqu’à la fin, pour la partie fiction, intégrée à une autre marche puisque c’était la période de Pâques et j’avais filmé une sorte de spectacle des gens de la montagne qui refaisaient la passion du Christ jusqu’à la crucifixion. Là c’est complètement documentaire et je l’ai intégré dans cette fiction pour donner à cette marche, à cette déambulation une sacralité, au sens large du terme et non au sens religieux, jusqu’au martyre, jusqu’au désespoir. Quelque part, la masturbation est elle aussi christique, avec la tête du mouton entre ses jambes.
(rire) En quoi est-elle christique?
Déjà il y a la tête de mouton, et c’est donc aussi en montage parallèle avec la marche du christ, en haut de la montagne – mais ça il faut le savoir, on voit la sainte vierge qui regarde. Christique, avec quelques critères plastiques, pas que dans le sens.
Les fantasmes sont crus, les personnages féminins violentés, humiliés. Certains spectateurs ont ressenti le film comme un shocker plus que comme une dénonciation. Comment s’est déroulé le travail avec l’actrice Marina Kitaeva ?
Ce choix vient du fait qu’elle a un physique assez fort et elle a supporté des coups, ça a été un critère de ce choix. J’ai parlé, je lui ai montré quelques références de films avec de la violence de couple. Je lui ai dit « Voilà, je vais aller dans cette direction là et il faut que tu supportes les coups. On va s’amuser aussi. Ce ne sont pas des vrais coups mais quand même, tu vas être secouée, il y aura de la violence brutale ». L’accueil a été très positif de sa part « pas de souci, j’aime ça ! ». Donc ce n’était pas compliqué. Le contrat physique et moral a été fait dès le casting. Moi j’ai une direction pour la dénonciation et même si peut-être elle a été perçue différemment par certains, et je vais aller dans ce sens là. Dès le casting, l’accord a été direct. Jamais je n’impose, ni ne fais de manipulation et après l’actrice va découvrir quelque chose… je pose des lignes dès les auditions.

Tournage de Too much love will kill you
Pour le film quels ont été les choix photographiques faits entre autres avec Johnny Karlitch dont on connaissait plus l’approche documentaire ou les images fantastiques tournées en mini dv pour son moyen-métrage Aquarius ?
Pas de grande préparation comme je te l’ai dit. J’avais donné deux trois lignes : le lumière doit être une sorte de terreur, montrer les angoisses. Le côté horreur était déjà dans ma tête, il fallait le traduire par l’éclairage. Johnny n’est pas tout à fait un chef opérateur professionnel, mais un cinéaste qui connaît aussi, qui crée des choses, qui a fait son parcours à la télévision, qui a éclairé sans être directeur de la photographie mais c’était aussi une expérimentation pour lui d’aller dans ce sens là avec le peu qu’on avait. On n’avait même pas de gélatines ! On mettait des protège-cahiers couleur devant les objectifs qui cramaient. On n’a pas trop préparé, parce que moi j’étais à Paris, donc c’étaient quelques coups de téléphone « on va aller dans ce sens là, on a ces moyens là » et lui m’a aussi proposé d’éclairer avec quelques bougies, donc il y avait des scènes carrément éclairées à la bougie, sans ajout d’éclairage d’appoint comme on fait maintenant. Par exemple, la scène de la bougie dans Zaman dark, c’est vrai qu’il y a deux trois bougies mais elle est éclairée par un projecteur artificiel d’appoint que le chef opérateur a rajouté. Ça c’est parce qu’on a plus de moyens et que lui est un vrai directeur photo. Dans Too much love will kill you, il y avait donc une scène avec que des bougies. Brute.
Il y a une montée assez phénoménale entre l’errance dans la montagne, le magnique plan de plage où tu n’es pas loin de disparaître dans la mer, sans parler de la scène finale de masturbation avec la tête de mouton, qui renvoie au symbolisme et au surréalisme le plus cru. Ce crescendo était-il écrit dès le départ ou ça s’est trouvé au montage ?
Non, c’était prévu dans le scénario, même si dans ma tête, c’était une autre forme de tête… Parce que là quand j’ai parlé avec le boucher et que j’ai dit « une tête de mouton », pour moi c’était aussi avec la chair et les poils. Je suis arrivé et surprise, il m’a donné une tête de mouton vraiment décharnée. On ne voit que les muscles et c’est encore plus cru. Ça c’était un imprévu , mais ça m’a plu et on a dit « OK, vite, on prend ! » mais je pense que dès mon premier film comme on l’a vu dans le précédent entretien, il y avait ce rapport à l’animalité et au surréalisme qui utilise ce genre d’accessoires, d’objets… Donc c’est une suite logique mais je savais que j’étais dans la provocation.
Effectivement, c’est un film de transgression et un film de frontières, comme un appel aux libanais enfermés dans leur propre pays à trouver une libération intérieure.
Oui quelque part… Et on en revient aux réflexions de cet ami parisien dont je parlais. On ne commence pas comme ça. Ça tu le fais au dixième long-métrage. Or moi j’avais commencé ce film dans l’idée de transgresser, de bouleverser, de choquer, de provoquer, de subvertir, sans concessions et sans compromis, avec en référence le Salo de Pasolini. On ne commence pas comme ça !
La fin rappelle aussi Stalker, les lieux avec les ruines, les bruits d’eau et on le sait, chez lui c’est récurrent puisque ça commence dès L’enfance d’Ivan, comme une espèce d’obsession.
Tarkovski trash… mais là je n’ai pas conscience de cette référence. Après par exemple, les couteaux, indirectement, c’est parce que sur ce lieu, ils étaient présents, ce n’était pas rajouté en post prod. C’étaient des sons seuls qu’on avait enregistrés sur le moment, pendant la prise de vues. Ce n’était pas une référence à Tarkovski. Concernant les gouttes, c’est flagrant, on pense directement à ça. Mais la composition, cette lenteur dans les ruines, là en effet, j’avais en tête cette référence cinématographique et que j’ai toujours. Dans Ultravokal, on peut voir un peu de Tarkovski, dans Zaman dark aussi.
À l’époque, le film a été présenté à Beyrouth pour la dixième édition du film libanais…
Ah oui c’est vrai, j’avais oublié ! (rire)
Je ne sais pas si tu étais présent mais quels retours as-tu eu de cette projection ?
En fait, ce film, vu qu’il était interdit par la Sûreté Générale, a été refusé au Festival à cause de cette interdiction. Mais il y avait un article dans le journal An Nahar, l’équivalent du Monde au Liban, qui a publié un article en faveur de mon film et qui a critiqué le festival en leur reprochant de manquer de courage pour montrer un film interdit. À cette époque, Nadim Tabet n’était plus dans le comité de sélection. Jusqu’à présent, c’était lui qui prenait mes films, et les autres, Pierre Saraf, qui gueulaient tout le temps « Oh non, pas Karabache ! » ou alors si Karabache y était, il fallait lui réserver une heure, midnight… Une fois, on m’a même censuré en effaçant des images d’un de mes films, Mondanités. Bref, c’était toujours une place à côté, mais c’était Nadim qui prenait mes films. Cette année là, il était occupé par autre chose. Après l’article, eux étaient vexés et ils voulaient montrer qu’ils avaient le courage. Ils ont donc projeté le film en parallèle, pas dans une salle mais pendant le festival, dans un bar en banlieue de Beyrouth, avec comme titre À vous de juger ! C’était une projection piège. Ils voulaient questionner les gens sur la qualité de mon cinéma, un peu pour me dénigrer, pour dire que ce n’était pas à cause de la Sûreté Générale mais parce que le film était mauvais. (rire) « On ne veut pas de ce cinéma là ». Quelqu’un du festival demandait aux gens « Alors qu’en pensez-vous ? ». Bizarrement, le public qui était plutôt jeune, a apprécié le film. Même moi je suis étonné d’un accueil favorable de la jeunesse libanaise. D’une certaine jeunesse…

Christophe Karabache sur le tournage de Dodgem – Droits réservés
Venons en à Dodgem… On peut dire que la trame de Dodgem est une variation sur le précédent avec des motifs et des figures récurrentes : l’étrangère, la montagne, la cagoule. Shaker Shihane revient cette fois pour en être l’un des personnages principaux. La violence y est aussi ritualisée… Quels étaient tes nouveaux partis pris pour Dodgem ?
Déjà pour Dodgem, je passe techniquement à un autre niveau si j’ose dire, avec des moyens plus sophistiqués, du HD. J’étais déjà dans cette démarche là, avec plus de fixité, moins de mouvement, même si c’étaient des plans longs, des plans « blocs ». J’avais gardé ce montage là mais j’étais plutôt dans la rigidité que dans le mouvement et même s’il y a en effet une errance. Donc une autre approche esthétique pour varier. Il y a des points de rapprochement, toujours le côté spectacle dans le sens où il y a une femme de l’étranger qui vient au Liban pour une affaire de spectacle. Dans Too much love, c’était pour danser, même si après elle s’est prostituée. Dans Dodgem, c’était une sorte de modèle qui veut défiler. Il y a ce côté spectacle qui passe par le corps. Et ça ne se passe pas comme prévu et du coup, elle s’expose à la violence. Pour Shaker Shihane, c’est effet sa deuxième apparition et là il prend un rôle plus important. Je pense aussi qu’il y a une continuité jusqu’à Lamia. Dans cette trilogie, je me posais des questions sur la violence de cette société libanaise de l’après-guerre et quelque part sa continuité. Même si on change un peu les personnages. C’est très proche de Too much love will kill you, pas thématiquement, mais dans les lieux aussi. Figure toi que j’ai tourné dans le même appartement ! En cherchant d’autres points, d’autres axes… Des fois, on le remarque, des fois pas mais c’étaient quasiment les mêmes lieux. Des fois, c’est comme une version 2 : moins en mouvement et plus de fixité. S’il y a un parti pris, c’est celui-là. Sinon, c’est cette question de la représentation de la société libanaise qui continue, qui passe par la jeunesse aussi.
Peux-tu nous raconter comment tu as découvert le danseur Shaker Shihane et quels ont été ses rapports avec Vanessa Prieto sur le tournage ?
C’était un camarade de classe à l’école quand on était enfants, puis adolescents chez les lazaristes jésuites. Après, on s’est perdus de vue et on s’est retrouvés une fois où je rentrais de Paris, je l’ai croisé par hasard dans la rue. Il était vraiment transformé parce qu’à l’époque c’était plus un garçon, avant sa transformation de son corps et de son orientation sexuelle, etc. Là j’ai vu sa transformation physique. Ça m’a plu, ça m’a attiré « Écoute, il faut absolument que je te filme ! » il a été d’accord direct, on a rigolé et à chaque fois qu’on filme, même si ce sont des scènes de violence, on rigole et il faut nous arrêter. Même la scène de viol dans Dodgem, c’était du comique hors caméra.
Et pour Vanessa Prieto ?
Pareil, là ce n’était pas prévu de caster une espagnole. Ce qui m’a plus c’est qu’elle aussi n’est pas une actrice professionnelle, mais une débutante, plutôt modèle. C’est elle qui m’a inspiré ce choix dans le film, de même que le nom de son personnage. J’aime bien parce qu’elle est dans l’intériorité, il n’y avait pas de surjeu. Il y a l’attirance physique que j’avais pour elle, même son visage me renvoyait à un certain imaginaire des films espagnols, le timbre de sa voix en tout cas ; c’était quelqu’un qui n’exagérait pas et ça équilibrait avec mon jeu à moi ou avec le jeu de Shaker. Ça créait un contraste que je trouvais intéressant même s’il est contradictoire, un équilibre dans le film.
Cette fois la déambulation de Nour rappelle inévitablement celle d’Aquarius et sa créature mais en plus avec un côté Tarantino et expérimental à la fois. C’est aussi le début des longues plages musicales – ici avec une séquence de marche musicale – qui brisent la continuité et ont dans tes films leur propre temporalité…
Oui, effectivement. D’ailleurs ce film là était ma première collaboration avec le compositeur franco-irakien Wamid al-Wahab. Après, ça a été une série jusqu’à Venus obscura. C’est un film composé par Wamid et c’est donc une proposition de sa part, même si je travaille toujours à distance avec les compositeurs. Ils voient rarement les images. Je dis ce que je veux, ils composent en fonction de mes propos plutôt que des images.
Ce sens de la durée tu le trouves au montage où tu avais déjà prévu cette scène ? Parce que personne n’étire la durée comme ça…
Tu parles de la séquence du rire ?

Tournage de Dodgem – Droits réservés
Oui, quand il flingue à droite et à gauche et que le rire revient…
Non, dans le scénario, il y a juste une phrase. D’ailleurs, une des difficultés, c’est que quand tu vas écrire un plan long, surtout si c’est juste une action en répétition, comment évoquer ça par l’écriture ? Bon après, vu que mes scénarios ne passent pas par des commissions ou par des producteurs, moi j’écris une phrase et je sais que je vais la prolonger. Mais ça reste dans la tête… L’écriture, c’est très minimaliste, une phrase : « il est dans la rue et il tire sur tout le monde, en boucle ». Par contre, j’ai le sens du rythme, même avant le tournage et le montage vient le confirmer. Cela dit, pour cette scène là, vu qu’on l’a tournée assez rapidement parce que… travesti dans les rues de Beyrouth avec une arme, c’est un peu chaud ! Surtout à cette heure. Et c’était une époque où il y avait beaucoup de policiers qui faisaient des tournées de surveillance et de contrôles et en effet on a croisé des policiers qui sont venus mais ils n’avaient pas remarqué vraiment ce qu’on faisait, (rire) donc on l’a échappé belle. Il y avait donc une certaine tension. Shaker Shihane était un peu stressé. Il fallait faire vite, d’où mon filmage en fragments. Et c’est au montage que j’ai eu l’idée de ralentir. Quelque part, c’était une technique pour rallonger les plans trop brefs qui me déplaisaient. En fait, je n’étais pas très satisfait de ce filmage là, en tout cas je voulais une chorégraphie différente. C’est donc au montage que j’ai eu l’idée de ralentir pour sentir un peu ce qu’il fait et entrer dans ce jeu complètement surréel et métaphorique. Et c’est là que j’ai dit à Wamid « Compose moi quelque chose qui va dans cette cadence là, dans cette rythmique, dans cette énergie… »
Par rapport à la représentation des personnages trans au cinéma, le personnage de Nour est un peu années 70 (le travesti assassin de Profondo rosso où à l’époque, la personne trans était forcément pathologique). Sais-tu quel est l’accueil que cette représentation a reçu auprès des personnes trans ?
Trans, pas forcément… Par contre, au niveau des homosexuels oui. Il y avait quelques homosexuels qui étaient très dérangés par cette représentation là. Je me souviens qu’à la sortie parisienne, il y avait un peu de critiques par rapport à ça. Et surtout, le fait que ce soit un anti-héros. Pas forcément méchant parce que dans mes films, les méchants sont aussi des gentils et les gentils des méchants, en tout cas cette notion est complexe. Donc je peux confirmer qu’il y a eu un peu de mécontentement lors des quelques projections parisiennes.
Compte tenu de l’homophobie exacerbée au Liban et de la violence identitaire toujours présente, la scène de viol nationaliste est particulièrement dérangeante. Ils ont du un peu tilter là-dessus aussi ?
Pas à Paris, mais je sais que quand je l’ai montré au Liban un peu à droite et à gauche mais de façon privée, à notre entourage ou à des gens qu’on ne connaît pas, ça a dérangé. Parce qu’en effet, là, j’incarne ce personnage nationaliste, brut, même si encore une fois, il est caricatural. Aujourd’hui, peut-être que je jouerais différemment… Mais au Liban, c’est une offense. Tu as le droit de tout faire à part d’insulter la Nation. Il y a encore cette idée de la sacraliser par les symboles, par l’hymne national. Le respect de l’Armée… Je prenais un grand plaisir à aller transgresser ces symboles là, par ce personnage ignoble et insupportable.
De fait, il n’y a ni complaisance pour la violence, ni pour le vide si je repense à un truc écrit à l’époque sur le film, alors qu’on commence par une séquence qui est presque une menace pour le spectateur et qu’on termine par un meurtre absurde et filmé à distance.
Une lapidation avec les lance-pierres.
Une lapidation disons « terminale » ! (rire) Contrairement à un cinéaste comme Ulrich Seidl…
Que j’aime beaucoup !

Christophe Karabache et Shaker Shihane sur le tournage de Dodgem – Droits réservés
… Tu ne cherches en rien à expliquer les actes de l’homme au lance-pierre ni à excuser ou rendre sympathique Nour.
Ah non, je n’ai pas à juger les personnages, c’est même un positionnement éthique, que ce soient les plus gentils, les victimes ou les bourreaux, les méchants. Le fond est une critique, évidemment, mais je ne rentre pas dans la logique du bien contre le mal. On la voit beaucoup, on la voit souvent, on la voit assez dans le cinéma en général cette logique là, pas seulement dans le cinéma américain. Moi je fais autre chose. Je fais les choses différemment.
Cette précision pour celleux qui auraient raté.e.s les deux premières parties de ce long entretien ! (rires) Une universitaire américaine, Sasha Waters, parlait de théâtralisation de la mort et disait que pour elle, seules comptaient les impulsions de corps, au delà de tout sens dramatique ou moral.
Très bien ! J’aime bien cet article. (rires) C’est la continuité du cinéma du corps et dans des cadrages insistants, que ce soit le meurtre dont tu parles ou même les plans vides. C’est fixer la caméra et prolonger la violence dans la durée.
C’est ça. Parce que dans cet ensemble de pulsions, il y a le voyeurisme des personnages témoin et jusqu’à celui, inévitable du spectateur. Là c’est un peu différent de Too much love et pas nécessairement lié à la société libanaise, ou alors lié à un immobilisme général. Alors pourquoi cette nécessité de nous confronter à notre voyeurisme ?
Parce que ça fait partie du cinéma ! Là, c’est la cruauté comme nécessité. C’est comme une fatalité et on ne peut pas y échapper. Donc la montrer en face et la plaquer dans la face du spectateur, c’est montrer le monde, et la violence est réelle ! On n’y échappe jamais, c’est la cruauté de la vie. C’est la philosophie du film.
On est toujours épatés par la précision de tes cadres, souvent extrêmes, quand la photographie, elle, peut-être plus changeante voire blafarde. Ça va aussi avec cette cruauté du regard ?
Oui, malgré le fait qu’il y a dans Dodgem, une certaine harmonie après le côté disparate de Too much love will kill you, plus hétéroclite et contradictoire. Malgré cette unité, c’est dans les détails, comme la lumière de certains cadrages, que l’on perçoit ces entrechocs.

Johnny Karlitch et Christophe Karabache sur le tournage de Dodgem– Droits réservés
Par rapport au précédent toujours, on a l’impression qu’on passe des fermetures (de frontières, d’esprit…) aux fractures. C’est plus violent encore, plus méchant me semble-t-il.
Peut-être… On est dans le néant quoi. Dans le vide, comme tu disais. Le choix d’être dans cette montagne désertique, aride. On a tourné au lever du soleil, à cinq heures du matin. Ça rajoute aussi à cette poésie du néant.
Les ruptures sonores sont encore plus flagrantes. Est-ce que tu travailles le montage son à part ? Est-ce que les transitions sonores impulsent les scènes ?
Oui, c’est à partir de Dodgem que le travail du son commence à prendre son importance dans mon travail, un peu du sound design avant l’heure. Pas avant. Le son était brut, avec très peu d’effets et très peu travaillé au mixage. Quand je te dis que j’ai monté d’un grade, j’ai eu aussi du nouveau matériel donc j’ai commencé à peaufiner cette matière sonore, à prêter attention à l’oreille et parfois, à la placer avant l’œil. J’ai aussi constaté au montage ces effets, ces impacts sonores qui me donnaient des fois des idées de transitions. Mais c’est aussi le hasard du travail en post prod.
La trilogie se termine avec un autre très beau film, Lamia.
Je pense que c’est le plus abouti des trois.
On retrouve l’inceste, mêlé à l’impuissance, et un autre beau portrait de fille indépendante mais qui cette fois finit mieux ! Il y a aussi cette belle performance de la comédienne Pascale Habib jusqu’à l’incroyable danse finale. Pourquoi cette évolution de la figure féminine par rapport aux deux autres et cette fin ?
Sur cette fin, hormis la danse, je ne sais pas si ça se termine mieux, car ça se termine en suspension, c’est un film qui n’a pas vraiment de fin, sans résolution narrative, inabouti. Les personnages sont jetés dans leur destinée. Normalement, ça aurait du se terminer par mon personnage marchant dans la forêt et un plan vide de la mer qu’il regarde dans le noir. Pascale Habib était encore une fois une voisine du quartier. Une fois elle est venue avec cette proposition de costume et le gode. Je ne savais pas quoi faire. Elle avait envie d’être filmée. On a dit « tu vas danser et je vais te filmer ». Après, pour le choix du placement de la scène… J’aurais pu la mettre au milieu, j’aurais pu commencer le film par ça. C’est un choix de montage où je dis que la narration est terminée mais pas le film. C’est une scène en plus du film, complètement proposée par la non-actrice du film.
Le contexte change, ici c’est celui de la présence dans la région de l’État Islamique. Comment les libanais vivaient-ils alors cette progression ?
On était impactés, même s’il n’y avait pas encore la vague des attentats à Beyrouth, provoqués par l’État Islamique. Là encore, je ne voudrais pas dire que j’ai anticipé mais je pressentais cette menace et cette chose là qui allait arriver. Effectivement, quelques temps après, une série d’attentats s’est produite à Beyrouth, à Tripoli, dans plusieurs endroits au sud du Liban. Mais ce film a été fait un peu avant et j’avais eu l’idée de ce danger qui venait de ce coin là, de cette organisation en tout cas. Ne me demande pas comment, c’est un pressentiment ! Ou une analyse politique lucide… (rire)
Ça va aussi avec la lumière qui est crépusculaire. Il y a une très belle lumière dans l’ensemble du film et qui est beaucoup chaude que d’habitude.
Oui, ça c’est ma première collaboration avec un nouveau chef opérateur, HTM, Harris Thierry Messari, un franco-yéménite. Il habite Paris et est venu avec moi. Son père avait une histoire particulière parce qu’il a rencontré sa mère pendant la guerre civile libanaise quand il était journaliste à L’Orient le jour et elle aussi, donc ils se sont rencontrés. Donc il était intéressé par le Liban. Je le connaissais c’était un photographe, le lui ai dit « Tiens, viens éclairer mon film, on va collaborer ensemble. » Il a sauté de joie et ça s’est fait comme ça. Donc quelque part, il a ramené sa pâte aussi, son savoir et cette lumière là comme tu dis, presque ténébreuse. On l’a travaillée ensemble, même si je ne sais plus ce que je lui ai dit à l’époque. C’est toujours un échange. Jamais aucun technicien, même s’ils sont très peu dans mes films, ne prend seul la décision. Je suis toujours là en train de discuter avec. Donc on a travaillé ensemble cette directive de lumière, parfois un peu délavée aussi, chaude parce que c’est le choix de tourner au moment du crépuscule et aussi on n’était ni en mars ni en hiver mais plutôt à la fin du printemps. Déjà la chaleur, le soleil bien présent, l’été quasiment.

Lamia -Droits réservés
La peur de la femme s’exprime ici à travers la mère et la tétée au poisson, symbole du christianisme. Le fils incestueux craint de voir sa mère lui échapper à travers le retour à sa communauté. Ça exprime pour moi la crainte du retour au communautarisme. Bon tu disais que tu n’aimais pas trop interpréter tes visions…
C’est pas que je n’aime pas, c’est que je ne saurais pas exactement mettre des mots, donc je ne serais pas sincère. Ça, ce sont des images que je peux avoir et je laisse plutôt le sens au spectateur, comme ce que tu viens de dire. C’est une nouvelle interprétation, on ne m’avait jamais parlé de ça avant. Donc le sens est très ouvert, surtout quand tu fais des paraboles, des métaphores, des images surréelles qui se prêtent à plusieurs interprétations et des films qui posent des questions plutôt que d’imposer ou proposer des réponses bien dogmatiques et bien fermées. Au contraire…
Dans Lamia, les personnages secondaires sont aussi plus importants, notamment les sbires du coach avec leurs entraînements. c’est de la violence mais c’est aussi quasi burlesque. En même temps, on retrouve ce discours commun à celui de tous les jeunes libanais désabusés, déjà entendu je crois dans Zone frontalière et qui n’ont pour exutoire que la violence et la drogue. Une situation qui perdure…
Ou le désespoir, parce qu’il y a aussi le suicide d’un jeune et qu’on voit aussi en effet dans Zone frontalière, dans le commentaire où je dis « il ne nous reste que le suicide comme solution ». C’est en effet la continuité de ma vision, je ne vais pas dire pessimiste, mais plutôt tragique, fataliste, de la situation libanaise, même si je peux exagérer et que je ne pense pas que le suicide soit la solution ! Au cinéma, j’aime aller loin en poussant la provocation pour bouleverser, justement pour déranger mais dans le bon sens. Après, il y a quelques spectateurs qui vont regarder, s’éveiller ou avoir une conscience pour dire « Non, il faut qu’on trouve une solution ». Je ne présente pas ça car en fait je n’ai pas de solution. Je dis suicide, je n’invite pas au suicide mais c’est une manière de secouer : « Là il y a un problème, faisons autre chose » et cet autre chose ce n’est pas forcément en tant que cinéaste. Je n’ai pas de programme à proposer, moi je montre les problèmes. C’est pour que la vie change.
Sans aller trop loin, on peut faire un parallèle avec le film de Waël Nourredine son court dont j’ai oublié le nom (Ça sera beau-from Beirut with love, 2005)…
Ah ! (éclate de rire)
Il y a un côté documentaire dans son film où on voit dans la dernière partie des jeunes qui se fixent dans un appartement et tiennent un discours totalement nihiliste et terminal.
Oui, en effet. Après, il n’y a pas de rapport direct avec son film. Peut-être que je peux partager avec lui la vision de cette jeunesse désabusée avec son discours nihiliste et très violent.
En tout cas s’il y a un aspect comique dans Lamia, tout le monde ne le perçoit pas forcément, par exemple dans la longue scène de meurtre de la prostituée qui est particulièrement douloureuse. Je pense notamment au travail sonore qui est à la limite du supportable…
Dans Lamia il y a ça ?

Lamia -Droits réservés
Oui. (silence) C’est bien toi qui joue le personnage qui l’étrangle dans l’immeuble ?
il n’y a pas de prostituée dans Lamia.
Dans cette scène dans l’immeuble en ruine, ce n’est pas une prostituée ?
Ah si ! Si, effectivement… (rires) Ahlala, à force de faire des films… Et d’ailleurs c’est cette dame là qu’on voit aussi en maillot de bains, qui est elle aussi une voisine du quartier, dans Beirut kamikaze où il y a ce plan de pause devant la télévision où je mets la phrase « Tous les hommes politiques libanais sont des assassins etc. » C’est encore une fois une non actrice qui a accepté de jouer ce rôle là et mon personnage la tue à plusieurs reprises. Là, il y a une inspiration avec l’axe derrière mon dos avec la pierre, avec cette distance, cette violence répétitive, qui vient des Rapaces, le film d’Erich von Stroheim. Enfin chez lui, la scène finale est au bord de la mer et on voit dans le même geste cette violence répétitive avec un cadrage fixe, insistant. Une référence directe à ce film là. Mais avant, il y a une douceur, je la prends dans mes bras, je l’embrasse un peu, il y a de l’affect.
Et puis le parcours de Lamia rattrape celui de Nour mais il y a aussi de la révolte. C’est pour ça que je disais que le film finit bien. À la fin de la narration tragique, il y a presque de l’émancipation. La danse, je la ressens comme une libération : il y a un côté chamanique, j’y vois une transe, une sensualité magique qui remplace celle du mari castrateur qui astiquait son fusil au début.
Quelque part, c’est la femme qui gagne.
Oui, c’est la défaite des mâles. Lamia devient un peu l’androgyne parfait. (rires)
Absolument. Une jolie interprétation. J’aime bien, je suis d’accord.
Tu filmes là aussi des choses depuis ton balcon, la vie beyrouthine. Ici on ressent beaucoup l’urbanité filmée d’en haut, un peu à l’instar du cinéaste brésilien Kleber Mendonça Filho qui dans Les bruits de Recife filme beaucoup ces rapports hiérarchiques d’un étage à l’autre, cette sorte de vigilance, d’observation des uns sur les autres…
Ah, je ne connaissais pas, mais merci pour le rapprochement. En effet, je me suis posé dans Lamia la question, encore plus que dans les autres films, de comment filmer la ville. J’avais cette interrogation ici plus que dans mes autres fictions, parce que quand même cette question était posée dans mes documentaires expérimentaux Zone frontalière ou Beyrouth kamikaze, même si ce n’était pas le centre direct mais plutôt la périphérie. Là, la question s’est posée à travers les personnages, même si ce sont aussi souvent des plans de coupe sans personnage. Quel était l’axe de la plongée ? Les angles étaient-ils assez insolites pour déformer monstrueusement parfois cette ville monstre que je voulais représenter?
Pour en revenir à la thématique du film, il y avait eu autrefois à Beyrouth un racisme anti-palestiniens qui avait précédé le départ des combattants de l’OLP. Aujourd’hui, c’est plutôt un racisme anti-syriens puisque ça s’ajoute à un contexte de crise. Wissam Charaf aborde lui aussi ce même thème dans son dernier film Dirty Diffcult Dangerous. Comment tu le ressens aujourd’hui à Beyrouth ?
Je le ressens dans le quotidien. On sort un peu du film parce que je ne l’ai pas abordé si directement, mais je ressens ce racisme qui m’énerve et je ne vais pas te raconter les maintes fois où je me dispute avec les libanais et où je prends la défense des syriens. Mais ça m’insupporte, comme en France quand on prend une histoire, un détail, un exemple et on va généraliser. Par exemple, s’il y a un syrien qui a volé la semaine dernière un libanais, on va généraliser. S’il y a un syrien qui a commis un meurtre il y a deux mois, on va généraliser sur tous les syriens. C’est toujours comme ça la récupération politique par les conservateurs extrêmes, comme en France, comme l’extrême droite dans sa guerre contre les immigrés. Même si ce n’est pas pareil, le Liban n’est pas la France. Il faut dire que 10400 km², c’est très petit, c’est trois fois l’Île de France. C’est en effet un problème de nombre, on ne peut pas le nier par contre car c’est un tout petit pays et là on est sept millions. Ça pose problème.

Christophe Karabache sur le tournage de Lamia – Photo Harris Thierry Messari, Droits réservés
Est-ce qu’il y a encore des personnes qui disparaissent à Beyrouth sans qu’on s’en aperçoive, du fait de cette densité, comme lors de la guerre civile ou de l’occupation syrienne?
Non, on n’a plus cette vague. Ça c’était surtout à l’époque où les services secrets syriens – là je peux les critiquer car ce n’est pas la population mais l’armée, la politique syrienne que je dénigre – qui exerçait la terreur quand j’étais enfant. Quand on croisait un barrage avec un militaire syrien, c’était l’horreur. Moi j’avais trop peur de ça. Aujourd’hui, il y a moins de kidnappings mais la violence se manifeste différemment après la crise économique. Beaucoup de vagues de suicides, une certaine mélancolie. Les gens sont chez eux, ne sortent plus. C’est plutôt comme ça la post crise, comme dans Zaman Dark.
Dans tes films, il y a comme toujours des plans exceptionnels comme celui du râle de la mère, entre Munch et Gaspar Noé, la surimpression en gros plan, des impressions purement plastiques qui tranchent avec ces images un peu rugueuses du quotidien.
Oui, absolument. J’avais plus en tête la référence au Cri de Munch que Gaspar Noé mais je cautionne carrément la référence et j’en suis ravi. Encore une fois, c’est la continuité et pas quelque chose de nouveau. On voit aussi dans mes autres films, y compris mes documentaires, l’incrustation du rêve, des plans plastiques dans le réel. Ce plan de cri est fait de façon très artisanale lui aussi, avec un filtre en verre que j’ai par hasard ici parce que je l’ai utilisé récemment pour tourner. Ce sont des plaques de verre où il y a de la colle dessus. C’est de la colle artisanale et quand tu le mets devant l’objectif et que tu tournes, ça crée automatiquement des déformations et du flou. Quant à la fumée que tu vois, c’était le chef opérateur qui lançait la fumée de la cigarette. Voilà comment on crée un effet.
Effet réussi. Pour clore cette trilogie, es-tu d’accord avec la définition qu’en fait Michel Amarger qui parle d’une trilogie sur les rapports de l’homme libanais avec les femmes, où tu vois autre chose?
Il n’y a pas de titre officiel mais moi je l’ai appelée comme ça : la trilogie de l’errance. (rire) Mais tous mes films sont sur l’errance, que ce soient ceux qui sont venus après comme ceux d’avant. Mais il a raison dans le sens où le personnage que je joue est plus ou moins le même, que ce soit le boss, le proxénète ou le mari violent de Lamia, le coach… C’est en effet ce rapport avec la première femme, la deuxième, la voisine et à la fin, le côté intime parce que l’idée de Lamia, c’est le reflet du politique via l’intime et il y a la famille via la maison. Le film est plus clair dans l’identification de la critique, parce que ça part justement de cet intime là, de la famille et de la maison, même si les rapports sont bizarres et ambigus. Plus clair en tout cas que Too much love will kill you où il y a une étrangère en plus ou que Dodgem où il y en a une autre. Là, c’est plus précis.
Fin d’un cycle et à nouveau rupture stylistique dès ton court-métrage New blood : wild cronicle of Beirut. On retrouve la voix- off mais cette fois il s’agit d’un diaporama, un montage d’images fixes pour matérialiser l’attente, le blocage du cinéaste puisque c’est de cela que ça traite. Ces images sont prises avec un portable ?
Absolument, un téléphone portable, en sépia. Ce n’est même pas une technique de post prod mais une option du téléphone. Évidemment, quand on a en tête le film de Chris Marker… Je ne me mets pas à ce niveau, mais en gros l’imaginaire, c’était ça. De faire ce montage d’images fixes. Je n’avais pas de caméra donc c’était mon premier film avec un portable parce qu’après j’ai fait d’autres films qu’on va aborder tout à l’heure, comme Kamaloca ou Kalashnikov society qui sont des films entièrement tournés avec téléphone portable, mais en mouvement. Là, c’est plutôt diapos fixes. C’est le parcours d’une kalachnikov et encore une fois l’obsession de la guerre, des ruines… On trouve quasiment les mêmes figures que je filme habituellement, mais là en photos. En inventant cette narration, absurde, décalée, qui a, je trouve, beaucoup d’humour. Techniquement, au niveau du montage, c’est aussi un film test parce que jusque là, à part mes films en pellicule puisque c’est moi qui montais à l’ETNA sur table de montage pelliculaire, argentique, une table Steinbeck ou Atlas, mes films en vidéo avaient tous été montés avec Manu Bodin jusqu’à la fin de Lamia. J’ai donc fait ce film pour me tester en montage parce qu’à partir de ce film, j’ai commencé à monter mes films moi-même, virtuellement et numériquement.
Et au niveau du montage,le film est justement un contrepoint entre le commentaire parfois provocateur, la force des photos et le Requiem de Mozart. Tu n’hésites jamais à reprendre des œuvres musicales très connues et à pousser leur volume sonore comme pour Beethoven dans le précédent. Une manière de travailler en contraste que tu aimes particulièrement.
Oui ! Ça c’est le côté pathos : accentuer les choses et surmonter l’affect. Pour moi, la musique, surtout classique, dépasse naturellement le cinéma et les images. Donc quand tu mets ça, c’est énorme ! C’est trop, c’est beaucoup. Mais l’utilisation du classique, ça a beaucoup été fait dans l’histoire du cinéma et à un moment donné même si c’est en crescendo, on va monter le volume et les décibels du crescendo à un détail près. Là, c’est vraiment le travail de la matière. Des sons, des images, on joue avec et on compose.
Une nouvelle ère avec Sadoum qui s’ouvre sur l’enfermement littoral, un sentiment partagé ailleurs dans le cinéma libanais, je pense au premier long-métrage d’Ely Dagher. C’est quelque chose que tu ressens toi aussi au Liban ?
Non, j’ai un autre rapport. Ce n’est pas l’exil et le mal du pays. Déjà, c’est une autre génération. Lui dépeint une génération qui est venue après, qui n’a pas connue la guerre. L’après-guerre, c’est un autre rapport au pays. Moi c’est un autre sentiment. Ce n’est pas amour-haine par rapport au Liban, c’est haine fois quatre peut-être, même s’il y a des attaches et des sentiments forts. Sadoum est justement un point de rupture avec le Liban parce que cette année là j’ai perdu mon oncle. C’est une histoire personnelle que je raconte. Parce que lui c’était une figure qui remplaçait le père et la mère, c’était un grand monsieur dans ma vie, qui m’a sauvé de plein de choses. C’était mon rocher, ma pierre. Malheureusement, suite à une maladie, il est mort à 58 ans et ça m’a fait un choc. Ça a renforcé si tu veux le sentiment de rage et de haine que je peux avoir contre le pays, parce que ça m’a ramené en arrière, à mon passé au Liban. Après, je suis resté cinq ans en France sans y retourner et j’ai commencé à faire une série de films en France, en Belgique. Donc ce sont deux générations différentes, la mienne et celle du film que tu évoques, deux façons de voir l’exil et le retour. Ce n’est pas le même fond et y compris avec la génération qui est venue avant moi, celle de Ghassan Salhab etc. Là, c’est encore autre chose. Trois générations.

Sadoum – Droits réservés
Dans Sadoum, les couleurs se font plus vives avec des oppositions marquées entre couleurs chaudes et froides, beaucoup de couleurs primaires. C’était dès le départ un parti pris esthétique ?
Absolument. Il y a des films manifestes dans la façon de faire – je ne parle pas du contenu politique. J’ai décidé de faire ce film sans techniciens, mais vraiment personne. J’ai donc fait l’image et le son. Parfois je demandais aux acteurs de prendre le son. C’était juste les acteurs et moi et quelque part, c’est un film performance. J’ai fait la lumière moi-même et en effet, j’étais intéressé par l’idée de me renouveler, de proposer autre chose, d’aller vers l’exploration d’une forme nouvelle, que ce soit dans l’image, le son ou le montage. Pour la première fois c’était d’aller vers la juxtaposition de deux couleurs différentes. Ça c’était le parti pris stylistique de l’éclairage.
Alain Masson parlait dans Positif, non sans ironie, de rigueur et de privations…
Je n’ai pas compris cet article : privation de quoi ? Je n’ai pas compris ce qu’il voulait dire… (rire)
Sans doute de technique ou de moyens.
Peut-être…
En tout cas, ça résume bien l’état affectif de tes personnages et la direction de la mise en scène dont tu viens de parler.
Oui en effet. Et le programme avant-gardiste très expressionniste dans ce film, que ce soit dans le jeu, dans les regards, dans le comportement, les gestes, la danse, l’exagération du désespoir à la fin. On est du côté de l’exacerbation de l’expressionnisme. C‘est un film où il y avait très peu d’indications pour les acteurs et pas du tout de répétitions contrairement à mes autres films où je fais en sorte que les acteurs se rencontrent et où on fait plusieurs séances de répétition. Ce n’était pas le cas pour Sadoum, ils se sont juste rencontrés autour d’un verre et on a commencé à tourner. Je n’ai même pas fait de casting, j’ai juste appelé parce que je connaissais ces acteurs là. Je les ai contactés et on a fait le film en six jours.
C’est court. Ici, j’ai eu souvent le sentiment d’être un peu perdu, de ne pas savoir si la skyline est-elle celle de Paris ou de Beyrouth ?
Paris !
Plus encore que dans tes films précédents, tu cherches partout les traces du Liban, des motifs communs comme les grues… cette obsession de la reconstruction typique du cinéma libanais. Est-ce qu’il y a d’autres choses ?
Oui et non. Je peux comprendre ton interprétation, que dans l’analyse on voie les choses de cette façon, mais c’est aussi le hasard de mes goûts, de ce que j’aime. Si demain je suis aux États-Unis, je vais aussi aller vers ces espaces là, vers ces décors là. C’est peut-être le Liban dans mon inconscient mais je ne saurais pas l’interpréter. Mais demain, en Europe de l’Est, je vais aller vers ça, une gare routière ancienne, vers des lieux glauques. C’est le goût que j’ai de poétiser ces endroits là, de voir de la poésie dans les choses sombres et glauques et que tout le monde n’a pas envie de voir, de simplement passer à côté et préfère rejeter. Mais c’est peut-être encore le Liban. Ça peut renvoyer à ce que disait Jonas Mekas « je filme toujours la Lituanie à New york ».
Il y a une belle séquence homo-érotique, une scène plus facile à tourner en France qu’au Liban (et ça n’a rien à voir avec l’affiche d’À bout de souffle au dessus du lit). L’aurais-tu filmée pareil à Beyrouth ? Ça aurait sans doute été plus compliqué.
Peut-être. Ce côté d’être à l’aise avec les corps, qui en France se donnent de façon plus libre en tout cas. Peut-être que j’aurais eu des difficultés à le faire, quoique dans le milieu homosexuel au Liban, il y a des gens qui prennent le risque et je le remarque de plus en plus, plus que dans le milieu hétérosexuel. Demain je peux demander à homo libanais de faire quelque chose, il le fera de manière plus volontaire et risquée qu’un acteur ou une actrice hétéro.

Sadoum -Droits réservés
Ici la narration est réduite au maximum, comme si rien de devait troubler la solitude du protagoniste jusqu’au très beau plan final. Des phrases comme « Je désire toujours les absents » avec en réponse « les morts ou tes ex ? » Tu viens d’en parler par rapport à ton oncle mais dans quel état d’esprit étais-tu à l’époque ? Est-ce l’absence de ton oncle ou du Liban qu’on ressent aussi fortement ?
Plutôt de l’oncle, d’où les sentiments. Je pense que c’est le film le plus sentimental que j’aie fait, même si j’ai transformé l’histoire d’amour avec l’oncle en amour autre dans le couple du film. Je ne parle donc pas des mêmes sentiments mais de la perte, du vide. J’étais dans une misère sentimentale totale. Je voyais tout sombre, tout noir, je pleurais tous les jours. j’étais vraiment dans un état affectif très pénible. Comme tout deuil. Je ne sais pas si tous les gens se comportent pareil mais moi j’ai un peu pris mes distances avec mon entourage. Je ne voyais plus mes amis et je sortais très peu, sauf au cinéma pour regarder des films toute la journée. Pas pour réfléchir, je regardais juste des films commerciaux pour être dans une salle, être dans la fascination des images pour passer le temps. C’était donc une période de deuil. Je ne sortais pas de la situation donc dans l’urgence, la seule solution, c’était de faire un film. Tout Sadoum, de l’idée de départ en passant par le tournage et jusqu’au montage, c’est un mois. Ça m’a permis de respirer après. Je n’ai pas tourné la page mais « Allez !, c’est un espoir… »
On retrouve le carcan du couple, l’impossibilité des hommes à aimer les femmes qui préfèrent les violenter… Quel que soit l’état, ça revient.
(rire) Oui. Mais depuis Ultravokal et même depuis Venus obscura, on voit chez moi des scènes de sexe, de baise, qui peuvent bien marcher. Il y a un peu la notion de plaisir et même si parfois ça se fait dans la violence, dans un désir impérieux. Mais jusque là, c’était un problème, une frustration. C’était une impossibilité, des gens impuissants, en tout cas les hommes. Jusqu’à ce qu’une actrice me fasse la réflexion « C’est peut-être toi… Non non non, ça n’a rien à voir ! Ce n’est pas personnel du tout. » (rire) Ce qui m’intéresse dans un film, c’est de parler des problèmes, pas de filmer un acte sexuel banal comme on le voit souvent où les corps sont heureux. OK, c’est déjà fait, d’autres le font très bien. Moi ça m’intéresse de parler de quand ça ne va pas.
On ressent une évolution dans la photo du film. Avec quelle caméra tournais-tu ?
J’ai fait une série avec ce qu’on appelle en langage américain DSLR. C’est un appareil photo Canon marque 2 que j’utilisais depuis Dodgem. Dodgem, Lamia, Sadoum, Venus obscura, c’est la même caméra. Après, j’ai changé. Là ce qui a changé, c’est comme tu disais la façon d’éclairer, qui change un peu la texture de l’image. Mais la caméra était la même avec des couleurs plus saturées, des juxtapositions de deux couleurs différentes… Ça a donné un autre type d’image.
Curieusement avec ce film moins libanais et plus minimaliste, les sélections en festival augmentent, de même que les prix. À ce moment là, te dis-tu qu’il vaut mieux être plus apprécié à l’étranger qu’être compris à Paris ou vu à Beyrouth ? Autant se tourner plus vers cette réception là…
Non, aucun calcul dans ce sens là. Encore une fois, si j’ai fait cette série de films en France, ce n’est pas pour cette raison là : je ne pouvais plus retourner au Liban à cause de la perte de l’oncle.
Mais je pensais plus à la diffusion. Parce que c’est quand même toi qui envoie les films. Alors est-ce que tu l’envoyais à autant de festivals mais avec moins de retours ? Là, j’ai le sentiment sur tes dossiers d’une meilleure visibilité.
Oui ! Il y a plusieurs raisons. Déjà, c’est moins critique que les autres films, moins radical, même dans la représentation de la violence. Il y a violence dans Sadoum mais en tout cas, elle est plus suggérée, moins brutale que dans la trilogie précédente, moins subversive et déjà ça joue. Je ne sais pas si c’est aussi parce qu’en Occident, on montre plus les films occidentaux qu’orientaux, je n’ai pas de regard là-dessus. Il y a aussi le fait que cette année là, j’avais rencontré un mécène qui m’a aidé financièrement. J’avais donc une petite somme et je mettais beaucoup plus dans la promotion et dans la soumission des films aux festivals, parce que ça coûte beaucoup d’argent. Il y a quelques films qui y ont accès gratuitement, mais si tu fais la démarche d’envoyer dans le monde, la plupart des festivals coûtent beaucoup d’argent. Et on n’est souvent pas pris, donc c’est un budget en soit. J’ai donc investi là dedans. Mathématiquement, il y a plus de réponses positives si j’ose dire. C’était aussi un changement d’époque parce qu’à partir de celle là, on voyait de plus en plus de plate-formes en ligne qui s’ouvraient aux candidatures de façon beaucoup plus simple. Tu cliques sur un bouton, alors qu’avant, le temps de faire les DVD, d’aller à la poste, de les poster, c’était une toute autre démarche que je faisais moins naturellement.

Christophe Karabache tourne Zeitgeist protest -Droits réservés
Le rythme d’un film par an continue inéluctablement, par contre le style de chacun évolue beaucoup plus vite. Variation sur Sadoum, Zeitgeist protest mute sur le tard en road movie.
C’est ça. Avec plus d’insertion d’étrangeté, du fantastique qui commençait à apparaître dans l’univers de mes films. En effet, c’est le film d‘après donc c’est la continuité. Là, j’ai retrouvé le chef opérateur de Lamia, HTM, le franco-yéménite qui est venu à Paris et m’a aidé à faire ce film, pareil, en une semaine. Ce road movie commence dans Paris et la route se poursuit jusqu’au Havre. C’est aussi le choix d’aller vers une zone portuaire un peu glauque, grise. Sinon sur cette juxtaposition avec des scènes de cauchemars, il y en a un qu’on peut identifier parce que c’est vraiment étrange avec le côté fantastique, que ce soit le lapin ensanglanté dans la baignoire entre les jambes de la femme nue ou la figure du personnage principal, Omar, debout, nu dans un hangar avec l’image bleutée, donc avec les codes d’identification du rêve. Mais on a aussi un autre rêve où on ne sait pas si c’est la confusion réel-imaginaire. C’est plutôt une baise violente qu’un viol, que je joue moi-même, une sorte de western où j’attrape la fille au moment où Omar est parti faire ses besoins et je la viole dans le champ. Après, il revient et il tue ce bonhomme. À la fin, je glisse un détail, un écho sonore, très réverbérant, qui indique que c’était un rêve, même si c’est confus. Encore une fois, c’est un cauchemar filmé de manière réaliste. Ça c’est Zeitgeist Protest, ce mélange… Je commence par le fantastique, mélange rêve-réalité, road movie et encore ce désespoir mais aussi – j’aime bien cette phrase de Jean-François Rauger dans Le Monde, « ce mystérieux mal contemporain ». Je pense qu’il a raison parce que j’évoque l’ambiance terrorisante de l’époque en Europe, la menace des attentats etc.
Le rythme du film est très travaillé…
Dans ces longues séquences, l’esthétique est plus sensorielle que dans les autres films. Je commence aussi par des plans séquences mais je rajoute aussi de la sensorialité par rapport aux précédents qui étaient plus bruts, ces cadrages insistants, ces vides dans la violence dont on parlait. Là ce sont des plans longs, mais par l’image et le son, il y a un surgissement du sensoriel qui n’était pas présent dans mes autres films.
Alors revenons justement au début, puisque tu commences par un long plan de lit de rivière bétonné, un de tes motifs récurrents puisqu’on en a déjà parlé à propos notamment de tes documentaires. Il est très long, 1 mn30, Alors qu’est-ce qui détermine pour toi le point de rupture, j’ai presque envie de parler de « douleur de la coupe » ?
(silence) Alors ce plan, c’est le seul plan qui vient de Beyrouth.
C’est intéressant.
Voilà, tout le reste du film se passe à Paris et sur la route jusqu’au Havre à part cette ouverture là. Moi j’étais à Paris et je voulais absolument ouvrir le film par ce plan fleuve. C’est le même fleuve beyrouthin asséché, plein d’immondices et de pourriture, très gras, très sale où j’ai filmé le mouton, la charogne de Beirut Kamikaze. J’étais donc à Paris et j’ai contacté ma copine de l’époque, May Kassem. Elle est elle-même cinéaste. Je l’ai appelée et je lui ai dit « Il faut absolument que tu filmes » et j’ai donné le détail : où elle doit être, avec quel axe, quelle focale etc. On voit d’ailleurs si on a l’œil que la texture de l’image vidéographique est très différente du reste du film parce que sa caméra était autre que la mienne. Je ne saurais pas expliquer cette ouverture mais je voulais absolument que ça commence là. Donc le choix de la coupe, c’est une question de pur cinéma. Où, quand, comment couper ? On a ces trois questions auxquelles on pense tout le temps dans un plan, qu’il soit court, moyen ou long. Ce sont les questions que chaque cinéaste se pose.
Bien sûr…
Là, c’était par rapport à un souffle, un rythme. J’étais guidé par le son, les klaxons des voitures. À un moment donné, j’ai dit « Bon, ça doit être là » et j’ai aussi ajouté en post prod, le croassement d’un corbeau
Au niveau sonore, il y a aussi ces cigales « métalliques » ? C’est un son seul pris sur l’endroit, c’est quelque chose que tu as ajouté, que tu avais pensé ?
Pensé oui mais rajouté en post production. Tout ça, c’est travaillé en sound design pour renforcer ce côté sensoriel et donner du relief à l’image.

Zeitgeist protest -Capture d’écran
Là on peut dire que les couleurs éclatent, par exemple dans la belle scène de bar extrêmement tendue, dans les plans en chambre d’Omar perdu entre rouge et vert et qui expriment un leitmotiv violent et sauvage « je vais tuer ». Retravailles-tu aussi la couleur en post-prod ?
Oui, absolument. Et d’ailleurs, pas les scènes de la chambre mais pour celle du bar, j’ai suraugmenté la valeur de la saturation de la colorimétrie par rapport au reste du film qui était à 90 %. Pour cette scène là, j’étais à 120 %! J’ai donc mis le curseur plus haut, en contraste avec le reste du film, même si ça reste des couleurs flagrantes. C’était des couleurs présentes dans le bar, nous n’avons pas rajouté d’éclairages à part quelques détails sur les visages. La couleur participait à une certaine tension, autre que l’insistance du flou et du net, de la mise au point et des mouvements en focales très rapprochées sur les visages. Donc les couleurs étaient très importantes pour moi et je les ai ressenties sur le moment, aussi je voulais absolument que ce soit présent dans le montage.
On retrouve plus poussés qu’avant tes obsessions pour le corps et la viande qui sont ici multipliées.
(rire) Notamment le lapin ensanglanté dans la baignoire et qu’on avait déjà vu crucifié sur un bâton dans Tout va mieux. C’est là aussi un film personnel dans le sens où c’est quelqu’un qui veut venger la mort de ses parents mais il n’y arrive pas. Il est bloqué. On retrouve la frustration, l’impuissance, pas sexuelle cette fois-ci, mais devant un acte qu’il n’arrive pas à accomplir. Il y a une hésitation ou une suspension…
Qui fait le lien avec un film dont on parlera tout à l’heure, Vortex, entre autres… Comme toujours chez toi, chaque plan ici a une valeur, je pense notamment à l’appartement et ses lignes de fuite. Il y a une capacité d’émerveillement à la caméra. Il y a des plans trouvés/tournés au moment dans ce film ci ?
Mais ça c’est le résumé du processus de création sur le plateau et pas que dans Zeitgeist Protest ! Certes, je viens, pas avec un découpage parce que ce n’est pas vraiment un storyboard comme dans un film normal, mais il y a quand même un plan de travail où je connais mes plans. Et des fois ce sont des croquis, ça s’exprime par une phrase où je décris l’image et le son. Je viens donc préparé mais sur le moment, il m’arrive soit de jumeler deux plans, soit une scène en trois plans que je fais en un seul plan séquence alors que dans ma tête c’était découpé, en un plan long, un plan unique – c’est le mot juste. Ou des fois je regarde cet axe là et je vois quelque chose du décor ou de l’emplacement que je n’ai pas remarqué pendant le repérage. Ici je connaissais l’appartement, c’était celui d’un ami que j’ai été plusieurs fois repérer. Mais parfois c’est un point que je n’ai pas vu ou bien une proposition du chef opérateur. Parfois, il sufit de déplacer l’axe de quelques millimètres et toute la vision change donc je suis ouvert aux discussions que je peux avoir avec le chef op pour modifier les distances ou le déplacement d’un acteur qui est en off et que je vois se déplacer du salon vers la cuisine. Tiens, ça m’inspire alors j’arrête tout et je dis « Allez, le prochain plan, tu vas faire la même chose que ce que tu viens de faire et on va la filmer ». Donc ça c’est sans cesse.
Le final est très beau : errance, résistance puis transgression. L’air de rien, tes films enregistrent la permanence des luttes comme bruit récurrent du monde, quel que soit le territoire, ce Zeitgeist auquel on ne peut pas échapper.
Pas mal… J’adore ce que tu viens de dire. Le film se termine par un plan où ils font l’amour mais on ne sait pas car j’ai suspendu l’affaire. En plus , j’ai mis « à suivre… » Et j’ai laissé une ouverture : peut-être qu’on ne l’a finalement pas attrapé ? Après techniquement, les policiers qui parlent dans le haut-parleur, c’était ma voix que j’ai déformée.
L’idée de l’attentat, un plan vague de quai, un bout de pano une sirène lointaine : tu nous immerges dans le mental d’un terroriste ou plutôt d’un tueur de masse, comme si tu nous immergeais dans son état de guerre intérieure…
Ou de ce que peut devenir un homme, encore une fois sans le juger. Qu’est ce qui pousse un homme à devenir un terroriste ou un tueur ? Et cette question s’est posée aussi pour Zaman dark puisqu’on peut le voir comme un mode d’emploi pour devenir tueur en série. Là c’est plutôt tueur de masse ou terroriste, selon l’appellation sociétale. En effet, j’ai donné une dimension cosmique à cette terreur. Pour la gare du quartier où j’habitais à Paris, Denfert-Rochereau, que j’ai fait exploser, j’ai mis un passage que je n’ai pas tourné, c’est du found footage, l’explosion cosmique d’une comète dans l’espace. Ça c’est la dimension haute ! (rire)

Zeitgeist protest – Capture d’écran
Si Sadoum avait un côté guérilla où tu étais à tous les postes, celui-ci est un vrai film de collaborations. À ce propos, quels sont en général les retours artistiques de tes producteurs ?
Il n’y en a pas au sens classique du terme, à part pour Ultravokal. Ce sont plutôt des mécènes ou de l’autoproduction. Du côté des mécènes, on me donne les moyens et je suis libre de m’exprimer comme je veux. Il n’y a pas de retours, ni de copie zéro qu’on montre au producteur pour voir s’il est content ou pas ou s’il nous autorise à continuer ou non le montage. Je ne suis pas du tout dans cette logique.
Mais est-ce qu’il y a quand même un retour une fois le film fini, un dialogue où ils te disent de film en film ce qu’ils apprécient par exemple…
Ah mais carrément ! Ça change en plus avec Cécilia Werkmeister, une autre mécène que j’ai rencontrée à Paris et qui m’a suivi pour plusieurs films. On échange, on fait une projection intime, on boit un verre. Mais ce sont plus souvent des soutiens que des critiques. La phase critique vient plus tard avec d’autres personnes et des remises en question. Là, c’est plutôt une continuité de l’œuvre et un soutien au cinéaste. À part Ultravokal où je me suis disputé avec le producteur, puisque là c’était un vrai producteur. (rires)
On en parlera tout à l’heure donc … À l’époque de Zeitgeist, te reconnaissais-tu dans le cinéma souvent cruel et coloré de Kim Ki DuK ?
La découverte de Kim Ki Duk vient tardivement dans ma vie de cinéaste, je dirais avant Zeitgeist, à partir de Dodgem. Même s’il n’y a pas de lance-pierres dans ses films, cette inspiration fait peut-être la spécificité du mien. Trouver des accessoires, des objets qui peuvent devenir en tout cas des outils de meurtre, vient de ma découverte du cinéma de Kim Ki Duk.
Et concernant son traitement de la couleur, notamment dans Crocodile…
Non, je n’avais pas pensé à ça. C’est une correspondance, plutôt un hasard.
Un journaliste étranger voyait dans le film une métaphore du monde intérieur de tes acteurs. C’est étonnant puisqu’après tu allais justement consacrer Venus obscura aux acteurs. Il y a donc des spectateurs qui voient assez bien venir les choses.
C’est ça ! (rire) C’est vrai. Même si dans Venus Obscura, la pièce de théâtre, Hamlet-machine était un prétexte. J’aurais pu choisir une autre pièce et le film ne changera pas. Les gens ont cru que c’était une adaptation ou une référence à la pièce. Pas du tout ! Ils auraient pu s’exercer sur une autre pièce. C’est en effet à partir des acteurs, mais pour parler d’autre chose, plutôt comme un arrière plan.
Souvent, les fins de tes films dialoguent avec les débuts des autres et semblent se répondre à chaque fois comme des enchaînements. Est-ce conscient ?
Ça se trouve comme ça. Je ne sais pas si c’est le cas pour les autres réalisateurs mais moi je fais un film et forcément ça dialogue avec celui qui a précédé, mais surtout en contradiction. On peut voir une continuité mais enfin…
Là, il y a l’allée d’arbres, les grilles et les buissons…
Oui forcément, il y a des motifs récurrents, en commun, mais de manière générale, le film vient pour contredire celui qui l’a précédé.

Tournage de Venus Obscura -Droits réservés
C’est marrant cette sensation que la caméra est l’otage d’un mystérieux commando, un peu comme si toi-même tu restais quelque part otage des miliciens libanais.
Quelque part oui. Et il y a surtout cette notion de la frontière, où est la limite… Et quand on rentre, même si on se trouve dans une nature belle, on est repris par la violence, même en pleine campagne.
La marche qui était présente à la première personne dans tes documentaires, un peu plus avec Omar, est ici un acte politique. Quelque chose a changé. Les personnes n’errent plus, ils se déplacent. Ils marchent avec un but, conscient ou inconscient, mais en tout cas ils marchent et nous avec eux, toujours vers quelque chose d’inéluctable. Tu vas désormais imposer cette figure de style – héritée de Bunuel et Pasolini – dans tous tes films pour des durées plus ou moins longues, avec ou sans musique. Qu’est-ce qui te motive à filmer le déplacement et à vouloir l’enregistrer dans le temps réel ?
C’est à chaque fois différent. Une des bases du cinéma reste de filmer des corps en mouvement. c’est la base des bases ! Et je ne sais pas pour les autres mais moi je prends un immense plaisir à filmer quelqu’un qui est en train de marcher.
C’est donc pour revenir aux fondamentaux.
C’est une des premières choses, qu’on filme ou non un acteur. Un sujet en mouvement, la première chose, c’est qu’il marche et la caméra le suit, que ce soit sur trépied, en voiture, sur des rails de travelling, caméra à l’épaule, sur un stabilisateur ou un steadycam, c’est pour moi le premier geste cinématographique. Après, il y a la décomposition. Ça c’est la première réponse, la deuxième, c’est que chaque film a ses raisons. Dans Venus Obscura, c’est aussi ce labyrinthe. Il y a la maison, la campagne et il y a les meurtres mystérieux qui se produisent et le reste des personnages qui vont les découvrir, marcher puis revenir. C’est une sorte de labyrinthe, de puzzle de la géographie du lieu, de l’espace. De par mon côté expérimentateur, ça me permettait aussi d’aller dans le côté sensoriel. Par exemple, pour la marche des trois après la découverte du corps à l’envers pendu à l’envers du personnage – ça c’est la marche la plus longue – on les voit marcher tristes, mélancoliques, là c’était une caméra avec un stabilisateur et ça m’a permis de souffler sur l’objectif et de fermer direct, de mettre un filtre ND, densité neutre, alors qu’il y a encore la buée de ma respiration, de mon souffle. Et ça a donné ce contour flou, avec au centre une netteté de l’image. Ça m’a créé cet effet là. Normalement, il y a un filtre que Carlos Reygadas a utilisé dans un de ses films où on voit ainsi le contour flou et le centre net.
Post tenebras lux…
Exactement. Lui a utilisé un filtre. Moi je ne l’avais pas donc je l’ai fait de manière artisanale et c’était un plaisir visuel, un plaisir de corps, de mouvement, de durée. Là on est dans du pur cinéma ! Au delà de la narration…
Les monologues croisés des acteurs matérialisent ta façon de traiter les personnages dans tes films antérieurs. Mais quels rapports entretiens-tu avec ce metteur en scène de théâtre, sa quête personnelle et ta propre manière de diriger les comédiens ?
Aucun. Il y a des personnes qui ont fait cette métaphore, cette assimilation. Il n’y a pas d’identification. Aucun rapport, ni effet miroir. Seulement le hasard de l’histoire que ce soit un metteur en scène. Après, il y a toujours cette métaphore du démiurge, du metteur en scène qui va contrôler, qui est obsédé, amoureux de l’actrice alors qu’elle est avec l’acteur. Bon, ça arrive. Évidemment. C’est un classique. Mais il n’y a pas une identification par rapport à mon propre travail. Moi ce qui m’intéressais, c’était de révéler les meurtres, la terreur mystérieuse.
Il n’y a pas non plus de métaphore dans le fait de balancer tes comédiens dans une aventure, aussi extrême qu’elle puisse être (rire) et quel que soit le résultat…
Ça peut l’être, parce qu’il y a eu un rapport très tendu avec l’actrice Zalfa Seurat qui joue l’assistante aux cheveux bouclés, Dora. Un peu la bourgeoise quoi… L’avant-dernier jour, des insultes, des injures. On a failli en venir aux mains. C’était vraiment très complexe… Il y avait une sorte d’attraction-répulsion, une tension sexuelle… (rire)
Est-ce que ça résultait du scénario, du dispositif ?
C’était un ensemble, ça venait aussi du rapport que j’avais avec elle depuis les répétitions. Le fait qu’on était confinés pendant sept jours. Pour elle, c’était quand même une première expérience en tant qu’actrice dans ce type de film. Elle était habitué à quelque chose d’un peu plus classique, où elle a sa chambre. Là, on dormait dans le lieu de tournage. Elle était habituée à être à l’hôtel, avec un accueil, où il y a une équipe. Là, la régie c’étaient les acteurs. Je leur demandais de nous faire aussi à manger ! Il n’y avait pas de régisseur. C’était un choc pour elle. (rire)
il y a un parallèle entre le processus du film et la pièce…
En effet. Un parallèle s’est créé de jour en jour. Elle a quand même une personnalité un peu forte et elle était moins réceptive à mes directives. Moi, ça m’énervait. D’un jour à l’autre, ça a été un cumul et à la fin il y a eu explosion. Je voulais même la virer, j’étais sérieux. J’ai pris la décision d’arrêter, non pas le film mais ses scènes à elle. C’était donc avant la scène du meurtre. Elle est restée dans sa chambre durant toute une journée et donc je commençais à réfléchir à comment remplacer cette scène, parce que je ne voulais vraiment plus la filmer. Après les négociations avec Loredana Flori, l’autre actrice et les autres acteurs qui ont servi d’intermédiaires ont abouti à une sorte de paix, au moins pour terminer les scènes.
Cette comédienne t’a-t-elle fait des retours sur le film ?
Oui bien sûr, parce qu’après la relation a continué (rire) et figure toi qu’elle est même revenu pour Kamaloca, c’est elle qui joue la louve et à chaque fois que je débute un casting, elle m’appelle, elle veut jouer encore et encore. Il y a quand même un côté masochiste !
Le Liban revient par les témoignages : viande de bébés, seins tranchés. Toi même tu abreuves tes acteurs d’anecdotes destinées à les mettre en condition ? Tu leur racontes ce genre de trucs ?
Oui, on a préparé. En général, je raconte ma vie, d’où je viens. Ça leur facilite la compréhension pour eux français qui n’ont pas vécu au Liban, qui n’ont pas connu la guerre civile, qui n’étaient pas orphelins de guerre avec toutes les conséquences… Voilà, c’est un monde particulier et pour les faire rentrer dans mon univers, on parle, je raconte ma vie, je montre mes films. Il y a un travail de conditionnement pendant les répétitions.

Tournage de Venus Obscura -Droits réservés
Mais tu ne rentres pas forcément dans les détails de la guerre civile…
Ah non, je raconte plutôt ma vie que la guerre. C’est une expérience personnelle. Ici en effet, le fantôme de Venus Obscura, c’est le Liban qui vient par les détails d’un passé lourd.
On a du te le demander souvent mais des scènes ici sont-elles inspirées d’un seul de tes tournages ? Des expériences vécues ont-elles guidé l’écriture ?
(étonné) Non, encore une fois, pas forcément…
Le fait qu’ils soient accros au sexe, à la drogue, ça n’a aucun rapport ?
Non. À part peut-être des sentiments cachés qu’on peut avoir si on est épris de l’actrice et qu’elle est avec l’acteur, alors le metteur en scène est un peu frustré, ça peut arriver. Mais ce n’est pas vraiment un film miroir de mon travail de metteur en scène.
Tu t’éprends facilement des actrices que tu filmes ? Comme d’autres metteurs en scène. Je pense à Philippe Garrel qui dit qu’il ne peut pas faire autrement…
C’est sûr qu’il y a toujours une relation de séduction et de désir, mais là, ça ne veut pas dire que ça se termine par une coucherie, un acte sexuel ou une relation amoureuse classique. Par contre, désir et séduction sont toujours là. Si quelqu’un dit que ce n’est pas le cas, c’est un mensonge ! C’est impossible. Ça se passe surtout entre le réalisateur et l’actrice. Avec l’acteur, la séduction se transforme en amitié, en autre chose. En tout cas pour moi, en tant que réalisateur, il y a souvent un désir et une relation de séduction qui s’imposent dès le casting, avant même les répétitions et le tournage. Évidemment, il y a évolution. Et puis je ne tombe pas amoureux tout le temps ! Mais le désir est là. Et il peut se manifester de plusieurs façons, ce n’est pas que sexuel.
« Mes mots n’ont plus rien à me dire, mes images aspirent le sang de mes pensées » Dirais-tu qu’un film c’est un conflit entre l’esprit et l’instinct, son sens et ce qui émane directement de certaines de tes images ?
Oui, c’est souvent ce conflit là, cette tension permanente entre ces affects, ces sensations fortes, ces émotions et la chair. C’est un cinéma de la chair donc avec toutes ses composantes et ce qu’elle dégage. Le corps, la cruauté, les sens, les sensations et la pulsion, l’instinct. Même dans la création, il y a toujours un parallèle entre quelque chose de conscient, de réfléchi, de posé et la pulsion, l’impulsion, l’intuition. Ça c’est dans l’imaginaire du processus de création, pendant la fabrication et ça se manifeste de façon pratique dans la mise en scène. Parce que c’est du concret une fois qu’on a conceptualisé le film. Le cinéma c’est très concret. Parce que c’est le rapport au réel. Même si on fait le film le plus fantastique, surréel ou fantasmagorique, au cinéma on est toujours récupéré par la réalité. Et dans cette réalité, il y a ce travail de corps, d’affrontements, d’échanges forts entre les désirs et ces pulsions. Sans cesse.
La surimpression est depuis toujours quelque chose qui te travaille et qui te relie à un certain âge d’or du cinéma. On pourrait d’ailleurs analyser l’évolution de cette recherche chez toi. Ici je pense à ce plan extraordinaire du visage rouge du metteur en scène sur la forêt en blanc saturé, puis sur un œil, puis sur un visage allongé dans l’herbe au lever du jour.
Le visage rouge en surimpression sur un paysage en bleu qui défile, on le voit déjà dans Zeitgeist protest.
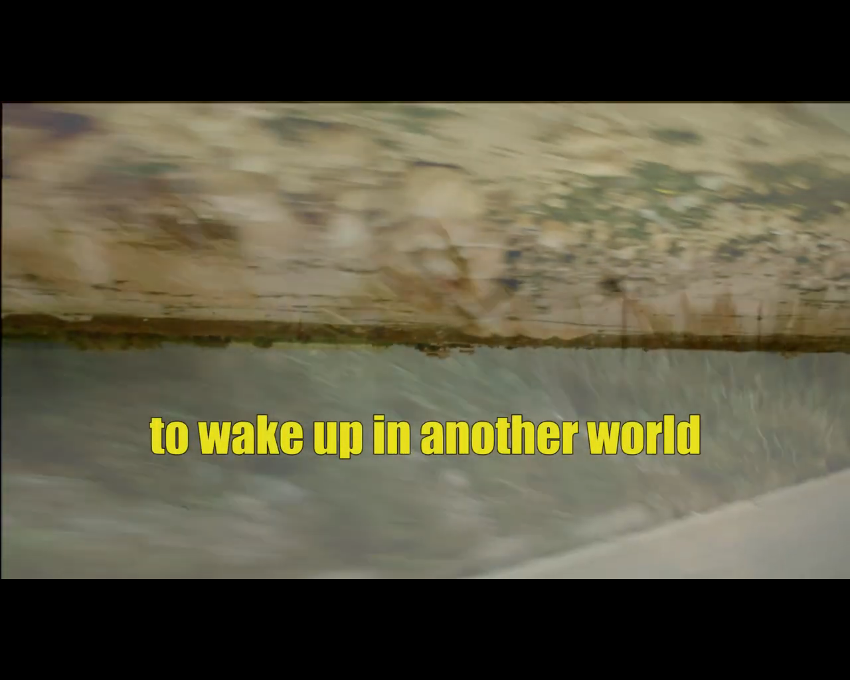
Dream politik 19 – Capture d’écran
Ce sont des effets réfléchis à l’écriture ou tu les trouves après ?
Non, ça c’est au montage. Même si j’ai déjà dit dans nos entretiens précédents que je pense le montage dès la préparation et dès le tournage. Mais pas pour les effets visuels. On pense en amont le bloc, la structure, la composition, quelques raccords, quelques enchaînements… Quoi mettre avant ? Le reste, c’est la post prod.
Il y a donc des collisions et des accidents qui se font sur la time line…
Absolument. Parce que c’est ça le plaisir. Si le montage est juste l’application du découpage pensé et qu’il consiste juste à donner forme à la prise de vue, ce n’est pas intéressant. C’est même ennuyeux. C’est sûr qu’au tournage on peut aussi avoir des accidents très malheureux qui vont bloquer le tournage, mais on a surtout des accidents heureux, inspirés et inspirants. Du hasard, de la chance, de l’aléa qui surgissent au tournage et justement au montage et j’accueille aussi ces moments là d’imprévus de fautes de raccords. « Tiens… » D’un coup, ce type de combinaisons non pensées à l’avance va donner quelque chose sur le plan sensoriel et va peut-être brouiller le sens de la narration ou la continuité. Ce n’est pas grave. Je le prends, je le cautionne et je le valide.
En travaillant sur les acteurs, as-tu songé à Bergman et à son approche plastique, l’enchevêtrement des visages pour matérialiser les pensées, la persona et le moi… Est-ce que tu as été sensible à ça ?
Certainement. J’aime beaucoup Persona, mais aussi Le septième sceau… Mais c’est un cinéma que je n’ai plus revu, que je dois revoir. Je l’ai découvert au départ. Évidemment, quand on est étudiant en cinéma, Bergman s’impose dans le programme parmi les cinéastes étudiés. Peut-être parce que trop étudié, j’ai fait une rupture, je n’ai plus revu ses films. Par contre dans Venus obscura, la question peut se poser parce que c’est un travail avec les acteurs et lui a énormément fait ça. Bizarrement, même si ce n’est pas du copié-collé, si on veut parler références cinéma et ça va peut-être t’étonner, le modèle de Venus Obscura, c’est Shining. (rire) Attention, pour en faire autre chose. Une fois, j’ai même entendu Hou Hsiao Hsien qui parlait d’À bout de souffle comme référence pour un de ses films en particulier alors que quand tu regardes son film, ça n’a rien à voir. Millenium mambo, ce n’est pas du tout À bout de souffle !
Mais selon toi, que reste-t-il justement de Shining dans Venus Obscura ?
C’est justement là où parfois j’avais des hic… Je pense au jeu de l’acteur Cédrick Spinassou dans cette folie là, celui qui joue le metteur en scène. Il a essayé d’aller dans l’imitation et à chaque fois, je faisais un blocage. « Non ! Non, il faut faire différemment ! » Il a repris un peu ça parce que moi c’était mon modèle. On a travaillé ce film avec les acteurs avant le tournage. Il reste aussi quelques moments de surprise dans le film, de sursaut. Voilà. Quand je dis Shining, il ne faut pas le prendre comme une copie conforme, ni une adaptation. C’est une inspiration secrète si j’ose dire. Dans ma tête, il y avait autre chose que Bergman.
Ce n’est pas la première fois que j’y songe mais le travail sur les textes opérés par Huillet et Straub, la distanciation est-ce ça c’est un truc qui te parle ou pas du tout ?
Oui ça me parle, mais peut-être pas par Straub et Huillet, ni même par Brecht, mais là aussi, il y a un retour de Fassbinder qui lui, a pris directement de Brecht. S’il y a distanciation, c’est plutôt par rapport à quelques leçons fassbindériennes.
Je suis toujours sidéré par l’amplitude, la diversité et l’audace de tes choix musicaux. On se demande forcément quand l’air s’est imposé. Il t’arrive de bouleverser ton montage par rapport à un morceau de musique prévu, par exemple, si tu entends un truc à la radio et que tu décides que finalement ça va être ça, c’est ça qu’il te faut ?
Ça m’arrive d’être pragmatique et de changer par rapport à ça. Pour ce film il y a eu deux ou trois compositeurs. Comme je le disais, ils ne regardent pas les images. Quand je veux quelque chose de vraiment précis comme la scène du meurtre que tu as identifié comme giallesque dans Zaman dark, une fois que j’ai transféré le plan à mes musiciens, parce qu’ils sont belges, Michel Duprez a composé par rapport à quelques indications que j’ai données, aux références et il a composé à l’image. Mais de manière générale, elle est composée en fonction de souhaits que j’émets avant même le tournage ou alors après le tournage je donne deux ou trois semaines au compositeur parce que là c’est du concret. Moi je connais les images mais je ne leur montre pas. Je décris l’ambiance et l’atmosphère. Ils composent et après c’est le hasard des correspondances. Ça marche, ça marche pas, je décale, je coupe la musique et je raccorde avec autre chose. C’est vraiment un travail avec la matière mais qui vient en montage.
Je pensais surtout aux airs préexistants. Ici c’est l’arrivée de Bella ciao avec un très beau mouvement de caméra.
Ah, ça par contre, c’est pensé à l’avance.

Venus Obscura -Capture d’écran
De fait, la musique caractérise un peu les comédiens comme des résistants (il acquiesce) qui incarnent un texte pour se trouver eux-mêmes.
Oui, c’est ce militant qui quelque part est déchu. Ça, c’est pensé à l’avance parce que ce sont des musiques diégétiques, ça fait donc partie de la narration comme l’autre morceau quand il rentre un peu désespéré après l’altercation avec le metteur en scène. Il entre dans une voiture, allume la radio et là, il y a le chant communiste « Debout les damnés de la terre… ». Ça, c’était dans le scénario.
Au final, le jeu n’est au final que mensonge une fois que ton double – qui donc n’en est pas un (rires) – confesse que diriger des acteurs dans tes films, c’est quelque part les envoyer à l’abattoir. Hors la tension dont tu nous as parlé, y a-t-il eu des comédiens ou comédiennes traumatisées par l’expérience au point de refuser un nouveau rôle ?
Pas pour Venus Obscura mais pour d’autres films. Pas directement. Si je me souviens, l’actrice de Zeitgeist a adoré le film. C’était une expérience plutôt positive. Quelques temps après, sous l’influence de son mec, il y a eu un rejet du film et de l’expérience. Voilà, ça c’est arrivé. Une fois, dans Ali is good for Jesus : il y a une scène d’abattoir d’hommes, de massacre. Une des actrices, plutôt une figurante dans la scène, a été choquée a posteriori et m’a même demandé d’enlever son nom du générique. Il y a eu entre nous une sorte de distance froide. Mais d’une manière générale… et même si l’expérience est forte, corporelle, physique, s’il y a une fatigue, des tensions, de la violence verbale dans ma façon de diriger – des fois je pète des crises et je peux insulter mais ce n’est pas que je vise quelqu’un, c’est une insulte générale due à la tension du moment, quand on est dans le travail et qu’on sent qu’un plan nous échappe alors qu’on veut plus, il peut m’arriver de mettre des mots forts ou lourds. Mais malgré tout ça, les comédiens reviennent toujours et me demandent encore. C’est plutôt un rapport positif, à part ces rares fois. De façon générale, les acteurs aiment ça.
Les plans de la fin m’évoquent à la fois le plan de fin de Japon de Carlos Reygadas et le tout dernier, la fin d’Irréversible de Gaspar Noé. La grande différence est que le long mouvement de caméra de Japon dévoile les victimes d’un accident avec un train à l’issue d’un long suspense et sans les regarder vraiment. Toi tu exposes le corps violenté comme une pietà. Le plan final nargue la caméra sans rechercher de mouvement virtuose et trop signifiant comme la spirale du plan final d’Irréversible. Il y a chez toi comme quelque chose d’ironique par rapport à l’existence de Dieu ou à une sorte de métaphysique. Quand tu les tournes, tu es plutôt guidé par un sens ou par une esthétique ? Est-ce que tu y transcris une idée ?
Alors, il y a un sens esthétique mis en scène, d’aller vers cet axe de plongée, de voir d’en haut le meurtre, est une vision dominante de ce corps écrasé. Parce qu’on a commencé très serré sur l’herbe et on avance et après on élargit et on monte, il y a ce côté d’élévation là. Avec le temps, je regrette par contre le choix de cette musique préexistante sur ce plan là. Parce que là j’ai sacralisé le sacré, c’est trop ! Pour moi, ce fut un mauvais choix du moment de mettre cette musique. Tu as raison d’évoquer le plan de Japon parce que durant la préparation de ce film c’était une de mes aspirations vers quoi tendre.
À quoi se réfère le titre du film ?
C’est venu comme ça après quelques tentatives de trouver un titre. J’ai trouvé ça beau. Vénus, ce n’est pas la planète mais la déesse et obscura, son côté obscur.
Donc c’est venu un peu comme pour Dodgem dont j’avais lu la signification dans une interview.
Dodgem, c’était « autotamponneuse » en anglais ancien, mais peut-être qu’il prend un sens encore plus critique, comme une métaphore de l’affrontement, du choc. L’idée de Venus Obscura, c’était aussi de mettre de la cruauté, de la laideur dans la beauté. C’est un de mes films les plus esthétisants. En plus on était dans un beau décor, dans une campagne belle. L’image est belle. Alors, mettre du sang, même si c’est plus suggéré et moins frontal que dans mes autres films.
Pour moi, Venus Obscura marque le début d’un nouveau cycle, avec de nouvelles visions, des motifs obsessionnels qui relient particulièrement ce film à Vortex , une direction photo et une collaboration pérenne avec Aurélian Pechméja, mais aussi avec Cécile Werkmeister, May Kassem, toutes deux déjà là dans Zeitgeist protest et un certain nombre de collaborateurs qui vont t‘être fidèles assez longtemps, bref tout le contraire du récit fictionnel du film… Est-ce que pour toi ça marquait aussi le début d’autre chose ?
Oui, la continuité aussi, mais comme je l’ai dit, je cherche à me renouveler dans la forme mais dans le fond, je change l’histoire mais je parle toujours du traumatisme de la guerre. C’est le point commun qui résume le cinéma que je fais. Pour les choses nouvelles, c’est la première collaboration avec Aurélian Pechméja qui a sans doute ramené sa pâte et son professionnalisme, ses techniques et son matériel. Un chef opérateur très esthétisant, ça a ramené quelque chose de nouveau. Parfois c’est moi qui pose les limites qui lui dit « Holala, là non, c’est trop composé, trop pictural. Qu’est-ce que tu me fais ? Un tableau ? ». Il a donc tendance à esthétiser et moi aussi. Des fois je trouve un équilibre. Je lui cache quelques filtres sur le tournage (rires) pour qu’il ne les mette pas. C’est aussi une jolie période. C’était avant le COVID, il y avait une belle énergie, on faisait un film par an, le distributeur était encore plus actif qu’aujourd’hui donc on enchaînait, c’était une belle dynamique et quand on est content, et bien, on reprend les mêmes gens et on enchaîne avec la même équipe, ce qui se fait aussi dans le cinéma traditionnel. Mais ce qui est vraiment nouveau là, c’est cette ouverture au cinéma dit « de genre ».

Tournage d’Ultravokal -Droits réservés
Le film reçoit de très nombreux prix, mais n’est guère couvert par la presse à l’exception d’un article court mais juste de Jean-François Rauger. Comment cela s’explique-t-il ?
C’est le hasard de la distribution. Cette année, là c’était un très mauvais attaché de presse. Le distributeur a fait la bêtise de ramener un débutant. Donc la distribution a mal fait son job même si, ni après, ni avant, je n’ai jamais une quinzaine d’articles non plus. Ça va de 3 à 6 articles, ça tourne autour de ça. Mais en effet, pour celui-ci, il y a juste eu deux articles, Les Fiches du Cinéma et le petit article du Monde. C’est peut-être aussi parce que le film est moins provocant que les autres, parce que souvent il s’agit de critiques assassines. Ils râlent, donc peut-être que dans celui-ci ils n’ont pas trop râlé. « On va l’ignorer. Il commence à esthétiser, à faire du beau… Ciao ! ». (rires)
Cela dit Venus Obscura a obtenu une distribution internationale en VOD sur diverses plateformes à l’étranger grâce à un distributeur américain qui a acheté le film. C’est l’œuvre qui m’a rapporté le plus d’argent si j’ose dire.
Ultravokal s’expatrie en Belgique, ce qui veut dire de nouveaux lieux, le Hainaut, une atmosphère plus plombée aussi. N’est-ce pas plus agréable de tourner en Belgique qu’en France ?
J’ai adoré ! Oui, beaucoup plus agréable, c’est plus ouvert. En tout cas, c’était inspirant. Il y a des décors gris, des espaces belges qui pouvaient m’intéresser à fond, plus qu’en France. Après, le choix de la Belgique, c’est parce que j’ai rencontré Vincent Fournier, le producteur, dans un festival de producteurs en Italie où nos films étaient projetés. Moi j’y étais avec Sadoum et lui avec une de ses productions dont le réalisateur n’était pas présent, donc c’est lui qui le représentait. Ça c’était génial, Parce que Sadoum, il peut attirer des spectateurs mais pas forcément un producteur. Il a adoré ce film. Il m’a dit « Mais comment tu as fait ? » Je lui ai expliqué. J’ai pris le risque d’expliquer ma démarche à un producteur qui normalement dit « Non, on aime pas ça. Il faut que ce soit gros et grand au cinéma ». Lui, il a plutôt apprécié cette démarche, la sincérité de ma manière de travailler. Il me dit « Écoute, le prochain c’est moi ! ». Le hasard qui a aussi aidé, c’est qu’on habitait dans le même quartier, à Denfert, dans le 14ème. Après, on se voyait souvent. C’était assez sympathique, une relation magnifique jusqu’au tournage où… rupture totale ! (rires) Vu qu’il était belge, il m’a proposé d’aller tourner en Belgique. J’ai accepté immédiatement et on a commencé. Là, on avait une équipe de repéreurs professionnels qui nous ont suggéré quelques lieux selon les souhaits que j’avais : la carrière de pierres bleues, les terrains vagues, le lac, et c’était magnifique.
Il y a le très beau pont…
Le pont ! Ça c’est magnifique aussi, ce sont des découvertes et j’ai pris aussi un immense plaisir à faire ce film avec une caméra différente. On a arrêté la DSLR, l’appareil photo, parce que c’était produit, donc il y avait un peu plus de moyens. C’était une caméra RED Dragon, là on est dans le format 6K professionnel. On a tourné avec la même équipe réduite de cinq techniciens mais l’équipement était vraiment plus conséquent. C’est le tournage le plus difficile que j’aie fait de toute ma carrière jusqu’à présent, le plus compliqué, le plus tendu. Ultravokal, c’est vraiment un tournage rude. Mais j’aime ce film, parce qu’après parfois, j’aime un peu moins. Je ne suis jamais satisfait à 100 %. Mais j’ai de l’affection pour Ultravokal et je ne suis pas mécontent du résultat, surtout si je compare avec comment s’est passé ce tournage très compliqué et difficile.
Qu’est-ce qui a été si difficile et sur quoi étiez-vous en désaccord ?
Difficile sur plusieurs plans. Déjà technique et pratique. Le choix de filmer en RED, c’était un choix du producteur et du chef opérateur. Moi je ne suis pas intervenu mais j’ai dit « OK, mais attention les gars parce que vu la façon dont je conçois mes films et mes plans, surtout en neuf jours de tournage, ça peut être un handicap ». J’étais conscient de la difficulté de ce choix mais aussi enthousiaste à l’idée qu’on aille tourner avec une caméra beaucoup plus grande, avec une qualité meilleure. On s’en fout mais quand même… Là, il y avait des rails avec de vrais travellings, de vrais éclairages, des HMI. C’était vraiment un bon équipement avec des objectifs Zeiss qui donnent une optique de grande qualité pour les focales. Mais l’erreur, c’est que le producteur s’est basé sur comment moi je fais. Le nombre… Deux techniciens à l’image, le même jour de tournage mais avec un équipement qui nécessite au moins une dizaine de personnes. Donc il y avait une grosse fatigue, jour après jour, avec des plans séquences très compliqués que j’avais en tête. La tension montait. Deuxième aspect, les relations avec les acteurs, et surtout avec Angelo Aybar, celui qui joue L’institoris. À un moment donné, c’était tendu entre nous. Troisième cause, assez classique, la météo, surtout par rapport à comment on était équipés et comme c’était une petite équipe il fallait transporter les caisses.… C’est quand même un facteur supplémentaire. Et surtout, ce qui s’est produit vers la fin, pendant la scène finale, c’est à dire le face à face ou la tuerie finale, quand il le tue et le viole. Encore une fois, en face de moi qui ai l’habitude d’une certaine liberté et des accidents qui peuvent surgir et me font modifier ma mise en scène par rapport à cet aléa, le producteur lui, était un peu plus carré. Au départ, Institoris était censé rentrer dans le champ par la voiture. Il arrive, il descend, fait la même action. Bref, on a fait la première prise et je n’étais pas content. Je voulais faire la deuxième mais en reculant, la voiture est tombée dans une petite vallée. Heureusement lui n’a rien eu mais pour la voiture, il fallait appeler un dépanneur. Là, Vincent le producteur, a pété un plomb. Il a paniqué, eu peur. Il a flippé et a voulu carrément arrêter le tournage, ce que moi j’ai refusé. Et là pour une question d’ego parce que disais, « Non, on va tourner !» – il n’était pas possible de récupérer la voiture – On était un peu plus bas, j’ai fait demi-tour et je suis remonté. Et le fait que les techniciens et les acteurs m’aient suivi, il s’est retrouvé seul et l’a mal pris. Il y a un peu d’ego, un peu de divergence. Et on a continué et voilà une cause supplémentaire pour rendre ce tournage encore plus difficile et encore plus tendu au plan relationnel. Après, il est resté là-dessus, il a détesté le film. Il a complètement dénigré le montage, fait pression pour que ce soit monté par une monteuse issue de la FEMIS, en tout cas d’un certain milieu bourgeois bobo parisien et que moi je ne voulais pas. J’ai insisté pour qu’on ne change pas ma vision. J’ai donc gardé le final cut mais le prix, c’est qu’on s’est fâché avec le prod.

Tournage d’Ultravokal -Droits réservés
Revenons au film proprement dit. Je pense que tu avais raison car moi je trouve Ultravokal très réussi. Justement parce que le genre s’affirme plus encore que le survival dans le précédent, ici c’est le polar mélancolique, le film de traque. La narration est presque classique avec un montage parallèle entre le protagoniste et Institoris.
Un procédé classique, des personnages stéréotypés ; Simple ! Mais s’il y a une singularité, c’est dans la forme, la façon de représenter les choses, même si je me suis basé sur quelques clichés du western, mais en les modernisant : la fille du saloon, le mec avec son colt. Au lieu d’un cheval, il une grosse bagnole et le déserteur qui fuit. C’est du déjà vu. c’est une narration continue, elle n’est pas heurtée, fragmentaire mais il y a une originalité dans les plans, dans l’image, dans quelques plans pause, dans le rapport son-image, le hors champ, le décalage. Par exemple, la scène quand ils dansent tous les deux à l’intérieur du bar, le fait qu’avant ils parlent mais qu’on ne les entend pas et le son de ce dialogue là vient après. Donc c’est original dans la forme, mais en effet le contenu est classique.
Le plan de boxe en dit assez long sur l’énergie du film. Sur les acteurs toujours vus comme des corps qui performent…
Le prologue de la tête du cochon est suivi par le titre et il y a le coup de poing, direct comme si je donnais un coup au spectateur, et ça renvoie à l’ouverture de Dodgem avec le lance-pierres et qui lançait dans la face du spectateur.
Institoris ça a à voir avec Instinct ?
Évidemment, c’est une allégorie. C’est le nom d’un des inquisiteurs du Moyen-Âge français, un des théoriciens de l’Inquisition.
Moi je croyais que c’était parce qu’il flairait leurs traces.
Non, non ! (rire)
Il y a presque un petit côté Twin Peaks dans les indices cherchés dans un catalogue de toiles de maître. La culture s’oppose alors à la nature.
Je n’y avais pas pensé. Pourquoi pas ? Avec la loupe.
La marche du tueur dans la forêt a aussi un fort côté Nosferatu, dans la version d’Herzog. Il y a un côté romantique, noir. Ce qui est drôle, c’est que ce tueur polymorphe est aussi un artiste.
Ce n’était pas dans le scénario mais là c’est une inspiration directe. C’est venu avant le tournage, pendant les répétitions parce qu‘Angelo Aybar est aussi peintre. Parce que je demande souvent aux acteurs de me proposer aussi des choses et je vois si je valide ou pas selon les propositions. Là ça m’intéressait et je voyais que ça lui faisait plaisir. Il n’avait pas besoin de directives là et je l’ai laissé libre de s’exprimer en tant que peintre devant la caméra. Sinon tu as évoqué le film noir et c’était une source d’inspiration pour Aurelian et moi d’aller vers le film noir, par exemple avec l’abat-jour, le côté contrasté, etc.
Vortex est à nouveau un prolongement des précédents : des visions meurtrières et des commandos d’homme, un tueur par ennui, un suicide… La spécificité du film depuis au moins Lamia c’est de mettre à l’honneur un personnage féminin fort et celui de Vortex est particulièrement fort et lumineux.
Là, j’ai travaillé en proximité avec Claudia Fortunato et le défi, c’était que c’était la même actrice qu’Ultravokal mais elle était un peu plus jeune, avec une coiffure différente aussi, brune et un côté un peu enfantin. Après ce film, elle a pris beaucoup de maturité. Elle voulait absolument faire Vortex. J’ai dit « OK, je te prends mais il faut que ce soit différent et pas que par la couleur des cheveux ». Et vraiment, j’ai senti et même elle le dit, que j’étais passé entre les deux films, de la fille à l’adulte. De ses 23 à ses 24 ans, elle a grandi et elle a senti en elle cette maturité à la fois en tant que femme et actrice. Je voulais saisir ce moment là, très personnel, intime, corporel de sa vie dans Vortex et je pense que c’est présent. La sorcière, c’est pour mettre une sorcière face à un tueur vampire. Claudia a aussi beaucoup participé aux idées du film, évidemment avec May Kassem, ma coscénariste. Par exemple, au départ, moi je voulais qu’elle ressuscite les morts par une matière organique, la pisse. Elle devait faire pipi sur les cadavres et hop, ils se réveillent. Ça vient d’elle, parce qu’on était au festival du Western pour présenter Ultravokal et on a beaucoup échangé entre nous, Claudia et moi, et elle m’a dit qu’elle avait une copine qui mettait le sang de ses menstruations sur les plantes. Pour elle, ça leur donne de la vie, c’est un truc spirituel… Ça m’a donc donné cette idée de remplacer l’idée principale et que ça devienne une partie du film.

Tournage de Vortex -Droits réservés
Le film est structuré en trois chapitres, le premier directement enfanté par le conflit libanais. À nouveau l’abandon et l’inceste. Y a-t-il beaucoup de figures parentales libanaises qui échappent à cet héritage de la guerre civile ?
Il faut leur demander, moi je ne sais pas. Je parle de mon expérience personnelle, de ce qui se passe dans ma tête. Certes, il y a un trauma. Le plus dur, c’est d’être directement touché par ça en tant qu’orphelin de guerre dès l’âge d’un an, parce que ça a touché directement mon corps… Ça a chamboulé ma vie. Parce que si tu veux, quand je parle à des amis, à l’entourage, ma génération, certes on a vécu la même chose : la guerre en général, les mêmes écoles, les mêmes peurs comme se cacher dans les abris etc. Mais j’ai ce quelque chose de plus par mon histoire personnelle qui me différencie en général et d’eux en particulier. Effectivement, il y a d’autres histoires. Mais c’est ce plus qui fait que la guerre est encore plus présente dans ma tête que chez d’autres personnes.
Avec ce couple parental, on a l’impression que leurs corps sont comme dilatés, plus alourdis encore et fatigués. Ça vient pour beaucoup de ta manière de les filmer. Le plan du champ avec Nabil raccorde pour moi avec un plan très important du dernier film de la filmographie de Jean Rollin, que je crois tu apprécies…
Ah oui !
…Dans la scène du Masque de la méduse (2010) où il dit qu’il ne peut pas mourir parce qu’il est prisonnier de la vision que sa femme a de lui. Il l’a ici nommée Médusa. Il lui coupe la tête et va l’enterrer dans un champ afin de pouvoir mourir. Et ce champ ressemble très fortement à celui-là.
(intéressé) Je ne connais pas ce film.
C’est un plan que j’adore et je trouve ça très beau de parler ainsi de son épouse qui l’a soutenu toute sa carrière, qui a été la seule a toujours avoir cru en lui pendant toutes ces années. De parler comme cela de leur rapport intime, ça m’a vraiment touché. Là ça raccorde avec le surréalisme belge, comme un paysage mental. Après ton expérience belge, est-ce qu’ici les paysages agricoles du Nord t’ont aussi inspiré cette scène avec Nabil?
Ce film est plutôt tourné en Bretagne. Il y a en effet une influence de l’espace et c’est fait presque sans repérages. J’avais repéré quelques endroits mais pas tous. Pour Vortex, le repérage se fait pour quelques scènes pendant le tournage. Et là ça rejoint ce que tu disais, d’ailleurs tu as fait toi-même la remarque pour Venus Obscura, de mettre de la cruauté dans un joli espace, de la terreur dans la beauté. On en revient à ce projet baudelairien bien avant moi.
Le texte est encore plus provocateur que d’habitude. Je me suis d’ailleurs demandé si tu te mettais dans un état particulier pour écrire ton texte?
Là non, il n’y a pas d’état particulier. Il y a des gens qui croient que je me shoote ou que je bois… (rire)
Que tu te cognes la tête contre les murs…
(rires) Le mec est taré ! Non je n’ai pas besoin de ça, même pour mes autres films. Les idées les plus folles, les plus délirantes, les plus cruelles que je puisse avoir me viennent comme ça. Après forcément, il y a des lectures, des inspirations. Là par exemple, il y a beaucoup de Cioran qui a été une base pour ce texte là. Pas d’état particulier mais par contre, je travaille beaucoup les nuits, donc l’ambiance nocturne peut donner des choses. Quand on arrive à une certaine fatigue, on ne se couche pas mais vers cinq heures du matin, on est encore éveillé. Là il y a quelque chose d’intéressant qu’on peut ne pas avoir en plein jour.
Les thèmes fantastiques (vampires, morts-vivants) préfigurent déjà Zaman dark. Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui le fantastique te paraît plus approprié pour rendre ton discours plus subversif ? Tu regardes plus de films de genre ou pas forcément ? Est-ce le réel qui tourne en rond et le genre te permet d’échapper à l’enlisement ?
Non, le cinéma fantastique est pour moi une découverte récente, même si je regardais des films d’horreur etc. Mais le fantastique avec toutes ses variantes et sous-genres. Le giallo et compagnie. Ça m’intéressait comme je le disais quand nous parlions de Zaman dark parce que je vois une ouverture vers quelque chose de libre, une expérimentation formelle, un imaginaire que le réel bloque quelque fois, notamment dans les drames et le cinéma d’auteur naturaliste. Des fois, on a des barrières, une éthique, on n’a pas le droit de montrer etc. J’aime le côté prise de risques du cinéma fantastique. Par contre, je n’aime pas les films dits de genre conventionnels, voir la même chose standardisée et conformiste, alors là non. Et il y en a plein. Quand je fais des festivals, je fais les autres sélections et c’est insupportable. Là, je ne me reconnais pas dans le cinéma dit de genre. Et c’est comme à l’époque de l’expérimental où les gens de fiction disaient, « ça c’est de l’expérimental, pas de la fiction » et les cinéastes expérimentaux me disaient « Non c’est de la fiction, c’est très narratif». Ou même le documentaire : des fois, j’ai montré mes films dans des festivals. La plupart étaient rejetés. Je parle des spectateurs qui me disaient « Non, ça ce n’est pas du documentaire, c’est de l’expérimental ! » Et là dans les sélections des films fantastiques puisque j’en fais beaucoup, à part les programmateurs qui m’ont sélectionné, les spectateurs et les critiques me regardent avec des grands yeux vides et énervés « Mais ce n’est pas du cinéma de genre ! » Ils sont même choqués. « Comment ça se fait que tu sois là ? » (rire) Encore une fois, c‘est une série, comme j’ai fait ma série de cinéma « d’errance/ drame » etc. Après, il y a eu ma série road movie. Pour ma série « Cinéma fantastique », je pense qu’à un moment donné je vais prendre ce qui m’intéresse pour aller vers autre chose et c’est comme ça j’explore de nouveaux chantiers. En fait, je n’aime pas les étiquettes.

Tournage de Vortex -Droits réservés
Ultravokal était d’une couleur bucolique, ici le bleu sombre domine, jusqu’à repeindre la côte bretonne ensoleillée. Quelle valeur accordes-tu au bleu ? Ça te connecte à ces moments où tu écris à cinq heures du mat ?
Peut-être. Comme tu l’as remarqué et ça ce n’est pas du truquage, ni de l’étalonnage même si c’est un peu appuyé après, ni même des filtres, on a vraiment beaucoup tourné au lever du jour, vers cinq heures, six heures du matin et je dénaturais un peu la texture de l’image en mettant un collant, un bas sur l’objectif, ce qui donnait un peu le côté brume et brouillard, qui granulait un peu plus l’image. Pour moi et en général, les moments vraiment les plus saisissant au cinéma, ce sont le lever et le coucher, ces dix minutes du réveil du bleu matinal et ces dix minutes du coucher entre le crépuscule qui devient bleu sombre, puis mauve, puis un peu vert, ce qu’on appelle le « chien et loup », ça se sont des moments qui nous dépassent parce que ce n’est pas quelque chose qu’on a créé artificiellement. C’est la nature qui est là, dix minutes, il faut saisir ces instants là. Ça crée une tension, une dynamique, un enthousiasme, une beauté et il faut faire quelque chose avec. Ce sont des instants que j’aime beaucoup.
On dit « Nous vivons tous entre vivants qui s’ignorent ». Mais ne crois-tu pas que depuis grosso modo 2019, nous vivrions plutôt en France entre victimes qui s’ignorent, même si nous reportons la violence subie sur nos congénères ?
(rires) Wow ! Mais oui ! Carrément même… Mais bon, ça c’était avant le COVID Quoi qu’il y a des gens qui y ont vu comme une sorte d’anticipation. Dans un autre passage, le personnage féminin dit « Tu veux pas t’échapper de la ville ? Parce qu’on va t’enfermer dans une cage ». Là, ils ont vu un côté confinement alors que ça n’évoque pas ça du tout. Mais en effet, il y a un avant et un après le COVID. Mais dans tout ! En tout cas, cinématographiquement, nous sommes bien impactés. Et plus on est indépendants, plus on est impactés par la vie post COVID, c’est certain.
Les personnages disent le contraire du film : détruire la propension de l’être humain à croire quand le cinéma lui ne fait que recréer indéfiniment le monde.
(dubitatif) Ouais… Tu montes le niveau philosophique ?
C’est assez marrant que finalement tous tes personnages soient si nihilistes quand tes films sont extrêmement créatifs.
Oui, mais c’est le propre de la création, qui donne la vie, l’espoir. Par définition, à défaut, on peut dire ça comme ça. Après, le nihilisme fait partie de ma vision du monde.
Dans la seconde partie, la minéralité de la côte bretonne succède aux silhouettes grotesques et âgées des parents. Ce chapitre exulte la vie. As-tu eu des réactions de spectatrices aux scènes les plus sexuelles et voyeuristes ? La scène onaniste à la japonaise… On a en permanence l’impression qu’elle va tomber, il y a cet espèce d’arbre… Des réactions positives ou négatives ?
C’est en oblique. Positives oui, négatives, beaucoup. Beaucoup plus que positives. Pas que de la part des femmes, même des hommes. Dans l’ensemble, Vortex a plus déplu que plu. Peut-être pas aux festivaliers parce que je pense que c’est un des films qui a le plus fait de festivals, quantitativement et même dans les prix gagnés. Mais chez les spectateurs, ça a créé des divisions. En fait, c’est le film qui a le plus divisé après Too much love will kill you et sans doute par rapport à la représentation du sexe. J’étais même rangé dans la catégorie « Public averti » du festival porno de Vienne. Tu imagines ? Et ce, alors qu’il y a avait des films trashes et vraiment pornographiques ! Ça passait mieux que mon film qui n’est pas du porno, mais la représentation du sexe les dérangeait d’avantage que dans les films pornographiques. (rire) J’ai halluciné quand même ! Il y a même des gens qui ont quitté la salle. Quelques bourgeoises autrichiennes qui faisaient comme ça (il mime) « Non, non, NON !!! » (rire sadique) Aux États-Unis, ça a cré un choc… Bon ! Mais ça a divisé parce qu’il y a aussi des gens qui ont aimé.
Est-ce que ça serait lié aux tabous ? Aux États-Unis, tout ce qui est organique est généralement tabou… Un critique américain disait d’ailleurs que c’était sans doute film où on voyait le plus de sang menstruel. (rire)
Oui, ça c’était au festival de Buffalo.
Je pense que c’est sans doute vrai.
Oui, sans doute. Ils étaient un peu sous le choc… Forcément. Parce qu’au niveau de la représentation sexuelle, du vagin, je pense que j’ai exagéré. Elle a toujours la main entre ses jambes. Mais justement, j’ai montré qu’il y a un tabou dans plusieurs pays, une difficulté à parler de ça, en plus de cette façon, alors que c’est une belle idée. Parce que ce que je dis, c’est que ça donne la vie. Ça ressuscite les morts, donc c’est plutôt quelque chose de positif. Mais ça dérange encore.
Complètement. Alors tu m’avais dit que Claudia Fortunato avait même dépassé ta demande et même fait des propositions de jeu plus extrêmes encore que ce qui était prévu dans le scénario. Peux-tu revenir là-dessus ?
D’abord, par rapport à ce que je disais de cette sorcière qui utilise ses menstruations. Mais il y a aussi une scène… Au départ, c’était la fin du film et après j’ai changé d’avis sur le moment. Au tournage, j’ai dit : « OK, je la filme, je la mets dans le montage mais ça ne sera pas le plan final. Je vais faire une autre scène et terminer le film différemment. C’est le plan où elle prend le revolver et où elle le met dans son vagin et elle tire. C’est une proposition qui vient carrément de sa part. J’étais excité par l’idée et j’ai dit « Allez ! On va la faire ! » Elle, après, elle a regretté. « Ah, il ne fallait pas filmer cette scène… » Moi, je l’ai filmée. Je voulais terminer le film par un suicide mais tout de suite, j’ai pris conscience que non, ce n’est pas la bonne fin du film et on a inventé le cannibalisme sur le tournage, le fait qu’elle aie toujours envie et qu’elle le mange plutôt.
Le mégalithe que tu as choisi pour une des affiches du film évoque ici plus un symbole phallique que le monolithe de la connaissance de 2001…
Oui, sans doute. Le fait qu’on a positionné la caméra face à un soleil couchant etc. peut y faire directement référence, mais là, la symbolique est plutôt dans la cohérence du film qui était sexuelle.

Tournage de Vortex en Bretagne -Droits réservés
Si les chaos rocheux sont comme des amas de traumas du passé, elle incarne la pulsion vitaliste, la résilience. Mais si elle peut nourrir l’homme de ses menstruations, elle ne peut pas lui transmettre le goût de vivre.
Oui c’est ça.
Donc la magie a ses limites.
Encore une fois, par cette idée récurrente qu’on retrouve toujours dans mon cinéma : la fatalité. Quand elle s’impose par la cruauté, et bien c’est notre destin. On ne peut rien faire et c’est comme ça. On ne peut pas agir, on est impuissants face à ça. C’est une des idées qui reviennent dans mes films.
Tu cites Debord et la révolution iranienne, de façon très ironique. Ça me fait penser à quelques lignes de l’Internationale Situationniste au début des années 60 : « Il ne s’agit pas de mettre la poésie au service de la révolution, mais bien de mettre la révolution au service de la poésie. C’est seulement ainsi que la révolution ne trahit pas son propre projet ».
J’y adhère et je prends ! Je cautionne cette citation à 100 %. L’idée, c’est qu’il échappe à la ville. Comment être original et ne pas aller filmer un plan de la ville qui a déjà été fait ? Vu que je viens un peu de cette école debordienne parce que je l’ai étudié quand j’étais à la Faculté, en tout cas j’ai fait mon mémoire sur Debord ou plutôt une partie, en relation avec le Lettrisme. Donc la négation dans le cinéma d’avant-garde, le Lettrisme et le Situationnisme. Donc je connaissais ce cinéma là et alors je me suis dit « Tiens… Je vais faire une référence très brève à Guy Debord en prenant un photogramme fixe, qui est déjà une image fixe dans son film In girum imus nocte et consumimur igni (1978). Voilà pour la référence mais j’adore la phrase que tu cites.
Mais quel est ton rapport au situationnisme en général ?
Maintenant, c’est la part révolutionnaire dans le quotidien, être toujours dans un quotidien révolutionnaire. Je pense que depuis, j’ai pris un chemin… Mais ce qui me reste c’est ce que je viens de dire et c’est très beau. Être révolutionnaire même dans les plus simples gestes, c’est une idée situationniste. Utopique ! Parce qu’eux-mêmes étaient utopiques. Ça ne s’est pas réalisé.
Tu disais dans l’interview radio à Without your heads que le scénario de départ était de deux pages et que le projet s’était encore une fois développé comme un work in progress entre Paris et Beyrouth du à votre éloignement avec May Kassem. Mais tu disais que pour Vortex ta vision était claire et pour toi le montage était déjà fait dans ta tête avant même le tournage. Quelles surprises t’a alors apporté le tournage ?
Laisse-moi me souvenir… Ah ! OK, oui ça y est. Déjà, la composition générale de Vortex était conçue à l’avance, la structure en trois parties : l’homme, la femme, la rencontre. Ça, c’était une idée de départ que j’avais conservée jusqu’au montage. Après, à l’intérieur, il y a des choses nouvelles au fur et à mesure de la progression du processus, du tournage et du montage, comme d’habitude. Un des accidents, c’était la scène où le tueur vampire au moment de son devenir vampire coupait ses cheveux avec un sécateur et il s’est coupé le doigt mais vraiment. D’ailleurs, le sang que tu vois était son vrai sang, c’était pas du maquillage. Moi j’ai vu qu’il n’y avait pas mort d’homme, qu’il continuait, que ce n’était pas si grave que ça malgré – quand même – la coupure du doigt. Il n’a pas arrêté, je n’ai pas arrêté la caméra. Là, c’est la cruauté du metteur en scène qui va jusqu’au bout pour terminer son plan. Ça a choqué l’assistante réalisation, qui était une amie qui nous aidait aussi pour la régie et depuis, elle refuse de me voir. Parce qu’elle a considéré qu’il fallait couper, qu’il fallait l’amener tout de suite à l’hôpital et après seulement, continuer, alors que j’ai continué et que nous l’avons amené à la pharmacie une fois le plan fini et on l’a soigné. Voilà un choix qui se fait sur le moment. Mais je pense que s’il avait arrêté, j’aurais coupé la caméra, mais j’ai vu qu’il était à fond dans sa métamorphose. Voilà un accident qui nous a donné du vrai sang et une scène réaliste, (rire) malgré un choix cruel, mais ça c’est un jugement moral. Ça nous ramène à Buñuel quand dans Las Hurdes, il a fusillé la chèvre pour qu’elle tombe, parce qu’ils ont attendu, attendu… À un moment donné, « On va pas attendre une semaine » donc il a fusillé la chèvre. Alors qu’aujourd’hui, tu fais ça, tu t’arrêtes tout de suite. Ce n’est plus possible de nos jours. Je peux concevoir que la morale change selon l’époque. Ça c’était une des choses imprévues, quelques points de suture au final mais vue la quantité de sang, tu te dis « Il y a eu un massacre ! »
C’est un peu ton côté Herzog ! (rires) Le film est primé dans un grand nombre de pays et continents. Ce qui est étonnant, c’est que tu révèles autant les festivals qu’ils te révèlent. Tu trouves toujours des lieux improbables, exotiques et dans des pays incroyables et c’est très intéressant. La liste semble infinie…
… Oui, il y a de tout parce que je ne me limite pas à une certaine perception qualitative du monde professionnel. Les gens, s’ils ne font pas Cannes, Venise, Berlin, Locarno, Sundance à la limite, tout le reste n’existe pas. Non, sinon on ne fait plus rien et on n’existe plus. Moi j’envoie. Après il y a des propositions où ce sont eux qui invitent, qui prennent le film sans que je candidate. Donc il y a les deux et pourquoi pas après tout ? J’aime bien aussi, surtout les festivals débutants. Dans les festivals naissants, indépendants ou pas connus – peu importe leur place dans le monde -, il y a une certaine fraîcheur, une certaine liberté qu’on ne trouve pas dans les festivals plus établis alors qu’ils en sont à leur 25ème édition ou 34ème machin, même si j’ai été sélectionné bien sûr dans des festivals reconnus mondialement tels que le BIFAN en Corée du sud, le « Cinéma Vérité » en Iran, le Dracula en Roumanie, le festival du Western d’Almeria ou encore le Ravenna Nightmare en Italie. Donc les programmateurs dans les événements indé sont encore frais et ils vont vraiment aller à la découverte des films vraiment singuliers, ce qui est une des missions principales des festivals.
En théorie, oui.
Après, il y a des festivals à d’autres degrés et plus leur rapport est étroit avec l’industrie, les exploitants et les acheteurs et c’est là où c’est malheureusement plus compliqué.
Ensuite, tu tournes un court qui s’appelle Dream politik-19…
C’est un film de confinement.

Dream politik-19 -Capture d’écran
Oui voilà, mais qui nous ramène un peu à l’époque de Luttes, comme si une couche recouvrait l’autre, avec ici le contexte des luttes au Liban. Je ne sais pas si tu as vu Nos défaites de Jean-Gabriel Périot…
Non.
Ce film où il dit que finalement le processus des luttes est plus important que leur résultat.
C’est intéressant. Après ici, outre que c’est un film de confinement, de montage, je renoue un peu avec la pratique expérimentale du found footage, du montage soviétique eisensteinien… À la fois un recyclage de mes vieux films, que ce soient des rushes ou des plans inutilisés, et un peu de filmage avec un téléphone portable de mon quartier pendant le confinement. Je me suis dit « Voilà : je vais passer de la pseudo révolution libanaise -parce que malheureusement la révolution libanaise a pris un triste détour et récupérée par la politique – jusqu’au confinement dont c’était la période. Je me suis vraiment amusé à faire ce film en quelques jours. C’est vraiment un film de confinement comme parenthèse. (rire)
Comme tu recyclais des plans de tes films précédents, je me suis demandé quel ratio tu as de plans non utilisés, que tu as tourné mais que finalement tu ne gardes pas au montage ?
Écoute, moi j’adore ces moments là parce que justement il y a toujours quelque chose à faire, au-delà de l’envie de remonter mes films. Ça c’est sûr et peut-être qu’un jour je le ferai. À présent, je mets cette barrière « Non je ne le toucherai pas », même si j’ai envie de tout remonter. Ces plans là, tournés mais non montés, sont pour moi des bijoux, surtout au montage, parce que l’imaginaire et la création y sont illimitées. On trouve toujours un sens par la juxtaposition et l’assemblage de deux plans, même si ce sont deux plans très éloignés, c’est justement l’école d’Eisenstein. Je n’arrête pas de les découvrir et de les redécouvrir. Récemment, j’ai fait le film expérimental que je pense être le plus abouti où j’ai justement récupéré des images inutilisées de mes autres films. Chaque fois je pense que c’est fini, mais à chaque fois je découvre des choses nouvelles et j’ai fait ce film en tournant autour de la tempête, parce qu’il y a eu une tempête au Liban au mois de janvier, donc j’ai filmé la tempête et l’ai montée avec ces images là. Ça a donné ce que j’ai appelé Zombie cortex. Je pense que c’est le film expérimental le plus abouti, de 39 minutes 40.
Pour ce qui est tourné et gardé, est-ce que tu regardes assez souvent tes films ou il t’arrive de ne pas les revoir pendant de longues périodes ?
Je ne les regarde jamais. C’est à dire que je les regarde au début, une dizaine de fois, puis après c’est fini. Si c’est le premier festival, d’accord, parce que je le découvre sur grand écran, mais par exemple pour la sortie récente de Zaman Dark à Paris, je n’ai pas vu le film en salle malgré ses plusieurs séances. Je reste dehors et après je parle aux gens. Parce qu’encore une fois, ça me donnerait envie de les remonter ! Et j’évite de regarder parce que je dis « Ah non ! Ça je dois le mettre ici, ça… »
Donc si tu les revoyais dix ans plus tard, le choc ferait que tu pourrais les désavouer ?
Je ne sais pas si je vais quand même les renier. (rire)
J’ai vu que pour Dream politik 19, tu avais justement utilisé des images de Jean Rollin, de Romero, de John Woo, des choses très diverses. De Pasolini, de Psychose…
De Fritz Lang, M le maudit. Ben, ça c’est la folie du confinement, cette circulation libre des images et des plans pour un sens précis. C’est un peu mon ego : j’étais très content de découvrir que, sans le vouloir ou alors inconsciemment, j’ai le même axe que le film L’abattoir d’Eisenstein. Lui il a filmé une vache ou un veau dans un abattoir, en train d’être découpé, si c’est en couleur et en super 8, j’ai carrément le même axe vu que c’est un corps, le même plan, dans mon film Fragments d’une vie anéantie, que j’ai justement repris dans Dream politik 19 en mettant un split screen en parallèle dans le même plan. Donc là c’est un peu ma fierté cette correspondance avec Eisenstein. Je me suis vraiment amusé à faire ce film, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça film. Il a été projeté un tout petit peu, dans des festivals même « on line ».
On en arrive à Kamaloca qui est un de mes films préférés. Mais c’est un de ceux qui ont été le moins vus non ? Dû aux circonstances…
Oui, il n’a pas été distribué au cinéma.
Est-ce que c’est un film qui pourrait ressortir plus tard ?
Ça je ne sais pas. En tout cas, le distributeur n’était pas motivé car, même s’il est indépendant, un petit distributeur, il a toujours ses petits calculs. Forcément. Moi j’ai essayé de le faire passer avant Zaman Dark : « Une petite sortie… – Non, ça date de 2020-2021, nous sommes en 2024… » C’est fini, c’est terminé. Un jour, il sortira peut-être en bonus DVD comme les films maudits, cultes. (rire)

Kamaloca -Droits réservés
Et bien je l’espère, parce que le film a plein d’aspects intéressants. Il y a un côté choc social, des images assez hallucinantes au plan esthétique, une ambiance très forte du côté du cinéma de genre aussi. Le couple hanté avec la femme enfermée et là on n’est pas loin du film de fantômes japonais. Il y a dans Kamaloca plein de trucs assez extrêmes. Il y a aussi des images que tu as utilisé de façon plus documentaires dans Kalashnikov society, sur l’explosion du port de Beyrouth. Ici, ça explose vraiment dans tous les sens. Revenons d’abord sur cet épisode : psychologiquement, qu’est-ce que ça t’a fait l’explosion du port de Beyrouth ?
C’est un choc… Mais à part le côté émotionnel, c’est le hasard de la destinée, le rapport que j’ai au pays et à mon cinéma, les ruines l’explosion et tout ça. Comme je l’ai déjà dit, après la mort de mon oncle, je suis resté à Paris pas mal d’années. Ça a donné la série de films français. Le moment où je décide de rentrer s’est retrouvé être le lendemain de l’explosion, le 5 mai. Mon billet était déjà réservé. Il y a eu l’explosion le 4. Le vol n’était pas annulé. À 8 heures du matin puisque c’était un vol de nuit, j’étais au Liban devant cette explosion, cette fumée et ces ruines. Ce retour au pays est pour moi symbolique (rire) : encore une explosion, toujours des ruines. J’ai tout de suite filmé, pas dans l’idée de faire un film mais j’avais mon portable et j’ai commencé à filmer. Ça a donné Kalashnikov society et puis après ou plutôt, tout d’abord Kamaloca et après j’ai construit Kalashnikov society. Les deux films sont tournés avec mon portable. c’est symbolique choc mais aussi toujours cette destinée, d’être dans les ruines, même si je ne veux pas et que je me dis « je dois filmer autre chose ! », le réel me récupère. (rire)
Et est-ce cette proximité avec les choses qui a fait que tu as choisi de filmer tout le film avec ton téléphone ? Parce que tu aurais pu opter pour une caméra…
Ah carrément ! C’est venu parce que j’avais une base d’images. j’aurais aussi pu mettre une autre caméra et jouer le décalage parce que comme tu le sais j’avais déjà fait des plans hétérogènes, des films hétéroclites. Je n’ai donc pas peur de l’hybridité des images. C’était donc pour moi une continuité. Et il y a aussi à chaque période un manifeste guérilla qui vient. Tous mes films sont guérilla et petite équipe, mais des fois, après cinq films, je décide de faire un film tout seul. C’est le cas de Kamaloca comme pour Sadoum. Le générique est en fait un faux générique. Fake news ! C’est à dire que tous les noms sont inventés, j’étais seul. Pour le chef opérateur, j’ai donné un nom portugais, c’est mon pseudo ! J’ai fait moi-même la lumière. Pedro je sais pas quoi (Perreira Gonzo!!!), c’est moi en fait…
Je me suis fait avoir… (rires) Je ne sais pas si tu as remarqué mais il y a presque un parallèle avec le Nocturama de Bonello avec tous ces personnages qui se rendent à un endroit…
Bravo ! Ah tu captes les choses, c’est bien.
Je viens d’y penser maintenant, ça ne m’avait pas interpellé avant.
Absolument ! Je suis grillé là…
Mais je ne suis pas fan de Nocturama par contre…
Ah mais moi, c’est juste le début, quand ils marchent chacun de leur côté, c’était une base pour démarrer le film. Je n’ai pas aimé comment il a terminé, mais ça c’est autre chose.
Tu veux dire, l’assaut final filmé au ralenti ?
Oui, je n’étais pas fan de la fin de Nocturama.
(rire) Moi non plus, ça c’est clair ! C’est la fin le plus problématique.
C’est ça.
Le rapport à Hakim Bey, c’est lorsqu’il décrit un certain nombre de communautés isolées, comme celle qui est en train de préparer un attentat ?
Aux hackers surtout, au piratage. Suite à l’époque , c’est à dire de nos jours et à l’expérience de la révolution libanaise, c’était l’impossibilité d’accomplir une révolution et j’ai mis une sorte de bande, un peu des bobos révolutionnaires, des hackers mais finalement ils ne foutent rien et le projet n’est pas abouti. C’est aussi de leur faute. Cette accusation vient de ma propre expérience déçue de la révolution libanaise et de l’époque post COVID européenne, en tout cas en France car j’étais bloqué à Paris. Il y avait comme ça un sentiment de « On veut être libres et se libérer malgré tout ». J’entends bien la gravité de la situation mais je ne pense pas au côté solidaire, je pense au côté politique. Du coup cette idée d’un échec, d’une révolution qui ne passe pas et ils sont rattrapés par les deux flics méchants qui les massacrent.
Finalement, il y a de l’espoir dans le film. Là aussi, c’est une fin plutôt positive, même si je l’ai suspendue. On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé à la fin, mais on peut y deviner qu’ils n’ont pas pu choper la plus sauvage, la fille qui se transforme en bête, en louve et il y a ce face à face à la fin même, si elle est hors champ et que je coupe carrément le film, où on peut supposer qu’elle saute sur eux et qu’elle va les bouffer ou bien ils la tuent. Peu importe mais c’est une fin ouverte.

Kamaloca -Droits réservés
Il y a ici un côté industriel dans la continuité d’Ultravokal mais en plus prononcé et ce à cause des lieux, du côté sombre…
Carrément mais qu’on voit déjà dans mes films libanais et même documentaires. Dans Beirut Kamikaze, on ne voit que ça. Tout ce qu’on appelle à Beyrouth la quarantaine, un lieu industriel où on voit les abattoirs, la déchetterie etc. Ou dans Sadoum où on voit toujours la fumée de la gare qui sort en arrière plan au fond du champ. C’est plus affirmé ici comme si le danger venait de ça, la contamination. Il y a un côté inquiétant que je voulais rendre par le son et par l’image dans cette usine industrielle autour de cette maison et qu’on entend sans cesse.
Les plans avec la main sont extrêmement bizarres…
(il cherche) Ah, la main avec le ciel et tout ça ? C’était une partie tournée au Liban. Je ne sais pas si tu te souviens mais on ne voit pas tout dans la métamorphose finale, quand elle devient donc une louve et donc on voit cette main qui est en train de se transformer en face du soleil, de la Lune et à la fin dans cette cave en face de la fumée. C’est la main de la bête mais ça n’est vraiment que mental, il n’y a pas tellement plus de sens que ça.
Il y a aussi une séquence dansée qui m’a paru plus intéressante que tout le Climax de Gaspar Noé. Ça m’a même fait penser aux trucs louche d’Otto Muehl, les material aktion des viennois…
(pas convaincu) Oui… Mais je ne peux pas parler de références. Pour les acteurs si par contre. Eux il y sont allés direct dès la préparation. Tout le monde savait qu’on allait tourner cette scène et eux l’attendait. C’était leur récréation. « Quand est-ce qu’on tourne la scène de la fête ? ». C’est tourné de manière très spontanée, il n’y a pas de découpage préétabli et la mise en scène se faisait en direct vu que j’étais seul à filmer. Il n’y avait pas la musique ou plutôt, on a mis une autre musique. Je donnais mes directives en filmant : « Toi, viens là ! Zalfa, cache machin ! Astrid, accroupie ! Romuald, vas-y passe devant la caméra, ! Vas y, Passe vite vite vite ! » Alors je le prenais par le bras et je le faisais passer devant l’objectif. C’était très organique, très physique cette scène là et je m’impliquais moi-même, je dansais presque avec la caméra, avec eux.
À un moment, on est très près de virer au torture porn. Puisqu’on est dans le genre, onse demande si tu vas y aller franchement, si ce n’est que toi d’habitude, tu ne filmes pas vraiment la violence. Tu filmes plutôt avant ou à côté que la violence même.
C’est ça.
Là, au moment de la vengeance des deux flics, as-tu hésité, as-tu eu la tentation de pousser jusqu’à l’extrême violence ?
Oui, j’étais tenté. Et encore, la première version de Kamaloca qui n’avait été regardée par personne, que par moi-même, ce qu’on appelle l’ « ours » dans le milieu, était encore plus violente parce que j’avais quasiment tout gardé de la violence physique. J’ai enlevé au fur et à mesure pour atteindre un équilibre qu’on juge au moment. Mais si je montais aujourd’hui, j’aurais fait encore une autre version. Sur le moment, on se dit que c’est la bonne et en effet, comme tu dis, c’est souvent soit l’après soit l’avant. Par rapport à cette partie du massacre, de la boucherie, on les voit plus en train de nettoyer le sang à la serpillière après que les tortures elles-mêmes. Même en quantité, il y a cinq bonnes minutes sur le lavage du carrelage, la serpillière, le seau, beaucoup plus que la violence et la torture. C’est un choix, même s’il y en a quand même !
D’un autre côté, je trouve que la scène de viol est rendue encore plus gênante par le balayage opéré par la caméra.
Le panoramique qu’il y a c’est le regard de l’autre flic, celui avec son attelle et qui observe le viol. Le pouvoir de la séduction n’est pas rien au cinéma et des fois on est plus provoqués par l’évocation que par la monstration directe.
Est-ce qu’on peut rattacher cette volonté de faire disparaître les traces de l’obsession de certains bourreaux durant la guerre civile ?
Je n’ai pas pensé à ça mais ça me plaît ce que tu me dis. (rire) Je n’ai pas pensé à la guerre, j’étais plus dans l’obsession du flic qui a aussi ce même réflexe de l’ordre.
Au niveau musique, il y a des passages où elle est insupportable, par exemple au moment des scènes de torture. Elle est super dans la dernière séquence où on a vraiment l’impression de voir débarquer les grands mythes du fantastique, ça rappelle aussi le vampire de Vortex. Ce sont toutes des musiques composées pour l’occasion ?
Je ne pense pas qu’il y aie de la musique sur les tortures mais du son, des bruits, du sound design, ça c’est sûr. Des effets sonores mais pas de musique. Kamaloca, c’est un son très fou, très dérangeant. C’est d’ailleurs le, film où j’ai utilisé le plus de bruitages, en saturation, en accumulation et même en couches. Couche après couche, je ne me souviens pas mais j’ai plus de 500 bruitages. Je n’exagère vraiment pas mais ce sont des bruits de quelques secondes et pas forcément inventés et créés par moi-même. Parfois j’ai un peu cette tendance à fonctionner à l’ancienne et de créer les sons moi-même, autres que les sons enregistrés que je peux distordre en post production. Des fois, je peux aussi faire des bruits artisanaux par ma bouche, des bruits beaucoup plus courts (il fait plusieurs espèces de jappements entre son d’oiseaux et batraciens), des trucs comme ça que je peux amplifier en sound design. Il y a aussi une librairie sonore où on peut récupérer à droite et à gauche des sons préexistants et qu’on peut mixer ensuite. Pour ce film là, c’est un truc de fou parce que ce sont des particules sonores qui ne sont pas là pour créer de l’émotion ou amplifier un plan. Ce n’est pas par rapport à un geste d’action, de narration, lié à un geste qu’on voit à l’image, là c’est du juste du sensoriel brut et on cumule. Pour chaque plan, il y a une vingtaine ou une trentaine d’effets et de bruitages qui sont très hétérogènes, très disparates.

Zombie cortex -Capture d’écran
Tu satures l’espace mental du spectateur !
C’est une saturation audiovisuelle. C’est un film assez brouillé et on ne sait pas où on est : on passe par le réel libanais, l’explosion… Il y a beaucoup de choses. Comme tu le dis, ça peut prendre un aspect positif quand on aime et par contre, comme on me l’a reproché, le résultat c’est qu’il y a moins de sélections, moins de projections. On me dit que ça part dans tous les sens… « Non ! On ne comprend pas ! ».
Moi au contraire, je trouve ça très lisible… (rire) On n’en a pas encore parlé mais tu pratiques l’art du teaser. Je ne sais pas combien de temps tu y passes en général, mais les teasers de tous tes films sont redoutables, au point que ça nous donne systématiquement envie de voir les films. C’est le cas du dernier, Zombie cortex qui intrigue aussitôt.
Ça aussi ça fait partie de l’art du montage. J’ai appris ça au fur et à mesure, parce que même si on sort mes films en salle et que j’ai un distributeur, je participe énormément à la promotion et de loin, je supervise le processus. Je fais donc moi-même les teasers et les trailers. J’ai appris à ne pas forcément prendre les meilleurs moments. C’est une balance entre des moments fragiles, des décors intéressants, des surprises car c’est en effet ce qui donne envie de découvrir un film. Des fois, c’est trompeur. On croit que ça va être extraordinaire et après les gens sont déçus.
Le rythme peut en effet être différent. Par exemple, dans Vortex, il y a un rythme beaucoup plus lent que dans son teaser.
Absolument, ou même dans Ultravokal. On croit que ça va être encore plus monstrueux, plus géant alors que finalement, c’est plus simple, plus minimaliste.
Est-ce que tu ne te servirais pas un peu de l’invisibilité ? Hors la sortie salle, hors les festivals et pour qui a les moyens de se rendre dans des pays très éloignés, il est difficile de voir tes films. Est-ce qu’un jour tu quitteras ce statut d’artiste maudit pour mettre tes films à disposition du public, ce qui leur permettrait de s’acclimater à tes films et mieux comprendre ta démarche, come j’ai eu la chance de le faire grâce à toi ? Sortiras-tu un jour tes films en DVD ?
Il y en a quelques uns mais plutôt petite distribution américaine et sur les plates-formes.
Moi je pensais plus simplement à un coffret…
Tu me dis ça comme si c’était moi qui bloquais mais ce n’est pas moi qui refuse ! Ce n’est pas moi qui suis dans une posture underground, pas du tout !
Ou ça pourrait être comme certains cinéastes, que tes films ne soient visibles que sur grand écran.
Non, même si on m’a fait cette réflexion. Je le vois, mes films sont plus forts sur le grand écran, surtout quand on les découvre pour la première fois. Même au niveau de mes amis qui connaissent mon travail : quand ils le voient sur grand écran puis ensuite sur petit écran, c’est carrément autre chose. Mais malgré ça, je ne fais pas de différence et ne pose aucun interdit. Ce n’est pas moi qui suis dans une vision restreinte, mais le monde du cinéma qui est très formaté, celui de l’audiovisuel, le monde tout court, nos sociétés. Si tu ne réponds pas à certains critères commerciaux ou à une idéologie politique, esthétique, si tu es hors du système, tu es hors du système et on t’accepte peu ou trop tard ou posthume.
Posthume ?! (rires)
Surtout après cet entretien. On viendra vers toi « Ah le grand entretien, on a besoin des informations sur Karabache ! »
On va sans doute encore me reprocher de parler de films invisibles…
En tout cas, moi je n’ai jamais refusé une proposition. Je ne me souviens pas avoir dit non à un programmateur qui soit venu vers moi. Pas du tout ! J’ai accepté que mes films soient projetés, dans un bar, dans un hangar, en cinémathèque, sur petit ou grand écran, en salle de cinéma, en plein air, je n’ai pas de problème avec ça. Après, ça reste un cinéma radical et difficile, j’en suis conscient.
Il faut donc convaincre Visiosfeir d’éditer tes films…
Soit lui, soit encore un autre distributeur qui a déjà une pratique de DVD, parce que Visiosfeir travaille plutôt la salle. Un éditeur… parisien ! (rires)
Aujourd’hui (l’entretien a eu lieu juste avant les élections législatives de juin), tu es à Beyrouth et moi en France. Dans les deux cas, ce sont des pays qui traversent des jours difficiles pour différentes raisons. Est-ce que tu sens monter la tension du fait de l’augmentation des bombardements dans le sud du pays ? Est-ce que ça se ressent à Beyrouth et y a-t-il une inquiétude que les choses dégénèrent ?
Alors, comme je l’ai dit au début, l’inquiétude du retour de la guerre est permanente. Mais depuis le 7 octobre, il y a cette guerre… On peut vraiment parler de guerre, ce n’est pas juste un petit conflit sur la frontière sud. Dans le sud, ça bombarde vraiment ! Là où j’habite, à un quart d’heure de Beyrouth, il n’y a pas vraiment de danger pour le moment et tant mieux, à part une période, en hiver où j’étais justement en train de filmer et monter Zombie cortex. J’en ai profité pour filmer ça et on voyait en effet les avions de chasse, passer un niveau très bas. J’ai le son et j’ai l’image et je voyais de loin leur chute dans la mer à l’horizon, parce que j’habite en face de la mer, où il y avait le porte-avion américain Eisenhower qui bien sûr aidait Israël. L’équipement était américain, j’ai donc retranscrit ça dans Zombie cortex, mon dernier film. Il y a donc cette peur des avions de chasse. Il y a une menace, des discours de guerre, la propagande, mais nous ne sommes pas encore bombardés.
Et est-ce qu’il y a danger pour toi de complication du fait qu’en France, les choses pourraient basculer et tu pourrais moins facilement faire des allers-retours comme tu l’as toujours fait ? Si Bardella devennait premier ministre…
Après, moi je suis français, donc je l’emmerde. (rires) Mais là non, malgré les côtés nihilistes et fatalistes de mes films, je ne veux pas que cette hypothèse soit une réalité, donc non, Bardella ne sera pas premier ministre ni au pouvoir ! (rire)

Dream politik-19 -Capture d’écran
Inch’ Allah !
Oh, ben on va voter dans ce sens. D’ailleurs je vais voter au consulat. Sauf si un jour une fois au pouvoir il me disait de choisir entre les deux nationalités, libanaise et française, là ce serait une autre affaire. Mais il ne faut absolument pas que ces gens là viennent au pouvoir, il n’en est pas question. Si en cette période de ma vie, je suis plus au Liban, la France est ma deuxième moitié, je suis né déjà français vu que ma mère est française, j’ai ce sang là par filiation. Là j’ai quitté mon studio mais il y aura un retour, à Paris ou ailleurs, parce que maintenant, Paris c’est dégueulasse. Quelque part en France pour être entre les deux. Six mois, je trouve que c’est assez équilibré. J’ai besoin des deux en fait.
(les questions suivantes ont été ajoutées pour faire le point sur la situation)
Peux tu nous présenter ton prochain projet de long-métrage ?
Jusqu’à cette nouvelle guerre entre l’armée israélienne et le Hezbollah au Liban déclenchée fin septembre 2024, j’étais depuis plusieurs mois dans les préparatifs d’un nouveau projet de long-métrage rôdant entre la science-fiction minimaliste et le thriller d’anticipation sombre, autour d’un ingénieur fou qui veut détruire la ville pour la reconstruire à sa façon. Ce que l’on peut appeler de nos jours Urbanicide. Pour cela, à l’aide de complices, il a un projet d’insérer de minuscules bombes vitalistes dotées d’une Intelligence Artificielle dans les ventres des êtres humains afin qu’ils deviennent eux-même des kamikazes programmés. J’ai eu cette idée bien sûr avant l’explosion des téléavertisseurs au Liban. On dirait que le réel a dépassé la fiction ! Mais ça m’a encouragé encore plus à le faire.
Comment le conflit impacte-t-il ton travail ? Comment survit-on- économiquement au jour le jour alors que la situation des libanais était déjà extrêmement précaire ?
Hélas, à cause de la situation actuelle ce projet est reporté jusqu’à janvier. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour être concentré et réussir un tournage avec un équipement professionnel. Sans parler de la panique de quelques techniciens ou même du fait qu’un des acteurs est parti à l’étranger pour fuir la guerre et être en sécurité. Mais on le fera coûte que coûte en janvier, espérons ! La vie est extrêmement difficile, surtout pour les déplacés et ceux qui ont perdu leurs foyers, abattus par les bombes. On voit les familles déracinées logées dans des squats, ou en plein air et sous des tentes, étalées sur les trottoirs publics, sur la longue corniche de la capitale ou bien encore elles occupent les écoles publiques vu que les cours sont arrêtés.
Tu nous a dit que tu créais beaucoup la nuit. Parviens-tu encore à créer sans quasiment pouvoir dormir ou tu ne peux plus prendre que des images comme celle que tu filmes et les photos belles et vénéneuses que tu postes sur les réseaux au jour le jour ? Sors-tu pour prendre des images ?
Du coup, pour ne pas se sentir frustré de ce report et de la lourdeur de l’attente dans une telle situation de guerre et de violence, j’ai décidé de filmer, de créer rapidement et instinctivement un nouveau projet, que je tourne actuellement, de façon spontanée et brute. Basé sur un fait divers qui s’est produit au début de cette guerre, je construit une fiction mais où le réel est très imprégné. C’est à la fois un mélange de scènes tournées avec des acteurs et d’autres plans arrachés et captés de cette réalité virulente et particulière qu’on est entrain de vivre et de subir. Je le tourne avec les mêmes acteurs principaux du projet initial qui a été reporté. Ce sont mes héros du moment qui prennent le risque avec moi, avec enthousiasme et ténacité, de faire ce film malgré tout ! Je m’incline donc devant Fadi Sroor, Raïa Haïdar, Shaker Shihane et Fadi Barbar (qui est un non-acteur). Pour les scènes fictionnelles c’est une équipe technique extrêmement réduite. Concernant les plans du réel, je suis seul à filmer, à faire l’image et le son.
Je dors peu en ces temps, car on peut sursauter à cause d’un éclat de bombes ou être dérangé par un bourdonnement d’un drone de surveillance, et forcément nous sommes fatigués le lendemain, et du corps, et du mental. Mais prendre mes outils de cinéaste, c’est-à-dire la caméra et le montage me donnent vitalement une force pour agir, résister et simplement exister. C’est un filmage quasiment au quotidien, quelques plans par jour. D’ici de petites semaines, je pense que j’aurais une matière suffisante pour monter un film. Ma ville n’est pas (encore) directement touchée par cette agression israélienne, je suis dans la région nord de Beyrouth, alors qu’ils visent surtout la banlieue sud de la capitale et bien sûr tout le sud du Liban. Donc c’est surtout par le son que je vis cette guerre et en apercevant de loin des fumées des bombes aériennes. Il m’arrive aussi de prendre un risque et d’être sur quelques sites démolis mais c’est hyper dangereux et surtout, ils interdisent catégoriquement de filmer pour éviter les fuites des espions.
As-tu croisé d’autres cinéastes et artistes libanais qui tentent également de témoigner de ce qui se passe ?
Je n’en ai pas croisé à titre personnel mais je suis certain que plusieurs cinéastes témoigneront de cette réalité. Après chacun à sa façon, son rythme, maintenant ou bien après la fin de cette guerre. Pour ma part, je ne voulais pas me répéter en faisant le même film (je pense à Zone Frontalière qui est un docu-expérimental sur la guerre de 2006) car en gros ils sont en train de bombarder les mêmes zones, les mêmes régions, de détruire les mêmes villages et cités. Un cycle répétitif, une spirale infernale ! Et pour éviter des sujets « classiques » ou trop attendus (à titre d’exemple de ne filmer que les ruines ou de prendre un sujet autour des déplacés), je suis en train de créer un film différent, qui sera donc intitulé Guérilla Beyrouth mais qui reflètera sans nul doute toute l’ardeur de la situation actuelle, la cruauté tangible et sensible de cette triste réalité.
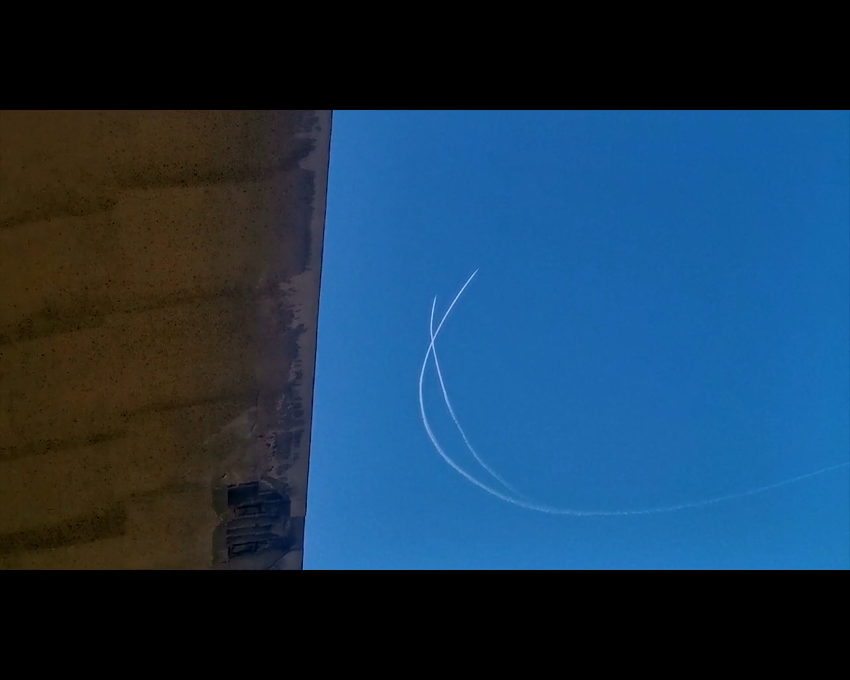
Zombie cortex – Capture d’écran
Y aurait-il une organisation qui se met en place et qui permettrait de diffuser à l’étranger des images de l’intérieur, comme une forme de résistance filmique à la terreur sioniste ?
Pas à ma connaissance.
Toi qui es tout autant français, que penses-tu que la France puisse faire aujourd’hui pour les libanais ?
Au niveau des politiciens, rien bien sûr, vu que le gouvernement actuel est à fond pro-sioniste et que de toute façon la France a carrément perdu de son influence dans la région du Proche-Orient. Par contre, plus la population bouge, manifeste, organise des sit-in, fait entendre la voix d’une contestation ou d’un appel au Cessez-le-feu, et plus ça fera une pression, symbolique mais c’est mieux que rien ou que l’insupportable silence mondial hypocrite. En tout cas, rien ne pourra arrêter ce criminel de guerre de Netanyahou, sauf les prochains contrats matériels et financiers entre des grandes puissances, régionales et internationales. (rire)
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).










