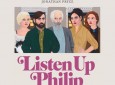Le 21e Festival Tous Écrans a commencé ce vendredi, s’étend sur deux semaines jusqu’au 14 novembre, et propose un programme très diversifié : au delà des longs-métrages, des compétitions de courts-métrages, de séries TV, de webséries et de projets transmédia sont organisées. Hors-compétition, les catégories « Highlight Screenings » et « Rien que pour vos yeux » proposeront les projections en avant première de films tels que La Calle de la Amargura d’Arturo Ripstein, 11 Minut de Jerzy Skolimowski ou Ryuzo and his seven Henchmen de Takeshi Kitano, sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir. Ce premier compte-rendu traite des cinq premiers long-métrages en compétition du programme.
Koza, d’Ivan Ostrochovsky
Koza est passé à la télévision, un jour : c’était en 1996 aux JO d’été à Atlanta, en boxe anglaise. Il garde de cet événement une veste Adidas aux couleurs de la Slovaquie, élimée à force d’être portée, et un enregistrement VHS de son match d’anthologie, qu’il rediffuse encore dans le noir le nez collé à la télévision, les yeux rêveurs, malgré sa défaite. Oublié de tous, Koza a laissé ses gants au vestiaire et vit avec sa femme et sa fille dans une maison délabrée, ornée de tant de tapis qu’on se demande s’ils servent de décoration ou de cache-misère. Mais lorsque Miša tombe enceinte, il décide de retourner sur le ring pour financer l’avortement. Commence alors un voyage déprimé, sans espoir et plutôt misérabiliste en compagnie de Zvonko, son employeur converti à l’occasion en coach.
Ivan Ostrochovsky ne laisse pas au spectateur le temps de douter de l’issue du film : l’affiche annonce « le voyage d’un ancien boxeur olympique jusqu’à son ultime défaite ». Une volonté de distanciation et d’objectivité imprègne clairement la totalité de cette fiction ultra réaliste. Les acteurs, qui jouent leur propre rôle et rejouent leur propre histoire, évoluent dans des lieux récurrents filmés de loin, à grand renfort de plans fixes et frontaux : c’est le ring, sur lequel Koza se fait systématiquement démonter par ses adversaires ; ce sont les routes enneigées, monotones et désertes de Slovaquie, sur lesquelles on voit le boxeur et son coach s’ennuyer en silence, avant une nouvelle désillusion dont ils sont tous deux conscients. Le film, sous prétexte qu’il refuse en bloc toute morale et tout pathos, prend rapidement les allures d’une expérimentation scientifique de la misère, dont les deux rebuts de la société slovaque seraient les cobayes ; le spectateur, lui, se voit imposer le rôle du scientifique qui doit de gré ou de force assister – de loin, certes – à la souffrance physique et à la détresse mentale des personnages : crachats ensanglantés, vomi après effort, aveu d’enfance difficile et humiliation publique sur le ring… En un peu plus d’une heure, on a fait plusieurs fois le tour de l’échec.
Il reste que Koza, de son vrai nom Peter Baláz, témoigne par ses mots, ses choix et son regard bleu à la fois vide et profond, d’une innocence radicale qui nous rappelle avec émotion certains personnages de Bruno Dumont, en particulier Freddy, l’épileptique de La Vie de Jésus. Koza n’est après tout qu’un grand enfant : il vole des bonbons (véridique), il joue ; on lui donne des ordres, on le punit. Il tire de sa misérable situation une sorte d’énergie du désespoir… On est bien forcé de se sentir touché, mais il est triste que cela se fasse par la prise en otage de la conscience morale du spectateur.
The Other Side, de Roberto Minervini
Avec The Other Side, l’italien Roberto Minervini nous fait entrevoir le fond des États-Unis. Cet « autre côté » dont parle le titre, ce sont ces pans de territoire américain rongés par la drogue, l’alcool et le chômage. Les habitants de ce bas-côté de l’Amérique survivent plus qu’ils ne vivent, à grand renfort de trafics en tout genre et de jobs sous payés, mais aussi grâce à l’amour et l’entraide. Une longue première partie nous conduit caméra à l’épaule au coeur d’une grande famille de rednecks frustres, vulgaires et miséreux. La petite communauté de West Monroe implantée en Louisiane, filmée crûment et sincèrement, fait preuve d’une tendresse infinie à l’égard de ses membres : les vieillards sèchent les larmes des plus jeunes, les couples s’aiment intensément à leur étonnante manière (« bitch I love you », susurre le personnage principal à sa femme). On se drogue en famille et dans la bonne humeur, et les femmes enceintes ont droit à un câlin après leur shoot d’héroïne. Mutuellement, ces cas sociaux se convainquent qu’ils sont « entourés d’amour », qu’« il n’y a que des belles journées ». On accueille avec émotion et sans jugement négatif cette communauté solidaire dans leur misère et l’ostracisme.
Mais subitement, au bout d’une heure, le fil est rompu. The Other Side prend une tournure inattendue, qui étonne par son fatalisme. La haine raciale, la violence et la désillusion deviennent centrales dans la dernière demie-heure du film alors qu’elles n’apparaissaient jusque-là qu’en arrière-plan, entre autres via un drapeau des Etats Confédérés d’Amérique, visible aux repas et aux enterrements. On est donc soudainement transporté au Texas, où des fêtes orgiaques dégradantes (oublions vite cette femme en maillot fluo qui suce un homme en portant un masque en latex à l’effigie d’Obama…) sont suivies de séances d’entraînement paramilitaire pour préparer une révolution/occupation/guerre civile que des ex-soldats au crâne rasé, véritables hommes-sandwiches du 2nd Amendment, prophétisent avec maladresse, ignorance et dangereux raccourcis. La scène finale sonne comme un début d’apocalypse. Minervini pointe une situation critique et la laisse telle quelle… Oubliée, la note d’espoir de la très belle fin de la première partie, filmée sur l’eau, où le père de famille repenti entame ce qui semble être une quête existentielle. L’amour montré plus tôt, aussi sincère qu’il fut, n’était en réalité qu’un leurre, une fausse bonne nouvelle.
Queen of Earth, d’Alex Ross-Perry
Catherine (Elisabeth Moss) part une semaine avec sa meilleure amie Virginia (Katherine Waterson, Shasta dans Inherent Vice) dans la résidence secondaire de cette dernière en vue de se ressourcer après le double choc de la mort de son père et de sa rupture amoureuse. Schéma assez typique donc, du huis-clos entre forêt et lac, durant lequel on assistera à la dégradation d’une relation qui paraissait pourtant sans problème, idyllique. Mais Queen of Earth est plus que ça : plus que la deliquescence d’une amitié, le spectateur assiste à l’entrée d’une femme dans la folie, et tout son monde avec. La première scène préfigure le pouvoir malsain et contagieux de Catherine : on la voit en gros plan, de trois-quart, passer par tous les états émotionnels possibles face aux aveux de tromperie de son petit ami situé hors-champ. Elle pleure puis rit, est impassible puis hurle, le maquillage coulant sur son visage, mi-pathétique, mi-grotesque. Elle aime et déteste, simultanément, et de tout son corps. En filmant tout cela de très près, Alex Ross Perry nous englobe dans le visage même de la Folie : la moindre micro-émotion suffit à nous perturber.
L’irrégularité et l’instabilité de Catherine est exacerbée par la présence de Virginia, son amie et alter-ego, d’une beauté apollinienne et d’un calme inégalable. Des flashbacks réguliers, introduits de manière assez atypique par saccades, informent le spectateur qu’il fut un temps où c’était la blonde qui passait pour la fille modèle… Les frictions du temps présent sont d’autant plus fortes que chaque personnage est rongé par les souvenirs d’un passé inversement polarisé.
Si la violence qui se dégage de Queen of Earth nous paraît si dangereuse, c’est parce qu’elle est incroyablement douce, et semble pouvoir entrer en éruption à tout moment du film. Toute expression fugitive capturée par la caméra est comme un volcan endormi. La musique, discrète mais omniprésente, de Keegan De Witt, y est aussi pour quelque chose : des notes isolées de piano et de xylophone révèlent doucement ce que les personnages cachent à eux-mêmes et aux autres : une intériorité en pleine déconstruction. Enfin, la caméra capture des couleurs de fin d’été qui irradient l’image de la même manière que Catherine contamine son entourage.
On saluera d’autant plus ce film qu’il fait partie de la mouvance mumblecore des films américains à très bas budget. Alex Ross Perry parvient avec très peu de choses à faire germer une perturbation malsaine dans l’inconscient de son spectateur.
Babai, de Visar Morina
Nori et son père Gezim vendent des cigarettes dans les rues en guerre du Kosovo des années 90. Ils vivent avec une dizaine d’autres membres de leur famille dans une petite maison dirigée d’une main de fer par l’oncle Adem. La situation du pays pousse Gezim à quitter son fils et les siens pour partir vivre en Allemagne en tant que réfugié. Nori va le rejoindre, inconscient du voyage qu’il s’apprête à faire. Cette inconscience sera sa force.
Nori subit absolument tout ce qu’un enfant ne devrait pas subir. Plusieurs fois dans le film, on voit en arrière-plan des enfants s’amuser, jouer au football, chanter des comptines, comme pour nous montrer le fantôme d’une innocence que Nori n’aura jamais eue. La guerre l’a jeté brutalement dans le monde adulte, un monde sérieux et grave, dans lequel il est soit invisible, soit indésirable. Pourtant l’incompatibilité entre l’enfance et la guerre fait de Nori le plus mature, le plus adulte de tous les personnages du film. On le voit par exemple silencieux, abasourdi par le cérémonial hypocrite qui se joue lorsqu’un oncle éloigné vient rendre visite à ses proches. La caméra se met à sa hauteur pour filmer un regard interrogateur et dur à la fois.
Avec Babai, « papa » en albanais, Visar Morina montre l’impossible épanouissement d’un amour filial en temps de guerre. Du début à la fin du film, le duo est balloté d’un pays à l’autre à la recherche d’assez de calme pour enfin apprendre à se connaître. Dans une très belle scène au milieu du film, le père essaie d’apprendre à son enfant à rouler à vélo dans un parc en Allemagne… La leçon sera rapidement interrompue par la nécessité de trouver un toit, de l’argent, un asile. Ces efforts du Gezim pour trouver un lieu où s’épanouir est perçu par Nori comme un clou qu’on enfonce dans l’enfance. La métaphore n’est pas gratuite : dans une courte scène qui donne au film une dimension quasi-expressionniste, on voit un clou saigner sous les coups de marteau du père qui cherche à enfermer son fils dans une caisse afin de faciliter le passage de la frontière germano-hollandaise. On ne peut pas mieux exprimer l’assassinat de l’enfance auquel conduit la guerre et l’exil.
God bless the child, de Robert Machoian et Rodrigo Ojeda-Beck
Un matin d’été dans un quartier résidentiel de banlieue en Californie, Harper, Elias, Arri, Ezra et Jonah se retrouvent livrés à eux-mêmes après le départ de leur mère. La force de God bless the child tient sans doute au fait que malgré ce sujet apparemment grave, ses réalisateurs ne s’engouffrent absolument pas dans la compassion et les larmes. Au contraire, le film est incroyablement léger.
Sur une journée, on accompagne le petit groupe dans son oisiveté générale, et on prend plaisir à les voir semer le chaos dans la joie la plus complète. Chacun s’occupe comme il peut : des groupes se forment, se déforment, fusionnent et se divisent. L’aînée, une adolescente, s’occupe presque constamment du benjamin, encore dans ses couches et très souvent en pleurs. C’est la figure maternelle de substitution, qui s’inquiète pour le cadet qui a parlé à un inconnu, qui raconte des histoires et chante des berceuses. Elle est la seule à s’inquiéter : une très belle scène vers la fin du film nous la montrera frontalement, en train de prier devant l’entrée de la maison en pleine nuit, pour que sa mère revienne enfin, après une si joyeuse journée. Les trois autres enfants sont hyperactifs, bavards. L’un est plutôt gros, mal élevé et cruel ; l’autre est maigre, sportif mais un peu peureux ; le plus jeune des trois semble tout juste sortir de ses couches : il est souriant et imite ses frères.
Les cinq enfants se battent, jouent au basket, se boxent, lavent le chien, grimpent sur le toit pour se moquer des passants. Leurs discussions animées sont imprégnées d’une culture américaine populaire que l’on s’amuse à reconnaître : la Reine des neiges, Avengers, Lady Gaga… Chacun s’agace, tout le monde se console, le tout devant une caméra qui nous donne souvent l’impression d’assister au visionnage d’une vieille vidéo familiale. Ironique : le spectateur visionne les films de souvenirs que ces enfants n’auront jamais. Le paradoxe se résout néanmoins dans la réalité du tournage : l’un des deux co-réalisateurs, Robert Machoian, est le père de ces cinq enfants. On a rarement été aussi peu inquiets à la vue d’enfants délaissés. On les envierait presque de s’amuser autant. C’est la bienveillance de la caméra qui nous y autorise : filmés comme ils le sont, ces enfants sont forcément entre de bonnes mains.
La suite du compte-rendu des longs-métrages en compétition sera publiée ces prochains jours. Au programme : La Peur de Damien Odoul, Occupy the pool de Seob Kim Boninsegni, Parabellum de Lukas Valenta Rinner, Pauline s’arrache d’Emilie Brisavoine et De l’Ombre il y a de Nathan Nicholovitch.
Site officiel du Festival Tous Écrans : www.tous-ecrans.com
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).