Dire que nous sommes à nouveau revenus enchantés du Arras Film Festival relèverait de l’euphémisme ! Afin de rendre hommage à ce vingtième anniversaire, parcourons comme il se doit la Compétition européenne du festival, appréciée bien au chaud dans le cocon arrageois, entre quelques déceptions et toujours de très belles surprises venues des quatre coins de l’Europe.
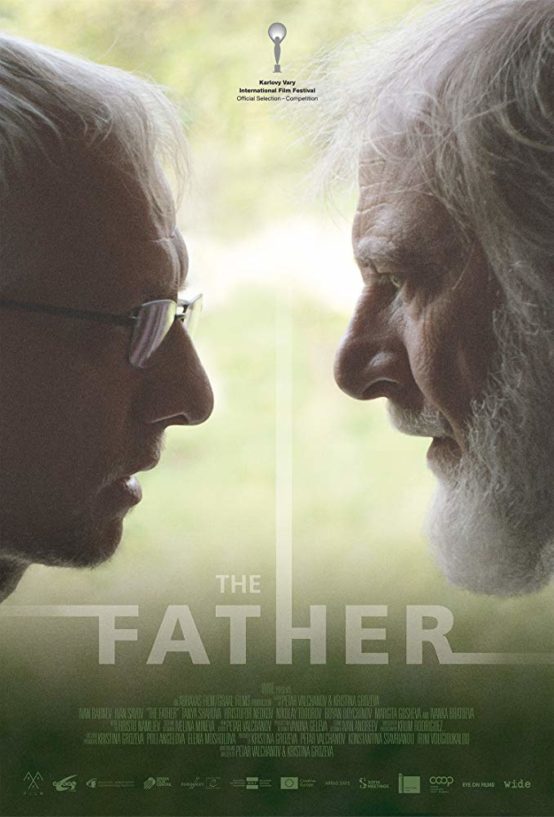 The Father (Kristina Grozeva et Petar Valchanov, Bulgarie / Grèce, 2019)
The Father (Kristina Grozeva et Petar Valchanov, Bulgarie / Grèce, 2019)
Le film des bulgares Kristina Grozeva et Petar Valchanov est le grand vainqueur de cette vingtième édition du Arras Film Festival ! Il repart en effet avec l’Atlas d’Or, le Prix de la Presse et le Prix Regards Jeunes. Et cerise sur le gâteau, les deux réalisateurs ont également remporté l’une des deux bourses attribuées par les ArrasDays (rendez-vous lors duquel des réalisateurs concourant en compétition présentent à un jury de professionnels européens un projet de film au stade de scénario) pour Triumph (cela ne s’invente pas !), qui sera donc certainement leur prochain long métrage, que l’on découvrira dans quelques années au festival. Quand on se remémore que leur film précédent, Glory, avait lui aussi remporté l’Atlas d’Or, on se dit que ces deux-là n’ont pas fini de nous rendre visite en terres arrageoises ! Nous partageons cet enthousiasme pour The Father, dont le principal atout réside dans le ton, tutoyant tour à tour l’intime et l’absurde, mélangeant habilement émotion et drôlerie, avec une mise en scène à l’unisson, tantôt dans l’observation tantôt dans l’énergie. Si la trame de fond est celle du drame, une foule de détails amusants ou caustiques apportent au film une dimension supplémentaire et une belle richesse. Nous faisons la connaissance de Vasil et Pavel alors qu’ils viennent de perdre respectivement leur épouse et mère. Persuadé que sa défunte femme tente de le joindre depuis l’au-delà, Vasil fait appel à un médium pour entrer en contact avec elle. Son fils Pavel, venu pour l’enterrement, va devoir prolonger son séjour afin de gérer la lubie de son père, et qui sait peut-être apprendre à mieux le connaître. D’emblée le duo ne va pas de soi : Vasil est impulsif, tête de mule et pas toujours très délicat ou attentif, tandis que son fils est beaucoup plus effacé, avant de gagner peu à peu en assurance, et plus secret. La première partie du film explore la façon dont chacun vit son deuil, avant que la suite des événements, voire des péripéties, n’opère un virage vers une peinture de cette relation père/fils quelque peu chaotique, entre incompréhension, entraide, non-dits et révélations. Central ici, ce lien exclut dans The Father la présence physique féminine tout en voyant son image convoquée. L’épouse du premier est décédée, mais elle vit encore dans les souvenirs de chacun et les mystérieuses manifestations que Vasil veut à tout prix lui attribuer ; celle du second est souvent jointe par téléphone mais maintenue à distance de la réalité car Pavel veut la protéger d’émotions fortes, enchainant pour cela mensonge sur mensonge, ce qui constituera le ressort dramatique le moins convaincant du film, même si l’on passera facilement outre ces redondances. Plus pertinente en revanche sera la discrète critique des institutions égrenée par le film : derrière l’humour (franc dans la scène des policiers, plus inquiétant dans celle se déroulant à l’hôpital) se cache en effet une fine causticité. Comme une allusion à l’état d’un pays, qui ne serait pas l’enjeu principal du film tout en méritant tout de même d’être évoqué. Comme un dernier tour de passe-passe, le film se termine abruptement, après une dernière séquence intense en forme de douloureuse révélation, qui sans être un twist fait reconsidérer le film sous un autre angle. La suite des aventures de nos réalisateurs bulgares dans un prochain épisode…
The Iron Bridge (Monika Jordan-Mlodzianowska, Pologne, 2019)
La première réalisation de la polonaise Monika Jordan-Mlodzianowska représenta une incursion tout à fait louable dans cette compétition, malgré certains défauts peut-être inhérents à des débuts cinématographiques, et pour laquelle la jeune femme nous demanda d’ailleurs, avant le visionnage, notre indulgence. Nous lui accordons volontiers, car il y a dans The Iron Bridge une tension prenante et une certaine audace. Le scénario allie de manière plutôt surprenante le triangle amoureux et la catastrophe minière : Magda entretient une liaison avec Kasper, collègue et ami de son mari Oskar. Un jour un éboulement survient. Oskar reste coincé sous terre, alors que Kacper et Magda étaient ensemble à ce moment-là. Ce point de départ fait l’originalité du sujet tout en en constituant ses limites, la culpabilité de l’amant, ayant fait en sorte d’envoyer son collègue sous terre pour pouvoir s’échapper quelques heures, étant à partir de là un peu trop pesamment appuyée. Narrativement, le film a les défauts de ses bonnes idées. Casser le rythme de la tension engendrée par la catastrophe en était une, mais entrelacer à ce point temps présent et flashbacks narrant le rapprochement entre Magda et Kacper entraine une lourdeur qui nuit à la progression narrative et au maintien de l’intérêt pour le sauvetage qui s’organise. Car cet aspect « film catastrophe » est justement l’un des éléments les plus intéressants du film,mis en place avec peu d’effets, mais cristallisant l’espoir, l’attente et les tourments internes des personnages. On retiendra la longue dernière séquence, dont la mise en scène hélas sans relief est compensée par une tension grandissante très bien menée jusqu’à devenir réellement poignante. Se détache également de l’ensemble son héroïne, personnage fort et complexe très bien interprété par Julia Kijowska. Partagée entre deux hommes, plongée dans une situation critique exacerbant les émotions, elle ménage à la fois une belle présence et un certain mystère. Oskar, lui, est paradoxalement effacé alors même que tout un dispositif s’organise autour de lui. Jamais réellement présent, puisque recherché sous terre ou seulement évoqué dans quelques scènes-souvenirs, il appartient déjà presque au passé, le lien l’unissant à sa femme étant lui-même peu représenté dans les flashbacks et réactivé par l’absence et sa possible disparition. Kacper quant à lui est saisi dans toutes ses contradictions, pris dans un étau qui se resserre, entre espoir de retrouver son ami, sentiment de culpabilité et effondrement soudain de sa relation avec celle qu’il aime. The Iron Bridge est un film imparfait mais intéressant, pas totalement convaincant mais comportant suffisamment d’attrait pour que l’on estime sa réalisatrice prometteuse et que nous attendions de sa part une belle transformation de l’essai.
 The Best of Dorien B. (Anke Blondé, Belgique, 2019)
The Best of Dorien B. (Anke Blondé, Belgique, 2019)
La magnifique Dorien (et par conséquent sa réalisatrice Anke Blondé) est repartie bredouille, mais qu’elle sache qu’elle fut notre coup de cœur ! On n’attendait pas forcément grand-chose de cette comédie dramatique belge qui s’imposa pourtant comme le film rafraîchissant et émouvant de la compétition. The Best of Dorien B. part d’un quotidien banal et d’épreuves souvent abordées en tant que ressorts dramatiques : la reconstruction du couple, des parents proches du divorce, la maladie, les interrogations professionnelles… tout cela sur les jolies épaules de Dorien, saisie dans un tourbillon existentiel donnant lieu à une réflexion tendre, intelligente et drôle sur les choix de vie, la perte des repères, la résilience. Jeune mère de famille des plus ordinaires au premier regard, Dorien se révèle au fur et à mesure diablement attachante. Des turpitudes au rayonnement, elle envahit l’écran, et donnerait envie de la connaître au-delà. Son interprète, Kim Snauwaert, est une vraie révélation. D’un naturel désarmant, elle pare son personnage de mimiques que l’on a peu l’habitude de voir, laissant transparaître la femme derrière l’actrice, ce qui ne laisse de renforcer la sincérité de l’ensemble. Comment ne pas être à fond derrière cette héroïne qui prend sa vie à bras le corps et qui fait face à une multitude de tempêtes sans se départir de son humour et de son humanité ? Au travers de ce personnage et de seconds rôles très justes, tous saisis dans leurs contradictions d’être humain et traités sans parti pris, la réalisatrice agence une alliance de moments graves, sensibles, et d’excès émotionnels qui insufflent une bonne dose de vie et d’énergie au film, à l’image d’une mise en scène sachant aussi bien être attentive, humble face à la vie et à l’intimité de ses personnages, et parfois plus enlevée. Véritable bouffée d’air frais sur des sujets très actuels et universels, tranche de vie menée tambour battant, le film est d’une justesse, d’une drôlerie et d’une sincérité emballantes. Ce « best of » du titre n’est pas ce que Dorien a à offrir de mieux, mais désigne sa compil d’adolescente sur K7 audio, ces chansons qui lui rappellent d’où elle vient, qui elle était, autant de choses qu’elle a vraisemblablement perdues de vue et avec lesquelles, la vie pleine de tournants aidant, elle va renouer. Finement, Anke Blondé livre alors une belle réflexion sur le temps qui passe, les responsabilités, les rêves mis de côté, la personnalité qui se dilue pour s’affirmer à nouveau. The Best of Dorien B. est l’histoire d’une renaissance, d’une liberté reconquise, de l’affranchissement d’une femme qui choisit sa vie plutôt que de la regarder de loin. On en redemande !
Free Country (Christian Alvart, Allemagne, 2019)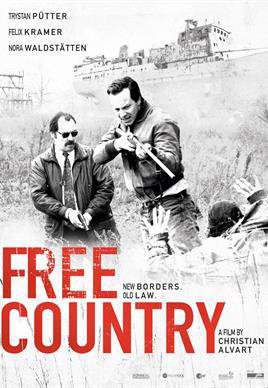
On peut être étonné que Free Country de Christian Alvart reprenne seulement cinq ans après sa sortie l’histoire de La Isla Minima, réalisé par Alberto Rodriguez en 2014. Mais c’est là aussi que l’on se rend compte, s’il en était encore besoin, de l’importance cruciale du pays et du contexte dans lequel se déroule une intrigue. Exit donc l’Espagne post-franquiste, et bienvenue (si l’on peut dire…) dans une région reculée d’Allemagne, à l’automne 1992, soit deux ans après la réunification. Les deux inspecteurs madrilènes sont ici troqués contre Patrick et Markus, aux vies, statures et méthodes très différentes, faisant équipe afin d’élucider le mystère de la disparition de deux adolescentes. Si la compétition européenne du Arras Film Festival fait rarement incursion dans le genre, on se souvient avec enthousiasme de I’m a Killer du polonais Maciej Pieprzyca, thriller de haute volée lancé sur les traces d’un serial killer dans la Pologne des années 70. Free Country fait moins forte impression mais ne démérite pas. On apprécie le classicisme narratif d’une enquête policière complexe, à laquelle viennent se greffer des considérations politiques, sociales, familiales. En toile de fond de la disparition des deux ados, ainsi que de précédentes affaires, émerge un dénominateur commun autour de la promesse d’une vie plus agréable, plus lumineuse, à Berlin, loin de l’absence d’horizon d’une campagne où l’ennui le dispute à l’incertitude de l’avenir. Free Country est un film très sombre, parfois glauque, tant d’un point de vue policier que d’un point de vue humain, où les zones d’ombre sont légion – aucun personnage, qu’il soit victime, proche, journaliste, et même enquêteur, n’y échappe – entre spectres historiques, avec ces références à la Stasi, alors dissoute mais continuant à infuser chez ceux qui en firent partie, culpabilité humaine, suspicions et petits arrangements lorsque la fin justifie les moyens. L’ensemble aurait sans doute gagné à être un peu plus sec, sans certaines redondances qui donnent à un moment l’impression de tourner un peu en rond, mais on retiendra globalement une belle maîtrise, une mise en scène racée, et une superbe bande originale signée Christoph Schauer. Au-delà du polar, le film est aussi un instantané d’une époque, un moment charnière de l’Histoire de l’Allemagne, son mur détruit encore dans tous les esprits, invisible mais présent dans les comportements, comme un stigmate intimement porté par tous ceux qui l’ont vu ériger. Une proposition réussie de polar historique, à qui l’on souhaite la même reconnaissance que son aîné ibérique.
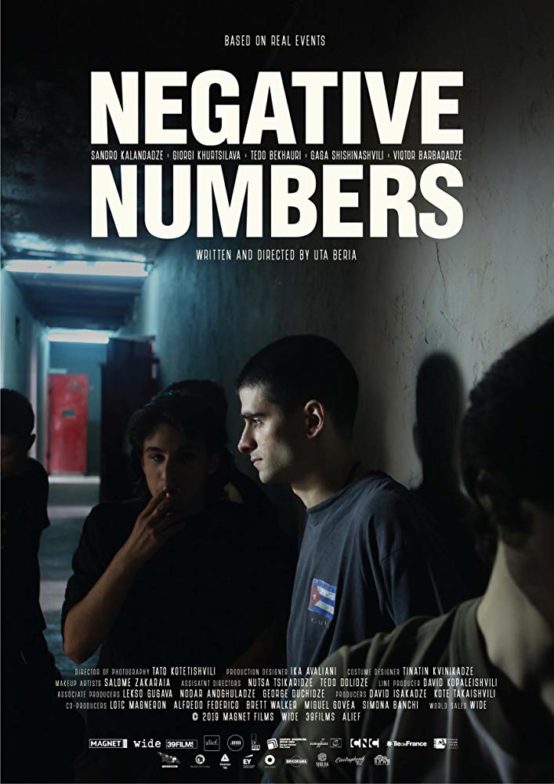 Negative Numbers (Uta Beria, Géorgie /France, 2019)
Negative Numbers (Uta Beria, Géorgie /France, 2019)
On ne doute pas un seul instant de la sincérité d’Uta Beria et c’est sans doute ce qui incite à l’indulgence malgré la faiblesse de Negative Numbers, ce premier long métrage qui évoque la vie quotidienne d’une prison pour mineurs en Géorgie et le sort de ces ados livrés à eux-mêmes ayant élaboré leur propre fonctionnement dans une micro société carcérale, avec son chef et ses petits soldats, reproduisant le même schéma dominants/dominés qu’à l’extérieur. Malheureusement Negative Numbers arrive à l’heure où tous ces éléments sont devenus des archétypes. Il arrive surtout après ses modèles, dont l’écrasant Scum d’Alan Clarke, et Uta Beria échoue à donner le moindre souffle à son film et incarner ses personnages qui restent à l’état de silhouettes. Certes l’habituel « inspiré de faits réels » prouve que le cinéaste n’a rien inventé, mais hélas il n’invente rien non plus du côté de la mise en scène, peu inspirée, filmant à l’épaule pour ses scènes d’action, et posant le reste du temps sa caméra mollement, laissant ses personnages dans un espace qu’ils ont bien du mal à occuper. Le sujet avait pourtant de quoi être déchirant à travers les hésitations de son héros, Nika, ce meneur qui ne doit jamais perdre la face. Condamné pour un crime que son frère a commis, il continue à être dirigé à distance par ce dernier qui lui ordonne de fomenter une rébellion à l’intérieur de la prison. Hélas, même si on sent bien la douleur et les tiraillements de tous ces adolescents, même si Beria veut montrer toute la détresse qui envahit les esprits au point d’en pousser certains au suicide, il se révèle incapable de susciter la moindre empathie. Le dilemme cornélien entre se soumettre aux ordres du frère ou participer au programme de réinsertion par le rugby débouche sur une conclusion plutôt convenue, assez simpliste, sur l’art du sport à sauver les âmes, trop sobre pour tomber dans le pathos à l’américaine mais renvoyant à des films assez stéréotypés comme le A nous la victoire de John Huston. D’autres clichés ne sont pas évités dont l’habituelle vision de gardiens pleins de duplicité, corrompus, de mèche avec le banditisme extérieur. Comparée à la puissance évocatrice de l’émeute de Ladj Ly dans Les misérables, celle d’Uta Beria ressemble à une bataille de polochons où les gamins mettent du désordre dans leur chambre. Restent des jeunes acteurs très convaincants, très réels, pour la plupart non professionnels. Sujet coup de poing pour un traitement coup de mou.
Let there be Light (Markko Sop, Slovaquie, 2019)

Let there be Light constitue indubitablement l’un des chocs sinon le choc de ce festival. Le cinéaste slovaque Marko Skop dresse un tableau tétanisant de la montée du nationalisme dans son pays, à travers les épreuves que traverse une famille dont l’adolescent s’est laissé embrigader par l’extrémisme. Milan est de retour au pays pour Noël, après avoir travaillé en Allemagne pour subvenir aux besoins du foyer. Il découvre que son fils Adam a intégré « la Garde », un groupe de jeunes paramilitaires se donnant pour mission d’éliminer tous les parasites gangrénant leur chère patrie. Après la mort mystérieuse d’un des camarades d’Adam, Milan parcourt le village pour comprendre et sa vie bascule, entraînant avec lui le destin de sa famille… Marko Skop prend avant tout le parti d’adopter le point de vue familial, s’attachant à la beauté de ses personnages, leur complexité. La manière dont le cinéaste étudie le fonctionnement de cette famille est pleine de compassion et d’attention. Milan est ce père aimant, généreux, toujours enclin à voir la lumière même dans les situations les plus terribles, presque candide, lançant régulièrement des blagues qui ne font rire que lui. Mais il est aussi cet amateur d’armes, avec son arsenal, lustrant quotidiennement ces beaux outils devant le regard anéanti de sa femme. Marko Skop scrute son héros, ses failles, ses traumas jamais résolus, avec un père qui en guise de communication ne cesse de l’insulter. Le réalisateur dit lui-même avoir beaucoup lu Lacan et s’en être inspiré, s’interrogeant sur les héritages parents-enfants, les mécanismes de l’éducation et ce que nous léguons de nos propres fissures à notre progéniture. Il est clair que Milan a sans doute transmis à son fils les traces de son humiliation et que comme le lui renvoie sa femme à la figure, le fait qu’Adam puisse désirer « prouver qu’il est un homme » un pistolet à la main, n’est pas étranger à son propre amour des fusils d’assaut. Avec un intérêt tout particulier pour tous ses personnages (celui de la femme est magnifique), le cinéaste opère une gradation dans la descente aux enfers de cette famille. D’étape en étape, l’étau se resserre, à mesure que Milan cherche à faire triompher la vérité, la loi du silence révélant une collusion terrifiante entre toutes les institutions, sans issue possible. Avec cette mise en scène rigoureuse, implacable, tendue au cordeau, la tension s’accroît jusqu’à l’étouffement, presque tout autant que dans un home invasion, avec ce climat d’abandon, de solitude, de traque. Let There Be light est une œuvre d’une grande noirceur qui garde cependant une foi lumineuse – l’unique espoir qui existe – en une harmonie familiale qui survivrait à tout. Le co-scénariste Frantisek Krähenbiel expliquait que le film était symptomatique de ce que subissait une partie de la Slovaquie, mais qu’en revanche, il connaissait des histoires liées au nationalisme plus horribles encore. Leur expérience documentaire nourrit une inspiration pessimiste : de témoignages très inquiétants de la montée de l’extrémisme aux assassinats de journalistes s’approchant trop près de la vérité, les faits entretiennent leur regard lucide, vigilant et préoccupé. Let there be light mêle avec puissance violence du contemporain et force de la fiction. Il sait nous ouvrir les yeux sur le réel et la terreur d’une Histoire en cours tout en nous apprivoisant à la beauté, à la profondeur de l’intime, à l’amour qui relie les êtres entre eux.
 Dafné (Federico Biondi, Italie, 2019)
Dafné (Federico Biondi, Italie, 2019)
Sur le papier, Dafné avait de quoi rendre méfiant, livrant un argument propice au pathos le plus obscène. Qu’on se rassure immédiatement, ça n’est pas le cas. Dafné, trisomique, la trentaine, voit sa vie bouleversée par la mort brutale de sa mère. Se retrouvant seule avec son père en proie à la dépression, elle réinvente ses rapports avec lui, ses envies, sa vie. D’emblée Federico Biondi évite adroitement les clichés, en précipitant son exposition, nous jetant simultanément dans l’existence de son héroïne et dans son drame. Nous faisons la connaissance de Dafné et de sa douleur. Juste le temps de faire la connaissance de sa mère, et elle disparaît à jamais. Cette instantanéité est un choix à la fois surprenant et judicieux qui nous place au cœur du mouvement et évite toute tentation de mélodrame. Dafné apparaît comme une boule d’énergie, pleine de vitalité et de rage, sans filtre. Elle emporte le film dès ses premières séquences, nous apprivoisant de son formidable tempérament, et interrogeant notre regard contradictoire. La trisomie – dont est atteinte Dafné, comme Carolina Raspanti l’actrice qui l’incarne –, dans son acception la plus concrète, désigne une anomalie chromosomique, provoquant ainsi de notre part un regard biaisé, distancé, observateur. Constamment à hauteur d’héroïne, sans jamais jouer sur la corde sensible et s’apitoyer sur son sort, Dafné opte pour un ton plein de légèreté d’où naît l’émotion vraie, naturelle, celle de l’élan vital. L’héroïne possède une force que beaucoup pourraient lui envier, une capacité à tout dire avec la délicatesse d’un tank, quitte à brusquer. Fusionnant la candeur enfantine et une lucidité faisant défaut à beaucoup d’adultes, son mode de communication est parfois d’une violence incroyable, sans pitié, comme en témoignent ces phrases cinglantes lancées à son père paralysé dans sa douleur, lui enjoignant de se bouger les fesses, ou la manière dont elle éconduit avec humour un soupirant dragueur atteint lui aussi de trisomie. La crainte que génère ce type d’œuvre provient de l’écriture d’un personnage volubile au potentiel tellement dramatico-comique que le scénariste peut être tenté de lui offrir bons mots et situations cocasses. Mais Biondi, qui à l’origine n’avait pas donné le scénario à ses acteurs, laisse une grande place à l’improvisation, permettant ainsi à la fabuleuse Carolina Raspanti de nourrir Dafné de son propre moi et de lui léguer son authenticité. La mise en scène de Biondi maintient cet équilibre entre l’exposition de sa truculence et la pudeur du regard, une parfaite distance entre la caméra et Dafné, entre le rire et l’émotion, ménageant également de belles ellipses. Même si Carolina Raspanti vampirise l’attention, Antonio Piovanelli, vu notamment chez Bellocchio et Bertolucci, tout en subtilité, bouleverse dans le rôle de ce père vieillissant et dépassé. Le parcours de Luigi et de sa fille constitue une splendide histoire d’amour, une initiation au temps qui passe inexorablement et au moyen de l’accepter. On la prend pour une enfant, Dafné, parce que sa spontanéité permanente trompe l’œil. Et pourtant c’est bien une adulte qui flirte avec les garçons, déclare « avoir besoin de son intimité » lorsqu’on ouvre la porte de manière impromptue. Comme si les rôles étaient susceptibles de s’inverser, en cette balade qui constitue un apprentissage l’un de l’autre, c’est Dafné qui conduira Luigi à la renaissance, finissant par endosser la responsabilité de mère. Elle offre à son père un apaisement, une nouvelle appréhension de l’existence et comme en témoigne la poétique métaphore finale, un nouveau souffle.
Carturan (Liviu Sandulescu, Roumanie, 2019)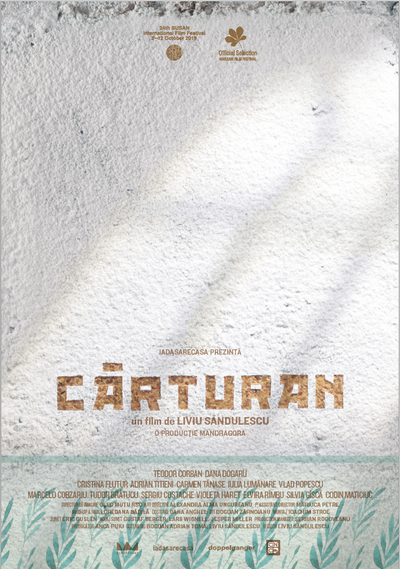
Du jour au lendemain, Vasile Carturan apprend qu’il n’aura pas de futur : les résultats médicaux sont catégoriques, il n’a plus que quelques mois à vivre. Avant que ses forces ne l’abandonnent, il a quelques affaires urgentes à régler et surtout trouver un foyer à son petit-fils, qui n’a que lui. Vasile Carturan va peut-être mourir, mais il agit comme un vivant : c’est un homme qui marche et l’une des qualités du film de Liviu Sandulescu tient à sa manière d’offrir un film qui respire la vie, et où la mort est dédramatisée. Carturan décidant de mener à bien ses projets, semble parfois extérieur à sa propre mort. Il décide d’organiser – pour perpétuer une tradition familiale – un repas funèbre pré-mortuaire en son honneur, où les invités fêteraient le souvenir du défunt de son vivant, avec la présence du futur cercueil, vide, semblant attendre la suite. Le refus du prêtre de participer à cette « mascarade » permet au cinéaste de s’interroger sur les conflits entre religion et superstition. Mais le désir de Liviu Sandulescu d’éviter toute effusion sentimentale finit par miner le film, le conduisant vers une absence totale d’émotion, comme s’il s’en méfiait. A force de quête de l’épure, de sobriété et de fuite de spectaculaire, Carturan finit par indifférer, manquant de manière flagrante ses deux climax attendus : l’annonce de la nouvelle à son petit-fils – séquence mal écrite et peu crédible, qui provoque plus la perplexité que l’émotion espérée – et la fête finale qui ne se détache nullement du reste du film. La multiplication des plans fixes interminables qui laissent dialoguer les personnages, la photo réaliste dans la tradition de documentaires anonymes, apparaissent d’abord comme un parti pris puis comme un aveu de manque d’inspiration formelle. Par ailleurs, on comprend bien que Sandulescu préfère observer les mœurs et les confrontations que prendre position, notamment pour le dilemme religieux, mais là, il se refuse tellement à nous aiguiller qu’il en devient abscons, illustratif et finalement très anodin.
 Disco (Jorunn Myklebust Syversen, Norvège, 2019)
Disco (Jorunn Myklebust Syversen, Norvège, 2019)
La Norvège, ses lacs, ses fjords, ses groupes de pop et ses sectes religieuses ! Disco suit les traces d’une jeune fille de 19 ans championne de danse « disco » qui grandit entre ses espoirs de jeune star et son éducation dans une famille appartenant à une communauté évangélique. La mise en rapport entre ces deux mondes avait tout pour créer une confrontation explosive. Comment faire cohabiter un monde de paillettes et de jeunes filles en compet’ à moitié déshabillées et celui d’un embrigadement vers la foi vampirique, la dénégation et la culpabilisation de soi, l’amour du Christ effréné ? Que veut réellement dire la cinéaste en mettant en place ce dualisme symbolique ? Une obscénité parallèle entre celle qui s’offre en spectacle et celle qui se dissimule sous ses spectacles bienveillants ? Cette communauté manipule, lave les cerveaux de ses jeunes fidèles à travers ses shows plein de fumigènes, d’effets spéciaux et ses groupes de rock chrétiens. Séduire la jeunesse, la caresser dans le sens du poil pour mieux anéantir leur esprit. Après avoir planté son décor avec un très bel enchainement de séquences au montage étonnant, Jorunn Myklebust Syversen peine à faire démarrer son intrigue et, plus gênant, à étayer son propos, de plus en plus invisible (le rapport danse/religion devient vite un gadget peu exploité). Certes l’enchainement de sermons de toutes sortes sert à traduire l’étouffement de son héroïne passant de Charybde en Scylla, vers une secte en apparence plus discrète, mais plus destructrice encore. Mais lorsque la dénonciation ne passe que par l’accumulation répétitive de séquences évoquant l’amour christique et l’abandon de soi, elle enferme le film tout autant que son héroïne dans une mécanique vaine. Ne pas cesser de représenter pour démontrer constitue hélas, un aveu d’échec. Plus troublante en revanche est l’étrange connexion provoquée par cet étalage d’un bonheur collectif illusoire. Le fait est qu’on se surprend à imaginer l’intervention, au milieu de ces louanges et hymnes destructeurs d’un autre fanatique à l’instar d’Anders Behring Breivik s’attaquant au camp d’été de la Ligue des jeunes travaillistes à Utoya. A se demander s’il n’existe pas une réminiscence – assez terrifiante il faut bien le dire – consciente ou non de la part de la cinéaste de cet événement traumatique lors d’une séquence de fausse alerte où les adeptes sont réveillés en pleine nuit au son d’un « alarme, alarme ».
Il y avait matière à un splendide portrait d‘une adolescente dans la tourmente, essayant tant bien que mal de se forger une identité propre tandis que la collectivité lui dénie tout droit à l’individualité. Ce thème magnifique n’est malheureusement qu’effleuré, pour un résultat finalement assez sinistre sous la blancheur diaphane de sa photo. Disco donne furieusement envie de se laver de ses pêchés en revoyant Midsommar, qui envoie valser tous ces ennuis christiques à grands coups de rites païens.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).









