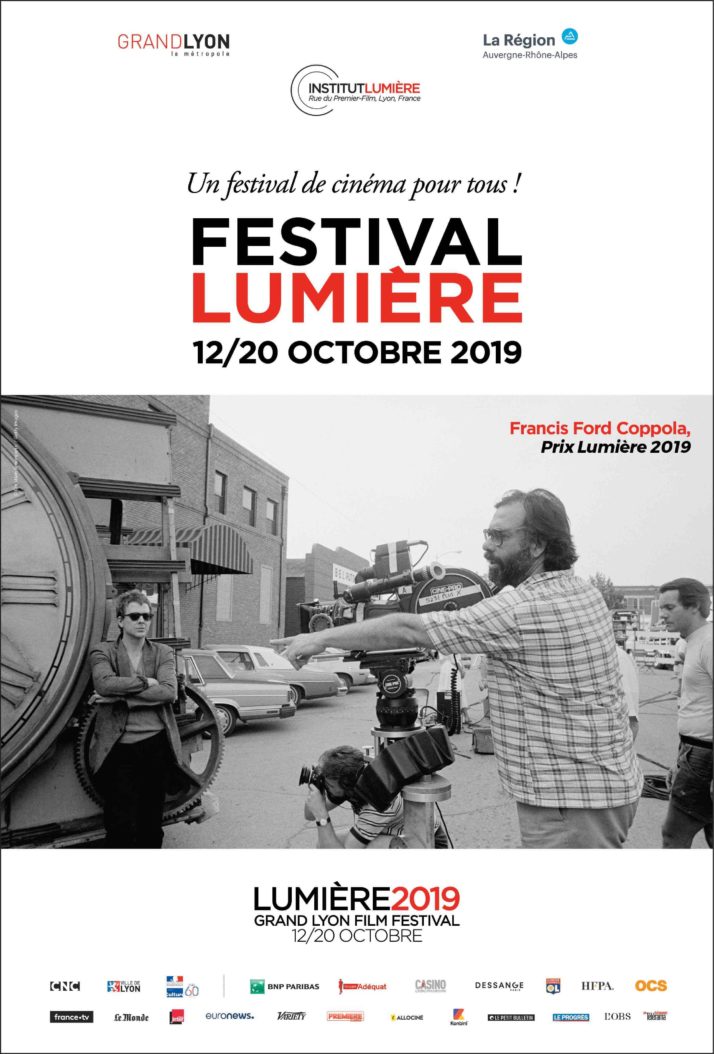Nous avions évoqué dans sa globalité l’édition dixième anniversaire du Festival Lumière à travers une première partie de compte rendu. Nous allons au cours de la seconde, focaliser l’attention autour de deux temps forts tout à fait sélectif. D’un côté, le retour d’un roi, le Prix Lumière 2015, M. Martin Scorsese. Annonce de dernière minute ou presque, la première projection hexagonale (deux jours avant de se rendre à la cinémathèque française) de son nouvel opus, The Irishman. Le film ne sera que très peu visible sur grand-écran dans nos contrées puisqu’il sortira à la fin du mois de Novembre en exclusivité sur Netflix. On ne va pas engager de débat sur le géant de la SVOD, notre position sur la question n’a pas bougée depuis notre paragraphe l’an passé pour le texte Lumière 2018 – Seconde Partie : La Parenthèse Alfonso Cùaron). De l’autre, celui que l’on a souvent appelé « l’enfant terrible » du cinéma français, Gaspar Noé. Invité régulier du Festival Lumière, il avait notamment eu droit en 2016 eu droit à une rétrospective un an après la sortie de Love. Cette fois une Mini-nuit lui était consacré, nous proposant dans l’ordre suivant, Irréversible, le moyen-métrage Lux Æterna et le nouveau montage, Irréversible – Inversion intégrale. Étouffons d’entrée de jeu toute ambiguïté, l’auteur de ces lignes considère le réalisateur de Taxi Driver comme l’un des plus grands cinéastes américains en activité (mais aussi de l’Histoire du cinéma) et celui d’Enter The Void comme l’un des plus précieux talents de l’hexagone pour ne pas dire davantage. Trêve de digressions commençons par l’un des événements les plus fantasmés de l’édition, la projection à l’Auditorium – Orchestre National de Lyon du film marquant la réformation du tandem Scorsese-De Niro.
The Irishman
Projet attendu comme l’arlésienne depuis sa première évocation il y a maintenant plus de dix ans, The Irishman cumule d’un même élan plusieurs fantasmes scorsesiens et cinéphiles. À commencer par les deux plus évidents, les retrouvailles d’un duo et le retour à un genre fétiche. Neuvième (et ultime ?) collaboration entre Martin Scorsese et Robert De Niro, lesquels ont ensemble durablement marqué l’Histoire du cinéma, de la première Mean Streets (1973) à la désormais avant-dernière, Casino (1995). Vingt-quatre ans après l’avoir laissée, pourrait-on même dire clôturée, le cinéaste retourne à la fresque criminelle, soit une veine ayant largement contribué à sa renommée. À l’origine, il y a un roman de Charles Brands, I Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride by Jimmy Hoffa, basé sur la vie de Frank Sheeran, apporté au metteur en scène par l’interprète de Travis Bickle. Sheeran aka l’Irishman du titre fut un haut fonctionnaire au sein d’un syndicat professionnel de conducteur routiers nommé Teamsters (l’un des plus grands des États-Unis) présidé par Jimmy Hoffa, deux hommes largement accusés de liens étroits avec le crime organisé. Le personnage de Hoffa a déjà été évoqué dans la culture populaire, d’abord comme source d’inspiration pour F.I.S.T de Norman Jewison (écrit par Sylvester Stallone qui tenais également le rôle principal) puis plus directement dans le long-métrage de Danny DeVito, sobrement intitulé Hoffa, où Jack Nicholson incarnait le dirigeant. Régulièrement annoncé puis délaissé au profit d’autres longs-métrages, The Irishman est à la fois le film le plus long (quasiment 3h30) et le plus cher de son réalisateur, ce qui peut suffire à expliquer sa gestation compliquée. Officialisé pour de bon au milieu des années 2010, le projet connaît un nouveau coup d’arrêt en février 2017, lorsque la société de production mexicaine Fábrica de Ciné se rétracte en raison d’un budget jugé trop onéreux. Dans la foulée, la Paramount, qui dispose alors des droits de distribution, se retire. Toujours à l’affût pour frapper un gros coup et orner son catalogue de prestige, le géant de la SVOD Netflix, rachète les droits et laisse carte blanche à Scorsese pour mener son dessein à bien. Outre Robert De Niro dans le rôle de Frank Sheeran, Joe Pesci sort de sa retraite pour camper une figure éminente du gangstérisme, Russell Bufalino, tandis, qu’Al Pacino fait son baptême devant la caméra du Maestro en incarnant Jimmy Hoffa. À 76 ans, le cinéaste reste sur une série de réussites majeures faisant de la décennie en cours l’une des plus passionnantes de sa carrière. Outre Le Loup de Wall Street, Hugo Cabret et peut-être plus encore Silence, doivent-être perçus pour ce qu’ils sont : des grands films aussi essentiels que viscéralement intimes. Avant la découverte, subsiste toutefois une question légitime : que peut-il apporter à un registre autrefois quitté en majesté ?

The Irishman – Copyright Netflix 2019
Au terme d’un mouvement inaugural, fluide mais aussi spectaculaire, la caméra déambule à l’intérieur d’une maison de retraite jusqu’à nous présenter un Robert De Niro vieilli et en chaise roulante. Un brin d’ironie traverse ce premier indice quant à la santé de son metteur en scène et son insolente jeunesse. Il s’agit aussi d’un leurre, la forme flamboyante qui semble s’annoncer, caractéristique de celles des Affranchis ou de Casino, ne sera pas reconduite. Frank Sheeran n’est ni Jimmy Conway ni Sam Rothstein, même s’il partage avec ce dernier une certaine sobriété, il ne dispose pas de réel pouvoir décisionnaire. Second couteau du crime organisé, éternel numéro deux, tiraillé entre sa loyauté et ses obligations, il est à une place convoitée tout en étant inévitablement positionné dans l’ombre sans réelle possibilité d’ascension. En si durant son premier acte, The Irishman, semble s’inscrire directement dans la continuité de ses prédécesseurs, c’est pour progressivement bifurquer et emprunter une trajectoire plus introspective. Nous sommes bien face à un rise and fall scorsesien avec ce que cela peut impliquer de motifs connus (la rivière dans laquelle sont jetées les armes, rappelle par exemple le désert de Las Vegas où étaient jadis enterrés les cadavres), de thématiques abordées (la rédemption, ici impossible, est toujours aussi importante) et de péripéties potentiellement attendues (à une nuance près, l’ascension est plus « prévisible » que la chute). Un point est particulièrement significatif d’une évolution dans l’approche, celle de la violence. On se souvient subitement de montées de sauvagerie inouïs, d’éclairs ultra-violents imprévisibles parfois gratuits, parfois choquants. La fonction de tueur à gages du héros revêt une appellation presque poétique : « celui qui peint les murs ». Dans les faits, la violence est au choix expédiée froidement ou évacuée hors champs, d’une certaine manière, on est plus proche de Funny Games que des Infiltrés. Cette apparence, plus rigide qu’à l’accoutumée, étonne d’autant plus que le film, regorge de pures scènes de comédies, pas amenées de manière aussi franche que sur Le Loup de Wall Street mais il n’empêche, l’humour a pleinement sa place au sein de la fresque.

The Irishman – Copyright Netflix 2019
Motif inédit et source potentielle de scepticisme, le challenge technologique inspiré par le de-aging (outil permettant de rajeunir et vieillir numériquement certains des acteurs). Procédé pas toujours heureux, comportant le risque de figer les visages, nuire à l’expressivité des interprètes, freiner l’émotion, ici employé pour la première fois par le metteur en scène. Si Martin Scorsese s’était emparé avec virtuosité et intelligence de la 3D en 2011 pour Hugo Cabret, il n’a pas toujours été attiré par les technologies de pointe. Dans le cas présent, il s’en sert, notamment, pour rajeunir (puis vieillir) Robert De Niro, qu’il a par le passé, filmé, de ses trente à cinquante-deux ans, dont il a imprimé durablement le visage à travers ses pellicules. Même s’il pourra demander un petit temps d’adaptation, le résultat est globalement convaincant et ouvre la voie à l’une des perspectives les plus excitantes du film. Le travail opéré sur De Niro nous rappelle au souvenir de l’une de ses plus grandes prestations, celle de Jake La Motta dans Raging Bull. Dans l’épilogue de ce dernier, le comédien apparaissait vieilli, à l’aide de moyens plus artisanaux, à savoir maquillage et prothèses. Ce vieillissement prématuré était un champs des possibles, qui de fait ne correspond pas à la réalité, de la même façon que cette nouvelle jeunesse proposée dans The Irishman est irréelle mise en rapport avec la vraie. Ce dernier point ouvre l’une des pistes les plus stimulantes du film. Un jeu entre le vrai et le faux, où Scorsese manie les grandes figures, réelles et fictives (héritées de sa propre mythologie cinématographiques). L’Histoire qu’il a écrit dans le cinéma et celle des États-Unis sont amenées à se télescoper, s’entrechoquer et en fin de compte dialoguer et s’interroger. La réformation du duo De Niro/Pesci, tous deux excellents (mention spéciale pour le second sidérant de justesse et d’intériorité contenue), induit avec elle la mémoire de leurs relations passées sous cette même caméra. En connaissance de ces antécédents, l’inversion hiérarchique constatée dans leur rapport, double celui ci d’un parfum de revanche pour celui qui joua Joey LaMotta et Nicky Santoro. Évolution et revisite de l’un des plus beaux tandems des cinquantes dernières années. À l’inverse, l’interprétation d’Al Pacino, employé dans un registre autrement plus excessif et cabotin (et jubilatoire) que ses partenaires se nourrie de fantasmes. Le spectre de ses incarnations de Michael Corleone, Tony Montana ou Carlito Brigante plane, à la fois comme une fusion possible dans son Jimmy Hoffa, mais aussi en faisant germer l’idée que ses gangsters cultes du septième art, ont supplantés les vrais, spécimen qu’il campe ici. Ce trio phare – Sheeran / Bufalino /Hoffa – n’est pas seul. Parmi les seconds rôles on croise différents visages clés de la carrière du cinéaste, de son premier long-métrage Who’s That Knocking at my door à ses récentes incursions télé. On remarque la présence discrète de son premier acteur fétiche, Harvey Keitel et du rôle principal de sa série Vinyl, Bobby Cannavale (également vu dans Boardwalk Empire).

The Irishman – Copyright Netflix 2019
Mis à par Gangs of New York, son grand projet partiellement mutilé par un producteur que l’on ne prendra pas la peine de nommer, Scorsese n’a jamais abordé aussi frontalement l’Histoire américaine. À l’écriture des deux films, on peut retrouver un même nom, Steven Zaillan. Scénariste d’envergure, qui a collaboré avec Steven Spielberg (La Liste de Schindler), Ridley Scott (Hannibal, American Gangster, Exodus), David Fincher (Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes) ou encore Brian De Palma (Mission : Impossible) et Sidney Pollack (L’Interprète). Un auteur n’aimant rien tant qu’ausculter des rapports de forces et de pouvoirs remis en cause afin de les inscrire dans une perspective historique. Ainsi, The Irishman, évoque plusieurs épisodes importants des années 60, du débarquement de la baie des Cochons (tentative ratée d’inversion militaire à Cuba) à l’élection de John Fitzgerald Kennedy puis son assassinat, de la nomination de son frère Bobby au ministère de la justice à la guerre du Vietnam en passant par l’élection de Nixon etc. La fresque dense et ample, basée sur un scénario complexe, à la structure divisée en trois temporalités distinctes, bénéficie des qualités de conteur d’un cinéaste qui lui confère une fluidité narrative peu évidente. L’étude de la vie mafieuse de Frank Sheeran, tend un miroir sur le monde « légal » autant qu’un éclairage désabusé sur des périodes clés. Martin Scorsese ausculte un pays corrompu, bâti sur des institutions gangrénées de l’intérieur. En comparaison, Casino, via la création de Las Vegas, ne montrait qu’un échantillon. L’intégrité artistique, l’éthique cinématographique dont a toujours fait montre le cinéaste, devient une sorte de dernier rempart contre un monde (et une industrie) en décomposition. Geste romantique et mélancolique d’un géant, qui n’entend pas céder à la facilité de la nostalgie. The Irishman, n’est pas le baroud d’horreur d’une génération d’acteurs hors pairs, qui retrouvent des sommets qu’ils n’auraient – idéalement – jamais dû quitter. La durée fleuve, épouse un dessein qui prend peu à peu tout son sens jusqu’à un dernier acte inédit dans l’œuvre du metteur en scène. Patient, Martin Scorsese observe et étudie le temps, celui qui passe et celui qui reste. Si ses personnages comptent parmi les plus touchants qu’il ait filmé, cela tient à un regard à hauteur d’homme, les yeux dans les yeux, sans omission ni complaisance. Une nouvelle question s’invite, celle de la mort, de la fin qui se rapproche à travers son alter ego de toujours, Robert DeNiro. Presque Eastwoodien dans sa facture testamentaire, il nous offre à contempler un homme rongé par les regrets, ses erreurs, son passé, l’impossibilité de se racheter, se repentir. Le film se double alors d’une émotion bouleversante, accentuée par plusieurs considérations : l’adieu définitif à un genre, à un pan de notre cinéphilie, la fin d’une Histoire sublime. On laissera le temps décider de la place conférée à The Irishman dans l’édifice scorsesien. Poursuivons brièvement l’analogie avec Clint Eastwood, après avoir dit au revoir au western en 1992 (Impitoyable), l’interprète de Dirty Harry a continué d’écrire sa légende et aligner les chefs d’œuvres. On ne doute pas que Scorsese en fasse autant.

The Irishman – Copyright Netflix 2019
Mini-Nuit Gaspar Noé
Irréversible / Irréversible – Inversion Intégrale
Accueilli telle une rockstar par une salle comble, Gaspar Noé a surpris en venant présenter Irréversible aux côtés de Monica Bellucci en lieu et place d’Albert Dupontel pourtant annoncé. Projeté deux fois au sein de la même soirée, entrecoupé par Lux Aeterna, le long-métrage qui fit scandale en 2002 sera prochainement à redécouvrir en salles, en copies restaurés et en deux montages. Le premier étant l’orignal, autrement dit monté dans un ordre antéchronologique, le second renommé Inversion Intégrale, raccourci d’un peu plus d’une dizaine de minutes et proposant une chronologie linéaire. Nous étions étrangement excité à l’idée de découvrir cette nouvelle version, tant la précédente est durablement imprimée dans nos mémoires depuis un premier visionnage précoce (avant d’avoir l’âge légal si besoin de précision). Le réalisateur s’était par le passé montré plusieurs fois hostile à l’idée de remettre son film dans l’ordre, l’évolution de sa position semblait être un indice de confiance. On aura l’occasion d’en reparler en détails lors de la future ressortie mais disons brièvement, que dix-sept ans après l’impact d’Irréversible est inaltérable et qu’un visionnage en salles est une expérience aussi intense, traumatique qu’extraordinaire et bouleversante. Dans ce contexte, enchaîner si vite sur l’Inversion Intégrale relève de la fausse bonne idée. Le souvenir brûlant oblige à la comparaison, quand les séances rapprochées ont, irrémédiablement, tendance à diminuer l’impact de séquences vues à peine une heure trente plus tôt. Lorsque dans le montage initial, la deuxième moitié, lumineuse, éblouit par sa beauté (renforcée par l’horreur qui a précédé), les séquences remises dans l’ordre se voient ôtées de cette double lecture. Le film ressemble alors à un rape and revenge beaucoup plus classique, au-dessus de la mêlée pour des raisons de puissances formelles et d’interprétations mais inévitablement en-dessous de sa proposition originelle. On a bien du mal à voir ces deux versions cohabiter dans le temps. Peut-être aurait-il été plus judicieux d’en rester à un supplément pour les éditions vidéos à venir comme initialement annoncé ?

Irréversible – Copyright Carlotta Films / StudioCanal
Lux Æterna
Moins d’un an après la sortie de Climax, Gaspar Noé effectuait un retour surprise sur la croisette avec la projection en séance de minuit d’un moyen-métrage de cinquante minutes intitulé Lux Æterna. En février 2019, dans le cadre du projet Self (il s’agit de la quatrième proposition après celles de Daido Muramayama, Vanessa Beecroft et Bret Easton Ellis) de la maison Saint Laurent (pour qui le réalisateur a déjà collaboré, souvenez vous, Les Nuits de l’homme ), Noé est contacté avec la promesse d’un soutien financier s’il dispose d’une idée de court-métrage. Quelques semaines plus tard, à l’aide d’une équipe réduite, d’un casting où Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg croisent dans leur sillage Karl Glusman (Love), Abbey Lee (The Neon Demon) ou encore Félix Maritaud (120 Battements par minutes/Sauvage) et sur la base d’une trame minimaliste aux dialogues improvisés, il en résulte un essai approchant l’heure de durée. Immersion sur un plateau de cinéma où Béatrice Dalle (dans son propre rôle) réalise son premier film. Charlotte Gainsbourg, doit y tenir le rôle d’une femme amenée à être brûlée vivante pour sorcellerie. Le tournage se passe mal, l’atmosphère est de plus en plus tendue, le chaos se répand…
Ouverture sur un carton (vantant les bienfaits de l’expérience d’une crise d’épilepsie ou plutôt des sensations ressenties juste avant qu’elle ne se produise) qui donnera au choix, fous rires moqueurs ou démangeaisons instantanées chez les détracteurs du réalisateur. Si l’on ajoute des références prestigieuses fréquemment exhibées (avec ce qu’il faut d’insolence pour intriguer et amuser d’un même élan) à coup de citations allant de Carl Theodor Dreyer à Jean-Luc Godard en passant par Rainer Werner Fassbinder, Pier Paolo Pasolini ou encore Luis Bunuel ainsi qu’un pitch évoquant une possible variation de Climax dans le milieu du cinéma : Lux Æterna semble venir consolider les positions entre les adeptes et les autres. Pourtant ces apparences sont trompeuses et Noé réserve plus d’une surprise à ses spectateurs. Cela commence dès le long split-screen observant un première échange presque paisible au coin d’un feu entre la néo-réalisatrice et son actrice. Il se contente alors de filmer des actrices investies (et potentiellement parmi les plus talentueuses avec qui il a pu collaborer), se mettant judicieusement et subitement en retrait, rappelant tout juste sa présence à coup de cartons citationnels. Le dépouillement apparent du projet épouse l’urgence de ses conditions de tournage, lesquelles lui confère une énergie nouvelle rapport aux réalisations précédentes de son auteur, où plus que jamais l’œuvre semble se créer dans l’instant avant de s’épuiser puis s’arrêter quand il n’y a plus d’énergie disponible.

L’aspect vaguement récréatif de l’essai, la légèreté relative (surprenante soit dit en passant) du dialogue de départ, est rattrapé par une réalité : les dures lois d’un tournage, lequel va virer peu à peu au cauchemar. Pas de drogue ou de sexe dans le cocktail mais un regard simultanément moqueur et acerbe sur les coulisses du métier. Gaspar Noé se libre à un commentaire plutôt osé tout en se saisissant des possibilités visuelles qui s’ouvre à lui, afin de laisser libre cours à ses désirs expérimentaux. De la part d’un cinéaste trop facilement ciblé par des procès en misogynie, le parallèle établi entre le traitement jadis réservé aux sorcières et celui des femmes réalisatrices, viendra peut-être calmer les ardeurs des chantres de la morale et de la vertu. Dépeintes telles des étendards féministes voués à pourfendre un patriarcat dont le pouvoir oppresseur quel qu’il soit, peine à se démentir, Ensuite, quand la « coquetterie » esthétique semble un temps se résumer à l’usage (captivant) de split-screens démultipliant les perspectives, le metteur en scène prépare sagement son coup jusqu’à nous amener à un final stroboscopique ahurissant. Il fait mine de se cacher pour mieux réapparaître quand on ne l’attend plus, confond sciemment le film dans le film et le sien. La simplicité première révèle peu à peu une sophistication stimulant à la fois les sens et l’intellect. Lux Æterna s’impose de fait comme la réalisation la plus abordable de son auteur, mais aussi celle témoignant le plus (malgré ce qu’elle raconte) du plaisir de filmer, créer, conceptualiser, comme une expérience collective et non un simple caprice égocentrique. Revigorant, éblouissant et assourdissant.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).