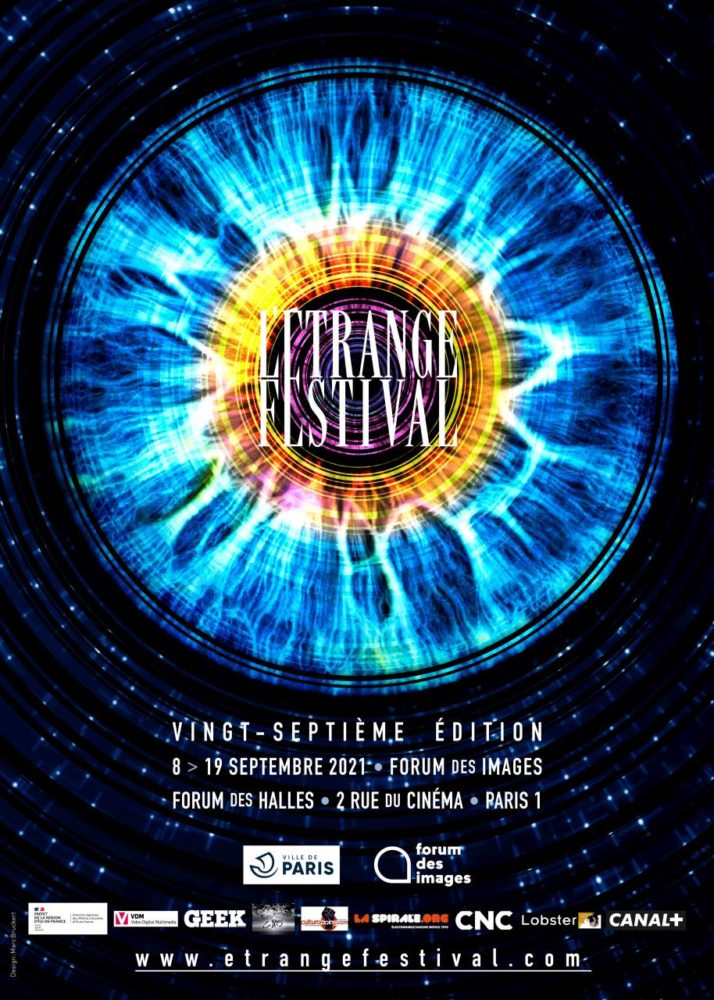Théâtre rêvé
 Programmé dans la sélection Nouveaux Talents, Il était une fois Palilula n’est pas si neuf. Réalisé en 2012, unique long métrage de l’homme de théâtre roumain Silviu Purcarete, ce film n’avait jamais jusque-là franchi assez de frontières pour arriver jusqu’à nos écrans hexagonaux. Peut-être justement trop théâtral (on peut déceler assez aisément les origines artistiques de son réalisateur), jurant trop avec les films réalistes et/ou conceptuels des jeunes tenants de la Nouvelle Vague roumaine ayant déferlé sur les rivages cinéphiles depuis le mitan des années 2000.
Programmé dans la sélection Nouveaux Talents, Il était une fois Palilula n’est pas si neuf. Réalisé en 2012, unique long métrage de l’homme de théâtre roumain Silviu Purcarete, ce film n’avait jamais jusque-là franchi assez de frontières pour arriver jusqu’à nos écrans hexagonaux. Peut-être justement trop théâtral (on peut déceler assez aisément les origines artistiques de son réalisateur), jurant trop avec les films réalistes et/ou conceptuels des jeunes tenants de la Nouvelle Vague roumaine ayant déferlé sur les rivages cinéphiles depuis le mitan des années 2000.
Car Palilula, ville fictive à la population pittoresque où se situe l’action du film, ressemble ne effet à un énorme plateau de théâtre, lieu à la fois assez grand pour abriter ses habitants tous plus extravagants les uns que les autres et assez petit pour être coupé d’un monde qui ne le remarquera même pas. Palilula évoque quelque peu le Macondo de Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez par ses allures picaresques et par cette idée tenace d’une ville en vase clos figée dans le temps mais aux constantes évolutions qui se font presque malgré elle. Nous connaîtrons l’endroit grâce à Serafim, jeune docteur arrivant par le train sous la neige dans cette étrange bourgade où il semble presque inutile (le médecin est obstétricien dans une ville qui ne voit plus naître d’enfants !) mais où il est inexplicablement attendu de pied ferme par la population.
Et le film de se faire chronique d’un temps qui passe, qui tourne en boucle tout en accueillant de façon plus ou moins gentille ou extravagante les événements toujours teintés d’onirisme qui vont rythmer cette vie où le dérèglement est une règle. La fresque de Silviu Purcarete, apparemment très personnelle, n’est pas sans rappeler parfois le Fellini de Roma (1972) par sa façon de considérer le temps comme une notion abstraite et malléable puisque dépositaire de la mémoire, par son choix de faire de sa ville-monde une artificialité faite de carton-pâte et de magie du rêve, par une volonté de porter la poésie baroque de son cinéma à une sorte de sommet exubérant. Tout ceci recèle un charme, une mélancolie, un sens de la nostalgie très touchants, permettant d’oublier quelques moments que l’on pourrait considérer comme « de trop ». Mais en même temps, l’essence même des plus beaux rêves n’est-elle pas de durer parfois plus qu’il ne faudrait tout en nous faisant dire au réveil que tout cela n’a pas duré assez longtemps ? Le rêve chez Marquez n’a-t-il pas duré cent ans ?
Beau film théâtral donc, dont les décors modulables (ansi que les personnages eux-mêmes, dont certains peuvent changer de visage !) nous laissent quelquefois dans le doute quant à savoir si ce que nous avons vu deux minutes plus tôt est bien advenu. Ou la vision d’Il était une fois Palilula comme une série de songes enchâssés se chassant les uns les autres.
Hallucinations collectives
 La Fièvre de Petrov est le troisième film de Kirill Serebrennikov à être diffusé sur le territoire français, ceci après Le Disciple (2016) et le triomphe Leto (2018) que l’on est en droit d’avoir toujours trouvé un peu abusif. Car à froid, il est possible que le coup de hype cannois ait été en son temps provoqué pour de mauvaises raisons : le metteur en scène et cinéaste russe venait d’être assigné à résidence du fait de ses œuvres polémiques et acerbes envers le pouvoir poutinien, le film traitait du punk et du post-punk (et un Russe qui parle de punk, c’est audacieux) dans une mise en scène léchée et classieuse en noir et blanc finalement proche des canons du cinéma occidental (qui n’était par exemple pas sans rappeler la mise en scène du Control d’Anton Corbijn [2007])
La Fièvre de Petrov est le troisième film de Kirill Serebrennikov à être diffusé sur le territoire français, ceci après Le Disciple (2016) et le triomphe Leto (2018) que l’on est en droit d’avoir toujours trouvé un peu abusif. Car à froid, il est possible que le coup de hype cannois ait été en son temps provoqué pour de mauvaises raisons : le metteur en scène et cinéaste russe venait d’être assigné à résidence du fait de ses œuvres polémiques et acerbes envers le pouvoir poutinien, le film traitait du punk et du post-punk (et un Russe qui parle de punk, c’est audacieux) dans une mise en scène léchée et classieuse en noir et blanc finalement proche des canons du cinéma occidental (qui n’était par exemple pas sans rappeler la mise en scène du Control d’Anton Corbijn [2007])
Serebrennikov est toujours ennuyé par le régime poutinien, son cinéma est toujours mordant mais le nouveau cru de cet artisan de talent s’avère beaucoup plus russe, ce qui fait que l’accueil cannois s’est fait cette année plus tiède qu’il y a trois ans. Dommage : La Fièvre de Petrov lui est pourtant très supérieur. L’argument du film est très simple : Petrov est un auteur de bande dessinée qui, malade de la grippe et méchamment enfiévré, va vivre une nuit de sévère beuverie avec une connaissance interlope, Igor. En parallèle, la femme dont il est séparé s’occupe de leur fils auquel il semble avoir refilé son mal. A partir de cette trame, Serebrennikov va faire un film débordant comme une marmite bouillonnante, adoptant visuellement et narrativement le point de vue du malade, créant ainsi une sorte de récit hallucinatoire, fiévreux et éthylique, distordant l’espace, le temps, les perceptions (les filtres de couleur teintant nombre de séquences d’un chromatisme allant du toxique au cadavérique) et multipliant les récits enchâssés jusqu’à une perte de repères parfois troublante. A ce récit principal s’accolent les scènes imaginées par Petrov pour alimenter son travail d’artiste, elles-mêmes influencées par l’esprit en surchauffe de leur auteur (dont une scène filmée en un plan-séquence de dix-sept minutes montrant le désarroi incendiaire d’un romancier alter ego du dessinateur qui, rejeté par une maison d’édition pour cause de travail trop audacieux, devient criminel et pyromane), ainsi que les images d’une mémoire d’enfance qui remonte lors d’une dernière partie de film en noir et blanc mélancolique et formellement apaisée.
Derrière ses allures désordonnées, son appétit d’ogre avalant tout sur son passage au risque d’une obésité pouvant désarçonner, La Fièvre de Petrov est une œuvre d’une maîtrise impressionnante, tant visuellement (rien n’est laissé au hasard dans une mise en scène dont le capharnaüm n’est qu’apparent) que dans sa narration éclatée où l’on se perd régulièrement mais qui s’avère finalement d’une cohérence étonnante au regard de son flash back en noir et blanc, pièce du passé à laquelle répond finalement l’ivresse malade de Petrov dans un présent russe qui, lui-même, ne va pas très bien. Car Kirill Serebrennikov, par l’intermédiaire de son personnage grippé, se fait bien sûr analyste de la Russie poutinienne actuelle, elle-même malade et en surchauffe, perdant les repères qui ont pu faire sa grandeur, le changement de tonalité générale lors de la dernière demi-heure du film évoquant avec une véritable mélancolie un passé plus paisible dans lequel germaient cependant les tares qui ont contaminé la version contemporaine de ce pays devenu, à l’instar de Petrov, des personnages qu’il invente (dans lesquels nous pouvons retrouver la figure de l’artiste maudit tel que le cinéaste se dépeint lui-même) et peut-être du film lui-même, une masse erratique et hallucinée perdant les unes après les autres les amarres qui l’attachent au rivage du raisonnable.
Sociologie du crime
 Certains voyages valent plus pour le trajet que pour la destination. C’est par exemple le cas de la grande littérature policière, dont il faut mieux évacuer d’emblée la résolution finale afin de goûter le mieux possible le cheminement menant vers l’irrémédiable. C’est ce que fait Bruno Reidal, remarquable premier long-métrage de Vincent Le Port, en montrant le jeune personnage éponyme interprété par l’acteur novice Dimitri Doré en train de décapiter un jeune berger de douze ans. La scène est terrible, violente, mais s’avère un aboutissement dès son démarrage : on sait que le garçon est coupable, qu’il sera condamné ; mais se pose une question, toujours passionnante dans les histoires de faits divers : comment en est-il arrivé là ? C’est à cette interrogation que ce film, marchant dans les pas du fameux Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… de René Allio (1976), tente de répondre dans une démarche de sociologie du crime.
Certains voyages valent plus pour le trajet que pour la destination. C’est par exemple le cas de la grande littérature policière, dont il faut mieux évacuer d’emblée la résolution finale afin de goûter le mieux possible le cheminement menant vers l’irrémédiable. C’est ce que fait Bruno Reidal, remarquable premier long-métrage de Vincent Le Port, en montrant le jeune personnage éponyme interprété par l’acteur novice Dimitri Doré en train de décapiter un jeune berger de douze ans. La scène est terrible, violente, mais s’avère un aboutissement dès son démarrage : on sait que le garçon est coupable, qu’il sera condamné ; mais se pose une question, toujours passionnante dans les histoires de faits divers : comment en est-il arrivé là ? C’est à cette interrogation que ce film, marchant dans les pas du fameux Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… de René Allio (1976), tente de répondre dans une démarche de sociologie du crime.
Bruno Reidal est donc un paysan cantalien vivant dans de rudes conditions, et perdant son père chéri alors qu’il est encore enfant. Très tôt, il prend plaisir à s’imaginer en train d’assassiner ses camarades de classe, tous plus riches, plus gracieux, plus beaux que lui. Un attouchement lui apprendra la masturbation, ce qui fera basculer sa vie et son état mental déjà quelque peu perturbé. La narration du film, un peu systématique, alterne les souvenirs de Bruno dans une mise en scène à la fois aride et pastorale et le récit de sa vie racontée devant un aréopage de médecins des âmes mené par le Docteur Lacassagne (Jean-Luc Vincent) qui lui avait demandé de se remémorer son existence dans une série de carnets intimes. Si le début du récit a un peu de mal à prendre, il devient assez vite cohérent lorsque tous les éléments disparates du parcours du tueur commencent à s’assembler. Le talent de Vincent Le Port se trouve dans cette façon d’agréger les moments forts d’une existence ne semblant pas avoir de rapports véritables les uns avec les autres et d’en faire une sorte de vue d’ensemble, de la même façon qu’avaient les peintres impressionnistes pour créer ; amoncelant trace sur trace de façon presque abstraite, ils finissaient par créer des paysages prenant tout leur sens et toute leur forme grâce à un regard distancié.
Le trouble que provoque Bruno Reidal se trouve dans cette façon qu’a le réalisateur d’élaborer tranquillement ce portrait, la douce précision de la représentation tranchant nettement avec la dureté d’enfant perdu du criminel, considérant la mise à mort comme un acte de jouissance, mettant sur le même plan ses fantasmes de meurtre et sa frénésie masturbatoire, ceci raconté avec la voix haut perchée, presque féminine, d’une sorte de monstre froid qui n’a pourtant pas l’air d’être le nid de violence qu’il est. Triste figure de l’alliance d’Eros et Thanatos, Bruno Reidal est la représentation d’un combat intérieur, du domptage impossible d’une bête assassine qui se révèle toujours plus forte que l’humain. Le début du film est sa fin, symbole imprégnant la narration elle-même d’une enfance à partir de laquelle le garçon était programmé pour tuer ; l’ouverture de Bruno Reidal serait alors comme l’explosion d’une bombe à retardement dont la totalité du film serait le compte à rebours, d’une cruelle fatalité.
Michaël Delavaud
Régler ses comptes
 Le film philippin de la compétition fut aussi l’un des plus réussis. On the Job : The Missing 8 de Erik Matti impressionne, par son ampleur, sa réalisation efficace anti tape-à-l’œil, et son absence de concession vis-à-vis du gouvernement de son pays. Après un premier On the Job déjà remarqué, en 2013, Erik Matti réitère avec ce second volet en en reprenant peu ou prou les ingrédients et le contexte, déplaçant son intrigue des rues de Manille à celles de la ville imaginaire de La Paz.
Le film philippin de la compétition fut aussi l’un des plus réussis. On the Job : The Missing 8 de Erik Matti impressionne, par son ampleur, sa réalisation efficace anti tape-à-l’œil, et son absence de concession vis-à-vis du gouvernement de son pays. Après un premier On the Job déjà remarqué, en 2013, Erik Matti réitère avec ce second volet en en reprenant peu ou prou les ingrédients et le contexte, déplaçant son intrigue des rues de Manille à celles de la ville imaginaire de La Paz.
En 2013, nous suivions deux détenus à la solde de politiciens corrompus, qui bénéficiaient de droits de sortie pour aller exécuter des contrats, et les deux policiers enquêtant sur ces meurtriers. Dans The Missing 8, l’enquête sera principalement menée par un journaliste, suite à la disparition suspecte et simultanée de 7 de ses collègues et de son jeune filleul. Déplacer les codes du polar en collant aux basques d’un quidam en quête de vérité apporte beaucoup au film. Quand de surcroît ce héros se retrouve à cette occasion ébranlé dans son fonctionnement et est amené à sortir de sa condition de citoyen-marionnette pour gagner en intégrité, on obtient un résultat tout à fait passionnant.
Derrière la caméra, on trouve un réalisateur se disant « en colère », écœuré par les exactions politiciennes commises dans son pays, les magouilles, les disparitions, les morts jonchant le sol philippin sous la présidence de Rodrigo Duterte. Dénoncer les crimes, la corruption et la censure des médias de son gouvernement correspond donc ici à une mise en fiction qui se révèle être le triste miroir de la réalité. Au suspense cinématographique s’ajoute une prise de conscience de la situation d’un pays totalement gangrené par le mal, où la vérité, la justice et l’équité sont un combat quotidien.
Concernant la disparition du titre, elle ne fera l’objet d’aucun mystère pour le spectateur : le maire organise le meurtre du rédacteur en chef d’un journal de La Paz. Six de ses collègues et son petit garçon ayant eu le malheur de monter avec lui en voiture pour se rendre à une soirée, c’est l’ensemble de ces huit personnes qui disparaissent d’un coup, leurs corps criblés de balles dans le SUV qui leur servira de tombeau. L’alerte est donnée. Face à ce drame et avec un très mince espoir de les retrouver vivants, Sisoy, animateur radio gouailleur et fanfaron se lance avec quelques collègues dans une enquête qui mettra leur vie à prix et ébranlera nombre de leurs convictions.
Du début à la fin, Erik Matti orchestre de main de maître cet opus labyrinthique dans ses enjeux mais d’une narration remarquablement claire. Pas une minute d’ennui ne vient nous étreindre durant les 3h30 de projection. Le divertissement est généreux sans abuser d’effets de rythme artificiels. Au contraire, le film prend le temps nécessaire et déroule son fil impitoyable au gré d’une construction linéaire partagée entre les différents camps en action (les collègues enquêteurs, le maire et ses pions policiers, le fils du maire et ses ambitions électorales, et enfin le très beau personnage de Roman, prisonnier meurtrier en quête de rédemption). La fresque criminelle est haletante, la charge politique courageuse, et la trajectoire du héros passionnante, depuis les petits arrangements qu’il pensait sans conséquence jusqu’à une soif de justice et de probité inébranlable. Une vraie réussite.
Audrey Jeamart
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).