Lors de la visite de la Cité Médiévale de Carcassonne, la guide ne manque pas de préciser que plusieurs films ont été tournés à l’intérieur de ses remparts. Parmi les productions les plus célèbres, se trouvent Robin des Bois, Prince des voleurs, de Kevin Reynolds, et Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré. Toujours considéré comme un classique du divertissement et de la comédie populaire, le film de Jean-Marie Poiré s’avère pourtant des plus politiques avec sa nostalgie de l’ancien régime et son mépris, à base de clichés rétrogrades, des classes les plus fragiles. Ville chargée d’histoire, décor de cinéma, tout semblait indiquer Carcassonne pour qu’y soit développé le Festival International du Film Politique. « Il n’y a rien de plus fort que le cinéma pour soulever des questions politiques », selon le co-directeur de la manifestation, Henzo Lefèvre. « Le cinéma est une super réponse et une manière de questionner extrêmement forte. Cela découle d’un besoin ou tout du moins d’une situation publique, politique, démocratique qui est moyenne et d’un autre côté, il y a avant tout la passion du cinéma. » À l’heure où le cinéma ressemble à un repaire de vieux cons lubriques, que des sites Internet prétendent dénoncer l’aspect réactionnaire des films en confondant engagement politique et lecture idéologique, redorer le blason du septième art apparaît comme une excellente idée. Pour Henzo Lefèvre, « le film politique englobe le film engagé et le film idéologique. La différence entre les deux est dans la manière dont on questionne ou qu’on apporte une réponse : le film engagé questionne avant tout et expose comment il peut apporter des réponses tout en restant dans le questionnement tandis que le film idéologique apporte des réponses en passant outre le questionnement. »
Les circonstances font que la première édition, qui s’est déroulée du 4 au 8 décembre 2018, tombe en pleine crise des gilets jaunes, alors que les ronds points sont à feu et à sang, que les occupants de l’Élysée vont bientôt devoir vivre retranchés tels John Wayne et Richard Widmark dans The Alamo, assaillis par des manifestants en colère prêts à en découdre. L’instant se révéle propice, l’occasion trop belle, pour débattre de la place du cinéma et le rôle des films dans la société, faire un pont entre les deux manifestations, l’une sociale, l’autre culturelle. Déception ! Le rendez-vous est manqué, le débat n’aura pas lieu. Seul un humoriste fait référence aux fluorescents contestataires dans un piètre sketch donné lors de la soirée d’ouverture.
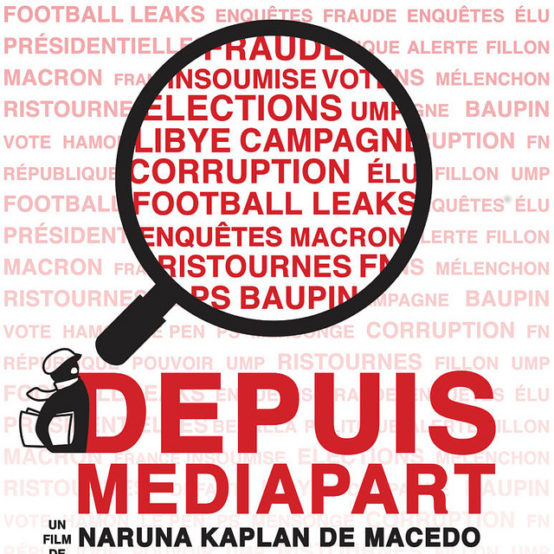
Certes, le mouvement s’est déclaré peu de temps avant le début du festival, et chambouler une programmation déjà établie relève de l’impossible. Cependant, parmi la sélection, un documentaire sorti le 13 mars dernier fait écho aux événements qui agitent le France depuis plusieurs semaines. Avec Depuis Mediapart, Naruna Kaplan de Macedo propose une autre vision d’un métier aujourd’hui mal considéré, le journalisme. « Je crois n’avoir jamais eu de doutes sur le fait qu’il y avait des humains derrière tous ces mots », explique-t-elle. « Je m’intéressais au travail. Qu’est-ce que c’est que le travail journalistique, c’était le point de départ. Très vite, j’ai compris que c’était un travail collectif et cela m’a d’autant plus intéressé. » Pendant deux ans, elle filme les journalistes dans les locaux du webzine. « La plupart des films sur le journalisme sont étrangers », s’emballe le producteur Serge Lalou, qui oublie L’œil du maître de Stéphane Kurc, Un nuage entre les dents de Marco Pico, Judith Therpauve de Patrice Chéreau ou encore Mille Milliards de Dollars d’Henri Verneuil. « Certains sont de la fiction et procèdent de l’héroïsation du journaliste. Ce qui était intéressant ici, c’est effectivement la restitution de la dimension collective qui était une de mes craintes en tant que producteur car, quand j’ai vu les rushes, je me suis dit : ‘’mais ils sont trop normaux ! Comment on va faire des héros, d’une certaine façon, parce que faire un film sans qu’il y ait des personnages qui émergent, cela va être un peu compliqué si jamais ils sont aussi normaux’.’ Tout le travail de filmage, de montage de cette dimension collective et la façon dont est montré le rapport entre les gens, bien plus que des trajectoires individuels de héros, restituent finalement assez bien la dimension de ce qu’est Mediapart. »
Si le sujet peut être intéressant, le film qui en résulte n’entretient que peu de rapport avec le cinéma tellement le filmage est anxiogène, la caméra s’aventurant rarement en-dehors des bureaux de Mediapart « Assez vite, s’est imposé le huis-clos, pour le coup, pour des raisons financières », se justifie la réalisatrice. « Nous avions discuté du fait de suivre les journalistes en reportage, qui vont beaucoup en reportage. » Pour un film qui veut redorer le blason d’un métier qui en a bien besoin, il donne à voir des journalistes plus souvent cantonnés dans leurs bureaux au lieu de se rendre sur le terrain. Par conséquent, la réalisation enchaînent les gros plans sur les visages, les écrans d’ordinateurs et de télévision, comme s’ils vivaient dans une bulle. « Je les ai vraiment trouvés très beaux et j’ai pris énormément de plaisir à les filmer », s’extasie Naruna Kaplan de Macedo. « J’aimais les regarder et les regarder de près. Il se trouve que les locaux, la configuration de cet open space était serrée, les locaux sont très petits. C’était quelque chose dont je me suis facilement accommodé parce que j’aimais les regarder de près. » Cette fascination transforme le documentaire en une véritable hagiographie, longue et pesante, qui épouse des codes très dans l’air du temps : avec une caméra tremblotante et une lumière naturelle particulièrement laide, la forme souffre d’un évident manque de soin. La narration, en plus d’être convenue, propose des séquences qui tombent parfois comme un cheveu sur la soupe et s’avère relativement décousue. Le spectacle de cet entre-soi va difficilement restaurer la confiance d’un grand public de plus en plus méfiant envers les médias, dont les métiers se font de plus en plus précaires.
Jawad Rhalib, avec Au temps où les Arabes dansaient, semble rendre hommage à la culture arabe et ses tendances épicuriennes. Las, le film se perd dans un discours idéologique et biscornu sur la montée de l’islamisme, entre images d’archives et gros plans. Ce choix de mise en scène se révèle étrange pour un film qui veut célébrer la sensualité à travers les danseuses du ventre. Sans oublier cette maladresse d’amalgamer les Perses à des Arabes lorsque le réalisateur s’égare en allant tourner en… Iran. De nos jours, ce genre de gaffe commise par un réalisateur européen aurait provoqué l’ire d’esprits plus consensuels.

D’autres films de la compétition touchent des thématiques similaire sur le racisme et la place de « l’autre » dans la société comme What You Gonna Do When the World’s on Fire, le documentaire signé Roberto Minervini, qui est sorti dans les salles françaises le 5 décembre 2018, et Genesis de Árpád Bogdán. Le film de Roberto Minervini, en voulant faire un état des lieux de la condition des Noirs aux États-Unis, pêche par son excès d’esthétisme, le cinéaste italien optant pour une image très soignée, en noir et blanc. Ce souci du beau cadre, de la belle lumière finit par rendre le film et les individus filmés complètement désincarnés.
Enfin, pour conclure sur les productions peu convaincantes, Tout ce qu’il me reste de la révolution, premier long-métrage de l’actrice Judith Davis sorti le 7 février, se montre particulièrement éprouvant. Sur le fond, le film pourrait être intéressant s’il n’était aussi mal écrit, cliché et téléphoné en plus de pâtir d’une réalisation aussi peu inspirée que la direction de la photographie est dépourvue de souffle. Judith Davis est présente aussi devant la caméra pour incarner une jeune femme intègre dont l’idéal politique est rattrapé par un réel décidément trop réel et trop néo-libéral. Voix off convenue et gags éculés se bousculent dans cette comédie poussive à l’esthétique téléfilmesque.

Avec Les invisibles, le troisième long-métrage de Louis-Julien Petit, la comédie reprend de la hauteur. Le réalisateur s’attache à décrire le quotidien de travailleuses sociales désemparées devant certaines lourdeurs administratives et autres lois mal faites qui les empêchent de venir efficacement en aide aux femmes sans domicile fixe. Les recevant dans un foyer de jour, elles décident de contourner la loi et d’ouvrir un dortoir clandestin pour palier aux manques de structures. Louis-Julien Petit réussit un film dynamique et drôle qui évite tout misérabilisme. Photo soignée en cinémascope, mise en scène inventive, actrices impliquées donnent aux Invisibles le ton juste.

Avec Le Silence des autres, les réalisateurs Amuldena Carracedo & Robert Bahar effectue une plongée dans l’Espagne de Francisco Franco. Ce documentaire, produit par Pedro Almodovar, s’intéresse aux victimes survivantes du franquisme, celles qui demandent désespérément réparation. Seulement, une loi d’amnistie générale est votée en 1977 après la mort du dictateur, libérant les prisonniers politiques, mais assurant l’impunité aux tortionnaires du régime. Le film se suit comme une enquête, un combat mené par les victimes ou les descendants de ceux qui ont péri, exécutés ou torturés durant cette sombre période. Le Silence des autres, sorti en salles le 13 février dernier, lève ainsi le voile sur cette partie encore méconnue de l’histoire de l’Espagne et se révèle passionnant.
Parmi les films toujours inédits, à part Le Secret des Kennedy, de John Curran, Je n’aime plus la mer interpelle avec ce titre étrange qui peut surprendre pour un documentaire qui se situe en Belgique. Le réalisateur Idriss Gabel attire l’attention sur ces enfants qui, comme leurs parents, fuient des pays en guerre et se retrouvent dans des foyers, à attendre l’étude de leur dossier. « Sur trois mois de temps, j’ai visité trois centres en même temps, donc j’ai rencontré plus ou moins 150 enfants avec qui nous avons fait toutes sortes d’activités et dont une par le dessin. », se souvient le réalisateur. « Dans l’un de ces centres, sont apparus ces mots qui m’ont énormément interpelé : ‘je n’aime plus la mer’ qu’une enfant avait écrits et qui ont fait naître en moi une grande réflexion. C’était pas normal pour un enfant de dire ça. »

Avec Je n’aime plus la mer, son troisième film, le misérabilisme n’est pas non plus de mise, la démarche d’Idriss Gabel s’élevant bien au-dessus, tout en adoptant le point de vue de ces enfants en exil. « Je voulais vraiment que l’on soit dans leur regard, la caméra est à leur hauteur, et je voulais vraiment que cela prenne tout l’écran. Quand le film prend vraiment tout l’écran, il y a une vraie rencontre et je trouve que l’esthétique ne doit pas ralentir le film », explique-t-il par rapport à son choix du cinémascope. « Cela dépend de ce que je veux montrer. Ici, ce n’est pas un film descriptif, c’est un film émotionnel. C’est un film où la sincérité dans le regard des enfants ou dans leurs postures et plus importante que tout et pour moi, c’est le meilleur format pour aller capter ça. » Idriss Gabel choisit un rythme lent et contemplatif pour raconter ces histoires, ces vies brisées échouées dans un environnement qui leur paraît finalement hostile.
En s’attachant à filmer les enfants immigrés, à recueillir leurs témoignages, Idriss Gabel dessine un autre visage de l’immigration. Un nomadisme qui est loin d’afficher une mine heureuse. Une grande partie du métrage est tournée dans un foyer isolé, situé au milieu d’arbres. La pénombre, le vent qui agite des feuillages qu’ont du mal à percer quelques rayons de soleil donnent à Je n’aime plus la mer des allures de conte fantastique où les enfants sont encore et toujours la proie de quelque menace invisible. Pourtant, cette atmosphère lugubre ne fait nullement appel à quelque artifice de mise en scène, Idriss Gabel privilégiant la lumière naturelle. « J’ai pris un gars qui a fait son travail de fin d’année sur les lumières naturelles », se souvient le réalisateur. « Je l’ai choisi pour ça, pour s’adapter tout de suite, qui a un sens du cadre permettant d’aller capter l’émotion. On a tous des expressions corporelles. Le non verbal, c’est tout le temps. Dans nos postures, nous en apprenons beaucoup. Lui était très technique, mais je l’ai sensibilisé à regarder même si on ne comprend pas la langue. La misère humaine, tu peux la voir partout. Je vois la force de vie dans ce film, je vois de la richesse humaine et c’est cela que je suis allé chercher. Je ne vais pas accentuer quelque chose. Pour moi, la misère humaine même dans une famille extrêmement riche, tu peux la voir. »

Aux idées préconçues et autres clichés, répondent le mal être de ces enfants, leur nostalgie et les souvenirs d’une vie passée, plus heureuse, dans leurs pays d’origine. En situation de détresse, ils doivent affronter l’administration, l’animosité de certains habitants et, chose nouvelle pour eux, la précarité. « La grande majorité de ces familles qui arrivent ici est composée de gens qui étaient aisés. Des familles qui avaient trois salles de bain, une piscine, des grosses voitures », raconte Idriss Gabel. « Au début du film, les enfants appellent toutes ces milices ‘les voleurs’. Dans le monde entier, quelle que soit leur religion… Quand il y a eut des troubles en Europe, pendant la guerre, les Allemands, la première chose qu’ils ont fait en France est de piller les œuvres d’art. Tous ces groupes se servent là où la richesse se voit. Toutes ces familles étaient des familles où leur richesse s’affichait sur leur maison et donc, c’est chez eux que Daech et les Talibans viennent tout de suite. C’est très simple, ils les rackettent : soit vous leur donnez ce qu’ils veulent – voitures, argent – soit ils prennent vos enfants. Ils prennent votre fils, ils le prennent pour aller faire la guerre, ils prennent votre fille pour la marier à une personne de leur groupe, même si elle a six ans. C’est le cas de plusieurs filles dans le film. C’est là, le dénominateur commun, c’est la même histoire qui se répète, quel que soit le pays, quelle que soit la religion. Finalement, c’est ça qui les fait arriver ici. Sur le chemin, les passeurs vont encore se servir, leur prendre tout ce qu’ils ont. Les passeurs sont souvent organisés à partir d’ici, ce ne sont pas forcément des gens de là-bas. Il y a tellement d’argent à se faire que nos mafias sont organisées. La peur des papas, c’est que leurs filles se fassent kidnapper pendant le trajet, ils ont les yeux sur leurs enfants 24H/24H. Beaucoup de filles disparaissent en chemin, souvent en Europe. » Idriss Gabel signe un film émouvant et beau qui, malgré son sujet, ne se révèle pas triste ou plombant. Au contraire, il s’affirme lumineux et ouvre d’autres perspectives, amène chacun à s’interroger. N’est-ce pas le but d’un cinéma qui se veut politique ? « Quand on regarde un film et qu’on ressent le caractère, la volonté politique du film, de la part du réalisateur, qu’il y a cet engagement-là, on regarde un film politique. Je pense qu’il s’agit vraiment d’une histoire de ressenti », soutient Henzo Lefèvre. Seulement, pour Idriss Gabel, « est-ce que finalement, tous les films ne le sont pas, politiques ? Mon film a une intention assumée, dès le début. »
Au milieu de ce panorama de films engagés récents, il fallait néanmoins revenir sur quelques classiques dont Les Camarades, de Mario Monicelli, et Missing, de Costa-Gavras, ont été les fiers représentants. Il aurait manqué quelque chose à un festival de cinéma si celui-ci n’avait mis en avant quelques perles issus du patrimoine. Du cinéma engagé, donc, mais engagé dans quel sens ? Pour présenter une radiographie la plus honnête et juste possible de la France, et du monde, il faut savoir jongler entre des œuvres progressistes et d’autres plus conservatrices. Faire se répondre les deux courants semble être le meilleur moyen d’amener un débat. « Nous avons eu des discussions là-dessus, notamment avec Costa-Gavras », se justifie Henzo Lefèvre, « sur la place de films conservateurs dans le festival. Il existe des films conservateurs, mais j’ai d’avantage vu des choses pour défendre le droit des femmes plutôt que de leur en enlever. C’est une difficulté car on ne prend pas le film uniquement parce qu’il est conservateur ou progressiste. Nous ne sommes pas fermés à ça, mais il faut aussi que le film réponde à des critères artistiques et pas uniquement politiques. » Pourtant, l’histoire du cinéma regorge d’exemples de films politiquement douteux, mais artistiquement réussis. Il aurait été intéressant de voir comment ces productions ont marqué l’histoire, pourquoi, et ce qu’il en reste de nos jours, tant au niveaux de leur fond que de leur forme.

Il ne faut cependant pas oublier que le cinéma n’est pas que du divertissement, qu’il peut aussi exprimer des idées, partager un point de vue sur le monde. Cela résume parfaitement la démarche de réalisateurs tels Idriss Gabel qui font du cinéma avec une vision : « Je dis souvent, ce genre de films est un test pour savoir si on est toujours humain, si on a bien un cœur. Si le film touche, c’est une bonne nouvelle, mais il y a aussi l’autre cas. Dans mon entourage pas si lointain, il y a des gens très arrêtés dans leurs idées, mais après le film, plusieurs sont venus me voir, leurs idées n’ont pas changé, mais leurs visions des choses étaient plus complètes. Leurs mots ont été soupesés, après. Les idées ne changent pas, mais il y a quand même… Et je peux comprendre, je n’ai pas une démarche politique très arrêtée, c’est une démarche humaine qui consiste à dire : ‘tu as vu ça, est-ce que tu peux redire ? Non, ce sont des êtres humains que tu as vus.’ Et là, alors, on peut débattre intelligemment. Ce qui, pour moi, est important, c’est rendre le débat plus intelligent plutôt que de dire des bêtises avec des chiffres en ou disant ‘on peut pas accueillir toute la misère du monde.’ Le temps qu’elle est là, cette misère, comment l’accueille-t-on ? J’comprends qu’on ne puisse pas accueillir tout le monde, mais on peut accueillir les gens en attendant leur dossier, dignement et s’interroger de ces accords signés en 1952 sur la demande d’asile. Évidemment, on l’a signé en pensant à nous. Ça nous arriverait en Europe de se retrouver de nouveau réfugiés après 1940-1945, on n’a pas pensé que cela serait ça. Le film sert à s’interroger sur la justice, les droits de l’homme, à une dimension humaine, simple. »
Propos recueillis entre les 5 et 7 décembre 2018 durant le Festival International du Film Politique à Carcassonne.
© photographiques : Idriss Gabel et Michael Inzillo.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).











