Lumière, quinze ans déjà ! C’est le premier constat qui s’imposait à nous, juste avant de débuter une 16ème édition couronnant Isabelle Huppert. De ses différentes évolutions (sa durée qui s’est rallongée au fur et à mesure) à sa prise en envergure (le coup d’accélérateur lié aux venues successives de Quentin Tarantino, Pedro Almodovar et Martin Scorsese), la manifestation s’est implantée durablement comme un événement incontournable qui rythme huit jours durant la vie des Lyonnais, qu’ils soient cinéphiles ou non. Dans cette première partie, voici le compte-rendu exhaustif et détaillé des projections auxquelles nous nous sommes rendus.
Soirée d’ouverture
De manière très classique, Lumière 2024 a commencé pour nous, à la Halle Tony Garnier lors de la Soirée d’ouverture. Ce grand événement lançant le festival en présence de nombreux invités et de cinq mille spectateurs, a notamment été marqué par deux hommages à des figures récemment disparues. Le légendaire Alain Delon évidemment (pour qui une nouvelle attention en présence de son fils Anthony a eu lieu plus tard en clôture) et Michel Blanc, dix jours à peine après son décès. Des images et une chanson (Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?) reprise spontanément par le public, qui restera comme le pic émotionnel de la soirée avec la remise d’un Prix Lumière spécial à Costa-Gavras. Le cinéaste franco-grec célébré cette année, s’est vu remettre cette récompense par un certain Tim Burton, invité surprise de cette ouverture.
Film d’ouverture – Un Revenant – Christian-Jaque (1946)

Un Revenant – Copyright 2024 René Chateau Vidéo
Pour lancer les festivités lyonnaises par une projection, avait été choisi Un Revenant, comédie dramatique de Christian-Jacque dont l’action se déroule dans la Capitale des Gaules. Un scénario d’Henri Jeanson (inspiré d’un fait réel), un casting haut de gamme pouvant compter sur les talents de Louis Jouvet ou Louis Seigner, une photo signée Louis Page (chef-opérateur, entre autres, d’Au-delà des grilles et de Mélodie en sous-sol), les amateurs de cinéma français d’après-guerre étaient en terrain connu. Cette histoire d’homme qui retourne dans sa ville natale pour se venger après vingt ans d’exil, réserve pourtant de jolies surprises. Si le cinéaste peut compter sur les très bons dialogues de Jeanson et sur la gouaille de Jouvet (qui effectuait lui-même un retour en France après avoir passé la période de l’Occupation à l’étranger), il s’autorise quelques audaces de mise en scène bienvenues. Lorsqu’il s’aventure au-delà de la simple captation du verbe (il est vrai, brillant), le réalisateur donne par exemple vie à un flashback narré en voix-off dont tous les personnages sont exclus, laissant des décors vides interagir avec des silhouettes invisibles. Derrière le clin d’œil à un Lyon du passé, à même de ravir le public local, le long-métrage, classique mais irréprochable (notamment grâce à la présence de son irrésistible acteur principal), se posait en parfaite mise en bouche pour l’édition à venir.
Soleil Rouge – Terence Young (1971)
1870. Dans l’Arizona, une bande de hors-la-loi, menée par Link (Charles Bronson) et son complice Gauche (Alain Delon), dévalise les voyageurs d’un train. Gauche dérobe le magnifique sabre en or qu’un ambassadeur japonais devait porter au président des États-Unis. Attaqué par des Comanches, il abandonne Link et fuit avec le précieux cadeau. Pour se lancer à la poursuite de son acolyte, Link doit contre son gré faire équipe avec le redoutable samouraï Kuroda (Toshiro Mifune).

Soleil Rouge – Copyright StudioCanal 2024
Deuxième collaboration entre Charles Bronson et Terence Young après le film d’action Cold Sweat, Soleil Rouge marque le retour de l’acteur au western européen après Il était une fois dans l’ouest. Young n’est certainement pas Sergio Leone, ce qui ne l’empêche pas de mener à bien sa mission première : orchestrer la réunion d’un casting poids lourds venu des quatre coins du monde, avec Toshiro Mifune, Alain Delon et Ursula Andress. Son film s’inscrit dans les tropes du genre investi (braquage, trahison, vengeance) sans chercher à le révolutionner mais avec un professionnalisme dont il est coutumier. En attestent ses très bons James Bond (Dr. No, Bons baisers de Russie, Opération Tonnerre), Triple Cross ou L’Homme du clan.
Généreux, rythmé et parsemé de morceaux de bravoure, Soleil Rouge bénéficie d’une réalisation solide et toujours propre. Un divertissement ludique, qui s’assume tel qu’il est, sans la moindre prétention, au sein duquel un plaisir est palpable entre les acteurs, notamment dans la distribution des rôles. Si Alain Delon, qui retrouvait Charles Bronson après Adieu l’ami (auquel on pense dans leur relation), est crédible en bad guy, c’est surtout le duo principal qui retient l’attention. Tandis que Mifune, dans le registre du samouraï partiellement taiseux et monolithique, va plutôt sur le terrain de prédilection de Bronson, ce dernier s’éloigne de la figure du cowboy solitaire. Étonnant, à contrepied que cette direction plus légère qu’à l’accoutumée, avec une partition taquine et très dialoguée, annonçant à sa manière, C’est arrivé entre midi et trois heures. En résulte un duo parfaitement fonctionnel et plein de charme, dans un récit mêlant gunfights et combats au sabre avec un plaisir certain jusqu’au très spectaculaire final, incluant les Indiens dans l’équation. Réjouissant.
Land and Freedom – Ken Loach (1991)
David (Ian Hart), jeune communiste anglais, s’engage dans la lutte antifasciste au début de la guerre civile espagnole. Il fait son apprentissage de milicien aux côtés d’autres étrangers, tous réunis autour d’un même idéal révolutionnaire. Leur combat pour l’espoir se heurte à un ennemi inattendu…

Land and Freedom – Copyright Sweet Sixteen
César du meilleur film étranger en 1996, quelques mois après une sélection en Compétition à Cannes, Land and Freedom a marqué un coup d’accélérateur dans la reconnaissance mondiale de son auteur, Ken Loach. Récit sur deux périodes, l’une présente, l’autre passée, nous immergeant au cœur de la révolution sociale espagnole de 1936, le film prend d’abord soin d’expliciter son contexte par des cartons assez complets et rigoureux. Il ne se pose pas la question des connaissances de la période et du sujet d’un spectateur auquel des repères sont proposés habilement. Brève introduction de nos jours avant de plonger rapidement au milieu d’un mouvement militant anti-franquiste composé de communistes des différents coins de l’Europe débarquant en Espagne pour contrer le coup d’État qui se prépare.
L’idée magnifique guidant Land and Freedom, consiste à éprouver le combat théorique dans la pratique en le confrontant au réel et à ses heures sombres. La grande force de Ken Loach dans cette entreprise est de créer de la vie à l’intérieur de cette lutte, aller chercher la vérité de ces instants plutôt que de se reposer sur une reconstitution presque abstraite. En dépit des enjeux, il y a beaucoup d’humour, de légèreté, d’humanité, n’excluant pas l’inévitable dureté. La mort n’est jamais loin et ne tient parfois qu’à quelques secondes d’hésitation. Le cinéaste met l’accent sur le doute qui s’empare de ses personnages, moins pour remettre en cause leurs finalités, que les moyens nécessaires pour atteindre leur idéal. Ces contradictions potentiellement fratricides rendent compte de la complexité de la situation dépeinte. Il relate également la découverte en temps réel pour ses jeunes héros, des sophistications d’un monde qu’ils ont pu penser pour certains, par des visions binaires, avant d’être soudain contraints de prendre du recul par la force.
L’issue malheureuse n’exclut pas une forme d’optimisme virtuose, donnant à la double temporalité toute son ampleur. Les morts passés n’ont pas eu raison de combats et idéaux immortels, les échecs d’hier seront peut-être la clé de victoires demain. Un très grand film, et peut-être le chef-d’œuvre de son auteur.
Les Evadés – Frank Darabont (1994)
Andy Dufresne (Tim Robbins), un jeune banquier honnête et respecté, est accusé d’avoir tué sa femme et son amant. Condamné à la prison à vie, il est envoyé à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l’État du Maine. La timidité d’Andy et ses manières réservées en font un détenu à part. Petit à petit, il se lie d’amitié avec Red (Morgan Freeman), un vétéran de Shawshank, homme affable et organisé qui connaît par cœur la prison, ses codes et ses pratiques.
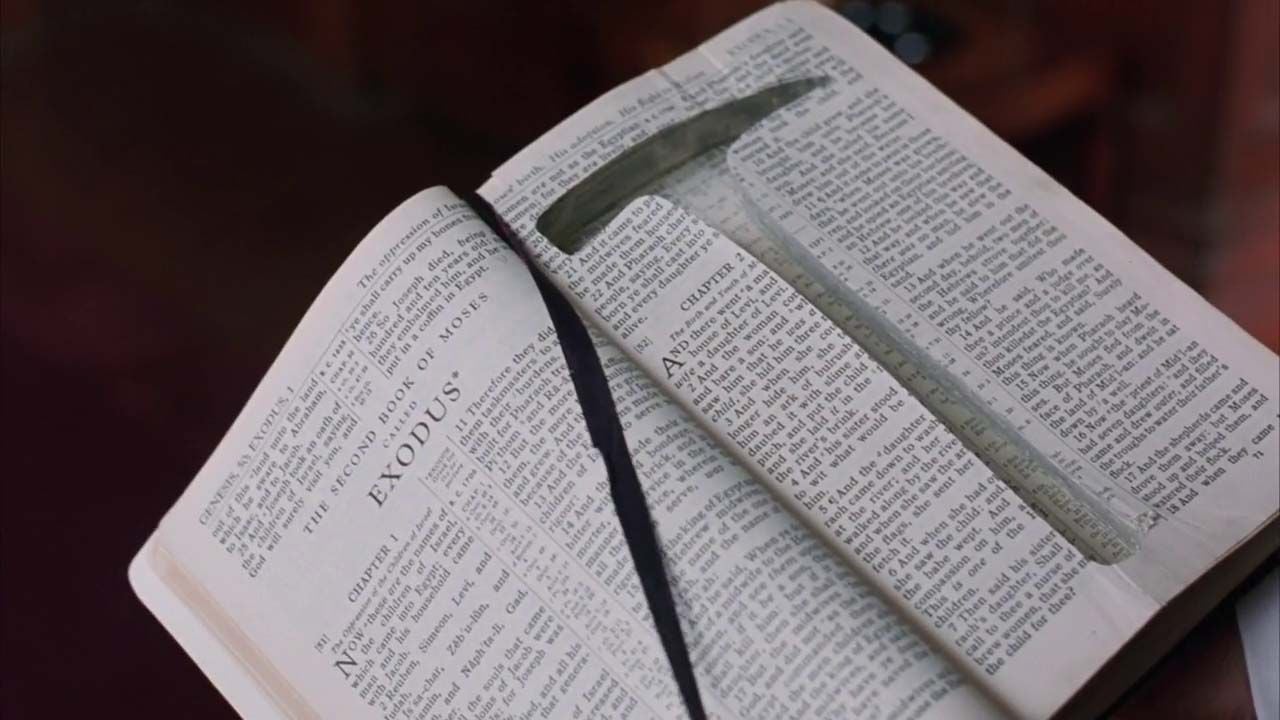
Les Evadés – Copyright Castle Rock Entertainment 2017
Aujourd’hui, Les Evadés, première réalisation de Frank Darabont, a l’aura d’un classique populaire, multidiffusé à la télévision, adoré par une large partie de ses spectateurs (voir sa réception sur les IMDB and co). Une réputation des plus favorables, qui l’a inscrit dans l’inconscient collectif comme une référence, parfois regardée avec une forme de condescendance. Cette postérité relève pourtant d’un cheminement relativement rare. Peu vu à sa sortie en salle (éclipsé par les cartons de Forrest Gump et Pulp Fiction), le film est d’abord un échec, sauvé de l’oubli par quelques nominations aux Oscars. Son culte commence à naître en VHS, il devient même le titre le plus vendu de l’année 1995, son bouche-à-oreille se lance et sa réputation va croître inlassablement. À l’origine de ce thriller carcéral, il y avait une nouvelle de Stephen King, Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank (dans le recueil Différentes Saisons), un auteur déjà adapté par Darabont en court-métrage (The Woman in the Room d’après Chambre 312) avec suffisamment de brio pour avoir durablement les faveurs de l’écrivain.
Trente ans plus tard et sur grand-écran, le long-métrage se redécouvre avec un plaisir total, pourtant pourvu d’un bagage plus chargé qu’à sa sortie. Bien écrit (le dosage de la voix-off n’est par exemple jamais superflu) et superbement raconté, il bénéficie d’une réalisation élégante (la photographie est signée de l’immense Roger Deakins) et d’un casting homogène (le duo vedette fonctionne parfaitement mais on apprécie également le soin pour chacun des rôles et personnages secondaires). Dans une forme de classicisme qui le rapprocherait d’un Clint Eastwood en plus lyrique, Darabont déploie un récit riche en rebondissements, mêlant émotion et cruauté, jusqu’à ses derniers mouvements libérateurs. Ancré dans une période passée, il met à profit le recul dont il dispose sur les époques qu’il met en scène, se prémunissant du risque de vieillissement prématuré de son œuvre. Derrière la sobriété, il s’autorise quelques subtilités visuelles (la manière de signifier le temps passant par changements de posters d’icônes cinématographiques (Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Raquel Welch) et sonores (l’usage de l’harmonica dans le thème final). Si dans un registre similaire Les Évadés, reste quelques crans en dessous d’un chef-d’œuvre comme Papillon, il serait dommage de se priver d’un objet aussi fort et soigné.
Viol en première page – Marco Bellocchio (1972)
Tandis que l’Italie se prépare à d’importantes élections, une jeune femme est retrouvée violée et assassinée dans un terrain vague près de Milan. Bizanti (Gian Maria Volonté), le rédacteur en chef d’un journal conservateur, décide d’instrumentaliser ce fait divers. Il fait du militant communiste Mario Boni (Corrado Solari) le coupable idéal, afin de manipuler l’opinion publique et de jeter l’opprobre sur les mouvements gauchistes.

Viol en première page – Copyright Minerva Pictures 2024
Viol en première page, quatrième long-métrage de Marco Bellocchio, longtemps oublié, aujourd’hui sur le point d’être réhabilité, impressionne à plus d’un titre. D’une part, la densité de ce qu’il raconte rapportée à sa durée somme toute courte (inférieure à une heure et demie) n’est pas négligeable. D’autre part, la rigueur froide et quasi chirurgicale avec laquelle le mène un thriller politique aux dialogues ciselés, constamment percutants, dont l’écho est on ne peut plus éloquent un demi-siècle plus tard. Pourtant, le film occupe une place particulière dans sa filmographie, d’abord il n’en est pas l’auteur, ensuite, il marque sa première collaboration avec un grand acteur, en l’occurrence Gian Maria Volonte. Ce dernier, monstrueux au sens propre et figuré, campe un homme de pouvoir, également rouage d’un système qui assure par le pire sa pérennité. Son portrait épouse en soi le dessein d’un Bellocchio qui filme la fin des illusions et la destruction de l’idéologie par une lecture biaisée du réel. En mêlant images documentaires et fiction, il ancre son récit dans une réalité définie sans pour autant s’empêcher de déborder, à l’instar d’un éloquent plan final.
Outre l’efficacité brute de son thriller, c’est son acuité politique quasi avant-gardiste qui sidère et sème l’effroi. En creux, le réalisateur parle sans filtre de l’alliance objective des pouvoirs et des présumés contre-pouvoirs afin de maintenir les privilèges, d’empêcher tout ascenseur social, tout renversement de classes et tuer les luttes visant davantage de justice. Il peint un monde de coups bas, de surveillance et de paranoïa, où les méthodes crapuleuses décrédibilisent la notion même d’idée politique. Comment certains utilisent des faits-divers à des fins électorales ? Comment ces mêmes gens souillent la mémoire des victimes, soi-disant pour leur venir en aide en feignant l’empathie, alors qu’ils deviennent de facto les complices des coupables et des criminels. Comment, à travers ses méthodes de voyous, l’État et les institutions sont corrompus. Comment certains médias se laissent devenir les relais du pouvoir, des instruments de propagande et de manipulations de l’information, plutôt que des garants d’un accès libre et impartial à celle-ci. Bellocchio abdiquait déjà, nihilisme prématuré ou lucidité extrême ? Son constat effroyable, à l’heure des Fox News, CNews ou un peu plus tôt en Italie, la RAI, a été largement validé par les faits. À découvrir impérativement.
Malcolm X – Spike Lee (1992)
Révélation fracassante de la fin des années 80, Spike Lee sort tout juste du succès de Jungle Fever lorsqu’il s’attelle à Malcolm X, un projet impulsé et initié bien avant son arrivée dans le paysage. Les droits de The Autobiography of Malcolm X ont été acquis dès 1967 par le Marvin Worth (qui produira un documentaire sur le sujet en 1972) et vont passer de studios en studios plusieurs années durant. L’écrivain James Baldwin, notamment, s’est attelé au scénario dans les années 70. C’est sous l’égide de la Warner que les choses vont décoller. Dans un contexte de déficit criant de biopic sur les figures noires de l’histoire américaine (exception faites de Bird de Clint Eastwood) et de combats pour les droits civiques relancés, la major veut placer Norman Jewison à la mise en scène. Spike Lee fera pression pour qu’un cinéaste afro-américain réalise et reprendra le flambeau, quand Jewison quelques années plus tard finira par tourner un autre biopic sur une figure de la communauté, toujours avec Denzel Washington, Hurricane Carter. Reste alors à boucler un budget à la hauteur de ce qu’il projette, ce qui passera par l’aide financière de célèbres amis du cinéaste (Janet Jackson, Michael Jordan…).

Malcolm X – Copyright Metropolitan 2024
Point d’acmé de la première partie de carrière de Spike Lee, Malcolm X est à la fois son film le plus ambitieux et le plus imposant. Biopic non consensuel autour d’une figure clivante, complexe et ambivalente mais essentielle dans l’histoire afro-américaine. Lee a certainement réussi des longs-métrages qualitativement plus homogènes (Do The Right Thing, La 25ème heure) avant comme après et plus proches d’une forme irréprochable, néanmoins il parvient à un résultat, à la fois peu fréquent et salutaire. D’une part, il est indiscutablement le réalisateur idéal pour traiter d’une icône aussi retorse, donner au sujet l’envergure nécessaire. Il se rapproche esthétiquement de Martin Scorsese et du Oliver Stone (qui fut un temps rattaché au projet) de JFK dans un mélange de séduction et de collages plus expérimentaux (assemblage d’archives documentaires et de fiction, collages d’images en couleur et N&B…). De son générique sobrement stylisé au carnage final, véritable scène de guerre nous plongeant au cœur du chaos, Malcolm X est bardé de fulgurances (pour certaines parmi les plus impactantes imaginées par son cinéaste).
Surtout Spike Lee, se met en cohérence avec son personnage par une forme de jusqu’au-boutisme, son long-métrage est trop gros, trop long, trop imposant, mais refuse systématiquement les concessions. À l’instar d’un anti-héros, qui malgré tous ses talents, n’a pas totalement la carrure pour les combats qu’il s’apprête à mener, dont les pensées radicales vont suivre le cheminement d’une modération progressive. Ainsi, le film s’accommode d’une dimension excessive qui va de pair avec le protagoniste, son imperfection est cohérente. Cette démesure s’accompagne d’une forme d’impolitesse à bousculer les règles cinématographiques (la représentation des Blancs au contraire de l’hégémonie coutumière d’Hollywood), politiques (le plaisir malicieux à retranscrire certaines punchlines de Malcolm X), narratives (la gestion de temporalité, la manière de faire se répondre plusieurs périodes). Une impertinence et une insoumission rarement osées à cette échelle, qui contribuent au geste fort opéré par le cinéaste.

Malcolm X – Copyright Metropolitan 2024
Enfin, quelques mots sur Denzel Washington, qui n’imite jamais Malcolm X, il l’incarne, au point que certaines images du film ont remplacé le vrai dans l’inconscient collectif. S’il avait déjà eu un Oscar pour Glory, ce rôle fera basculer sa carrière et le transformera en icône. À la fois par sa propension à incarner des figures importantes de l’histoire afro-américaine que celle à instruire un imaginaire culturel aussi bien dans le cinéma d’auteur (Man on Fire, Flight) qu’un cinéma plus mainstream (Training Day, Equalizer).
Disclaimer – Alfonso Cuarón (2024)
Surprise révélée tardivement au sein de la programmation, le retour d’Alfonso Cuarón, qui n’avait plus rien réalisé depuis son extraordinaire Roma. Le réalisateur persévère sur les plateformes avec une mini-série (qu’il avoue avoir envisagé comme un très long film) portée par Cate Blanchett, intitulée Disclaimer. Présenté par ses soins, en deux projections (épisodes 1 à 4 puis 5 à 7), nous avons passé une moitié de journée plongés dans son nouvel univers.
« Je ne sais pas faire de télévision, j’ai donc fait du cinéma » nous a-t-il dit en préambule, évoquant le désir de revenir au serial, qui s’était, selon lui, perdu. Il invoqua autant le Napoléon d’Abel Gance que Rainer Werner Fassbinder (Berlin Alexanderplatz), David Lynch (Twin Peaks), Lars Von Trier (The Kingdom), Olivier Assayas (Irma Vep) ou encore son favori P’tit Quinquin de Bruno Dumont. Il explicita son intérêt premier sur ce projet, la narration et comment nous la percevons au sein d’un monde dans lequel les histoires nous entourent. Il précisa ensuite sa démarche en disant que de plus en plus de films de cinéma ayant des images télévisuelles, sa tentative était d’opérer une reconquête en proposant une expérience filmique directement à la télévision. Série ou film de 5h30 ? Une chose est sûre, la découverte de Disclaimer s’est transformée en expérience fulgurante et hors normes.

Disclaimer – Copyright Apple TV+
Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) est une journaliste reconnue et réputée pour mettre en lumière les méfaits et transgressions des autres. Lorsqu’elle reçoit par courrier le roman d’un auteur inconnu, elle réalise avec horreur qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres. Tandis que Catherine s’efforce de découvrir la véritable identité de l’auteur du roman, elle est contrainte d’affronter son passé avant que celui-ci ne détruise sa vie et n’affecte son époux Robert (Sacha Baron Cohen) et leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee).
Thriller de vengeance d’abord opaque et morcelé, se révélant progressivement telle une mise au point allant de l’érotisme torride au drame endeuillé, parsemé de motifs phares de la filmographie de Cuarón (Londres, la plage, le sauvetage…), Disclaimer est l’adaptation d’un roman de Renée Knight. Un matériau retors qui prend le temps de se déployer, amplifiant les spécificités narratives que permettent la télévision et sa durée fleuve, pour imposer une mise en scène sensorielle et immersive qui ne dépaysera pas les laudateurs (dont nous faisons partie) de Gravity, Roma ou Y Tu Mamá Tambíen.

Disclaimer – Copyright Apple TV+
D’épisode en épisode, ou plutôt de chapitre en chapitre, Alfonso Cuarón rebat les cartes et invite à reconsidérer narrativement, formellement, physiquement et émotionnellement, ce qui a été vu et raconté. Il construit un récit multipliant et croisant des points de vue clairement définis, dont la netteté n’apparaît au fur et à mesure. Il laisse le spectateur dans le même état que ses personnages, à devoir établir son récit selon ses propres clés de compréhension. Il invite à considérer l’intrigue selon qui s’exprime, comment et à partir de quels éléments il s’exprime. Une particularité dont il se sert pour nourrir une forme malicieusement trompeuse (un roman, des photos, des souvenirs…). Le traitement du récit, de la fiction, que l’on s’invente pour se rassurer mais aussi du mensonge finalement se révèle passionnant. À l’instar des passages du livre écrit par Nancy Brigstocke (Lesley Manville) pour exorciser sa douleur, une sorte de romance kitsch et érotique, avec musique rappelant au porno des 70’s (Where Else do you touch her ?), où son fils Jonathan (Louis Partridge) est une sorte d’enfant naïf quasiment violé. La confrontation avec la réalité de Catherine (LA réalité, comme une réminiscence du Dernier Duel de Ridley Scott), n’en est que plus marquante.
Le cinéaste, outre l’envergure et l’ampleur narrative nouvelle dans son travail, peut s’appuyer sur des dialogues d’une grande rigueur, d’une précision et surtout d’une importance capitale nouvelle dans son travail. Le mot est puissant, son poids est lourd, il peut être dévastateur ou salvateur, il est un moteur actif constant de chapitre en chapitre. Il constitue l’un des leviers du suspense haletant concocté par Cuarón. Après avoir expérimenté des expériences formelles, revenant par exemple au cinéma des pionniers sur Gravity, allié une sophistication pour filmer, soit l’anticipation, soit le passé, sur Les Fils de l’homme et Roma, il utilise la longueur du format sériel et ses possibilités narratives pour confronter sa mise en scène, à une écriture elle-même sophistiquée et ambitieuse. En collaboration avec ses deux chefs opérateurs (Emmanuel Lubezki et Bruno Delbonnel), le style s’adapte et change selon les personnages. Par exemple, les parties centrées sur le mari, Robert sont plus sèches, plus naturalistes, souvent caméra à l’épaule, employant zooms et dézooms. Cette minutie et ce soin du détail sur tous les fronts confortent l’impression d’un perfectionnisme sans réserve de la part d’un auteur surdoué et dévoué.

Disclaimer – Copyright Apple TV+
Au sein de cette distribution hétéroclite, on peut croiser un Kevin Kline vieilli et sur le retour, impressionnant dans l’une des meilleures prestations de sa carrière, mais aussi un Sacha Baron Cohen redoutable dans une sobriété le mettant à contre-emploi ou encore l’excellent Kodi Smit McPhee, déjà remarqué dans The Power of the dog. Il convient de garder le plus de mots pour l’actrice principale, Cate Blanchett dans un rôle de prime abord cousin de Lydia Tar qu’elle jouait l’an passé chez Todd Field. Sa performance lorgne un temps du côté d’une forme d’hupperisation (et la composition de cette dernière dans La Pianiste) brillante au demeurant, qui, comme l’intrigue, se révèle peu à peu à nous sous sa véritable nature. Se dessine alors une nouvelle prestation somme et imprévisible dont l’actrice a déjà fait l’effort sur Blue Jasmine et Tar justement, poussant toujours plus loin les nuances, ambivalences, pour atteindre des sommets d’incarnation.
Expérience intense et étourdissante, Disclaimer d’Alfonso Cuarón est une proposition hors normes qui méritait bien des conditions de visionnage à sa démesure. Rien ne peut remplacer la salle de cinéma pour en profiter pleinement. Merci au Festival Lumière pour cette opportunité.
Jaguar – Lino Brocka (1979)
Premier cinéaste philippin de l’histoire à être sélectionné au Festival de Cannes avec Insiang en 1976, Lino Brocka retournait sur la Croisette trois ans plus tard avec Jaguar. Le récit de Poldo Miranda, surnommé Jaguar, un jeune homme pauvre qui rêve d’un avenir meilleur, devient le garde du corps de Sonny Gaston, riche chef de gang. Servile, Poldo cherche à s’attirer les bonnes grâces de son patron. Les ennuis commencent lorsque Sonny séduit la petite amie de son rival Direk.

Jaguar – Copyright 2024 Carlotta
Au jeu des comparaisons faciles (et accessoirement anachroniques), Lino Brocka pourrait être le pendant philippin d’un James Gray. En suivant cette analogie, son formidable Bayan KO réalisé en 1984, constituerait un équivalent de La Nuit nous appartient quand le présent Jaguar se rapprocherait de The Yards. Dans les deux cas, c’est le charismatique Philip Salvador qui porte les films. Il incarne ici un homme sensible et dévoué, intègre et loyal, prêt à tout pour réussir à monter socialement et permettre à sa famille de vivre sereinement, infiltrant presque malgré lui les rouages du crime organisé. Dans ce polar social aux accents tragiques, empreints de fatalité, l’ascenseur social est grippé et le personnage constamment ramené à ses origines. Fusible à faire sauter en cas de besoin, il prend peu à peu conscience qu’il ne pourra jamais faire partie d’un autre monde que celui de ses origines. La romance impossible qui se dessine en parallèle avec Christy Montes, son alter ego féminin, elle aussi issue des bidonvilles, constitue l’une des rares relations authentiques à l’intérieur d’une intrigue haletante et déprimante.
Parenthèses heureuses et tendres respirations au cœur d’un scénario construit comme un piège étouffant. Le dernier acte en forme de chasse à l’homme, observant le protagoniste rattrapé par le réel et sa cruauté, marque une dernière montée en puissance à la faveur de climax imposants (la montagne de déchets en feu pendant la traque policière) et d’une conclusion étonnamment sereine (puissant usage du gros plan). Formidable long-métrage, usant efficacement du genre pour embrasser des problématiques sociales, à l’aide d’une forme très accessible. Tout le travail effectué autour du travail de Lino Brocka depuis quelques années est d’évidence précieux (les ressorties de Manille, Insiang et Bayan KO) mais il convient désormais d’en parler au maximum. Il s’agit d’un cinéma qui, s’il était davantage vu et montré, pourrait toucher énormément de monde, des sphères cinéphiles à un public beaucoup plus large.
Rocco et ses frères – Luchino Visconti (1960)

Rocco et ses frères – Copyright 2015 Les Acacias
Pièce centrale dans la filmographie d’Alain Delon, Rocco et ses frères allait faire de la révélation de Plein Soleil, la superstar que l’on connaît et le grand acteur que certains voudraient parfois minorer. Revoir ses premiers pas sous la caméra de Luchino Visconti, au-delà d’un film incontournable et incontesté, a quelque chose de fascinant en connaissance de sa carrière à venir. Encore innocent et inconscient de son aura hors norme, il se donne corps et âme à son metteur en scène, comme si sa vie en dépendait. On ne le l’a jamais vu comme ça avant et ne le reverra plus ainsi. C’est aussi à ce prix que s’apprécie et se revoit sur grand écran cette fresque néoréaliste tragique et déchirante, intemporelle et universelle. Visconti et Delon se retrouveront trois ans plus tard pour Le Guépard. Souvenez-vous, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Deux films complémentaires et opposés stylistiquement, laissant le réalisateur et l’acteur exprimer deux facettes de leur talent. La naissance d’une légende et son avènement précoce à certains égards.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).








