Après avoir mis l’accent sur Paolo Sorrentino et Jane Campion au cours d’une première partie thématique, cette seconde partie se veut plus diversifiée, avec au programme des retours sur certaines avant-premières, deux masterclasses et enfin quelques coups de cœur issus des nombreuses sections rétrospectives. Nous parlerons des dernières réalisations de Clint Eastwood et Gaspar Noé mais aussi du premier long-métrage de Maggie Gyllenhall, d’Edouard Baer, Juan Antonio Bayona… Cessons de tourner autour du pot et clôturons dès à présent notre évocation de cette 13ème édition du Festival Lumière !
Cry Macho de Clint Eastwood (2021)

Copyright 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Claire Folger
À plus de quatre-vingt-dix ans, Clint Eastwood continue de tourner avec une régularité que peu pourraient lui égaler (on décompte dix-sept réalisations au cours les vingt dernières années). Surtout, cette productivité intacte ne se traduit pas par un fléchissement qualitatif, si l’on excepte le calamiteux 15h17 pour Paris (que l’on enfoncera pas davantage), on range American Sniper et Le Cas Richard Jewell dans la catégorie des grandes réussites d’une carrière qui n’en manque pas. Plus rare devant la caméra, il avait effectué un retour réjouissant en 2018 dans La Mule, qui tendait à revisiter sa filmographie (le Colin Bates campé par Bradley Cooper, n’était pas sans rappeler Red Garnett dans Un Monde Parfait) et la mythologie d’acteur qu’il a façonné. Un exercice introspectif et testamentaire débuté en 1992 avec Impitoyable, ses adieux au western, qui trouvait son pendant contemporain en 2009 lors de la sortie de Gran Torino et connaissait ainsi une nouvelle variation. Autocritique maline d’une figure de dur à la sensibilité dissimulée, d’un homme d’un autre temps marqué par les regrets et les incompréhensions, prisonnier de son image et de ses erreurs, fidèle à ses idéaux mais conscient des nombreuses évolutions sociales. Cry Macho, son trente-neuvième film en tant que réalisateur, est l’adaptation d’un roman éponyme de N. Richard Nash publié en 1975, qui lui avait déjà été proposé il y a une quarantaine d’années. Ironie, le cinéaste se trouvait à l’époque trop jeune pour le rôle et avait soufflé le nom de Robert Mitchum, prêt à se contenter de la mise en scène. L’affaire était alors tombée à l’eau, avant de resurgir au début des années 2000, avec pour tête d’affiche Arnold Schwarzenegger, dans l’impossibilité de se libérer en raison de ses obligations politiques, puis en 2011, toujours rattaché à l’interprète de Terminator et sous la houlette de Brad Furman (La Défense Lincoln). Nouvelle tentative infructueuse, le script co-écrit par Nash et Nick Schenk (déjà scénariste de Gran Torino et La Mule) est finalement porté à l’écran fin 2020. Clint délaisse les faits divers et l’histoire contemporaine pour replonger en 1979 où il prête ses traits à Mike Milo, une ancienne star du rodéo, désormais éleveur de chevaux. Il accepte la mission d’un de ses anciens patrons : aller chercher au Mexique le jeune fils de celui-ci, Rafa (Eduardo Minett) pour le ramener aux États-Unis. Contraints d’emprunter des routes secondaires jusqu’au Texas et de cohabiter avec un coq de combat, les deux hommes s’embarquent dans un périple dont ils n’ont pas mesuré les difficultés. Contre toute attente, le dresseur de chevaux désabusé croise d’anciennes connaissances et trouve sa propre forme de rédemption…

Copyright 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Claire Folger
En réinvestissant des motifs et une imagerie chers à son auteur, Cry Macho navigue en terrain connu, créant des repères immédiats mais pointant aussi rapidement ses limites. S’il flirte dans un premier temps avec un cadre hérité du western (les chevaux, la terre, les grandes espaces) et se pare d’un postulat nous rappelant au souvenir de La Mule (un vieil américain en « mission » au Mexique), c’est une autre voie qu’il choisit, celle du road-movie. Pourtant, bien que traversé par les fantômes évidents d’une œuvre dense et conséquente, ce nouvel opus se révèle au mieux terriblement dispensable, au pire, carrément décevant. Pénalisé par des enjeux imposés laborieusement (à commencer par la raison du périple du héros), lesquels amoindrissent toute tension dramatique, le film semble dévitalisé et programmatique. Ce récit de transmission entre deux générations, mené à un rythme poussif (à l’image d’un Clint Eastwood lui-même inévitablement fatigué), se repose paresseusement sur le capital sympathie (globalement intact) de son protagoniste afin de divertir. Toujours crédible dans un registre qu’il affectionne particulièrement et percutant lorsqu’il s’agit de retourner ses répliques tels des coups de poing, il domine sans mal une distribution inexplicablement indigente composées de débutants (Eduardo Minett plus agaçant qu’attachant) et interprètes plus expérimentés en roue libre (numéro gênant de Fernand Urrejola, sorte de madrina du pauvre, à des années lumières de Salma Hayek dans Savages d’Oliver Stone). La mélancolie sous-jacente et la sincérité manifestes du cinéaste s’avèrent impuissantes au moment de donner du relief à un script (très faible) cousu de fil blanc, pétri d’inhabituels bons sentiments et d’éléments embarrassants (ce coq utilisé en guise de sidekick comique). Les clins d’œil faciles priment sur l’ossature narrative, réduisant l’héritage de Clint à une compilation de lieux communs, déjà creusés par le passé avec davantage de rigueur. Signe supplémentaire d’une ambition en baisse, quand Impitoyable revisitait, entre autres, ses rôles phares tenus chez Sergio Leone, que Gran Torino invoquait Dirty Harry, ici la filiation s’effectue avec des personnages moins « marquants », moins ambigus, Billy McCoy (Bronco Billy) et Red Stovall (Honkytonk Man). Superficiel jusque dans le maigre commentaire qu’il tente tardivement d’effectuer autour de la figure machiste désuète qu’incarne l’acteur, Cry Macho se double d’une sensation de redite peu inspirée, jamais en mesure de justifier ce retour devant la caméra. En fin de compte, ce trente-neuvième long-métrage se rapproche ainsi davantage de l’anecdotique Une Nouvelle Chance signée Robert Lorenz (producteur et assistant réalisateur récurrent de Sur La Route de Madison à American Sniper), que des standards attendus de la part d’un tel maître. Loin du chant du cygne bouleversant secrètement espéré, une parenthèse gentillette et inoffensive, que l’on souhaite de tout cœur bientôt supplantée par une réalisation d’une autre envergure.
The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal (2021)
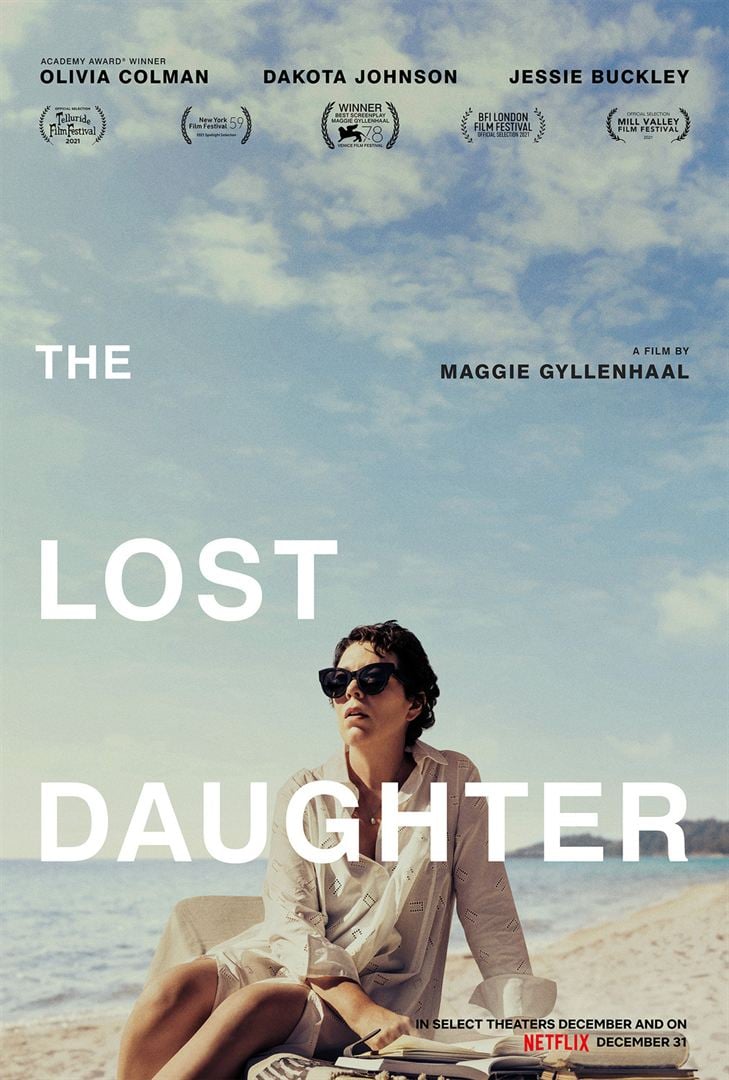
Actrice talentueuse, découverte dans Cecil D. Demented de John Waters et aux côtés de son frère Jake dans Donnie Darko, Maggie Gyllenhaal s’est construit une carrière solide (The Dark Knight, la série The Deuce) à défaut de trouver un rôle réellement marquant. Si l’on excepte La Secrétaire de Steven Shainberg, dans lequel elle excelle, elle reste une comédienne identifiable par le grand public sans pour autant atteindre la popularité et la respectabilité de ses consœurs telles que Michelle Williams, entre autres. Après avoir signé un segment du film à sketches Homemade, tourné par différents cinéastes comme Ladj Ly, Paolo Sorrentino ou Pablo Larraín durant le confinement de 2020, elle s’attelle à son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Adaptation par ses soins d’un roman d’Elena Ferrante, Poupée volée, paru en 2006, The Lost Daughter écope du prix du meilleur scénario au festival de Venise. Produit par Netflix, ce dernier sera disponible dès le 31 décembre sur la plateforme et raconte l’histoire de Leda (Olivia Colman), professeure quadra qui voit ses vacances d’été bouleversées par sa rencontre avec Nina (Dakota Johnson), une jeune mère délaissée qui la renvoie aux événements douloureux de son passé.

Copyright Netflix 2021
Pour mener sa mission à bien, la jeune réalisatrice / autrice peut compter sur un très bon casting féminin dominé par les excellentes Olivia Colman (La Favorite, The Father) et Jessie Buckley (Jersey Affair, Je veux juste en finir, la mini-série Chernobyl). Les deux actrices illuminent le film de leur présence, chacune interprétant Leda à différents âges de sa vie. Un quasi sans-faute, malheureusement entaché par la présence de Dakota Johnson, totalement à côté de la plaque dans son rôle de bimbo épouse de mafieux. Regrettable bémol qui ne saurait faire oublier le vrai point fort du film : sa direction d’acteur ainsi qu’une réalisation élégante et réussie. Gyllenhaal, aidée par sa chef op Hélène Louvart, à la photo sur The Smell of Us de Larry Clark et collaboratrice d’Alice Rohrwacher (sa sœur, Alba, fait d’ailleurs une apparition), qui avait déjà pu se plonger dans les récits de Ferrante à l’occasion de la mini-série L’Amie prodigieuse. Les deux femmes optent pour une mise en images sensuelle, proche des corps, des peaux, multipliant les gros plans. La cinéaste réussit ainsi la première partie où l’intrigue n’est perçue qu’à travers le regard de l’héroïne, les différents membres de la famille ne se dévoilant que par les indices que cette dernière saisit en les observant (un surnom, une voix…). De même, les personnages féminins, souvent victimes d’hommes, de leurs proches, de leur environnement, n’ont besoin que d’un regard, saisi avec pudeur par sa caméra pour comprendre leurs souffrances et leurs points communs. Elle signe également quelques belles séquences telle la conclusion aux relents oniriques, ou cet instant suspendu où Leda se retourne sur une enfant venant de dire « maman ». Le suspens qui enferme progressivement la protagoniste dans un étau tragique trouve une matérialisation subtile et prenante, dans un premier temps tout du moins. Une simple corbeille de fruits pourris, une cigale s’introduisant dans une chambre ou une pomme de pin se décrochant d’un arbre, devenant des signaux d’avertissement, comme si la nature de l’île la sommait de quitter les lieux. La paranoïa va malheureusement peu à peu s’inscrire d’une une réalité tangible et révéler le véritable point faible de The Lost Daughter : son écriture.

Copyright Netflix 2021
En choisissant d’adapter elle-même le roman d’Elena Ferrante, Maggie Gyllenhaal (dont c’est également le premier scénario), tombe dans un piège commun de la transposition sur grand écran, celui de ne pas trahir le roman et, par conséquent, d’en conserver toute la dimension littéraire au détriment des qualités cinématographiques. Ici, la structure épisodique du récit renvoie aux chapitres du livre et affaiblit la puissance de la narration. Si la menace qui pèse sur l’héroïne, cette famille toxique et dangereuse, se retrouve simplement résumée à des mots et à des menaces, sans que l’image ne vienne jamais faire ressentir le danger, est un problème en soi, un autre élément joue en la défaveur du film. Le passé de Leda, qui vient d’abord pénétrer le présent par l’intermédiaire d’images dénuées de contexte, se retrouve en cours de métrage, à prendre de plus en plus d’importance. Les flashbacks quasi impressionnistes des débuts, se retrouvent ainsi au premier plan et viennent appuyer le discours tout en éliminant, de fait, toute ambiguïté quant à la personnalité de la protagoniste. Une sorte de dispositif systématique se met en place, où un instant présent qu’elle est en train de vivre, renvoie à un événement de son passé, de ses jeunes années, annihilant, par trop d’explications, la moindre émotion. Le climax dramaturgique, pourtant réussi dans son exécution formelle, tombe presque comme un cheveu sur la soupe, advenant à la fois trop tôt pour mener à un crescendo émotionnel, et trop tard pour que l’on éprouve la moindre compassion. De plus, les personnages masculins se révèlent d’une fadeur effarante (Ed Harris, sous-exploité, et Oliver Jackson-Cohen, inutile) quand il ne s’avèrent pas carrément insupportables, à l’image du pourtant talentueux Peter Sarsgaard. Compagnon de Gyllenhaal à la ville, le comédien écope d’un rôle caricatural de prof de littérature qui récite de la poésie de Yeats en italien, sorte de fantasme issu d’un roman à l’eau de rose pour adolescentes. Le choix des décors insulaires de la Grèce (évoqué dès le prénom de Leda, mère d’Hélène, violée par Zeus) relève au final plus de la vision de carte postale touristique que de la peinture d’un pays pourtant au cœur de l’actualité ces dernières années. Sur le versant politique, que la réalisatrice aborde maladroitement et timidement, elle dévoile une vision américaine grossière et autocentrée, là aussi néfaste à la réussite de l’ensemble. Ainsi, au détour d’une scène de suspens, la quadragénaire menace de jeunes délinquants d’appeler la police, ces derniers l’enjoignant alors de passer à l’action en scandant « Blue Lives Matter ! » (slogan inventé par les manifestants pro-forces de l’ordre, en opposition au fameux Black Lives Matter). Une manière très peu subtile d’appuyer le statut de « méchants » des adolescents en invoquant une référence purement états-unienne. Dommage que ces nombreux défauts d’écriture (d’autant plus étonnant que ce soit son scénario qui fut récompensé à Venise), viennent gâcher la première réalisation de la comédienne, qui fait pourtant montre d’une vraie maîtrise technique et formelle.
Vortex de Gaspar Noé (2021)
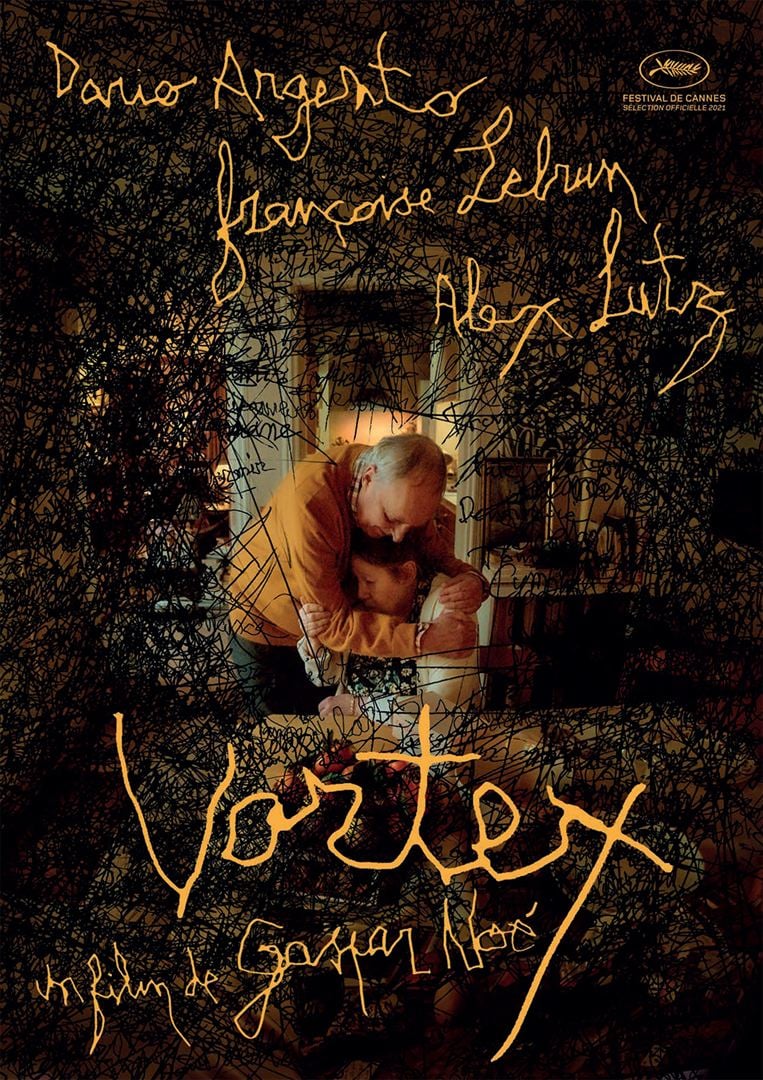
Grand habitué du festival (il était venu présenter Lux Æterna ainsi qu’une nuit Irréversible à l’occasion de l’édition 2019, après une invitation et une rétrospective en 2016), Gaspar Noé était de retour à Lyon pour une avant-première de son nouveau long-métrage, Vortex. Projeté à Cannes en juillet dernier, le film reçut un concert de louanges de la part de la critique, fait qui devient étonnamment habituel pour l’enfant terrible du cinéma français. Inspiré au réalisateur par une terrible expérience personnelle (une hémorragie cérébrale qui lui a fait frôler la mort il y a deux ans), on y suit le quotidien d’un couple de personnes âgées (Dario Argento et Françoise Lebrun) confronté à la maladie d’Alzheimer de la femme…

Copyright Wild Bunch 2021
Après son diptyque épileptique Climax / Lux Æterna, Noé surprend par une approche plus tendre, adoptant un rythme lent, patient et funèbre, comme une inéluctable marche vers la mort. Après un clip introductif de Françoise Hardy (magnifique chanson Mon Amie la rose), il déploie une vraie maestria technique – le film est un très long split screen de plus de deux heures – souvent impressionnant, au service d’un cinéma de la déambulation et du temps qui passe. Le réalisateur délaisse ses aphorismes (seule une citation d’Edgar Allan Poe est à noter) et le propos politique cinglant de ses deux dernières œuvres (exception faite de la séquence avec les accros au crack) pour un traitement plus intimiste et une esthétique littéralement étouffante, à l’image de ces décors pleins de détails hétéroclites jusqu’à ras-bord. Comme toujours, le septième art et ses propres influences sont au cœur de son dispositif, en témoignent les extraits de Vampyr de Dreyer ou les innombrables clins d’œil à Godard, notamment à travers l’utilisation de la bande originale du Mépris, lors d’une scène bouleversante. En ce sens le choix d’un cinéaste comme acteur principal (Argento) et de l’actrice inoubliable de La Maman et la putain (référence revendiquée depuis toujours par Noé), formidable Françoise Lebrun, ici incroyablement touchante, n’est pas anodin. Tous les deux sont rejoints par un très bon Alex Lutz, dont la carrière cinématographique se révèle positivement surprenante après le réussi Guy, qu’il avait signé en 2018. Délicat et tragique, Vortex marque un moment essentiel dans la filmographie de son auteur, dont on est plus que jamais impatient de découvrir les futurs projets.
Masterclass Edouard Baer / Juan Antonio Bayona

A Monster Calls – Copyright 2015 A.I.E. / Quim Vives
Parmi les nombreuses masterclasses au programme de cette 13ème édition (Edgar Morin, Bulle Ogier, Philippe Sarde), nous avons assisté à deux d’entre elles. La première était dédiée à Edouard Baer, venu présenter son nouveau long-métrage Adieu Paris, se changea en véritable one-man show de l’acteur / réalisateur. Jouant avec le public, relevant des moments de gêne et d’ennui parmi l’auditoire, il est revenu avec beaucoup de passion sur son rapport à la technique (son amour pour les gros plans) et a évoqué son travail avec les comédiens, notamment l’aspect essentiel de leur voix, au détour d’une imitation hilarante de proches de Charles de Gaulle. Juan Antonio Bayona quant à lui, a offert une leçon d’humilité et de générosité plus d’une heure et demie durant. Il a ainsi abordé pêle-mêle sa carrière, ses méthodes, la primauté des ambiances dans ses films, mais aussi sa fascination pour l’enfance et la figure du monstre. Entre ses tentatives avortées de percer à Hollywood (il refusa un épisode de Twilight, Hunger Games 2 et la suite de World War Z), et sa collaboration avec Steven Spielberg sur Jurassic World : Fallen Kingdom, il a longuement discuté de l’importance de A Monster Calls. Œuvre charnière qui condense toutes ses obsessions, le long-métrage est aussi son meilleur souvenir de tournage, celui où il a enfin eu les mains libres. Enfin, notons que cette rencontre fut l’occasion d’apprendre quelques secrets concernant la future série Le Seigneur des anneaux produite par Amazon (dont il a signé les deux premiers épisodes) ainsi qu’un scoop, puisque le cinéaste démarre un nouveau tournage dès janvier 2022 en Espagne.
Rétrospectives en vrac

Millenium Mambo – Copyright DVD TF1 Vidéos 2003
Comme chaque année, Lumière fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir des grands classiques auxquels seule l’expérience de la salle rend véritablement hommage. Si les projections de Huit et demi et de la version restaurée de Millenium Mambo se posent évidemment en intenses expériences cinématographiques (il est amusant de revoir le film de Fellini l’année même où son disciple, Paolo Sorrentino est mis à l’honneur), d’autres rétrospectives comptent parmi les grands moments de cette édition. Parmi celles-ci, différents films mettant en vedette Jean Gabin ont attiré notre attention.

Le Jour se lève – Copyright Blu-Ray Studiocanal 2014
Le Jour se lève, immense drame social signé Marcel Carné, constitue évidemment l’un des chefs-d’œuvre indémodables. Récit en flashbacks d’un prolétaire poussé au crime par amour, il est l’un des sommets de la collaboration Carné/ Prévert et une œuvre incroyablement moderne dans son propos. Mais la vraie découverte eut lieu, pour notre part, du côté des Bas-fonds de Jean Renoir. Charge poétique et souvent très drôle, contre l’aristocratie (rien d’étonnant venant de l’auteur de La Règle du jeu), le long-métrage est surtout une défense émouvante de la marginalité. Adapté très fidèlement d’une pièce du dramaturge russe Maxime Gorki, il se détache du théâtre filmé par ses partis pris formels, notamment une introduction en vue subjective, techniquement impressionnante. Le face à face Jean Gabin / Louis Jouvet, trouvant son acmé dans une amusante séquence de « cambriolage », demeure indéniablement l’un des grands moments du cinéma français d’après-guerre. Œuvre sans doute plus mineure, mais véritable plaisir de cinéphile, la projection de Gas-oil, signé Gilles Grangier, le vendredi 15 octobre fut marquée par la présence d’une classe de CM2. L’occasion parfaite de constater que la verve de Michel Audiard et le charisme de Gabin n’avaient pas pris une ride compte tenu des réactions des enfants présents dans la salle. Bien que l’intrigue criminelle à base d’argent volé à des gangsters vienne se greffer de manière artificielle à une peinture parfaitement écrite d’un milieu ouvrier et besogneux, le tout emporta facilement tous les suffrages. Divertissement réalisé sans génie mais avec efficacité, il peut se reposer sur d’excellents dialogues et une scène de suspens finale qui fit visiblement forte impression auprès de la jeune génération présente. La relève semble assurée.
Pour conclure, revenons sur quelques coups de cœur de cette édition :
Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 d’Alain Tanner (1976)

Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 – Copyright Capture d’écran DVD Doriane Films 2002
Également mis à l’honneur cette année avec la projection de La Salamandre (dans le cadre de l’hommage à Bulle Ogier), Alain Tanner a marqué notre festival Lumière avec son magnifique Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000. Film d’une liberté hallucinante où se mêlent digression sur les échecs de mai 68, l’extermination des baleines, l’héritage du marxisme, et où l’histoire du capitalisme est matérialisée par un boudin noir. Parsemé de répliques brillantes (« On ne fait pas la révolution pour le futur, la révolution c’est la revanche du passé »), le long-métrage est porté par un casting parfait, Jean-Luc Bideau en tête. Ce qui pourrait être purement théorique et abstrait, se retrouve magnifié par des choix formels audacieux (telles ces « virgules » allégoriques et oniriques en noir et blanc) et une mise en scène venant magnifier la moindre discussion, le moindre moment a priori banal. Œuvre férocement contemporaine (les liens qui se tissent entre capitalisme et patriarcat), le film se pose en réussite magistrale d’un auteur discret mais essentiel.
Le Sang des bêtes de Georges Franju (1949)

Le Sang des bêtes – Copyright Blu-Ray Criterion Les Yeux sans Visages 2013
Véritable choc cinématographique, Le Sang des bêtes de Georges Franju (projeté lors d’un double programme avec le culte Un Chien andalou) n’a pas laissé le public indifférent. Balade parisienne se transformant en véritable cauchemar éveillé, le documentaire frappe par sa modernité (antispécisme, dénonciation de la cruauté animale), et ose des parallèles avec la Shoah pour le moins risqués. Pourtant, l’évocation de trains de la mort, d’assassins et de victimes, à remettre dans un contexte de traumatisme encore vivace, quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces attaques sont pourtant on ne peut plus justifiées tant les abattoirs y ressemblent à un enfer à ciel ouvert autant pour les animaux que pour les travailleurs. Usés, physiquement diminués, les hommes et femmes sont également montrés comme des victimes en même temps que des bourreaux malgré eux, obligés de gagner leur de la pire des manières. Loin de sombrer dans un morbide racoleur, Franju fait le choix payant d’une stylisation transformant ses visions d’horreur en purs tableaux, évoquant tour à tour la poésie de La Charogne de Baudelaire et les gravures de Gustave Doré. Film dur et visuellement somptueux, il inspira par ailleurs Gaspar Noé pour l’introduction de son séminal court-métrage, Carne.
Fille du Diable d’Henri Decoin (1946)

Fille du diable – Copyright Pathé Distribution
Réalisateur prolifique près de trente ans durant (actif de 1931 à 1964), Henri Decoin avait été mis à l’honneur lors de l’édition 2018 et la projection de près d’une quinzaine de ses longs-métrages. Homme aux multiples vies, d’abord dans le sport de haut niveau, il fut notamment champion de France du 500 mètres de nage libre en 1911 (il avait participé aux jeux olympiques de 1908), il reçut la légion d’honneur à titre militaire après la première guerre mondiale, intégra l’équipe de France de water-polo et devint encore par la suite journaliste sportif. Plus tard, il commença à écrire pour le théâtre puis le cinéma avant d’exercer en tant qu’assistant réalisateur, ultime étape préalable à son passage à la mise en scène, effectué en 1933, sur la base de l’un de ses scripts, Toboggan. Opus rare au sein d’une filmographie conséquente, Fille du Diable a bénéficié d’une restauration qui s’accompagnera en 2022 d’une reprise en salles. Saget (Pierre Fresnay) est poursuivi par la police après avoir braqué une banque. Il est pris en voiture par un automobiliste ivre, Ludovic Mercier (Henri Charrett), qui revient dans sa ville natale après avoir fait fortune aux États-Unis. Mais le véhicule dérape, sort de la route et heurte un arbre : Mercier meurt mais Saget est sain et sauf. Il décide alors d’usurper l’identité du mort.
Fille du Diable débute sur un leurre, soit une scène de fusillade impliquant un dispositif policier impressionnant, observant la fuite miraculeuse d’un individu traqué de toute part. Ce thriller en puissance mis en scène comme un film de guerre brutal, ne tarde pas à bifurquer vers d’autres enjeux et d’autres horizons, ceux d’une chronique noire profondément misanthrope, vilipendant les accommodements et agissements d’une bourgeoisie provinciale. À travers la dualité de son protagoniste, à la fois ennemi public numéro un et homme providentiel attirant les convoitises, Decoin observe le délitement progressif d’une communauté égoïste et intéressée. Un microcosme pourri de l’intérieur par ses propres habitants, dont les méfaits présents ou passés, se révèlent peu à peu avec l’arrivée de ce bienfaiteur inespéré. Ce héros ambigu, possible avatar du cinéaste, se retrouve tiraillé entre deux personnages, emmenant chacun le récit en directions de deux genres potentiels. D’un côté, le docteur campé par Fernand Ledoux, figure publique respectée, redoutable maître chanteur, tirant pleinement profit de la situation, semble obéir à une convention héritée du cinéma criminel. De l’autre, Isabelle, une jeune fille malade et marginalisée, mystérieuse et inquiétante, perturbe le réalisme ambiant, le teinte d’un fantastique suggestif. Cette fille du diable auquel le titre se réfère, incarnée par une actrice à la présence aussi magnétique que fascinante, Andrée Clément (vue chez Robert Bresson dans Les Anges du pêché), imbibe le film d’un trouble précieux. L’attention appuyée que lui porte le réalisateur,, traduit une discrète quête de lumière, dissimulée à l’intérieur d’un dessein global peu optimiste où il ausculte sans pitié une humanité déliquescente.
Walk on the Wild Side / La Rue Chaude d’Edward Dmytryk (1962)

Edward Dmytryk a beau avoir signé plus d’une cinquantaine de long-métrages répartis de 1939 à 1979, il demeure un nom méconnu pour ne pas dire complètement oublié. Ses idées politiques, marquées à gauche, et son adhésion au parti communiste américain en 1944, lui valurent de figurer parmi les Dix d’Hollywood, soit un groupe de producteurs, scénaristes (dont Dalton Trumbo) ou réalisateurs convoqués en 1947 par la Commission sur les activités anti-américaines. Condamné à six mois de prison ainsi qu’à une amende en 1950, il renie par la suite publiquement son engament et se livre à une dénonciation (certes symbolique, il ne donne que des noms déjà connus) auprès de la Commission. Cette période marque un tournant, il délaisse les réalisations modestes (Les Enfants d’Hitler, Feux Croisés) et personnelles pour s’atteler à des productions plus importantes, dans un rôle plus proche du simple exécutant que de l’auteur. Une évolution et des actes qui auront raison de la réputation du cinéaste, autant que d’un désintérêt relatif de la profession à son égard. En résulte une œuvre confidentielle et inégale, aléatoirement rééditée (seul Mirage, avec Gregory Peck est disponible en Blu-Ray), où sa première partie de carrière est, à ce jour, très compliquée à trouver. Wild Side s’est intéressé à l’un de ses films des années 60, Walk on the Wild Side (La Rue Chaude), restauré en 4K pour l’occasion, adapté d’un roman de Nelson Algren (dédié à Simone de Beauvoir avec qui il a nourri une relation sentimentale), six ans après L’Homme au bras d’or d’Otto Preminger. Le script est signé de deux romanciers, John Fante et Edmund Morris, épaulés officieusement par Ben Hecht (Les Enchaînés). Dans les années 30, au Texas, Dove Linkhorn (Laurence Harvey), se retrouve seul après la mort de son père. Il décide de partir à la recherche de son amour perdu, Hallie (Capucine), qui se trouve peut-être à la Nouvelle-Orléans. En chemin, il rencontre une jeune femme, Kitty Twist (Jane Fonda) : ils feront la route ensemble.

Copyright Wild Side 2021
Le générique d’ouverture conçu par le génial Saul Bass, esthétiquement léché (Noir & Blanc, jeux d’ombres et surimpressions), s’apprécie autant tel un court-métrage proposé en préambule, que la prémisse métaphorique des motifs dominants du film à venir. Idées de fuite en avant, d’emprisonnement et de violence sont palpables à travers les mouvements d’un chat de gouttière. Cette entrée en matière graphique et originale (le travail sur les gros plans du visage faisant ressortir les yeux clairs du chat) précède un récit solide, mais nettement plus balisé, du moins dès lors qu’il lance véritablement sa mécanique mélodramatique. Edward Dmytryk emprunte d’abord la voie du road movie, mettant son héros aux prises d’une jeune femme, campée par une Jane Fonda énergique, qui effectuait alors sa deuxième apparition à l’écran. Il délaisse ensuite l’extérieur pour se concentrer sur la quête de son protagoniste une fois arrivé à la Nouvelle-Orléans, la fraîcheur et la légèreté relatives des premières minutes cèdent à la gravité et au fatalisme. Plus que sa trame, c’est par l’un des décors de son action que Walk on The Wild Side se distingue, celui de la maison-close, représentée pour l’une des premières fois au cinéma. Peinture d’un milieu d’exploitation violent, à la fois relié à une partie de la haute société et au monde criminel, s’exerçant presque à la vue de tous, générant craintes et fantasmes. Dans ses meilleures inspirations, le réalisateur hybride les registres, croise le drame avec le film noir, trouvant un bel équilibre entre intensité et émotion. Sa mise en scène, sobre et « invisible », intéresse dans son usage des mouvements verticaux, illustration discrète mais pertinente des rapports sociaux dépeints et leur hiérarchie inamovible. Enfin, il peut compter sur l’excellence de son casting féminin tandis que dans le rôle principal Laurence Harvey se révèle certes honorable, mais globalement éclipsé par ses partenaires. À commencer par l’étonnante Capucine, dont la carrière faîte d’apparitions chez Blake Edwards (La Panthère Rose), Joseph L. Mankiewicz (Guêpier pour trois abeilles) ou Federico Fellini (Satyricon) mériterait largement d’être réévaluée.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).











