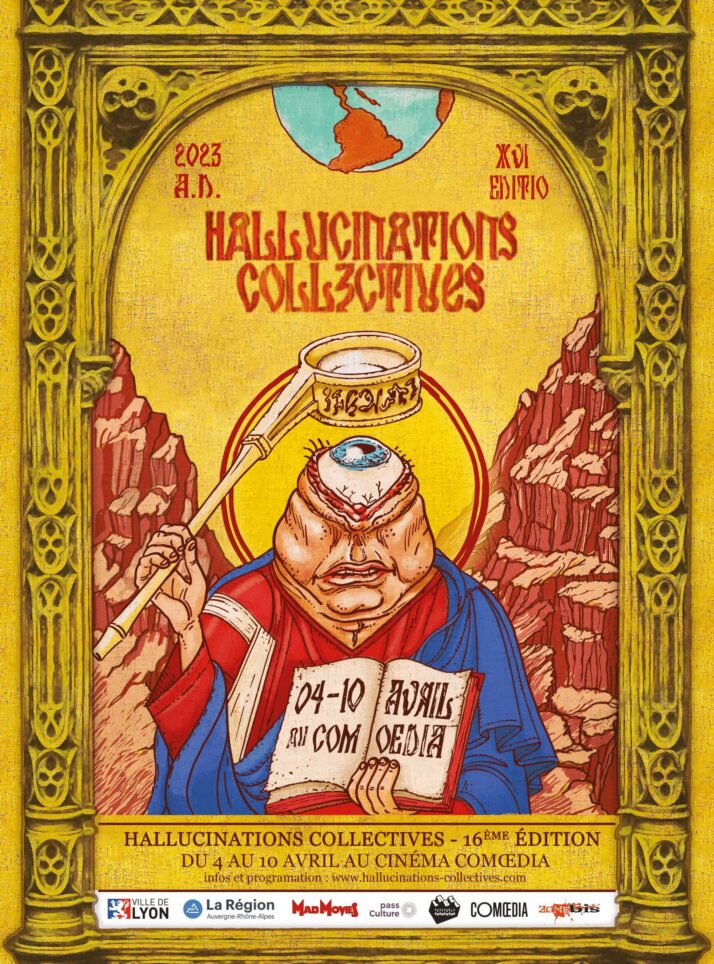Fidèles du festival Hallucinations Collectives depuis ses débuts ou presque, chaque nouvelle édition constitue une semaine à part dans notre année cinéma en terres lyonnaises. Pour cette 16ème (déjà), un total de vingt-sept séances était proposé, parmi lesquelles huit avant-premières. Nous allons revenir en deux temps sur la manifestation. Au cours de cette première partie de compte rendu, nous parlerons des six nouveautés que nous avons pu découvrir. Nous évoquerons ensuite dans une seconde partie, nos coups de cœur tirés des diverses sections rétrospectives.
Shin Ultraman de Shinji Higuchi (Japon, 2022)

Shin Ultraman – Copyright Toho 2022
Il y a deux ans, Hallucinations collectives proposait en film de clôture Shin Godzilla d’Hideaki Anno et Shinji Higuchi, vingt-neuvième volet de la célèbre saga, marquant le retour de la créature sur ses terres natales, le Japon. Une vraie réussite artistique, qui modernisait les enjeux pour proposer un divertissement mature, déjouait les attentes, quitte à reléguer le spectacle au second plan. Porté par le très gros succès commercial, critique et publique, le duo a décidé de poursuivre ses relectures des grands mythes pop nippons. Ils transposent ici l’univers d’Ultraman, une série importante des années 60, qui a connu deux nouvelles versions télé dans les années 2000, Ultraman Nexus et Ultraman Max, ainsi que quelques adaptations sur grand écran d’Ultraman : The Alien Invasion (1990) à Ultraman Zero Side Story: Killer the Beatstar (2011). Petit changement, cette fois-ci le film est réalisé en solitaire par Hideaki Anno tandis que Shinji Higuchi officie seulement à la production (son implication demeurerait très importante). Les deux hommes ont ensuite de nouveaux échangé leurs fauteuils pour leur troisième bébé, Shin Kamen Rider (quelques images nous furent diffusées en préambule de la séance). Cette envie de remise au goût du jour, s’adjoint d’une volonté d’imposer sur le marché local des blockbusters maison et ainsi faire de la résistance face aux mastodontes américains sur le terrain des entrées. Un choix payant, en 2022, six des dix premiers films au box-office étaient issus du pays du soleil levant, Shin Ultraman se classait en neuvième position. Cependant, si Godzilla pouvait revendiquer une aura internationale, Ultraman et Kamen Rider, semblent davantage s’adresser (hors de leurs frontières évidemment) à une niche de spectateurs initiés. Il est ici question de kaijū de plus en plus résistants aux attaques qui ne cessent de se manifester sur le territoire japonais et d’attaquer les infrastructures. L’armée comme les politiciens s’avouent impuissants, mais Ultraman, un robot géant d’origine extraterrestre veille au grain…

Shin Ultraman – Copyright Toho 2022
Ce deuxième opus du Shin Multiverse reprend dans les grandes lignes, la formule qui a fait le succès de son prédécesseur : recherche d’un écho contemporain (question écologique, nouvelles technologies), amour tangible de la mythologie transposée, inventivité du spectacle, tentation réaliste. Néanmoins, entre autres, en raison d’une différence de nature entre Godzilla et Ultraman, ce traitement partiellement similaire, accouche d’un résultat nettement plus contrasté. Passons sur notre découverte en néophyte total du lore relatif à l’univers du robot géant, ses origines feuilletonesques se font immédiatement ressentir. Le scénario donne l’impression de juxtaposer à la suite plusieurs épisodes où se succèdent pléthore de personnages, sans que l’on ait réellement le temps de les identifier ou de s’attacher à eux. Cette frénésie narrative accouche d’un enchaînement de péripéties au cours desquelles les humains sont très majoritairement les spectateurs passifs du récit. Ils dissertent sur l’action plutôt que d’y prendre part. Une position qui se confond avec la nôtre, finalement peu immersive, nous laissant extérieur à ce qui se joue. En contrepartie, la dimension sérielle du long-métrage, lui confère aussi une étrange singularité, l’imagerie oscillant entre un charme rétro et le kitsch, téléporté dans le monde moderne, crée un horizon insituable et stimulant. Shin Ultraman emporte peu à peu l’adhésion lorsqu’il décolle d’une approche terre à terre et de la logique qu’il s’est évertué à mettre en place pour laisser cours à des visions psychédéliques délirantes et inspirées (toutes proportions gardées le spectre de 2001, est brièvement perceptible). En somme, dès lors, que Shinji Higuchi s’affranchit de l’exposition et de ses dialogues trop explicatifs pour se consacrer à ses morceaux de bravoure, son film gagne en légèreté et en envergure. Angles de caméra insolites et audacieux, travail souvent impressionnant sur les échelles et surtout une forme de jusqu’au boutisme dans les scènes d’action, accouchent de séquences hallucinantes (ou hallucinogènes, c’est selon). Prototype hybride partagé entre la déférence à son matériau de base et la tentation de proposer un kaiju eiga proche du trip, cet Ultraman déconcerte autant qu’il titille les sens, mais ne manque assurément pas d’intérêt.
Venus de Jaume Balagueró (Espagne, 2022)

Venus – Copyright Sony Pictures Releasing International
Poids lourd de l’horreur espagnole adoubé dès son coup d’essai, La Secte sans nom (1999), Jaume Balagueró a connu la consécration en 2008 avec [•REC], coréalisé avec son compatriote Paco Plaza. Si le succès de ce qui a donné lieu à une franchise de quatre épisodes (de qualité décroissante) aurait pu être une bénédiction pour cet auteur important, il résonne a posteriori, comme le point de départ d’une malheureuse perdition. Exception faîte du traumatisant Malveillance (Mientras duermes) en 2011, qui compte parmi ses plus grandes réussites. Balagueró vient d’enchaîner au cours de la décennie passée un [•REC] 4 : Apocalypse poussif et dispensable, suivi d’un Muse qui marquait la tentative infructueuse de revenir à ses premières amours et enfin une coproduction britannique impersonnelle, Braquage finale, dans laquelle il tentait de s’éloigner de l’épouvante, sans réellement convaincre. Dans le même temps, son compère Plaza allait, lui, monter en gammes, d’abord avec le solide Verónica, puis surtout le très bon Abuela, écrit par l’excellent Carlos Vermut. Il est intéressant de constater que le réalisateur de Fragile est aujourd’hui remis en selle par une collaboration avec un autre cinéaste ibérique incontournable, Álex de la Iglesia. Ce dernier, à la tête de la société de production Pokeepsie Films aux côtés de son épouse et muse, Carolina Bang, s’est associé en 2020 avec Prime Video pour lancer The Fear Collection, une série de films de genre oscillant entre l’horreur et le fantastique. De la Iglesia inaugure sa propre collection en 2021 avec Veneciafrenia (toujours inédit dans nos contrées françaises) avant de confier à Balagueró, la mise en scène de Venus. Ecrit par Fernando Navarro, qui a déjà œuvré sur les scripts de Muse et Verónica, ce nouvel opus jouit d’une notoriété croissante dans les différents festivals où il a pu être montré (Sitges et Tiff en tête). L’histoire de Lucia (Ester Expósito), « danseuse exotique » dans un club qui vole ses mafieux de patron et file se planquer chez sa sœur Rocio (Ángela Cremonte), dans une barre d’immeuble avec son lot de secrets. L’étau se resserre, les gangsters rôdent et une éclipse risque de compliquer encore plus la situation…
Venus – Copyright Sony Pictures Releasing International
Cartons ésotériques sur fond de bande-originale opératique, suivis d’une illustration symbolique de l’étrange prophétie qui nous est délivrée : une nouvelle planète va apparaître et dévorer la lumière du soleil. Venus s’annonce telle une tragédie que l’on ne saurait à quel degré appréhender, si elle n’était pas balayée sauvagement d’un raccord tapageur amorcé par le son. Une musique explosive vient accompagner un travelling vertical dévoilant l’héroïne Lucia, en plein show assez peu suggestif. Elle surplombe une foule en transe et en état partiellement second, avant de quitter le public et son piédestal. La caméra l’aimante, le spectacle continue à côté, il n’intéresse déjà plus un réalisateur sincèrement captivé par son protagoniste, qui nourri également un autre dessein : aller dévaliser ses employeurs dans leur dos. Blessée et traquée, elle prend la fuite vers une destination qui nous est temporairement inconnue. Cette entrée en matière rentre-dedans (que certains n’hésiteront pas à qualifier de racoleuse) réjouit à plusieurs égards. Cinématographiquement, Jaume Balagueró semble avoir retrouvé tous ses réflexes mais aussi, le plaisir de filmer. Qui est cette femme ? Que fait elle ? Pourquoi ? Quel rapport avec l’hermétique message inaugural ? Un sentiment d’excitation et de jubilation parcourt ainsi immédiatement un film brutal et sensible, quand bien même il s’accroche à des archétypes qui en d’autres mains apparaîtraient comme éculés. Le matériau scénaristique, à la fois bancal et galvaudé, de Fernando Navarro, constitue un terrain de jeu idéal dont le cinéaste s’accommode très bien. D’un côté, il peut réinvestir les motifs phares de sa filmographie, l’immeuble (décor central de [•REC] et Malveillance), l’enfance malmenée (La Secte sans Nom, Fragile), la demeure maudite (Darkness), de l’autre, entremêler plusieurs sous-genres de l’horreur et du cinéma d’exploitation. C’est dans un équilibre délicat entre peurs primales et instincts bisseux, subtilités et accès bourrins, qu’il retrouve en quelque sorte la sève de son travail, en grande partie grâce à la solidité de sa mise en scène. Il se dégage de Venus, un sentiment d’ivresse et de générosité, un désir de déborder des normes du bon goût, sans pour autant renier ses fondamentaux. C’est au prix de ce précieux dernier détail, que s’acceptent les excès et dérives potentielles, d’un projet impur et pourtant galvanisant. Visions de cauchemars réellement effrayantes et séquences de terreur viscérale côtoient des virages gores outranciers parfois à la frontière de la série Z notamment au détour d’un dernier acte qui lâche la bride sur la vraisemblance, abandonne délibérément la notion de respectabilité. Bad guys caricaturaux, fusil de Tchekhov grossier (et un hommage involontaire – ou pas – au Lucy de Luc Besson), sorcières mi-flippantes mi-ridicules, le long-métrage se débarrasse peu à peu de tout complexe, moins par démission, que par envie d’en découdre purement et simplement, sans comptes à rendre à qui que ce soit.

Venus – Copyright Sony Pictures Releasing International
Il serait hâtif de résumer l’ensemble à un best-of bas du front de son auteur, sans constater l’exhumation d’une cinéphilie et d’une identité filmique aux horizons larges, se moquant des étiquettes et des idées préconçues. Adaptation très libre de La Maison de la sorcière de Lovecraft, Venus rappelle à certains égards La Sentinelle des Maudits de Michael Winner, dans sa propension à mêler, digérer références de prestige et goût assumé pour les déviances visuelles, dans les deux cas sur fond de malédiction. Il évoque également un certain cinéma du bis européen largement réhabilité avec le temps, notamment l’Au-delà de Lucio Fulci, avec lequel il partage une volonté de s’extraire de la logique pure pour laisser les sensations prendre le dessus. Reste que Jaume Balagueró, même sur un mode prétendument récréatif, sait valoriser les atouts dont il dispose et tirer profit du potentiel de son scénario à des fins plus ambitieuses. Dans le rôle principal, Ester Expósito, connue pour sa participation à la série Elite, se montre très convaincante, tant sur le registre de la sœur défaillante cherchant à se racheter, que celui de l’héroïne bad-ass. De plus, sa relation avec sa nièce Alba a beau prendre racine dans un schéma narratif classique, elle permet au réalisateur de raviver la facette la plus sentimentale de son œuvre, laquelle s’exprime dans un climat de noirceur ambiante soit par l’épure relative soit par de saisissantes envolées poétiques aux relents macabres. Ces exemples de respirations au cœur de l’horreur et de la violence, parcourent un film, par ailleurs soutenu par une tension constante où l’action et les rebondissements prolifèrent, que le talent du metteur en scène permet d’encadrer et harmoniser. Assurément, Balagueró en a encore sous le pied et cette remise en selle des plus réjouissantes est un pur plaisir à apprécier pour ce qu’il est, en espérant qu’il ne soit qu’une mise en bouche avant un retour au premier plan.
Prochainement sur Amazon Prime
Missing de Shinzô Katayama (Japon, Corée du Sud, 2021)
Missing – Dark Star Pictures 2022
Réalisateur et scénariste japonais, Shinzô Katayama a fait ses armes en Corée du Sud auprès d’un maître désormais incontesté, Bong Joon-ho dont il fut l’assistant sur le segment Shaking Tokyo à l’intérieur du film à sketchs Tokyo ! puis Mother. Il attendra 2019 avant de passer lui-même à la réalisation avec le mélodrame Siblings of the Cape, au synopsis casse-gueule, pour l’heure totalement inédit dans l’Hexagone, soutenu par une belle réputation auprès des initiés. Il poursuit ensuite à la télévision, d’abord sur la mini-série Samayou Yaiba (The Hovering Blade), dans laquelle il s’essaie au thriller avant de persévérer dans le registre et la forme sérielle sur Gannibal, un polar horrifique adapté d’un manga à succès. Ce dernier projet, écrit par Takamasa Ōo, le scénariste de Drive My Car d’Hamaguchi, est à ce jour son seul travail visible facilement en France, puisqu’il est disponible sur la plateforme Disney +. Étonnamment ou pas, Shinzô Katayama, bien qu’affilié à des auteurs influents au gré de ses collaborations, construit une carrière confidentielle. Missing, son retour au grand-écran, en dépit d’une présence à divers festivals, ne semble pas avoir vocation à l’exposer davantage. Flanqué d’un titre international des plus communs (l’original Sagasu signifier « chercher »), ce film à suspense teinté de drame s’articule autour d’une relation familiale défaillante. Suite au décès de sa femme, Santoshi a sombré dans la dépression et les dettes, à la grande consternation de sa fille, la lycéenne Kaede. Pour alléger leur dette, Santoshi dit à Kaede qu’il traquera un tueur en série et récupérera la récompense, mais Santoshi disparaît et Kaede doit découvrir ce qui lui est arrivé.
Missing – Dark Star Pictures 2022
Coproduit entre le Japon et la Corée du Sud, Missing malgré la nationalité de son réalisateur, tient plus dans son approche des caractéristiques cinématographiques du pays qui a vu émerger Bong Joon-ho, Park Chan-wook et Nah Hong-jin pour ne citer que les plus célèbres. Le travail autour du genre, est avant tout un moyen de dessiner des individualités complexes et ambivalentes afin de sonder leur nature, dans ses recoins les plus obscurs. C’est par ce choix et ce prisme qu’il tend à une universalité dépassant les frontières de la case potentiellement réductrice du registre au sein duquel il s’inscrit. Le long-métrage commence et se termine par un échange père-fille, deux séquences séparées de deux heures qui constituent en soi des films à part entière. Moins que l’originalité de leur rapport, se distingue une volonté de faire passer les personnages et leur relation au-dessus du suspens pur. Un détail essentiel avant que le récit ne bascule vers le thriller à rebondissements, l’efficacité narrative se mettra au service de l’intensité émotionnelle. Dans une construction gigogne où trois grands ensembles narratifs s’imbriquent progressivement en puzzle, se dessinent des portraits pathétiques, terrifiants mais jamais dénués d’humanité. L’incarnation (le niveau de jeu est irréprochable) évite toute tentation mécanique à un script qui se refuse également au manichéisme ou à la psychologie facile. Shinzô Katayama fait montre d’une rigueur, d’une précision scénaristique. Il livre ainsi l’autopsie glaçante d’adultes à la dérive, s’abandonnant au mal pour sauver les apparences sociales et leur modeste condition. Peinture d’un déclin moral et par ricochet d’un pays en voie de déshumanisation, son tableau trouve une pointe de lumière. La jeune Kaede encore protégée et innocente, va découvrir malgré elle une cruauté à laquelle elle était étrangère. Elle incarne néanmoins une possibilité d’avenir optimiste, sa détermination et sa droiture agissant tels des remparts aux réalités sordides qui s’opposent à elle. Petit bémol, la mise en scène, bien que globalement très maîtrisée, souffre d’une photo terne qui a tendance à l’invisibiliser plus qu’elle ne le mériterait. À l’exception d’une séquence finale impressionnante de virtuosité minimaliste et littéralement bouleversante, Missing imprime insuffisamment la rétine. Une carence aucunement rédhibitoire, pour un projet qui sans réinventer le genre, en propose une interprétation dense et émouvante.
Limbo de Soi Cheang (Hong Kong, 2021)

Limbo – Copyright 2021 Sun Entertainment Culture Limited
Réalisateur hongkongais arrivé dans le paysage cinématographique après l’âge d’or et la rétrocession de l’archipel à la Chine continentale, Soi Cheang compte pourtant près d’une vingtaine de films à son actif. La plupart sont inédits en France, tout au mieux ont-ils eu droit à une exploitation directement en vidéo à l’instar de son très bon, Dog Bite Dog en 2006. Un long-métrage sombre et violent, scrutant la quête d’humanité d’un tueur sauvage et en apparence dénué d’émotion. Cette dimension quasi nihiliste symptomatique des débuts de son auteur, aurait peu à peu disparue au profit d’œuvres plus commerciales et moins personnelles, au point que l’on avait perdu sa trace. Pourtant, de la Berlinale 2021 au Reims Polar et aux Hallucinations Collectives (il est reparti primé à l’un et l’autre), Limbo (titre générique loin de la traduction littérale de l’original : Dents de sagesse), adaptation d’un roman de Lei Mi, Wisdom Tooth, fait sensation partout où il est montré depuis près de deux ans. La carrière de Soi Cheang, se fait l’étrange écho d’une industrie progressivement aspirée par une Chine tentaculaire et liberticide. Se conformer pour survivre ou résister dans l’ombre tel est le choix impossible qui s’offre aux artistes locaux. Si un Tsui Hark a su feindre de rentrer dans le rang pour ensuite subvertir de l’intérieur des productions prétendument à la gloire du régime, son compatriote semble quant à lui avoir pris son mal en patience. À près de cinquante ans, il s’apprête à connaitre sa première sortie sur grand-écran français, un motif de satisfaction pour ce qui s’impose comme le film de la revanche et de la résurrection, Limbo rappelle aux grandes heures de Hong-Kong, ravive une flamme que l’on croyait teinte pour de bon. Will Ren (Mason Lee), un jeune policier doit faire équipe avec Cham Lau (Ka Tung Lam), un vétéran désabusé pour traquer le meurtrier dans les tréfonds d’un purgatoire urbain crasseux et envahi de détritus, cinglés par des pluies diluviennes.

Limbo – Copyright 2021 Sun Entertainment Culture Limited
Un carrelage humide et le reflet dévoilant une partie du hors champ. Une fraction de secondes durant, le plan d’ouverture de Limbo évoque celui du chef-d’œuvre Roma, d’Alfonso Cuaron. Le temps que la caméra de Soi Cheang ne révèle la silhouette d’un homme puis l’étendue du décor, au moyen d’un mouvement aérien sillonnant la métropole pluvieuse. Dans un noir et blanc stylisé où l’hyper réalisme se mue en visions quasi futuristes (des réminiscences de Blade Runner et Enter the Void), la périphérie d’Hong Kong est intronisée telle une déchèterie à ciel ouvert. Le théâtre de crimes sordides à l’intérieur duquel errent des âmes désespérées, déjà mises au ban de la société. Loin du centre actif de la ville, la bourgeoisie et les classes aisées ne sont pas concernées, le cinéaste s’intéresse à un monde caché, face auquel il serait facile de détourner le regard. Il dégaine une vision d’horreur qu’il reconduira à plusieurs reprises, celle d’une femme en souffrance, enfermée nue dans un espace étriqué appelant à l’aide. Un coup de feu est audible, une ellipse nous envoie à l’hôpital. Ce prologue nous plonge dans l’intrigue sur le vif, sans contexte précis si ce n’est un cadre magnifiquement exposé, qui sera un personnage à part entière d’un thriller esthétiquement à tomber par terre. Ensuite seulement, nous est présenté un duo de policiers, élaboré sur un schéma en soit maintes fois éprouvé, depuis le mètre étalon Seven de David Fincher. Le jeune et le vétéran, le maître et l’élève, un crack des institutions fraîchement sorti des bureaux et l’autre, rompu au terrain. Ce dernier, définitivement de l’ancienne école, revendique de mener ses investigations « à pied ». Pendant leurs premières interactions, les deux hommes se taisent et se jaugent. Après son démarrage tonitruant, Cheang opère un contrepied, développe ses individualités, explicite les tenants et aboutissants du récit, la nature de l’enquête : un tueur agresse sexuellement des femmes vulnérables, clandestines et sans identité, leur coupe les mains, avant de les éliminer. Ce mal incarné apparaît d’abord flouté, impossible à discerner, appréhender, comme une chimère à traquer avec peu d’indices pour l’arrêter. L’entrée en scène de Wong To (Yase Liu), une jeune délinquante qui vivote de vols et petites affaires illégales, dynamite à plus d’un titre l’intensité narrative. Liée à un accident ayant grièvement blessé l’épouse de Cham Lau, toujours dans le coma, elle révèle à ses dépens la bestialité de l’inspecteur autant que ses démons. La rencontre entre ce mort-vivant ruminant sa vengeance au détriment de sa mission et cette jeune femme rongée par la culpabilité, en lutte pour sa survie, permet au long-métrage de basculer à l’échelon supérieur.

Limbo – Copyright 2021 Sun Entertainment Culture Limited
De l’exercice de style virtuose et flamboyant, Limbo se transforme en polar nihiliste et existentiel au cœur d’une cité dystopique, violente et dangereuse. Construit autour de motifs de courses – concrètes (plusieurs séquences de poursuites éreintantes) et métaphoriques (la notion de compte à rebours afin d’empêcher de nouveaux crimes) – de la sensation de vitesse, le film est traversé d’un souffle lyrique (magnifique bande-son de Kenji Kawai) et d’un spectre mélancolique. Plus d’une fois, Soi Cheang dédouble à l’écran le visage de ses héros, un geste esthétique et symbolique, illustrant extérieurement leurs tiraillements intérieurs. Il sonde la complexité d’êtres abimés, en quête de rédemption, au sein d’un univers vicié où tous les idéaux sont depuis longtemps abandonnés. Il prend le soin de montrer de deux points de vue, le trauma qui hante Cham Lui et Wong To, dévoilant ainsi leurs propres perceptions de l’évènement et l’impact sur leurs psychologies. Ce flashback apparaît aux personnages tour à tour comme un cauchemar ou une hallucination, un rappel brutal, sur lequel ils n’ont aucune prise. Le vétéran, incapable de se contenir face à la jeune femme, privilégie les coups violents au dialogue, quitte à être jugé inapte émotionnellement par son partenaire quant à la suite de l’enquête. Wong To, plus belle création du scénario, acculée de toute part, résiste, se bat pour sauver sa peau et au fond gagner le droit du vivre dans cette société qui l’a exclu. Leur relation aussi forcée que délicate (elle se met au service des policiers en tant qu’indicateur), sera salvatrice pour l’un et pour l’autre. Une once de lumière dans un océan de noirceur, tel est l’horizon ultra pessimiste qu’établit le metteur en scène, auscultant sa ville du fond des yeux. La superbe d’Hong-Kong n’est qu’un lointain souvenir, tant cinématographique que sociologique, le réalisateur tend pourtant à montrer que peu importe le prix à payer, de grandes choses sont encore possibles. Son dessein se télescope avec l’odyssée rédemptrice de ses héros, rongés par leurs passés, en difficultés face au présent. Il parvient néanmoins à ses fins, après deux heures à filmer viscéralement un champ de ruines, à lui insuffler une identité filmique puissante : ce qu’il a présenté comme une poubelle ou pire un gigantesque cimetière, semble tardivement de nouveau animé d’une pulsion de vie. Thriller crépusculaire conçu en crescendo d’action, physiquement et émotionnellement épuisant, Limbo remet sur le devant de la scène un auteur oublié (ou perdu), autant qu’il réveille les fantômes d’une industrie autrefois d’une richesse inouïe. Une possible future référence du genre.
Sortie le 12 juillet 2023
Pearl de Ti West (Etats-Unis, 2022)

Pearl – Copyright A24 2022
L’automne dernier, alors que X n’était toujours pas sorti sur les écrans français, sa préquelle Pearl, arrivait dans les salles américaines. Elle suscitait un enthousiasme similaire à son prédécesseur et venait attester d’un changement de paradigme pour son réalisateur, Ti West. Près de quinze ans après ses débuts, l’auteur de The Innkeepers et The House of the Devil, bénéficiait d’une reconnaissance qui lui avait jusqu’alors échappé ou tout du moins seulement auprès d’une poignée de connaisseurs. Si la présence d’A24 à la production et à la distribution a été un atout non négligeable dans cette « ascension », le cinéaste semble également avoir trouvé une matière lui permettant d’exploiter au maximum ses qualités, ainsi qu’une précieuse alliée devant la caméra, Mia Goth. Et la réciproque est vraie, la comédienne britannique remarquée chez Lars Von Trier (Nymphomaniac : Volume II), Gore Verbinski (A Cure for Life), Luca Guadagno (Suspiria) et Claire Denis (High Life), qui avait toujours, a minima, généré le trouble, disposait sur X d’un double rôle en or pour exprimer son talent. Plus que le désir de décliner de manière opportuniste un succès, Pearl naît d’un contexte et d’une envie partagée entre l’actrice et son metteur en scène. Tandis qu’il vient tourner son slasher en Nouvelle-Zélande durant le premier trimestre 2021, le cinéaste a l’idée d’un nouveau projet réexploitant les décors construits pour l’occasion. Il tire profit de la quarantaine obligatoire et propose à son interprète de prolonger son séjour sur la terre des kiwis. Il l’invite à prendre part à l’écriture d’un scénario centré sur les origines de Pearl. Il dévoilera ultérieurement qu’il n’envisageait initialement pas ce script comme un potentiel film, mais un « apport matériel » afin de densifier son rôle dans X. Les deux tournages s’enchaîneront finalement, grâce à l’approbation d’A24 et une suite très attendue, MaXXXine viendra prochainement conclure cette trilogie horrifique à part. Plébiscitée par un certain Martin Scorsese à sa sortie, cette prélude nous replonge en 1918 où Pearl (Mia Goth) trouve le temps long, coincée dans la ferme familiale. Quand un sémillant projectionniste commence à la bercer de douces illusions, toutes les frustrations de la jeune fille trouvent enfin une finalité qu’il ne faudrait surtout, surtout pas contrarier…

Pearl – Copyright A24 2022
Si X réussissait avec brio à se défaire de son étiquette réductrice d’énième relecture de Massacre à la tronçonneuse sur fond d’âge d’or du porno, Pearl change totalement de référentiel. Ti West avance sur un terrain moins immédiatement connoté, moins braconné (ou galvaudé) par le cinéma d’horreur, mais aussi moins directement codifié. Le réalisateur le dépeint non sans humour comme « un mélodrame qui fait se rencontrer Mary Poppins et Douglas Sirk », le film s’apprécie autant en connaissance de son prédécesseur (cela se limite à quelques échos et clins d’œil amusants) qu’en tant qu’en œuvre autonome. Tourné dans un superbe Technicolor, le long-métrage s’ouvre par un générique en guise de faux-semblants empreint d’une dimension quasi-féérique. Les couleurs étincelantes à la beauté presque irréelle amorce l’entrée dans le champ d’une Mia Goth démultipliée par le reflet d’un miroir. Un sentiment de grâce emballe ces premières minutes, brutalement interrompues à l’arrivée d’une figure maternelle autoritaire et terrifiante. En une poignée d’images, le cinéaste confronte d’un même élan, la projection que Pearl se fait de son existence et la réalité profonde de celle-ci. Il articule ainsi le conflit intérieur de son protagoniste, autour de ces deux espaces indissociables dans son esprit, l’un et l’autre menaçant son équilibre psychique. En tension permanente, elle lutte contre ses frustrations et ses démons, bien que certains penchants cruels soient déjà perceptibles. Cette jeune femme, condamnée à la solitude (son mari est au front) et aux travaux ingrats dans l’enceinte familial, qui a pour principale compagnie les animaux de la ferme, est soumise à la brutalité d’un monde auquel on lui interdit d’appartenir autrement que dans l’ombre. En ce sens, Pearl est moins l’origine story d’une psychopathe en puissance que le récit d’une douloureuse émancipation au sein d’une société puritaine et conservatrice. Mordant, West ne manque pas de charger cet archaïsme mortifère, au détour de séquences tour à tour jouissives (l’évocation des prémisses de pornos) et dérangeantes (l’audition de danse). Dans son dessein ironique, l’Europe apparaît comme la terre de toutes les promesses et opportunités, face à une Amérique repliée sur elle-même et sans perspectives. L’imagerie par aspects parodique vient traduire un recul sur une époque qu’il fustige ainsi qu’un refus d’une quelconque forme de nostalgie. Pour autant, malin, il ne cède jamais à la tentation du second degré, préférant chercher la beauté délicate à l’intérieur de ce tableau cauchemardesque, en s’accrochant coûte que coûte à son héroïne abimée.

Pearl – Copyright A24 2022
Point de jugement ou de psychologie de comptoir, le cinéaste aime profondément son actrice, sa muse et sa coscenariste, Mia Goth, à qui le film pourrait être entièrement dédié. Personnage pathétique, émouvant et intense, elle s’impose comme une créature de cinéma à la fois anachronique et intemporelle. Ses traits angéliques et son visage enfantin contrastent avec une violence longtemps contenue, en mesure d’exploser sauvagement à tout moment. La comédienne, de tous les plans ou presque, saisit l’opportunité qui lui est donnée et livre une prestation aussi puissante que sidérante. Juste dans ses excès, subtile dans ses nuances, imprévisible et entièrement dévouée à son rôle, elle est le plus bel atout du long-métrage autant que sa raison d’être. Il n’est dès lors plus question de genre, sauf à chercher des étiquettes hybrides (un mélodrame horrifique ?), l’ensemble paraît affranchi de tout cahier des charges, d’une grande liberté, à l’inverse justement de l’existence de son protagoniste. Le parcours de cette dernière raisonne étonnement avec celui d’un réalisateur, qui aura progressivement réussi à se défaire de ses référents afin de façonner sa propre identité, avec celui d’une actrice longtemps réduite à une présence énigmatique qui bénéficie enfin l’espace d’expression qu’elle mérite. Œuvre libératrice sur la frustration et les ambitions déchues, Pearl ne se contente pas de réinventer le décor de X, il dynamite sa nature de préquelle pour se poser en objet de cinéma iconoclaste, riche et passionnant. Doit-on préciser que l’on trépigne d’impatience à l’idée de découvrir MaXXXine ?
Sisu de Jalmari Helander (Finlande, 2022)

Sisu – Copyright 2023 Sony Pictures Entertainment Inc.
En 2011, Jalmari Helander arrivait dans le monde du cinéma muni d’un solide passif dans la publicité, qui lui a autrefois valu plusieurs récompenses. Il signait avec Père Noël Origines, une relecture horrifique toute personnelle, violente et teintée d’humour noir de la légende hivernale (il se murmure que Cate Blanchett adorerait le film). En dépit, de la petite cote que lui a valu ce galop d’essai, il n’a pas cédé aux sirènes hollywoodiennes et réalisait trois ans plus tard, Big Game. Une coproduction européenne, devenant par la même occasion le plus gros budget de sa Finlande natale (8,5 millions d’euros), où ses fidèles Onni Tommila et Jorma Tommila partageaient l’affiche avec Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Ted Levine ou encore Felicity Huffman. Il s’essayait alors à l’actioner, tendance eighties, pourvu d’une réelle affection pour le genre et animé par une recherche de plaisir primaire, mais sincère. Son troisième long-métrage Sisu (un mot finlandais intraduisible, nous annoncera-t-on d’entrée), fort d’une projection électrique au festival de Sitges (il a décroché le prix du meilleur film), s’inscrit dans le même sillage, celui d’un artisanat modeste et soigné, au référentiel assumé. En 1945, un soldat (Jorma Tommila) découvre de l’or dans les profondeurs sauvages de la Laponie. Lorsqu’il tente d’apporter son butin en ville, un escadron de soldats nazis dirigé par un officier SS brutal (Askel Hennie) se met en travers de son chemin et une bataille pour l’or s’engage entre le mercenaire solitaire et les nazis.

Sisu – Copyright 2023 Sony Pictures Entertainment Inc.
Fort d’un pitch aussi prometteur qu’excitant, Jalmari Helander surprend par sa volonté de ne pas précipiter les choses et prendre le temps de poser son décor. La Laponie, territoire porteur d’histoires et au potentiel jusqu’à présent bien peu exploité : ses vastes étendues arides, ses terres détruites par les nazis, ses couchers de soleil. Le réalisateur impose d’un même élan un pur paysage de cinéma autant qu’il revendique une identité européenne affirmée, dans l’héritage du western-spaghetti. Le chapitrage et la typographie de Sisu, rappellent immanquablement Quentin Tarantino, mais aussi et surtout certaines de ses sources d’inspirations, Enzo Castellari et son Inglorious Bastards en tête. Un projet clair se dessine, finalement loin de la bourrinade décomplexée post-John Wick (pour citer le haut du panier), celui de réinvestir tel un contrebandier un genre porteur et le délocaliser « à domicile » afin de mieux se l’approprier. Si le cinéaste ne s’évertue pas à faire du développement psychologique, il fait montre de la même patience au moment de laisser germer ses enjeux. Il permet ainsi à son récit de se construire, imposer sa propre mythologie et enfin iconiser son protagoniste. Héros de cinéma immédiatement évocateur et emblématique (charisme naturel et imposant de Jorma Tommila), cet homme décri comme « un escadron de la mort à lui tout seul » avance avec un objectif simple : préserver son butin, quitte à tuer massivement les nazis qui se dresseront sur son passage. Individu quasi mutique (le film contient peu de dialogues, quasiment aucun ne sort de sa bouche) refusant de mourir, il semble à la fois hors normes et paradoxalement humain. Une forme de fatalisme et de résignation sont perceptibles, il avance vers son destin, conscient des obstacles et épreuves qui l’attendent. Cette dimension désabusée, est moins un vecteur de suspens qu’une façon de rendre l’action plus physique, plus tangible et en définitive moins gratuite. Pourquoi se donner autant de mal à soigner un produit par essence mineur et mal élevé ? Précisément pour nous permettre de mieux apprécier le spectacle et lui offrir un minimum de consistance.

Sisu – Copyright 2023 Sony Pictures Entertainment Inc.
Malin, Jalmari Helander ne gaspille pas ses meilleures cartouches. Si les promesses annoncées seront tenues, il tient à y mettre les formes, le dosage est en ce sens primordial. Cela s’exprime moins dans la richesse d’un script rectiligne (exception faite d’un flashback jouissif explorant les origines du protagoniste) que dans la variété de l’action et un désir d’éviter la répétition d’une séquence à l’autre. De la nature des modes opératoires – corps à corps, armes à feu, explosifs (la scène à base de mine se révèle assez inventive) – à l’exploitation des différents décors, le réalisateur optimise son argument de départ. On pourrait pointer un final un brin expéditif, moins impactant que ce qui a précédé, mais il nous est difficile de faire la fine bouche devant un film qui connaît parfaitement ses limites et ses atouts. Sisu se pose en série B sanglante et chiadée, modeste et efficace, nourrie d’une affection sincère à l’égard d’un pan cinématographique trop souvent pris de haut ou abordé sans rigueur. Il constitue en définitive une heureuse anomalie, à la fois fondamentalement mineure et foncièrement réjouissante.
Sortie le 21 juin 2023
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).