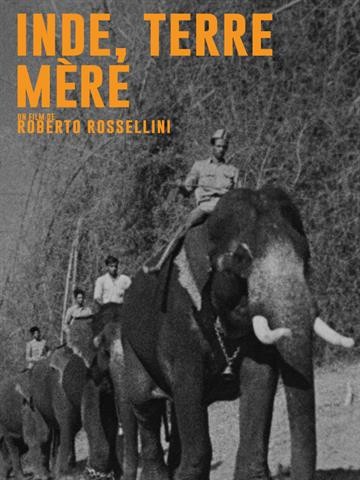Sortie de neuf films de Roberto Rossellini par Bac Films. Parmi eux, India, Terre Mère – India, Matri Bhumi. Une version restaurée en 2K.
—
En 1954-55, Roberto Rossellini a sorti sur les écrans Voyage en Italie, Jeanne au bûcher et La Peur. Comme beaucoup de ses films précédents, depuis Paisà (1945), ce sont des échecs commerciaux, et Ingrid Bergman s’inquiète pour ses situations familiale et professionnelle.
En fait, le couple bât de l’aile.
L’actrice accepte de tourner dans un film hollywoodien, ce qu’elle n’avait pas fait depuis longtemps. C’est Anastasia d’Anatole Litvak… Le cinéaste regarde aussi vers d’autres cieux…
Bientôt, les époux divorceront.
En ces années, et notamment parce qu’il se sent lâché par les producteurs italiens, Rossellini fait des séjours à Paris. Il y rencontre et fréquente André Bazin, les rédacteurs des Cahiers du Cinéma dont beaucoup vont devenir des acteurs de La Nouvelle Vague et qu’il encourage dans leurs premiers travaux scénaristiques et/ou filmiques. Il engage d’ailleurs François Truffaut pour l’aider à préparer de nouveaux projets, qui n’aboutissent cependant pas. Parmi eux, une adaptation de Carmen de Prosper Mérimée, et une du Serpent à plumes de D.H. Lawrence.
Et puis, finalement, l’Inde et le réalisateur se tendent les bras. En 1956, Rossellini rencontre le Premier Ministre indien Njawarharlal Nehru et son Ministre des Affaires Étrangères à Londres et l’idée de venir tourner dans et sur le sous-continent commence à prendre forme. Des difficultés diverses lui font prendre du retard, mais, finalement, il part au mois de décembre de cette année-là. Sur place, de nouvelles difficultés le freinent dans son élan. À Bombay, il entre en contact avec des producteurs appelés les Frères Borkei, mais la relation tourne court. Il rencontre Harisadhan Das Gupta, un documentariste qui a travaillé avec Jean Renoir sur Le Fleuve (1951) et que le réalisateur français lui a recommandé. Das Gupta pourrait guider Rossellini dans l’Inde profonde, mais, accaparé par son travail personnel, il pousse à proposer que sa femme, Sonali Senroy Das Gupta, aide le metteur en scène italien. Elle participe notamment à l’écriture du scénario avec Rossellini lui-même (1). Pour avancer au niveau de la production, le réalisateur se met en rapport avec les autorités indiennes à New Delhi et il rencontre Nehru qui accepte de l’aider et qu’il va suivre et filmer durant quelques-uns de ses déplacements.
Le tournage proprement dit, chaotique, commence en janvier- février 1957 et se déroule probablement jusqu’en juin – Rossellini quitte l’Inde en octobre.
Aldo Tonti, le chef opérateur (2), tourne avec une caméra 16mm et une caméra 35mm. À partir des centaines d’heures de rushes accumulées, à travers un long travail de montage, Rossellini tirera un journal de voyage, qui sera diffusé en noir et blanc à la télévision française et à la télévision italienne (3), et un film en couleurs dont la version officielle est la version française, durant 95 min.
Le film est d’abord intitulé India 57, puis India 58, et enfin India, Matri Bhumi. Il est présenté à Cannes en mai 1959, mais ne sera pas exploité dans les salles françaises. La version italienne sort en mars 1960 – sa durée est de 90 min.
India, Matri Bhumi a souvent été comparé à Paisà (4), car il est composé de plusieurs épisodes situés dans des régions différentes d’un pays donné. Parce que ces épisodes sont tournés avec des acteurs non professionnels ; sont introduits – et parfois accompagnés – par un commentaire informatif… Une voix off qui fait écho à des images représentant un voyage, un déplacement ; résultent d’une démarche mêlant documentaire et fiction.

© Bac Film
Le commentaire liminaire présente la foule de Bombay. Il s’agit pour l’auteur de restituer, sous forme de catalogue, par accumulation de termes sémantiquement connexes, par homéotéleutes, la forte densité de la population, le mélange pacifique de différentes catégories d’Indiens, d’Indiens parlant des langues différentes – ce peuple serait « le plus tolérant de toute la terre ». Mais aussi d’évoquer l’organisation de la société en castes. Le ton est hyperbolique. Le débit parfois accéléré de la voix du commentateur – dimension prosodique -, le montage rapide, les percussions enlevées que l’on entend par intermittence en participent.
En réalisant son film, Rossellini s’inscrit dans cette lignée de visiteurs, d’intellectuels, d’artistes qui ont vu dans l’Inde une alternative à la société occidentale impérialiste, consumériste, matérialiste, qui ont été fascinés par la capacité des Indiens à conserver leurs traditions et à se projeter dans l’avenir, à se développer industriellement, par l’importance pour eux de la spiritualité, par le rapport encore très fort qu’ils entretiennent avec la Nature.
On peut cependant être frappé de ce que, au-delà de la poésie indéniable du film et de la capacité du réalisateur à capter de manière authentique certains aspects de la société indienne en sortant des sentiers battus, des circuits touristiques et des clichés attrape-nigauds, il idéalise quelque peu celle-ci, passe sous silence des problèmes historiques comme les massacres qui ont marqué la partition entre l’Inde et le Pakistan, certaines questions sociétales comme celle des Intouchables. Pour avoir une idée du sort réservé aux populations hors-castes – aux « backward classes » -, on peut par exemple s’intéresser au film de Louis Malle intitulé L’Inde-fantôme (1969). Malle montre par exemple les Dobis de Bombay, blanchisseurs dont la « besogne » est considérée comme « impure ».
Il se trouve que Rossellini a travaillé avec l’indianiste Alain Danielou pour certaines parties de la musique de son œuvre. Danielou (1907-1994) a mis en question la notion de caste. Il a par là même été accusé de défendre le système hiérarchique mis en place dans la société indienne. Il faut alors se reporter au discours de Louis Malle qui évoque plus généralement un problème d’« exploitation de l’homme par l’homme », d’organisation sociale reposant sur des valeurs religieuses, mais permettant l’« oppression économique ».
Concernant l’extrême pauvreté d’une grande partie de la population indienne, situation que Rossellini n’aborde quasiment pas, c’est vers Pier Paolo Pasolini et Alberto Moravaia qu’il faut se tourner : vers l’ouvrage L’Odeur de l’Inde (1962) et le film Notes pour un film sur l’Inde (1968) pour le premier ; vers le récit de voyage intitulé Une certaine idée de l’Inde (1962) pour le second.
Des critiques italiens comme Guido Aristarco ou Pio Baldelli (5), qui a consacré une monographie à Rossellini, ont reproché en leur temps au cinéaste son approche parfois trop immédiate de la réalité, sous forme de chronique, et sa difficulté à approfondir du point de vue historique, idéologico-politique, socio-économique, les phénomènes, les mondes qu’il a filmés – ou son refus de le faire.

© Bac Films
Le guide acousmatique, hétérodiégétique – le premier ou un autre – nous emmène dans l’Inde des villages, plus authentique que celle des grandes villes. Progressivement, il permet au spectateur de se rapprocher des éléphants qui aident les Indiens dans leurs activités – l’ « éléphant est le bulldozer de l’Inde » – et de ceux qui s’en occupent : les mahouts – ou cornacs. Nous entrons dans la Jungle de Karapur, sise dans la Province du Kerala – au sud-ouest du pays -, et située près de la ville de Madurai.
Les plans sont plus longs, avec d’amples panoramiques, et le montage est plus posé. Le regard est contemplatif.
Une longue séquence décrit le travail des mahouts et des éléphants. Ceux-ci déracinent des arbres en les poussant, tirent des troncs, les soulèvent entre leur trompe et leurs défenses et les déposent sur des camions. La post-synchronisation aide à cela, mais ce qui est extraordinaire c’est d’avoir l’impression que cette activité se fait avec délicatesse – mouvements et bruits. De la sérénité émane des plans. La voix off : « L’Indien fait tellement partie de la Nature, qu’il réussit par la douceur plutôt que par la force à faire de l’éléphant son associé dans le travail ».
Puis c’est le bain. La voix off change : celui qui parle et explique ce qui se passe, donne des informations est un des mahouts – on va le comprendre assez vite,. Ce commentateur est homodiégétique. Il y a comme un glissement métaleptique qui nous permet d’entrer en empathie avec les personnes filmées, avec l’une d’entre elles en particulier, dont on va suivre une partie de l’existence. D’ailleurs, cette voix s’adresse aux spectateurs.
Les cornacs lavent, brossent leurs collaborateurs. La tâche est dure. Les pachydermes se laissent faire et nagent dans le bonheur, cela se voit ! Dans son autobiographie, Rossellini a donné son avis sur cette situation : « Le fait est qu’on peut se demander (…) qui des deux est le maître. Ma conviction est faite : c’est l’éléphant qui est le propriétaire du mahout, et le mahout est le serviteur de l’éléphant » (6).
Nous assistons plus tard à la rencontre amoureuse entre le cornac dont la voix a été entendue – qui, par un nouveau glissement énonciatif, passe du « nous » renvoyant à l’ensemble du groupe auquel il appartient de par son travail au « je » correspondant à son identité propre. Les familles du jeune homme et de la jeune femme négocient les conditions du mariage (7). Celui-ci a lieu. La femme tombe enceinte.
Rossellini réalise un montage parallèle montrant, avec un certain humour d’ailleurs – qui découle de l’observation attentive du comportement des animaux et de la bonne utilisation des plans dans le montage -, les amours d’un éléphant et d’une éléphante. Une démonstration éloquente de ce lien entre l’Homme et la Nature.
Le deuxième épisode évoque la construction d’un immense barrage appelé Hirakud, sur le fleuve Mahanadi – au nord-est du pays. À travers la voix off hétérodiégétique, l’auteur justifie la réalisation du chantier permettant de dompter les forces néfastes de la Nature pour le bien de l’humanité indienne par cette loi édictée dans l’hindouisme : celle du karma, de l’action. Rossellini montre le dur labeur de milliers de travailleurs, hommes et femmes, qui creusent la terre et l’évacuent, déplacent des blocs de pierre. La voix off homodiégétique, celle de l’un des travailleurs ayant permis l’accomplissement de cette œuvre pharaonique, explique : « Dans le chantier, nous étions trente-cinq mille. C’était dur, oui, mais nous y sommes arrivés. Sept années de travail ». Se mêlent l’information factuelle – dimension pédagogique -, et le ressenti : en l’occurrence une grande satisfaction quant à ce qui a été accompli pour le pays. Une fierté que l’on a l’impression de voir : par exemple à travers les femmes droites comme un i, avançant en file indienne, portant sur leur tête des paniers de terre à emmener au loin.
Rossellini a effectué un montage productif, car il n’a évidemment pas pu filmer les travaux lancés par Nehru en avril 1948 et qui se sont terminés en juin 1955.
La musique du film, réalisée par le compositeur de musique concrète Philippe Artuys (1928-2010), est très importante dans cet épisode, et réussie. Artuys crée une symphonie de bruits. On entend les coups de marteau, le son des marteaux-piqueurs, des véhicules, des machines excavatrices, des grues…
La représentation de l’ouvrier est intéressante en ce qu’elle montre qu’il est hanté par deux mondes auquel il tient : celui des traditions, des rites religieux, et celui du progrès de la science, de la connaissance, de la technique… le spectateur peut entendre une voix intérieure qui résonne, répète comme un mantra problématique le mot « électricité ». Un geste répétitif du personnage est mémorable, qui montre son trouble, sa préoccupation, son possible déchirement : le fait de passer la main sur la tête, dans les cheveux.

© Bac Films
L’ouvrier doit quitter Hirakud pour travailler sur d’autres chantiers, parce qu’il veut le faire. Quelque chose semble le pousser à aider au développement de son pays – l’esprit de solidarité ? Sa femme ne l’entend pas de cette oreille. Elle lui fait des scènes, souhaitant rester là où ils se sont installés depuis de nombreuses années, là où ils ont pris leurs habitudes. Alain Bergala a fait une lecture intéressante d’India, Matri Bhumi dans un texte intitulé « India comme autoportrait de Rossellini en cinéaste et en mari » (8). Tout est dans le titre, mais citons l’auteur qui étaye son propos à travers les pages de son texte : « (…) caché derrière le postulat cousu de fil blanc que les quatre épisodes du film racontent autant de petites histoires indépendantes, Rossellini nous raconte à l’évidence, dans l’ordre (celui des trois premiers épisodes) soixante ans de ce qui pourrait être la vie du même couple » (p.56). Et Bergala de préciser que le cinéaste, qui a eu des amours tumultueuses, se rêve en fait en la personne du mari indien. Plus loin, il écrit : « India est aussi un autoportrait de Rossellini : il s’y peint en filigrane aux prises avec ce travail d’éléphant ou de fourmi qui consiste à faire un film (…) » (p.60).
Le troisième épisode met en scène un vieil homme qui parle de sa femme dévote et de la vie de son couple, de sa progéniture, de son existence désormais contemplative et non plus laborieuse, de son sentiment de fusion de plus en plus fort avec la Nature, probablement dû à l’âge. Cette Nature est ici une forêt supposée être à proximité de la ville de Rourkela, au nord-est du pays.
Dans ce passage, il est question de l’intervention de l’homme, mais le propos est différent de celui du deuxième épisode, il est moins équivoque. Ici, la Nature n’est pas hostile. Il ne s’agit pas pour ceux qui vont la transformer de sauver des vies humaines, mais d’exploiter la terre – pour y extraire du fer. L’arrivée des ingénieurs, de leurs voitures, de leurs machines rompt l’équilibre naturel. Un tigre, considéré comme habituellement indifférent à l’homme, devient agressif, en dévore un. Une chasse est organisée par les prospecteurs pour éliminer le fauve. Le vieil homme (se) demande : « Pourquoi tuer ? Le monde n’est-il pas assez grand pour tout le monde ? »
Il est amusant de voir comment les plans des animaux de la jungle sont insérés dans la séquence à travers les artifices fort visibles du montage. Tout simplement parce que ces animaux n’ont pas été filmés dans cette jungle ou au même moment que les plans du vieil homme qui est parfois censé les voir devant lui. Rossellini est justement et paradoxalement fameux pour avoir été un pourfendeur du montage productif : « Les choses sont là (…) pourquoi les manipuler ? » (9).
En fait, le réalisateur n’a jamais refusé de recourir à ce type d’association des plans. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à regarder des films comme Fantasia sottomarina (1939), La Nave bianca (1941 / réalisé sous la tutelle du cinéaste Francesco De Robertis dont le travail fut inspiré par le cinéma soviétique des années vingt et trente), Europe 51 (1952), Voyage en Italie (1954).
En 1959, Fereydoun Hoveyda et Jacques Rivette posent cette question assez naïve à Rossellini : « André Bazin se méfiait des trucages qui reposaient sur le montage. Il fallait disait-il, montrer le tigre et l’homme dans le même plan. Votre film les montre séparément ». Les deux rédacteurs des Cahiers du Cinéma font évidemment référence au texte intitulé « Montage interdit ». Ils semblent tellement aveuglés par le dogme bazinien qu’ils projettent India dans l’écrit de l’auteur de Qu’est-ce que le cinéma ? Or, quand Bazin le rédige et le publie, India n’a pas encore été réalisé !
Le cinéaste italien, qui ne craint pas la contradiction – ou de se contredire – répond en faisant preuve de pragmatisme : « Si l’on veut rendre l’histoire plus crédible, logiquement c’est mieux de les montrer tous deux dans le même plan. Mais si elle est crédible par d’autres moyens, je ne vois pas pourquoi il faudrait user d’une technique particulière ». Et il précise, en s’opposant à l’un des aspects essentiels du propos de Bazin, qui est d’ordre esthétique, que son film n’a pas besoin de « sensation » (10).

© Bac Films
Le quatrième épisode a pour protagoniste un singe femelle appelé Ramu. C’est un primate domestiqué et dressé pour faire des numéros dans des foires, sous la houlette de son maître humain. En traversant un désert, supposément en direction de Bodhgaya – au nord-est du pays – , celui-ci meurt d’hyperthermie. Ramu reste à ses côtés, comme par empathie et fidélité, et parce qu’il est attaché à lui par une chaîne. Les charognards veillent, s’approchent, menacent. La description est longue. Rossellini fait ici comme à d’autres moments du film, il suit les animaux en mouvement et les cherche. On sait que le réalisateur travaille déjà à ce qui deviendra son Pancinor, un dispositif lui permettant d’actionner de lui-même, à distance, le zoom, en combinant ses actions et celles du chef opérateur qui effectue parfois des travellings et/ou des panoramiques.
Finalement, Ramu réussit à partir. Rossellini montre le singe tenter de rejoindre ses congénères restés à l’état sauvage, mais être rejeté, car son odeur porte celle de l’Homme. Il se produit en ville comme il a l’habitude de le faire, mais il n’a personne pour s’occuper de lui. Il est dans un entre-deux invivable. Finalement, il sera adopté par un nouveau maître et se produira dans un cirque.
Difficile de percevoir un message clair de Rossellini dans cet épisode qui est à mettre en quelque sorte en relation avec les autres. Le lien homme-animal, la domestication ne sont pas vus comme systématiquement négatifs. L’action de l’homme sur la Nature non plus, et la Nature n’est pas considérée comme inoffensive. Ce qui compte pour le cinéaste est de constater les effets positifs ou négatifs que peuvent avoir les relations ici évoquées et son souhait que celles-ci soient envisagées avec sagesse, sens de l’équilibre, réalisme.
Par ailleurs, Rossellini a manifestement voulu renvoyer à la figure de l’Homo sapiens à travers sa représentation du singe. Il déclare à ce propos : « Je n’ai pas mis cet épisode à la fin parce qu’il était le plus dramatique, mais parce qu’il figure la règle parfaite de la Nature. Les vautours attendent, mais ils ne vont pas manger l’homme parce qu’il n’est pas mort. Il faut attendre le décret de mort. Il faut que soit, en quelque sorte légalisée la mort de l’homme pour que les vautours – partie de la nature – bougent et viennent accomplir leur fonction de nature. (…) Alors, son maître mort, le pauvre singe qui n’est plus un singe ni un homme, éprouve le besoin d’aller à la fois chez les singes et chez les hommes, de retourner en arrière et d’aller en avant. C’est bien là le drame qui est notre drame à tous. C’est la lutte à laquelle nous sommes mêlés » (11). Nous rejoignons en fait ici le point de vue de Peter Brunette, auteur d’une belle monographie sur le cinéaste dans laquelle l’œuvre est étudiée film par film (12).
***
Selon certains témoignages, Sonali Senroy Das Gupta était réticente à l’idée de travailler avec Rossellini – notamment du fait de sa condition de femme indienne, âgée de seulement 27 ans. C’est son mari qui l’aurait poussée à le faire. Le réalisateur italien et sa collaboratrice se sont rapprochés au-delà de leur relation professionnelle. Le documentariste indien s’en est mordu les doigts. La situation a fait scandale. Rossellini et Sonali Senroy Das Gupta quittent l’Inde ensemble avec l’enfant de la jeune femme. Ayant divorcé d’avec Ingrid Bergman, le cinéaste épouse Sonali Senroy Das Gupta et ils ont ensemble, en 1958, une fille prénommée Rafaella.
India, Matri Bhumi est considéré comme un film-charnière, ouvrant, quoiqu’indirectement, une période de films pédagogiques, didactiques à travers laquelle Rossellini cherche à créer une encyclopédie audiovisuelle du savoir, de la connaissance ; à prôner haut et fort les valeurs de l’Humanisme, du savoir élargi – il se réfère à la Pansophie, concept proposé par l’éducateur tchèque Comenius (1592-1670) -, de la raison et du progrès ; à défendre une spiritualité éclairée ; à s’éloigner de toute forme d’art nombriliste et gratuit.
En fait, et parfois même malgré ce que peut parfois affirmer le réalisateur, cette œuvre à la fois humble et puissante est à la croisée des chemins qui forment sa carrière… L’essentiel du propos réside finalement, selon nous, en cette phrase du Maître italien : « J’ai essayé, si je puis dire sans ridicule, de rendre poétiquement mes sensations de reporter » (13).
—
Notes :
1) Fereydoun Hoveyda (1924-2006) est également crédité au générique. C’est un écrivain et diplomate iranien participant à l’aventure critique et éditoriale des Cahiers du Cinéma.
2) Aldo Tonti (1910-1988) a travaillé avec de nombreux grands réalisateurs italiens. Par exemple Luchino Visconti pour Ossessione (1942-43) ou Alberto Lattuada pour Il Bandito (1946). Avant India, il a collaboré avec Rossellini sur L’Amore (1948) et Europa 51 (1952)
3) L’émission italienne, intitulée L’India vista da Rossellini, est produite pour la RAI. Elle est constituée de dix épisodes. Le cinéaste commente les images avec Marco Cesarini Sforza. Le programme dure 251 min et est diffusé entre janvier et mars 1959.
L’émission française a pour titre J’ai fait un beau voyage et est produite par l’ORTF. Les images sont à peu près les mêmes que pour le programme transalpin. Rossellini dialogue avec Étienne Lalou. L’ensemble est d’une durée de 239 min et est diffusé entre janvier et août 1959.
4) En fait, Rossellini avait envisagé plus d’épisodes, des tournages dans plus de régions. Les difficultés rencontrées lui ont fait abandonner une partie d’entre eux. Le cinéaste en parle dans un entretien qu’il accorde en 1959 à Fereydoun Hoveyda et Jacques Rivette pour les Cahiers du Cinéma [n°94, avril 1959]. Reproduits in Roberto Rossellini, Le Cinéma révélé, Flammarion, Coll. Champs Contre – Champs, Paris 1988, p.80 [1re édition : Éditions de l’Étoile, Paris, 1984] : pp.75 et 76.
5) Cf. Pio Baldelli, Roberto Rossellini, Samonà e Savelli, Roma, 1972.
6) Roberto Rossellini, Fragments d’une autobiographie, Editions Ramsay, Paris, 1987, p.171.
7) Les versions actuellement projetées proposent un sous-titrage des dialogues entre les Indiens. Nous pensons que Rossellini ne souhaitait pas, à l’origine, permettre une compréhension claire de ce qui se dit devant la caméra, pour conserver, malgré la question de l’empathie que nous avons évoquée, une distance entre lui et le spectateur, d’une part, les personnes filmées, d’autre part. Question de respect de l’extranéité, question de pudeur.
8) In India – Rossellini et les animaux – Un livre [collectif] réalisé par Nathalie Bourgeois et Bernard Bénoliel, avec le concours d’Alain Bergala, Cinémathèque Française (Paris), Le Cinéma Jean Renoir (Martigues), La Coursive/Scène Nationale (La Rochelle), 1997.
9) Entretien accordé à Fereydoun Hoveyda et Jacques Rivette [art.cit. en note 4]. Reproduit in Roberto Rossellini, Le Cinéma révélé, op.cit., p.80.
10) Ibid., p.82.
À savoir : dans Inde, Terre Mère, les lieux mentionnés ne sont pas toujours ceux où le tournage a concrètement eu lieu.
11) Ibid., p.80.
12) Peter Brunette, Roberto Rossellini, Oxford University Press, New York / Oxford, 1987, p.206.
13) Entretien accordé à Fereydoun Hoveyda et Jacques Rivette [art.cit. en note 4]. Reproduit in Roberto Rossellini, Le Cinéma révélé, op.cit., p.73.
—
Indications bibliographiques complémentaires :
* Gianni Rondolino, Roberto Rossellini, UTET, Torino, 1989. Cf. « Capitolo sesto : L’Esperienza indiana », pp.229-258.
* Tag Gallagher, Les Aventures de Roberto Rossellini, Éditions Léo Scheer, Paris, 2006 [Traduction : Jean-Pierre Coursodon / Édition originale : New York, 1998]. « Cf. Chapitre 18 ; The Great Mother », pp.465-496.
—
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).