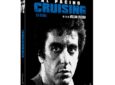(à voir également sur le site, notre rencontre avec William Friedkin)
Difficilement visible au cinéma, ou bien présenté dans des éditions vidéo recadrées, « Sorcerer » avait acquis une réputation de film « maudit », autant pour son échec commercial que pour son expérience extrême de tournage. Le film, relecture très personnelle du « Salaire de la Peur » (le roman de Georges Arnaud et surtout le film d’Henri-Georges Clouzot) revient sur les écrans en version restaurée.
Réalisé après « French Connection » et « L’Exorciste », « Sorcerer » est le climax créatif de la première décennie dans l’œuvre de fiction de Friedkin, un « chef d’œuvre maudit » selon la formule rebattue (re donc), dont le réalisateur ne parviendra à se relever qu’épisodiquement. « Sorcerer » sera balayé par le succès de « La Guerre des Étoiles« de Georges Lucas, sorti la même année ; une version beaucoup plus affable et comestible des « forces noires » de l’univers, un « space opera » romancé et héroïque (ce qui ne gage en rien, bien sûr, les qualités du film). Par la suite, Friedkin ne pourra renouer qu’épisodiquement (avec « La Chasse » ou « Police Fédérale Los Angeles ») avec une ambition et une liberté artistiques plus grandes.

« Sorcerer » débute par la présentation des personnages, des sortes de scènes d’exposition juxtaposées, développant chacune leur propre dramaturgie, avant de coaguler dans un ultime contexte, un village reculé dans une contrée imaginaire d’Amérique du Sud (le film est tourné en République dominicaine et au Mexique), avec sa grande indigence, sa répression militaire, et son exploitation par une compagnie pétrolière nord-américaine, bien peu soucieuse des vies humaines (Friedkin pointe délibérément son propre pays, et le vampirisme des pays pauvres). Un véritable bagne à ciel ouvert, dans la chaleur d’un enfer tropical, muselé par une dictature complice du capital étranger. La destinée des quatre personnages, ouverte sous le signe peu engageant d’un masque primitif gravé dans la roche, sera forcément d’échouer dans cette épouvante sans nom. Leur seule planche de salut consistera à acheminer, avec deux camions, des bâtons de nitroglycérine qui peuvent s’embraser au moindre choc, et ce jusqu’à un site reculé au fin fond de la jungle, pour éradiquer l’incendie d’un puits de pétrole… Bien évidemment, la mission, de l’ordre de l’impossible, s’avère très périlleuse, d’autant que chacun ne pense qu’à empocher la prime pour lui seul. Les éléments naturels se liguent contre le convoi, quand ce n’est pas la grossièreté des « infrastructures », ponts branlants suspendus ou aboutements précaires de longs rondins…

Comme nous sommes chez Friedkin, il y a un humour, évidemment sardonique, qui s’amuse sous cape, non pas de ses personnages, mais de l’absurdité de la condition humaine, et de la tendance innée à un égoïsme sans scrupule. « Sorcerer » pourrait tout à fait être la fable d’un moraliste qui aurait oublié sa morale en chemin. Le contenu serait d’une noirceur sinistre, si Friedkin n’y glissait pas de savoureuses allusions, parfois délibérément appuyées, comme la gueule du camion baptisé lui-même « Sorcerer », qui parodie le masque primitif vu dans le générique, avec son capot brun hérissé et sa dentition cannibale (la direction artistique est signée John Box, connu pour son travail sur les films de David Lean, avec des vestiges, encore un peu excentriques, des dessins commandés à Philippe Druillet durant la pré-production). De l’autre côté, il y a « Lazaro », nom de baptême du premier camion, au nom tout aussi explicite. Le fait qu’il y ait deux camions comme dans le film de Clouzot, rend manifeste cette équation binaire : pour survivre, il s’agira de jouer à pile ou face avec la duplicité du sort ; ce génie, tantôt protecteur, tantôt menaçant, qui s’amuse des équivoques. Le film vaut évidemment pour ses grands moments de bravoure d’autant plus spectaculaires qu’ils ont été réalisés sans trucages, parfois au péril de l’équipe. Les interprétations impeccables de Roy Scheider (le seul à glisser ostensiblement dans l’excès), Bruno Cremer, Amidou et Francisco Rabal n’y sont pas non plus pour rien. « Sorcerer » garde une grande véracité même quand ses péripéties semblent improbables (par moments, la symbolique et le trait sont assez forcés).
Mais l’élément le plus impressionnant reste la façon avec laquelle Friedkin instille, doucement ou bien par à-coups, un irrationnel, toujours entre deux (mi-fantastique mi-mental), jusqu’à l’indescriptible séquence pré finale : une traversée hallucinée d’un paysage minéralisé (territoire sacré des indiens navajos, situé dans le Bisti Badlands, au Nouveau-Mexique), qui ne semble plus appartenir au monde des vivants. Contre toute attente, Friedkin y parachève tout l’expressionnisme contenu dans son film, qui ne surgissait jusqu’ici, que par éclats baroques et surnaturels. Impossible de ne pas voir là, non plus, un écho de la cinéphilie de Friedkin ; un hommage à la photographie teintée et aux faciès grimés des films muets (les effets optiques sont toujours signés par Marv Ystrom, déjà présent sur « L’Exorciste »).

A l’instar des autres grands films réalisés par Friedkin dans les années 70, il y a donc, dans « Sorcerer », des moments de décrochages où le récit s’échappe, en raison de l’hypertrophie spectaculaire de certaines scènes, de leur glissement très insidieux dans le fantastique ; ou encore d’une stylisation visuelle (sans compter le travail du son réalisé par Jean-Louis Ducarme) qui nous sort de l’étiquette documentaire, à laquelle nous a habituée le réalisateur.
Il faut rappeler que le cinéaste a fait ses armes à la télévision, au sein de laquelle, il a réalisé plusieurs documentaires. Le plus célèbre (mais peu visible) reste « The People vs. Paul Crump » de 1962. Crump était un jeune noir de Chicago, accusé d’avoir participé à un braquage meurtrier, qui n’avait cessé clamer son innocence, avant de se résigner à sa condamnation. Ses aveux lui avaient été extorqués par des policiers racistes, au terme d’un long et violent interrogatoire. Persuadé de son innocence (bien qu’il ait émis quelques doutes par la suite), Friedkin réalisa le film pour sauver Crump, qui attendait depuis huit ans dans le couloir de la mort, promis à la chaise électrique. Son film permis de commuter la condamnation en peine de prison.
Héritée de cette formation documentaire, la caractéristique de « Sorcerer », tout comme « French Connection » avant lui, est de mettre en tension un récit d’une facture très réaliste, sans effets de scénarisation ou de dramatisation trop marqués, avec des moments, d’apparence aussi excessive et démesurée, que le reste est « restreint ». Il en va autant du style que du ton du récit, comme un reversement qui prend le spectateur régulièrement au dépourvu par son contraste impromptu. En un sens, Friedkin a développé une forme du spectaculaire bien à lui, durement réaliste dans la caractérisation des personnages et dans le choix de filmage-montage simili « sur le vif », et dans le même temps, totalement outrancier, par effet de remontée.

Ce sont, paradoxalement, une forme de lyrisme baroque ou même une méchanceté de ton, qui traduisent à l’écran, la personnalité du regard, son plaisir et sa « perversité » maligne de mise en scène. Ces sortes de grandes percées, spectaculaires ou subjectives, font la réputation de Friedkin mais suscitent aussi, un peu d’incompréhension. Les scènes en question semblent se détacher significativement pour devenir autonomes – telle la grande séquence de poursuite de « French Connection » sous le métro aérien, ou son revirement final, en forme de séquence mentale – et elles donnent au tout, une allure un peu composite. Mais à revoir les films, on est frappé de voir combien ils tiennent, tout et parties, et que tous ces éléments participent d’une élaboration dramatique très rigoureuse. Probablement, c’est cette mise en place méticuleuse (le fameux long prologue sur les quatre personnages ; film(s) dans le film), plus la noirceur du récit et la variation de tons, à cheval entre le film d’aventure objectif et son pendant, fantastique et mental, qui eurent, par leur complexité, un peu raison du public lors de la première sortie en salle. Mais comme on le sait, les bons films vieillissent très bien, et leur singularité devient limpide quand on les regoûte.

« Sorcerer » reste fable très pessimiste sur la destinée et la négativité humaine ; une sorte de voyage de non-retour, une épopée de la survie aux confins de la folie. Le fantastique et la poisse du film noir, courent dans ce film de (més)aventures allégorique, au climat souterrainement horrifique. En ce sens, le film n’est absolument pas un remake mais bien une œuvre originale, une recréation entière du « Salaire de la Peur ». La construction pointilleuse du scénario, son éclatement « choral », et son « grand angle » narratif (d’une ambition quasi littéraire), œuvre du scénariste Walon Green, ne sont pas pour rien dans la « réussite » (toute artistique) de ce film, âpre et noir, dans lequel tous les personnages sont des pauvres diables, assez antipathiques, et désespérés. Le film traduit à sa manière l’accablement et la désillusion des années post Vietnam en Amérique. Comme si, quels que soient nos efforts individuels ou collectifs, une malignité sourde et chaotique, tapie hors, ou bien au dedans de nous, finissait toujours par l’emporter, en ayant littéralement raison de tout. Une blague d’une ironie carnassière.
sortie nationale le 15 juillet 2015 avec La Rabbia – Bach Films.
Culturopoing est partenaire de l’évènement.
(c) La Rabbia

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).