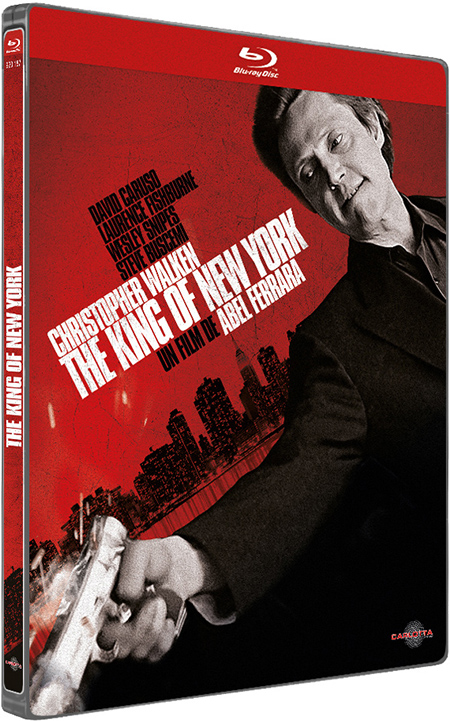Frank White, fantôme urbain.
« Vous savez… je suis parti depuis si longtemps…… que je n’ai plus aucune sensibilité, plus aucun remord…… c’est vraiment terrible… »
Frank White
Un « fatum » puissant comme une tragédie grecque – une habitude chez Abel Ferrara – distillé par une mise en scène maitrisée qui s’appuie sur l’ambiguïté de chacun de ses messages : car il n’y a rien de manichéen chez Ferrara, le film préférant définir sa rencontre entre deux mondes qui se retrouvent sous le sceau de la dépendance au lieu du trop simpliste conflit. Malgré deux espaces qui s’opposent – la saleté des bas-fonds / la proprété luxueuse d’un intérieur de Limousine -, seule la lumière que chacun apporte à l’autre semble offrir une droit d’existence à l’image, un légitimité cinématographique : les visages sortent de l’ombre, les individus deviennent personnages. Mis « à l’ombre » tant d’années, Frank White a résolumment besoin de cette lumière urbaine mais refusera de s’arrêter : avortement d’une première rencontre.

Interdépendance

Une prière
Et si King of New-York est une tragédie, celle ci ne s’épanouit pas dans l’affrontement perpétuel mais bien dans cette rencontre irrésolue : le film nous contera dès lors non pas une histoire d’amour contrariée mais une histoire d’amour impossible.
King of New-York sera dès lors la peinture d’un homme voué à rester spectateur d’un monde qui aurait besoin de lui, échouant à en devenir acteur et condamné à l’errance. En se prophétisant un destin – à l’image d’un geste inaugural en prison qui pourrait être une prière -, Frank White ne révèle au spectateur que son caractère apatride. A partir d’une première séquence dont on ne saurait dire si les grillages s’ouvrent ou l’enferment vers un ailleurs, Frank White sera condamné à vivre dans des hôtels au luxe fallacieux, des bas-fonds indéterminés, des lieux publiques ou il ne sera que « de passage ». Une errance de fantôme, d’un homme « déjà-mort » qui cherche à redevenir quelqu’un, à – littéralement – se « réincarner ».
Il faudra ressentir de nouveau l’eau couler sur sa peau, retrouver la douceur d’un sein niché dans le creux de la main ou l’odeur d’une paire de gants : retrouvez un peu de matérialité, de « vivant ». Mais au risque de réveiller la pulsion destructrice, de révéler l’attrait du vice : c’est un nouveau rapport au monde qui s’instaure portant en lui les germes de son autodestruction.

Retrouvez un semblant de matérialité…
Dans un équilibre précaire, pour mieux résister à une incarnation qu’il désire tant mais qui le mènerait à sa fin, Frank White s’entoure des oripeaux fallacieux du luxe, évoluant dans un univers de papié glacé, froid et inconsistant. Abel Ferrara excelle dans la descrition d’un monde de la vacuité, peignant comme une couverture de magazine les usuels objets d’un luxe qui se noie dans son inutilité et son autosatisfaction. Un art en surface comme une peinture vaine et qui n’en révèle que l’aspect désincarné : une dimension du futile déjà à l’orée de sa décadence, à l’image d’une première séquence qui rapelle les « bordels » ou ne se trainent que des corps désarticulés et des âmes en peine. Trop peu pour s’accrocher au monde… Trop peu pour Frank White.

Décadence et papier glacé…
Dans un monde sans saveur, pour un roi sans royaume, la tentation est grande de se « laisser vivre » au risque du pire: il se voulait un « homme de moralité », notre roi sera fatalement rattrapé par un monde vicié par la pulsion.
Posséder, jouir, exhulter, dominer : autant de tentations qui nourissent les ambitions des personnages qui entourent Frank White et qui mettront à mal sa destinée espérée. Abel Ferrara excelle dans la peinture d’un personnage devenant bicéphale, vicié à son tour par la pulsion et capable, dans un simple raccord, de basculer du dialogue à l’explosion soudaine d’une violence sèche. Se murer dans l’ataraxie ou sombrer dans le vice : un déchirure perpétuelle qui place le film dans une religiosité typique de Ferrara.

Frank white, créature bicéphale le temps d’un raccord…

Reflets et Duos
Et c’est dans un métro, qui sera un tombeau, que viendront s’affronter les derniers représentants d’une noblesse perdue, les ultimes légataires d’une humanité mise à mal, d’une morale abîmée. Mais qu’on ne s’y trompe pas : s’ils ont, un temps, survécu au basculement du monde, c’est qu’eux mêmes étaient déjà morts.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).