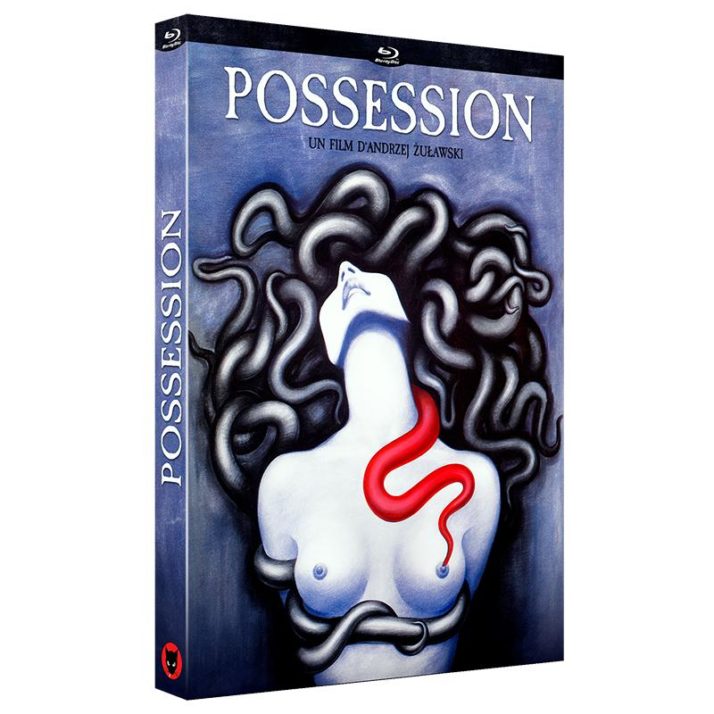« Par la folie, une œuvre qui a l’air de s’engloutir dans le monde , d’y révéler son non-sens, et de s’y transfigurer sous les seuls traits de pathologiques, au fond engage en elle le temps du monde, la maîtrise et le conduit ; par la folie qui l’interrompt, une œuvre ouvre un vide, un temps de silence, une question sans réponse, elle provoque un déchirement sans réconciliation où le monde est bien contraint de s’interroger. » (1)

Copyright Le Chat qui Fume 2021
Après s’être attiré les foudres de la censure polonaise pour son deuxième long-métrages, Le Diable, Andrzej Żulawski se voyait contraint de s’exiler en France où il avait, plus jeune, fait ses études, afin de tourner L’important c’est d’aimer. Le film permet à Romy Schneider de décrocher le césar de la meilleure actrice et s’avère un triomphe dans l’hexagone (il réunit plus d’un million et demi de spectateur). Le metteur en scène est ainsi découvert d’un public plus large et bénéficie d’un retour en grâce auprès des autorités chargées des affaires culturelles de son pays. Invité à revenir en Pologne pour réaliser le projet de son choix, il s’attelle entre 1976 et 1977 à une entreprise ambitieuse : Sur le Globe d’argent, adaptation d’une fresque littéraire de science-fiction, La Trilogie Lunaire, écrite par son grand-oncle, Jerzy Żulawski. À neuf jours de la fin du tournage, le nouveau ministre de la culture et chef du département cinéma Janusz Wilhelmi, percevant à travers ce récit une allégorie contre le totalitarisme, une œuvre dangereuse pour le régime, ordonne l’arrêt immédiat des prises de vues. Les décors sont détruits, un gigantesque trou est creusé afin d’enterrer les costumes, tandis que le cinéaste est fiché et interdit de travailler. Cette tragédie professionnelle vient s’ajouter à une autre douleur, quant à elle sentimentale. Peu avant la réalisation de L’important c’est d’aimer, l’actrice Małgorzata Braunek, son épouse qu’il avait dirigée dans La Troisième Partie de la nuit et Le Diable, le quitte. Esseulé à Varsovie, à s’occuper de son fils Xawery, au cœur d’une ville qui lui apparaît tel un territoire ennemi, commence à germer l’histoire de Possession. Grâce à l’aide de son ami Christian Ferry, officiant alors à la Paramount, il parvient à rejoindre New York et trouver des fonds pour se lancer dans l’écriture de ce nouveau scénario. Deux mois durant, enfermé au Mayfair hôtel et à grand renfort d’alcool, épaulé par le romancier américain Frederic Tuten, le script prend forme. Lâché par son producteur initial mais désormais indéfectiblement soutenu par Marie-Laure Reyre, Żulawski peut penser à la concrétisation de son dessein. Isabelle Adjani, premier choix pour incarner Anna, refuse, quand Sam Neill accepte immédiatement. Le réalisateur contacte le chef opérateur Bruno Nuytten dont il a apprécié plusieurs travaux (notamment sur Barocco d’André Techiné), ignorant qu’il partage la vie de l’actrice, ce dernier persuadé qu’il s’agit d’un rôle pour sa compagne promet de la convaincre. Quelques heures ou jours après (selon les versions), l’interprète d’Adèle H. répond favorablement à la proposition. Dévoilé en mai 1981 au Festival de Cannes, Possession clive, entre adorateurs et féroces détracteurs, Adjani reçoit tout de même le prix d’interprétation (partagé avec sa prestation dans Quartet de James Ivory, également en compétition). Échec dans les salles françaises, il est mutilé lors de son exploitation américaine (le montage passe de 127 à 77 minutes) où il est vendu comme un vulgaire film d’exploitation. Ce n’est qu’avec le temps qu’il commence à être plus largement apprécié à sa juste valeur et acquiert un statut d’œuvre culte. Inédit dans l’hexagone en haute-définition, il bénéficie quarante ans après sa sortie d’une édition à sa démesure, concoctée par Le Chat qui Fume (L’Important c’est d’aimer est d’ors-et-déjà annoncé à leur line-up dans les mois à venir). Après un long séjour à l’étranger, Mark (Sam Neill) retourne à Berlin pour y retrouver sa femme, Anna (Isabelle Adjani), et son fils Bob. Mais il réalise très vite que son épouse a changé. Il apprend notamment que celle-ci a un amant, un certain Heinrich (Heinz Bennent). À cause de cela, les rapports du couple se dégradent rapidement. Mark décide alors d’engager un détective privé (Carl Duering) afin qu’il suive Anna, souvent absente du foyer. Un jour où Mark va chercher son garçon à l’école, il se rend compte que l’institutrice est le portrait craché de sa femme. Le détective, quant à lui, découvre avec effroi qu’Anna entretient une liaison avec… une « chose » monstrueuse…

Copyright Le Chat qui Fume 2021
Expérience hors normes, Possession constitue à plus d’un titre un véritable casse-tête analytique, comme si chaque tentative d’en percer les secrets, d’en approcher la vérité, était vouée si non à l’échec, à la découverte d’autres mystères, témoignant d’une richesse d’interprétation proche de l’infini et plus que jamais propre à la subjectivité de chacun. Œuvre tentaculaire, d’évidence déroutante et déstabilisante, bouleversant à mesure qu’elle se révèle nos repères et nos croyances, se pose en creux la problématique suivante : Comment tenter de rationaliser l’irrationnel et surtout est-ce réellement pertinent ? Le premier dialogue entre Mark et Anna, tel un indice subliminal, place le long-métrage sur le terrain de l’incertitude : « Quand sauras-tu ? – Je ne sais pas ! ». Plusieurs questions, trouvant de pesants silences en guise de réponses, tandis que la caméra distante se rapproche légèrement, tournant autour de personnages qu’elle semble indiciblement enfermer dans le cadre. Ce couple dont on ignore tout ou presque (il est de retour après une longue absence) est introduit au bord de l’implosion et sans joie. Leur seul bonheur palpable au cours de ces minutes inaugurales, est à mettre au crédit de leur fils, Bob, qu’ils observent brièvement en train de jouer dans la baignoire. Une réunion familiale de courte durée, précédée d’un plan prenant soin d’isoler au sein de la même image l’homme et la femme : éloignés plusieurs mois par la distance, ils le sont désormais à l’intérieur de leur propre foyer. Si l’issue de leur relation paraît dès lors, déjà inéluctable, le chaos à venir, lui, demeure imprévisible. Andrzej Żulawski le laisse imprégner son film par fragments, invitant successivement l’absurde (« notre ami porte-il toujours des chaussettes roses ? »), la violence, d’abord verbale (la décision initiale de Mark de ne plus voir son fils) puis physique (l’issue de la scène de rupture au restaurant). Brutalité d’une autre nature, lorsqu’une ellipse amorcée par un cut de montage, rompt avec la linéarité du récit ou quand le regard d’Anna croise de la caméra, s’émancipe des supposées règles élémentaires du cinéma. En contraste, avec la dimension d’emprisonnement imbibant peu à peu les différentes couches de l’intrigue et du métrage (en intérieur comme en extérieur), le metteur en scène, lui, s’affirme libre, sûr de son dessein, jusqu’au boutiste au moment d’exorciser ses démons, d’exprimer ses visions et les imposer à son spectateur. Conséquence alors logique, les cloisons propres aux différents genres empruntés, abordés, du drame conjugal nappé d’horreur en passant par l’enquête policière ou en invoquant le fantôme de l’espionnage, ont vocation à voler en éclats, accoucher d’un monstre cinématographique mutant et sans réelle équivalence.

Copyright Le Chat qui Fume 2021
Le générique sillonnant le mur de Berlin (visible également de la fenêtre de l’appartement familial), frontière concrète et allégorique d’une menace insidieuse aux portes de la ville, prête à la contaminer elle et ses habitants, induit avec lui la notion de double. Cette capitale divisée en deux, terre d’exil pour le metteur en scène et lieu de vie de son avatar fictif, Mark, contient en son sein deux visions opposées d’un monde prêt à basculer sans s’en rendre compte vers l’abîme. Le couple, apparaît alors telle la parabole intimiste d’une vision politique désabusée, au bord du nihilisme. Ainsi l’histoire et l’Histoire s’entremêlent symboliquement jusqu’à un plan final marqué par un effet sonore synonyme de destruction quasi définitive. L’incapacité de Mark à se défaire de ses sentiments pour Anna, le pousse à une folie, significative d’une sorte de totalitarisme sentimental, directement héritée de son environnement. « Je suis en guerre contre les femmes » dit-il à Helen, institutrice de son fils et ressemblant comme deux gouttes d’eau à son épouse, à l’exception de ses yeux verts. L’usage d’un vocabulaire martial à l’intérieur d’une conversation théoriquement quotidienne trahit l’aliénation d’un individu encore persuadé d’appartenir au camp du Bien. « Je viens d’un endroit où le Mal semble plus facile à dépister parce qu’il prend chair. Il s’incarne dans les gens, les autres voient alors clairement le danger d’être déformé par lui. » lui répond la jeune femme, qui elle, a été (devine-t-on) exposée à d’autres formes de dangers par le passé. « Si ça peut t’arranger je serais la méchante » suggérait Anna à son mari au moment de leur séparation. Égoïste et refusant d’accepter son sort, rongé par le ressentiment, ce dernier perd tout discernement, toute rationalité dans ses actes tandis que son ex-compagne se libère sous nos yeux des emprises multiples qui semblent l’avoir trop longtemps conditionnée. À ce titre la scène de prière masturbatoire suivie de l’hallucinante et mémorable séquence de transe dans les couloirs du métro, marquent autant l’abandon suprême d’une actrice en état de grâce, que la résurrection d’une héroïne malmenée enfin maîtresse de ses actes. À ce titre, si la distribution se révèle homogène et sans la moindre fausse note, à commencer par Sam Neil qui tient là l’un de ses plus beaux rôles, Isabelle Adjani livre l’une des performances les plus inouïes et extrêmes jamais vues sur un écran, imprimant de manière indélébile la rétine du spectateur. La désinhibition totale qui caractérise sa prestation vient épouser viscéralement le dessein cathartique d’Andrzej Żulawski, quitte à parfois donner l’impression de déposséder le cinéaste de son métrage pour mieux le servir. Une symbiose miraculeuse achevant de hisser Possession au rang des œuvres les plus obsédantes et fascinantes sur la fin de l’amour, la folie des sentiments, l’inaltérable passion. Le vertige des sensations qui parcourt le film de visionnage en visionnage, l’ambivalence des émotions qu’il génère et son inépuisable furie créatrice, inspire une idée rare. Comme si en se débarrassant violemment de ses hantises, l’auteur nous les avait transmises, nous laissant durablement possédés et contaminés par son objet filmique, vers lequel il nous faudra régulièrement revenir car désormais dépendants et potentiellement en proie à des manques nécessitant d’être comblés. C’est à ce prix que le long-métrage se donne au spectateur prêt à l’accepter.

Précieux sésame récolté par Le Chat qui fume qui s’est offert le luxe d’éditer l’un des titres les plus prestigieux et convoités de son catalogue, Possession est disponible en deux éditions. Un double Blu-Ray « simple » ou une box collector tirage limitée comprenant les deux Blu-Ray, le film en UHD, le CD de la bande-originale, le dossier de presse d’origine, ainsi que l’ouvrage de Mathieu Rostac et François Cau rédigé spécialement pour l’occasion : Une Histoire orale d’Andrzej Żulawski. La nouvelle restauration en 4K (un bonus nous plonge dans les coulisses de cette fastidieuse opération) est éblouissante, donne toute sa splendeur à la photographie de Bruno Nuytten, ses magnifiques couleurs bleutées froides contrastent magistralement avec les interprétations fiévreuses et excessives des comédiens. Fidèle à ses habitudes, l’éditeur propose pléthore de suppléments, on retient particulièrement deux documents nous familiarisant avec la genèse et la création de l’œuvre : De l’autre côté du mur, Possession : Histoire d’un film & l’interview passionnante de Zulawski. Curiosité malsaine, le remontage de soixante-dix-sept minutes dont le long-métrage fit les frais outre-atlantique est proposé en version non sous-titrée, ainsi qu’un module d’un petit quart d’heure disséquant les transformations survenues d’un montage à l’autre. Nul doute, les adorateurs peuvent désormais posséder et contempler dans les meilleurs conditions possibles, un objet d’extase cinématographique dont on n’a assurément pas fini d’explorer les recoins.
(1) Histoire de la folie à l’âge classique, Michel Foucault. Citation utilisée en préambule de l’essai de Jerome d’Estais, Possession d’Andrzej Zulawski : Tentatives d’exorcisme. (Éditions Rouge Profond, 2018)
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).