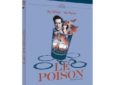Rimini Éditions présente deux éditions spéciales des DVD de La Garçonnière (1960, N&B) et d’Irma la Douce (1963, couleur) de Billy Wilder. Ces deux films scellent la collaboration des acteurs Jack Lemmon et Shirley MacLain dans les rôles principaux, ainsi que celle de Billy Wilder et de son co-scénariste I.A.L. Diamond. Rimini enrichit son édition de suppléments qui éclairent l’œuvre de Billy Wilder de contributions variées, dans une présentation soignée, au graphisme ludique et à la couleur élégante. On trouvera notamment des entretiens entre les journalistes Mathieu Macheret et Frédéric Mercier, des analyses du décorateur Dider Naert, ainsi que les témoignage de Chris Lemmon, acteur et fils de Jack, et de Hope Holiday, actrice fantasque qui a joué dans les deux films du réalisateur. Chaque coffret comporte en outre un livret papier richement fourni, retraçant le travail méticuleux du réalisateur et évoquant les conditions de tournage. Deux belles éditions s’offrent ainsi au public désireux d’approfondir sa connaissance de l’œuvre de Billy Wilder.
Partie 1/2 : La Garçonnière (1960)
Dans la filmographie du cinéaste, entre les films noirs – Assurance sur la mort (1944), Boulevard du Crépuscule (1950) – et les comédies – Sept ans de réflexion (1956), Certains l’aiment chaud (1959) – La Garçonnière nuance les types de registres. Puisant dans le drame intimiste[1]et la comédie sociale, le film tire à boulets rouges sur le rêve américain. De ce point de vue, il représente le tableau désabusé d’une société où tout le monde trompe tout le monde et où l’ascension sociale s’obtient sinon à coups de compromissions, au moins de compromis douteux. L’appartement de Calvin Clifford Baxter (John Lemmon) et son lieu de travail constituent les pièces maîtresses de la dramaturgie de La Garçonnière, en signant la porosité entre les univers social et intime.
C.C. Baxter travaille pour la Consolidated Life, une compagnie d’assurances ironiquement nommée, où « il faut des années pour atteindre le 27eétage et trente secondes pour se retrouver sur le pavé ». Si l’employé modèle doit sa promotion à son patron Jack Sheldrake[2], c’est pour s’être prêté à un chantage accablant. Celui que l’on surnomme affectueusement « Buddy » Baxter confie sans broncher ses clés à ses supérieurs désireux d’abriter leurs ébats avec les petites employées. Billy Wilder met l’accent sur le bureau comme lieu des tractations amoureuses où s’exprime la domination masculine et, corollairement, le pouvoir des puissants sur les faibles. La Consolidated Life est en effet implantée dans un building au personnel fourmillant, que le va-et-vient des ascenseurs déverse quotidiennement à chaque étage. Ces scènes récurrentes figurent de manière comique et sordide la mécanique de l’ascension sociale, nourrie d’une promiscuité malsaine. Mains aux fesses, échanges de sourires et de sous-entendus concupiscents sont le lot des employées amènes, résignées ou complices. En complément de ce mouvement vertical, la scène d’ouverture impose la vision panoramique d’un bureau qui s’étend horizontalement. Comme microcosme social, la compagnie est un concentré édifiant de New York, dont tous les habitants « mis bout à bout » permettraient de « relier Times Square à la banlieue de Karachi, au Pakistan[3] ».
Chef-d’œuvre de reconstitution[4], le bureau est le contexte d’une intense agitation professionnelle, si bien qu’en s’arrêtant sur la conversation intime de Buddy Baxter la caméra prend le spectateur à contre-pied. En catimini, il est question de la clé de son appartement circulant secrètement d’un supérieur à l’autre et obligeant Baxter à jongler avec un calendrier serré. Cette mise en scène révèle astucieusement les dessous sordides d’une société qui se veut bien sous tous rapports. Dans un milieu plus soucieux des apparences que de loyauté, les patrons couchent avec les secrétaires, les employés s’encanaillent trivialement le 31 décembre, et les femmes trompées sont mises au courant des frasques de leur mari par des secrétaires désabusées. Si les bureaux de la Consolidated Life donnent lieu à une satire sociale mordante, l’appartement de Buddy en représente les coulisses. Le mélodrame s’y noue plus intimement à la comédie, d’autant que Baxter tombe amoureux de sa collègue Fran Kubelik (Shirley MacLain), la maîtresse de son patron Jack Sheldrake.
L’immeuble de Baxter est modeste, tout comme son domicile. Certes, le champagne s’y déverse au gré des rencontres nocturnes et des morceaux de jazz, mais les voisins vertueux peinent à fermer les yeux sur les frasques qu’ils attribuent au locataire. C’est là que se révèle le plus l’amertume profonde du réalisateur à l’égard de l’âme humaine. Une tentative de suicide s’y déroule, à renfort de barbituriques – l’autre face de la fête, des restaurants chics et des music-halls de Manhattan. Qu’on se souvienne de Boulevard du Crépuscule, qui retourne magistralement le gant de la gloire hollywoodienne pour en montrer les coutures les plus sinistres. Dans La Garçonnière, le mélodrame est en demi-teinte. Il apparaît dans l’existence esseulée d’un Baxter qui s’enrhume à passer ses nuits sur le trottoir, mais aussi dans les effets mortifères de la tromperie et de la désillusion. Cependant, sous le regard bienveillant quoique sévère d’un voisin au fort accent yiddish, le Dr. Dreyfuss, la garçonnière est aussi le lieu où se joue le devenir d’un Mensch. L’humanité se révèle à la faveur des solidarités et des liens interpersonnels qui s’opposent aux relations intéressées et à l’individualisme forcené qui sévit au bureau. On mesure bien la dette de Billy Wilder, juif autrichien, à l’égard de sa culture d’origine et la distance qu’il prend vis-à-vis de sa patrie d’adoption.
Dans ce vaste rouage cynique, Buddy Baxter et Fran Kubelik sont comme deux étrangers qui ne trouvent pas leur place. Dans la veine de Sabrina (1954) et d’Ariane (1957), La Garçonnière permet une réhabilitation par l’amour. Mais là où le goujat (au choix : Humphrey Boggart ou Gary Cooper) parvenait à une transformation morale, il est définitivement perdu dans La Garçonnière, au profit de son double vertueux. Cette bipartition des caractères montre la condamnation sans appel de Billy Wilder à l’égard d’un système corrupteur. Si le film fait la part belle aux quiproquos et regorge de comique, il n’en joue pas moins sur des ressorts tragiques. Shirley MacLain donne à Fran une gracilité fragile qui témoigne de la difficulté des femmes à s’émanciper de l’emprise perverse des hommes. L’acteur Fred MacMurray raconte d’ailleurs combien son rôle lui a valu la déception voire la détestation publique, tant il avait été identifié à Jack Sheldrake. Dans Assurance sur la mort, dont l’intrigue se déroule aussi dans le milieu d’une compagnie d’assurances, il jouait une victime du machiavélisme féminin, ce qui l’avait rendu populaire et sympathique.
Miroir social convaincant, La Garçonnière fonctionne sur un modèle scénographique en forme d’entonnoir. Depuis New York jusqu’au domicile de Baxter, en passant par le building où il travaille, le drame se resserre dans un huis clos, où la partie renvoie incessamment au tout. Jamais on ne perd de vue que les situations tragiques qui s’y jouent proviennent de plus loin, de cette gangue capitaliste et libérale qui broie les êtres fragiles. Si le dénouement est heureux, la satire sociale n’en est pas moins cinglante et réussie : le film est accueilli favorablement, qui rafle les Oscars et recueille les critiques élogieuses. Un tel succès permet à Billy Wilder de tempérer l’échec de son films suivant, Un, deux, trois (1961) et d’enchaîner favorablement avec une équipe quasi-identique, sur le tournage d’Irma la Douce.
Durée du film : 2h05
Durée des suppléments : 2h20
[1]Le titre original The Apartment l’évoque bien
[2]Fred MacMurray, que Billy Wilder a dirigé dans Assurance sur la mort.
[3]Buddy Baxter, en voix-off lors de la scène d’ouverture.
[4]Le décorateur Alexandre Trauner a reconstitué un espace décloisonné et créé l’illusion de la profondeur en avantageant la perspective du plafond. Pour jouer le rôle des employés qui s’affairent au fond du bureau, Billy Wilder a employé des enfants et Alexandre Trauner a fait fabriquer des mannequins, des machines à écrire et téléphones miniatures. Le plateau, d’une soixantaine de mètres sur quarante, donne l’illusion d’une profondeur de deux cent cinquante mètres.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).