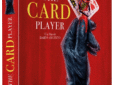Le soir de Noël, dans une maison de famille. Une jolie mélodie enfantine retentit, tandis que l’ombre menaçante d’un bras brandissant une arme est projetée sur le mur. Un couteau ensanglanté tombe aux pieds d’un petit garçon. Cut. Une autre scène, un autre temps, un autre lieu : Une jeune médium, Helga Ulmann, donne une conférence de parapsychologie durant laquelle elle subit une attaque de panique, persuadée de pressentir la mort dans la salle. Le même soir, elle est assassinée dans son appartement. Marcus, pianiste de jazz, entend la scène depuis la rue et accourt chez elle. Lors d’un entretien avec la police, le pianiste fait part de son étrange impression que quelque chose lui échappe…

TMDB Tous droits réservés
Profondo Rosso constitue un film charnière de Dario Argento, qui fait le pont entre le giallo policier et le giallo d’épouvante, teinté de surnaturel et de fantastique. C’est aussi par ce film qu’il impose véritablement son style, aussi désarçonnant soit-il : entre le fétichisme des objets sous les mains gantées de cuir noir du tueur, l’orgue retentissant du groupe Goblin, les dialogues emprunts d’ironie et de surréalisme, la caméra follement subjective. Tout participe à créer une atmosphère absolument inédite, où le réel est sondé sous tous ses angles, comme une structure aux contours infinis. Dario Argento réalise ici un coup de maître en plaçant le tueur sous nos yeux, avant même que l’enquête ne commence. Cette enquête vient d’ailleurs sonder cette fameuse « impression » qu’éprouve Marcus, que quelque chose n’est pas à sa place.
« Profondo Rosso », c’est le rouge profond, celui que l’on assimile instantanément au sang, ce liquide organique qui jaillit d’un être à l’apparence d’une poupée de cire. Le sang irrigue la vie qui meut tout être vivant, mais traduit la mort dès lors qu’il jaillit abondamment des veines. Il tache le sol, les murs, les objets, laissant des marques qu’il faut à tout prix nettoyer (on pense au sang sur la clé dans Barbe-Bleue). Ici, le titre suggère une transgression : le rouge sang, métonymie du meurtre, est appelé à un voyage, une contemplation, voire une méditation en ses profondeurs. Le film plonge son spectateur dans une traversée rouge sang, du début par l’ouverture d’un rideau rouge de théâtre, à la fin, quand le protagoniste se contemple dans une flaque de sang.

Prod/©Les Films du Camélia / Rizzoli Film S.p.a. / Seda Spettacoli
Donner le titre d’une couleur à son film a quelque chose de profondément audacieux, plus encore quand il s’agit du rouge : c’est affirmer sans scrupules que l’expérience promet d’être cruellement captivante et empreinte de représentation explicite. Profondo Rosso fait de la mort et du sang une cérémonie, en stylisant le meurtre comme jeu et acte créatif. Par cette ouverture du rideau qui ouvre le film comme une pièce de théâtre et sur un théâtre, Dario Argento annonce littéralement la couleur Helga Ulmann, y est soudainement prise d’un malaise : « Je ressens la mort dans cette pièce. Je ressens une présence. Je suis entrée en contact avec un esprit pervers ! Il est obnubilé par la mort. Vous…avez..tué..et vous tuerez encore ! ». Une prophétie qui s’inscrit habilement dans la mise en abyme du spectateur de cinéma, dont le regard se retrouve pris au piège : car c’est justement par un savant procédé de mise en scène que l’on se voit, à l’instar du protagoniste joué par David Hemmings, dupé par l’image. Ou plutôt, dupé par la présupposition factice que l’image qui surgit à l’écran n’en cache pas une autre.

©2021 Camelia
Stylisant le meurtre comme jeu et acte créatif, Profondo Rosso peut ainsi se voir comme une véritable messe mortuaire, où chaque scène de meurtre répond à un rituel artistique : la musique annonciatrice du meurtrier, une comptine pour enfants ; un montage saccadé, traduisant l’état d’hypervigilance de la victime, jalonné de plans fixes sur un pan de porte ou un carreau de fenêtre ; une succession de travellings dansants sur des objets fétiches —une poupée, des billes, un bracelet tressé multicolore, et la bande originale du groupe de rock progressif Goblin. Le suspense devient alors un processus créatif et cérémoniel. Dès la première scène, au passage du générique, le meurtre se représente de manière fragmentaire, dont les images qui nous restent sont un salon décoré d’un sapin de Noël, une ombre menaçante sur le mur, un couteau ensanglanté, et des jambes d’enfant surgissant dans le champ. Ce qui devrait être la fête de la nativité devient la fête de la mort. Et Dario Argento ne se lasse pas de faire jouer cette dualité : on pense à cette séquence, terriblement et magistralement impressionnante, où le protagoniste pianiste, Marcus, répète un morceau de jazz seul, assis à son piano. Autour de lui, quelques indices disséminent une inquiétude croissante (un craquement au plafond, une ombre fugace à la fenêtre, des grincements du parquet). Son regard n’a de cesse de scruter des recoins de la pièce, ses mains continuant à plaquer les accords, tous ponctués d’appogiatures et d’ornements participant à l’atmosphère d’inquiétante étrangeté. La caméra s’échappe et effectue de sinueux détours, s’arrêtant sur la poignée de la porte d’entrée qui se soulève, puis prend le point de vue des pas du tueur, faisant grincer le parquet et s’avançant dangereusement vers le pianiste. La caméra subjective épuise ce réel angoissant, où toutes les choses, meubles et bibelots prennent une ampleur d’inquiétude grandissante. Il aura suffi de quelques détails sonores, de quelques jeux d’ombres et de lumière, et surtout de cet enchevêtrement de points de vue, pour créer un sentiment de puissant malaise, dans cette situation d’accalmie et de musicalité. Le film de Dario Argento jongle avec les codes de la ritualisation, tant dans sa représentation du meurtre organisé selon un mode opératoire spécifique (les mains gantées, la caméra subjective, la comptine pour enfants), que dans le rituel (Noël, le sapin, sa ritournelle répétitive), par sa distanciation avec l’horizon d’attente de la cérémonie en tant que telle : notamment lors de la scène de l’enterrement de Helga Ulmann, qui prend place dans une atmosphère printanière et joviale, où les protagonistes plaisantent gaiement.

©2021 Camelia
Profondo Rosso se modèle dans une esthétique qui joue sur plusieurs niveaux de sens, en maniant l’image comme une source inépuisable de signification, mais aussi comme un leurre auquel l’on ne peut réellement échapper (ou alors, seulement par l’illusion). Le piège envahit le film, ponctué de ces rétines en gros plans qui tourbillonnent et de ces mains qui trompent l’œil : comme lorsqu’une poupée, filmée en gros plan, apparaît soudainement minuscule entre les doigts du tueur. Aimanté malgré lui, le regard se voit constamment soumis à la polyphonie du réel, et à l’image infinie —c’est-à-dire, celle qui en cache toujours une autre. Dans le film de Dario Argento, cette idée est obsédante pour le protagoniste : convaincu que quelque chose lui échappe, il s’évertue dans une quête de vérité, aveuglé par son propre traumatisme. On a d’ailleurs souvent Profondo Rosso comme une suite logique de Blow-Up d’Antonioni, avec ce choix évident du même acteur-protagoniste.
Profondo Rosso épouse une esthétique du traumatisme, au sens propre comme au figuré, qui confine à un éloge de la folie. Car si le traumatisme désigne ici le choc, et la blessure psychologique qui en découle, produits par la vision du meurtre,—auquel assiste d’ailleurs le spectateur peu de temps après que le rideau rouge se soit ouvert—, il s’entend aussi comme l’idée d’une rupture. La tension à l’œuvre dans tout le film tient à cette constante dichotomie entre la fêlure, la fissure ou la dégradation, et la création. Les jouets cassés, fissurés ou dégradés parsèment l’intrigue comme d’incessants rappels au trauma : cette poupée mécanique fendue au niveau du crâne, ou encore cette autre poupée pendant du plafond, le corps disloqué, ces murs qui ne cessent de s’effriter, ces vitres qui se brisent en morceaux, ce lézard planté d’une aiguille, cette maison de l’enfant qui hurle en ruines, ce siège passager de la voiture de Gianna cassé…Et pourtant, l’intrigue s’anime d’un rappel incessant à la création, d’abord par la répétition de jazz au tout début du film, où Marcus avoue que c’était « trop précis, trop parfait », et plus tard, par les tableaux ornant le couloir de l’appartement de Helga Ulmann, et par ce dessin d’enfant macabre, indice à première vue (car là encore, l’image perçue est fragmentaire) décisif de l’enquête.

©2021 Camelia
L’art et l’inventivité s’enracinent dans l’acte de tuer, thème que l’on retrouve également dans L’Oiseau au plumage de cristal par exemple, où le protagoniste assiste à une tentative d’assassinat à travers la vitre d’une galerie d’art. L’obsession de l’objet fragmentaire pose la perspective de l’objet intact comme une source d’angoisse insoutenable : et d’ailleurs, dans L’inquiétante étrangeté, Freud décrit ce sentiment d’inquiétude, lié à la présence de poupées et d’automates, comme étant à l’origine de « la peur puérile que l’inanimé ne prenne vie ». En cassant les bibelots sans vie, Dario Argento les tue métaphoriquement, comme pour conjurer cette peur. Ces poupées constituent aussi des objets-mémoire, motifs du tueur, pour aboutir à une poétique du macabre et du traumatisme. Le meurtre articule un monde qui se déstructure sous les yeux du protagoniste et devient littéralement un angle mort, voire un point aveugle —dont la mise en scène fait preuve lorsque Marcus traverse le couloir de Helga Ulmann sans voir l’évidence, trahie par le miroir qui se confond parmi les tableaux accrochés au mur. Il y a aussi une allusion diffuse au monde de l’enfance. De la comptine, leitmotiv du tueur, à la petite fille maléfique, en passant par le dessin de l’enfant tenant un couteau ensanglanté, et les poupées (immobiles ou mécaniques, des pantins), l’univers enfantin se fraie sournoisement un chemin, comme pour mettre en lumière cette mémoire traumatique, qui hante la pellicule.
Profondo Rosso représente alors l’aboutissement d’une esthétique et d’un mode opératoire inédits, donnant l’impression qu’il ne nous a jamais été donné à voir un tel film, dans lequel Dario Argento parvient à créer une substance nouvelle, notamment grâce à ce que l’on pourrait qualifier de l’image-pulsion qu’évoque Deleuze dans L’image-mouvement. Dans cette forme d’image, c’est le hors-champ qui transparaît de manière récurrente et habite l’image tel un fantôme. L’usage de la caméra subjective sert habilement ce procédé, mais c’est aussi, et surtout, l’immersion dans une sorte d’ekphrasis (hypotypose de l’œuvre d’art) infinie qui prolonge ce sentiment. En d’autres termes, on accomplit par le visionnage de Profondo Rosso un long voyage artistique : dans cette séquence du début, devant le Blue Bar où discutent Marcus et son ami Carlo, c’est face à un véritable tableau de Hopper vivant que l’on se trouve. L’atmosphère retranscrite donne cette impression étrange et fascinante d’avoir pénétré de l’autre côté du miroir —ou plutôt du tableau, mais le réalisateur ne dessine pas, et c’est sans doute volontaire, la limite entre ces deux types de cadres.

©2021 Camelia
Dans cette manière de manier la caméra, la faisant glisser, effectuer des détours, s’éloigner et se rapprocher, le cadre de l’image a quelque chose de très architectural, parfois pas loin de l’expressionnisme allemand. Cet dialogue fusionnel entre le montage et la gestion de l’espace coupe le souffle et hypnotise, peuplée d’angles innovants, comme dans ses successions de plans fixes pour zoomer, ou au contraire dans sa façon de s’éloigner en fondu, laissant apparaître des parcelles de réalité (architectures, poutres qui occultent la vue), dans ses plans en plongée, panoramiques et travellings où les personnages paraissent en tout petit. Les vitres jouent également un rôle dans ce voyage vertigineux dans l’art, faisant de l’image une architecture à visée d’épuisement du réel. Ainsi, lorsque Marcus assiste au meurtre de Helga Ulmann, et la voit collée contre la vitre brisée et ensanglantée de son appartement, il s’empresse de gravir les escaliers de l’immeuble dans l’espoir de lui porter secours. C’est un véritable retour sur image, mis en abyme, qui s’opère. Le verre constitue une pièce composite du film de Dario Argento —par toutes ces fenêtres, ce miroir, ces baies vitrées, ces verres d’alcool, ces vitres de voitures ou de cabines téléphoniques. D’ailleurs, la communication téléphonique, comme dans un cauchemar dont on ne parvient pas à émerger, n’arrive jamais à se faire, toujours interrompue par des bruits parasites, comme pour rappeler que l’enquête policière n’a pas lieu d’être, et que c’est au contraire un cheminement dans l’image mémorielle qui produira l’épiphanie. L’omniprésence des vitres traduit la polyphonie du réel et son inépuisable possibilité interprétative. Elle est aussi vectrice d’illusion, comme lorsque les bruits des éclats de verre sur laquelle la victime tombe, en sang, se confondent en l’image de Carlo buvant son verre devant le bar. Dans ce périple artistique, la musique elle aussi participe à cette ekphrasis continue, notamment dans ces répétitions de jazz. Le son devient d’ailleurs aussi image, puisque le leitmotiv macabre de la comptine pour enfants, mais aussi la sonnerie stridente du téléphone ou de la sonnerie, s’accompagne systématiquement du mouvement visuel des vibrations produites. Parallèlement, il arrive que des discussions soient interrompues par un fondu en noir qui vient poursuivre l’intrigue, comme pour déshabituer la rétine de la continuité de la scène. Cette citation continue de l’art en tant que vecteur de sens —puisque, la clé de l’intrigue se trouve parmi une série de tableaux, et son indice consiste en une fresque murale et un même dessin d’enfant—, Dario Argento la conclut en affirmant : « Un film s’emboîtait dans l’autre, je me citais moi-même, mais en même temps, je faisais table rase de mon passé ».

TMDB Tous droits réservés
Profondo Rosso peut aussi se voir comme un film sur l’enquête en tant que telle, à défaut d’un film policier à proprement parler. Dario Argento élabore tout un méta-questionnement autour de la narration policière, en peuplant son intrigue d’indices cachés (le doigt qui trace le nom du tueur sur le miroir embué de la salle de bains), de biais interprétatifs (il reprend le thème de la photo tronquée déjà présente dans Le Chat à neuf queues, en montrant son protagoniste découvrant la fresque murale en partie seulement), de policiers incompétents —qui affirment que le tueur agit forcément dans des moments de crises psychiques, et donc se trouve d’apparence tout à fait ordinaire en temps normal (« comme vous ou moi »), de coups de téléphone qui traduisent l’avancée de l’investigation, une histoire d’amour, une succession de meurtres selon un procédé ritualisé. Mais tous ces motifs du polar sont détournés, retournés, manipulés, de telle sorte que le film devient une sorte de méta-giallo : les crimes perpétués, particulièrement sanglants et originaux, ont cette spécificité scénaristique de tendre à inclure le spectateur dans une douleur qu’il connaît. Dans son autobiographie, le réalisateur évoque que « La meilleure intuition de Zapponi concernait la mécanique des meurtres : selon lui, on devait trouver des solutions que le public pouvait comprendre d’un point de vue physique, de façon immédiate. Peu de spectateurs peuvent savoir quelles sensations provoque un projectile en pleine poitrine ou un couteau dans l’estomac, mais la douleur ressentie en se cognant la tête ou en se blessant sur un coin saillant, ou encore en se brûlant avec de l’eau bouillante, étaient toutes des expériences que n’importe qui aurait pu vivre dans sa propre existence ».
Dario Argento crée aussi un cinéma visionnaire et progressiste. Il fait d’abord satire de la police, filmant des individus aux comportements risibles —l’un d’entre eux mâchouille un sandwich triangle tout en se moquant de Marcus, lui objectant que « pianiste n’est pas un vrai travail », et aux paroles vides d’intérêt pour l’enquête : « La victime semble avoir 35-40 ans, a des blessures et coupures sur le corps ». En parallèle, le réalisateur produit une véritable comédie des genres, raillant la virilité de Marcus : Gianna le bat au bras de fer, le fait asseoir sur le siège passager cassé de sa voiture, l’abaissant d’une vingtaine de centimètres…C’est sans compter le caractère social du propos de Dario Argento, qu’expose le dialogue entre Marcus et Carlo, où ce dernier lui signale : « Toi, tu joues pour l’art, mais moi, je joue pour survivre ».
Une belle manière de conclure, que, finalement, l’art et la survivance ne sont pas séparables.
Profondo Rosso bénéficie en cette fin d’année 2022 d’une nouvelle restauration 4K, disponible dans un coffret Collector Blu-Ray en édition limitée incluant six longs-métrages de Dario Argento (L’Oiseau au plumage de cristal, Le Chat à neuf queues, Ténèbres, Phenomena, Opera) ainsi qu’un livre de 252 pages écrit par Olivier Père.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).