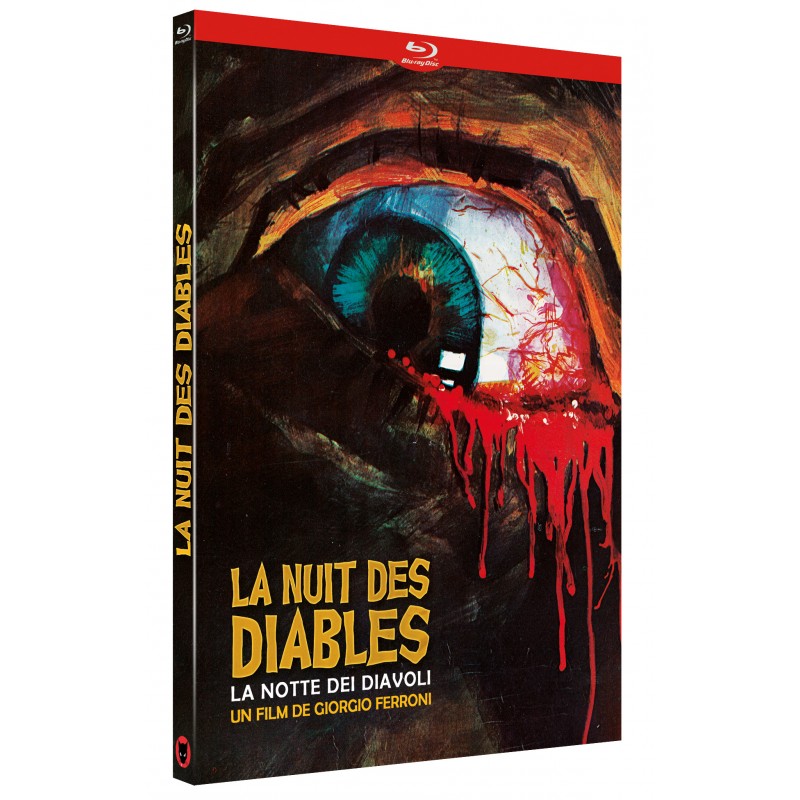Moins prolifique que Mario Bava ou Riccardo Freda, Giorgio Ferroni appartient – comme Terence Fisher en Angleterre – à une génération d’auteurs à cheval entre deux époques qui ont vu naître l’âge d’or du cinéma fantastique italien, furent ses acteurs majeurs et le regardèrent s’éteindre. Ainsi l’esthétique de Ferroni comme celle de Bava se trouve en quelque sorte scindée en deux périodes, commençant par un gothique dont ils furent les maîtres, où l’inspiration anglo-saxonne le disputait à la pulsion latine. Le Moulin des supplices en cela, constituait un condensé magistral de l’essence romantique du fantastique à l’italienne, avec son moulin se découpant dans la nuit orageuse, son musée des tortures avec ses figures de cire trop humaines, son feu salvateur … et son amour fou.
A la manière de Bava changeant radicalement de style avec La Baie Sanglante plus noir, ironique et sanglant, Ferroni signe donc avec La Nuit des Diables son deuxième chef d’œuvre, adaptation d’une nouvelle d’Alexeï Tolstoï, « Les Wurdalaks ». En 1963, Mario Bava avait déjà fait l’un des segments des 3 Visages de la peur de ce splendide récit d’épouvante du XIXe dans lequel un jeune marquis en route pour la Moldavie assiste à la vampirisation de la famille qui l’héberge. En 1972, pour le cinéma de genre, l’heure est – entre autres – aux gialli d’Argento ou aux poliziesci de Fernando Di Leo. L’Italie de 1972, c’est celle des brigades rouges et des années de plomb. Si les temps ont changé, les obsessions des cinéastes aussi. En dehors de l’évidente (r)évolution esthétique des années 70 à laquelle les artistes doivent s’adapter, ils ont vieillis (Ferroni a 64 ans en 1972) ; leur rapport intime à l’imaginaire et à la mort s’est lui aussi modifié, désormais noir, pessimiste, anxieux, peut-être porté par une Histoire en court qui a livré son lot d’horreurs et d’atrocités : le surnaturel ne peut plus s’offrir le surnaturel comme un refuge idéal. C’était également l’évidence qui s’imposait chez le cinéaste espagnol Serrador qui après son gothique La Résidence (1970) ouvrait son deuxième joyau Les Révoltés de l’an 2000 (1976) sur un éventail de toutes les exactions faites sur les enfants pendant des décennies. Désormais, le réel vient hanter l’imaginaire qui ne se suffit plus à lui-même, il le contamine, et La Nuit des Diables en constitue une preuve criante. Finies les fines incisives pour des baisers vampires romantiques, finis les pieux qui se plantent pudiquement dans le cœur des non-morts. Ici le sang jaillit des plaies purulentes, les enfants s’en mettent plein la bouche lorsqu’ils mordent leurs parents en éclatant de rire. L’hallucination du héros qui ouvre La Nuit des Diables – fascinant moment de beauté baudelairienne – pourrait résumer à elle seule le parti pris de Ferroni sur le film. Nous plongeons désormais dans les ténèbres, faites de sexe tourmenté et de décomposition. Oui, Eros et Thanatos à leur apogée. Les spectres ne sont plus séduisants, ils vous poursuivent les bras grands ouverts et vous entrainent vers les profondeurs du tombeau, là où chacun finit : la putréfaction et la disparition de l’enveloppe corporelle. Si les années 60 employaient une forme d’attirail traditionnel chrétien fait de crucifix et de gousse d’ail, La Nuit des Diables ouvre sur un monde sans Dieu. Comme s’il anticipait sur la vague de films de zombies à venir, contrairement celui de Bava, le wurdalak ressemble ici beaucoup plus à un mort-vivant qu’à un vampire.
 Et pourtant le traitement de Ferroni est puissamment poétique, d’une poésie vénéneuse et sans apparat, désormais défaite de ses atours chatoyants. Les couleurs primaires ont laissé la place aux teintes exsangues de bois blafards, avec leurs tapis de feuilles mortes. La subtilité de la photo de Manuel Berenguer (également chef opérateur de La Résidence) restitue parfaitement ces tons crépusculaires, ces heures entre chien et loup. Si Ferroni abandonne le romantisme du Moulin des Supplices, il n’en délaisse pas pour autant le fantastique pour des visions qui ont la beauté des natures mortes et de la peinture surréaliste. On pense à Bacon à la vision de ces carcasses d’animaux décharnées. L’abandon au temps transparaît dans l’accumulation d’objets épars, jamais époussetés, toujours laissés à leur place, un bric-à-brac de cruches fêlées, de vieux outils rouillés posés sur les meubles ou accrochés à des murs écaillés maculés de taches. Et que dire de ces étranges divinités sculptées à même le bois, posées sur la cheminée ou de ce vieux portrait d’ancêtre veillée par une bougie ?
Et pourtant le traitement de Ferroni est puissamment poétique, d’une poésie vénéneuse et sans apparat, désormais défaite de ses atours chatoyants. Les couleurs primaires ont laissé la place aux teintes exsangues de bois blafards, avec leurs tapis de feuilles mortes. La subtilité de la photo de Manuel Berenguer (également chef opérateur de La Résidence) restitue parfaitement ces tons crépusculaires, ces heures entre chien et loup. Si Ferroni abandonne le romantisme du Moulin des Supplices, il n’en délaisse pas pour autant le fantastique pour des visions qui ont la beauté des natures mortes et de la peinture surréaliste. On pense à Bacon à la vision de ces carcasses d’animaux décharnées. L’abandon au temps transparaît dans l’accumulation d’objets épars, jamais époussetés, toujours laissés à leur place, un bric-à-brac de cruches fêlées, de vieux outils rouillés posés sur les meubles ou accrochés à des murs écaillés maculés de taches. Et que dire de ces étranges divinités sculptées à même le bois, posées sur la cheminée ou de ce vieux portrait d’ancêtre veillée par une bougie ?
Faute d’être immergé dans les soleils couchants, les bleus chatoyants, le brouillard sous la lune, le fantastique plonge dans un cauchemar froid, une terreur qui éloigne l’humeur rêveuse et la saveur du conte. La transposition moderne de la nouvelle d’Alexeï Tolstoï incline à un traitement réaliste du fantastique. Loin du gentilhomme en costume qu’était Mark Damon, Nicolas est un type un peu banal avec pull à col roulé, un homme de son époque qui arrive dans un lieu reculé, ou les êtres semblent s’être extraits de leur plein gré de toute vie collective.. La façon dont Ferroni s’empare du stéréotype des villageois superstitieux peinant à ébranler le cartésianisme du héros et à le convaincre de l’existence d’un Mal immaîtrisable est d’autant plus intéressante que sa relecture introduit le réalisme dans la réflexion, en creusant le fossé entre campagne et ville. Certes le cadre de la Yougoslavie joue la carte d’une connotation exotique avec son aura mystérieuse, mais loin du cliché habituel, c’est en plein jour que Nicolas tombé en panne fait irruption au milieu de ces paysans pour assister à une étrange inhumation. Il pénètre de plein pied dans un lieu de coutumes et de croyances qui exclut toute atmosphère envoutante des légendes et des mythologies. Nicolas arrive en terre inconnue, découvre des rites qu’il ne connaissait pas et Ferroni les met en scène assez de manière presque factuelle. Dans son parti pris réaliste, Ferroni sous entend que le cadre est bien moins celui des légendes qui les inspire. Avec un vrai souci d’authenticité – vestimentaire, notamment – il peaufine le quotidien d’une famille rurale portée par les peurs, laissant planer longuement le doute quant à la nature du danger. Aux yeux du héros citadin, ils apparaissent comme primitifs et d’un autre temps – à l’instar d’un fantastique déjà presque anachronique ?
La version qu’offre Ferroni des Wurdalaks s’oppose donc autant visuellement à celle des 3 visages de la peur qu’au Moulin des Supplices, mais propose également de nombreuses similitudes, voire des clins d’œil et citations tels cette vision de visages livides observant de l’autre côté de la fenêtre ce qui se passe à l’intérieur. Ferroni se complait à jouer avec les atouts de son prédécesseur. Il est fascinant de comparer le traitement de la photo un peu comme si le décor de Bava était devenu un vieux musée débarrassé de ses couleurs. La beauté des ruines subsiste chez Ferroni, mais désormais aux antipodes de celle de C.D.Friedrich. La masure de La Nuit des Diables pourrait être celle des Wurdalaks – ou son cadavre – un lieu qu’on aurait laissé lentement se fissurer, dans lesquels les araignées auraient tissé leur toiles, un lieu qui respire le dénuement et la mort. La vieille maison baignant dans la brume cède sa place à un habitat de paysans pauvres vivant de leurs terres, dans toute leur indigence, leur absence de décorum.
Au milieu de cette austérité, de cette violence, seule Sdenka (magnifique Agostina Belli) telle un ange perdu apporte la douceur et la mélancolie d’une passion aussi immédiate qu’inébranlable. La musique de Giorgio Gaslini vient chanter ce spleen féminin, plus encore lorsque s’envole la voix de la morriconienne Edda Dell’orso. Car tout comme Le Moulin des supplices, La Nuit des Diables suit bien le fil d’une histoire d’amour rendu impossible par la malédiction, mais le final imaginé par Ferroni – d’un pessimisme achevé – plongera dans l’abime : non seulement il rend l’union des âmes impossible mais il laisse l’individu dans la désolation d’un vide existentiel bien réel, sans échappatoire. Avec cet ultime joyau, Giorgio Ferroni abandonnait la grandeur des moulins maudits pour renvoyer l’homme au cauchemar de sa condition. Lugubre, funèbre, d’une tristesse absolue. En un mot, magnifique.
Le master proposé par Le Chat qui fume est une splendeur. La photo y est restituée dans toute sa complexité presque décolorée dans laquelle se détachent les ombres et éclatent le rouge du sang. Beaucoup d’excellents suppléments sont également au menu. Pour commencer, en plus de la très attendue « Version VHS », le Chat qui fume a la pertinence d’intégrer le livre audio de la magnifique nouvelle de Tolstoï, nous permettant ainsi, en plus de s’en délecter de se lancer dans le jeu des comparaisons d’adaptation entre celle de Bava et celle de Ferroni. Parmi les nombreux intervenants, Olivier Père propose une excellente analyse du film qu’il définit comme le chant du cygne du gothique italien (ce qui peut être contestable si l’on considère justement qu’il s’agit de l’abandon du gothique) qui annonce selon lui par son irruption de la violence le cinéma de Lucio Fulci. Il insiste sur l’aspect particulièrement dépressif et tragique du film. Dans son émouvant entretien, Agostina Belli revient sur sa carrière. Elle évoque notamment sa première apparition dans Bandits à Milan de Lizzani ou sa participation à Holocauste 2000 de Martino mais étonnement elle ne mentionne pas Parfum de Femme de Risi dans laquelle elle était inoubliable. Concernant son tournage avec Ferroni, elle se souvient de ses rapports avec l’équipe avec émotion de son personnage d’autant qu’il s’agissait d’une des premières fois qu’elle avait un premier rôle. On s’amusera également de sa digression sur la poudre zombie et les rites vaudous qui lui amène à dire que dans La Nuit des diables, tout n’est peut-être pas si faux qu’on le croit. L’une des interventions les plus intéressantes est sans doute celle de Gianni Garko qui offre peut-être l’analyse la plus poussée et la plus pertinente de son personnage et du film de Ferroni, soulevant son ambiguïté, le tragique de l’histoire d’amour, et la dimension presque sociale du film de Ferroni de part la nature de Nicolas, négociant en bois découvrant un monde qu’il ne soupçonnait pas. Un peu plus amère est la voix de Cinzia de Carolis, la formidable gamine de La nuit des diables, qui confesse qu’après quelques rôles personne, elle ne fut plus jamais appelée. Elle travaille depuis dans le doublage, et même si elle semble en être heureuse on ressent une certaine frustration. Il est intéressant de constater combien les souvenirs d’une petite fille sur un tournage peuvent être différents de ceux des adultes : ses yeux d’enfant lui renvoient surtout ces moments comme un jeu. Giorgio Gaslini est quant à lui passionnant lorsqu’il définit son travail et la nécessité d’une musique qui ne soit pas plaquée sur des images. Bien au contraire, il s’agit pour lui de vivre le film de l’intérieur. Sa qualité de musicien de jazz l’incite à ne pas considérer la musique de film de manière superficielle. Rien d’étonnant à ce qu’il cite Miles Davis et son extraordinaire travail sur Ascenseur pour l’Echafaud ; car l’approche harmonique de Gaslini est particulière, à l’instar d’autres musiciens de jazz qu’il admire et qu’il côtoya. Loin de tout mépris pour le cinéma de genre, Gaslini a tout saisi de l’essence métaphysique de La Nuit des diables. Il évoque le choix des thèmes hantés, subtilement modulés selon les personnages et les situations et les rejoue devant nous en les commentant. Il insiste notamment sur l’aspect très féminin du leitmotiv, soutenant tout le tragique de cette héroïne rédemptrice qu’est Sdenka. Le savoureux Nino Celeste se remémore son aventure de cameraman évoluant vers la direction photo lorsque Manuel Berenguer dut s’absenter pour raisons familiales. On lui doit par exemple, l’élaboration de la première séquence ou Gianni Garko blessé erre, avec ce plan sur ses jambes titubantes. Nostalgique de cet âge d’or du cinéma il termine son entretien par un constat plutôt terrible : « je repense à La nuit des diables avec beaucoup de nostalgie parce qu’à l’époque nous travaillions avec de la pellicule, avec de vrais personnels et des personnes humbles, pas comme maintenant où il n’y a que des vidéastes, des « filmmakers ». Le numérique a tout détruit et ils sont tous très prétentieux ».
La Nuit des diables (Italie, 1972) de Giorgio Ferroni, avec Gianni Garko, Agostina Belli, Cinzia de Carolis, Bill Vanders
Combo DVD – Blu-ray édité par Le Chat qui fume
Vous pouvez commander La Nuit des diables sur le site du Chat qui fume
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).