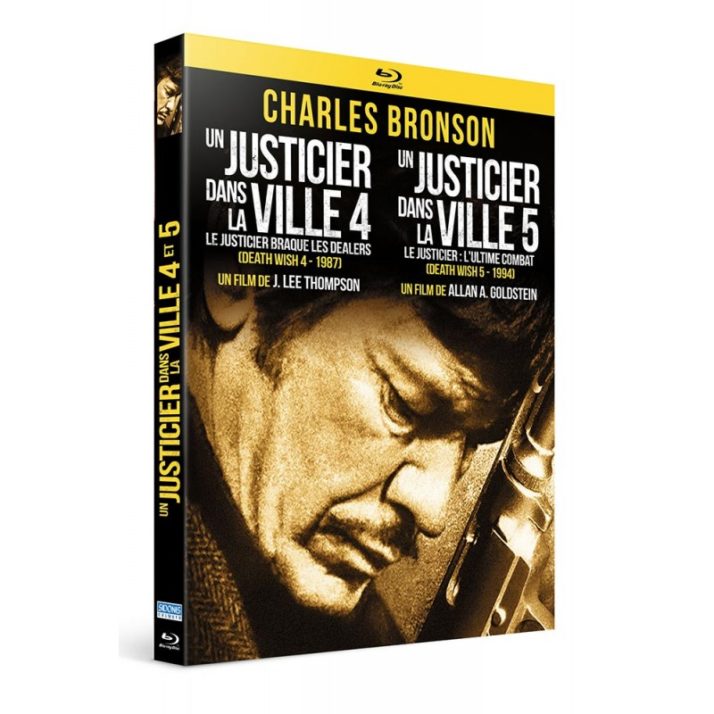Dernier tour de piste pour Paul Kersey, après avoir édité à quelques mois d’intervalles les trois premiers Death Wish, Sidonis Calysta clôture sa remise au goût du jour de la controversée franchise avec Charles Bronson en réunissant les quatrième et cinquième volets au choix sur un même Blu-Ray ou en 2 DVD.
J. Lee Thompson – « Le Justicier Braque les Dealers / Death Wish 4 : The Crackdown » (1987)

© Sidonis Calysta 2020
Principal changement dans la saga, deux ans après le troisième opus, Michael Winner passe définitivement la main et on retrouve un autre britannique aux manettes de ce Justicier Braque les dealers (Death Wish 4 : The Crackdown), J. Lee Thompson. Réalisateur expérimenté dont la carrière a débuté dès les années 50, auteur de quelques réussites telles que Les Nerfs à vif, L’œil du Malin, La Mort en rêve ou Le désert de la peur, il devient sur le tard le complice privilégié de Charles Bronson. Les deux hommes feront neuf films ensemble dont sept sur la seule décennie 80, soit plus de la moitié des apparitions de l’acteur à l’écran. La franchise toujours sous pavillon Cannon Group, s’inscrit dans une logique de production à la chaîne toujours plus abondante (14 sorties pour la seule année 1987). Bronson a désormais plus de soixante-cinq ans et la concurrence sur le terrain du cinéma d’action est de plus en plus rude : Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger connaissent les pics de popularité de leurs carrière respectives. Si Le Justicier de New-York avait, en dépit de toutes les réserves que l’on pourrait émettre et au prix d’une surenchère décomplexée aussi coupable que potentiellement jouissive, a rencontré le succès, la problématique demeure toujours la même : comment renouveler un filon qui n’avait pas vocation à le devenir ? L’action se situe à Los Angeles (comme le deuxième volet) où Paul Kersey (Charles Bronson) vit avec Karen (Kay Lenz) et la fille de celle-ci, Erica (Dana Barron). Mais l’adolescente succombe à une overdose. Paul ne tarde pas à identifier et à abattre le dealer responsable. Il est bientôt contacté par un certain Nathan White (John P. Ryan), qui a vécu un drame identique au sien et lui propose de mettre fin aux agissements des deux gangs qui contrôlent le marché local de la drogue. Il lui offre de financer entièrement cette croisade et lui remet des dossiers sur les revendeurs et leurs chefs. Paul se met aussitôt au travail…

© Sidonis Calysta 2020
Au détour de son introduction, Le Justicier braque les dealers semble valider les pires clichés véhiculés par la franchise, avant d’ouvrir in extremis par une pirouette, la voie à ce qui pourrait s’avérer être une donnée, une problématique intéressante. On découvre à la faveur d’un lent travelling arrière, un parking de nuit, désert. Un mouvement latéral précède l’arrivée d’une femme regagnant sa voiture, que la caméra accompagne (non sans se priver d’un petit insert racoleur sur ses talons, en guise d’annonce). Elle entre dans son véhicule qu’elle ne parvient pas à faire démarrer, tandis que le contrechamp dévoile un premier voyou, puis un deuxième et enfin un troisième. Construite comme une séquence de film d’horreur, la scène laisse monter la tension jusqu’à basculer dans la violence sauvage et gratuite. Les trois hommes cagoulés (ils n’ont ni visage ni personnalité), s’apprêtent à la violer en bande, mais là encore le réalisateur prépare son spectateur par un mouvement de caméra, amorce l’entrée en scène de Paul Kersey. « Qui êtes-vous ? » , « La Mort » répond le justicier, les exécutant froidement et mécaniquement un par un. Un plan rapproché observe alors le visage de Charles Bronson, mâchoire serrée, fixe et monolithique, dans ce qui ressemble plus que jamais à une caricature de lui-même. Prévisibles, dénuées d’une quelconque ambiguïté, ces premières minutes jettent pourtant le trouble grâce à une conclusion inattendue. Il s’agissait en fait d’un cauchemar, Kersey a retrouvé un semblant de vie stable mais reste hanté par son passé, sur lequel il aurait tiré un trait. Malheureusement, cette petite promesse se voit très rapidement mise à mal par la suite des événements. En effet, si le héros bénéficie d’une contextualisation relativement propre, les personnages qui gravitent autour ne constituent que des prétextes afin de lancer une intrigue aux furieux airs de déjà-vu. Le film a beau témoigner d’une volonté de revenir (toutes proportions gardées, il ne refrène pas certains excès) à un cadre plus réaliste que son prédécesseur, renouer avec les fondamentaux, son scénario se contente principalement de compiler et remixer des péripéties entrevues au sein des trois premiers épisodes telle une vulgaire resucée. Le protagoniste a repris situation professionnelle initiale, sa nouvelle compagne est journaliste (comme l’était Geri Nichols dans le deuxième épisode) et sa vengeance s’exerce pour le compte d’une tierce personne (non plus un policier mais un riche homme d’affaire). Concédons une petite nouveauté, il n’affronte plus cette fois la petite délinquance mais la grande, en étant opposé aux cartels.

© Sidonis Calysta 2020
Passé cette absence d’originalité, le film souffre d’un manque d’envie criant dans l’exécution de son programme, y compris dans ses nombreux contours réactionnaires, qui ne font même plus l’effort d’être un tant soit peu incarnés ou nuancés. Les intrigues secondaires multiples n’ont d’autre intérêt que d’allonger artificiellement la durée, certains personnages disparaissent arbitrairement du récit plusieurs dizaines de minutes, le facteur émotionnel est définitivement abandonné, sans parler des rebondissements invraisemblables ou de gadgets tout droit sortis d’un James Bond (la bombe dissimulée dans une bouteille de vin). On note également des négligences techniques laissées au montage, significatives d’une production prise par-dessus la jambe, à l’image de ce mannequin, visible quelques secondes avant une explosion. J. Lee Thompson, artisan plutôt compétent mais sans vision, ne possède ni l’ironie, ni le jusqu’au-boutisme d’un Michael Winner, beaucoup plus terre-à-terre, il emballe l’ensemble passablement. Exception faîtes d’une séquence tardive à l’esthétique étrange, où Paul Kersey poursuit les bad guys sur une piste de roller disco. Les couleurs flashys tranchent avec l’atmosphère plus convenue du polar urbain, dessinent in fine un sous-texte que le long-métrage n’a pas pris la peine d’exploiter : une opposition générationnelle entre jeunesse insouciante et ancienne école, qui s’incarnerait aussi dans les codes visuels en vigueur. Reste intacte la figure anachronique de Charles Bronson, dont le charisme naturel suffit à assurer un minimum syndical même vieillissant et sans que ce dernier ne fasse preuve d’une conviction débordante, comme s’il partageait la même lassitude que le spectateur. Il campe, un héros qui n’est fondamentalement plus d’actualité dans le cinéma américain, tentant malgré tout de prouver le contraire, à travers un quatrième opus faisant office de geste désespéré. Poussif et à réserver aux inconditionnels du personnage ou de l’acteur.
Allan A. Goldstein – « Le Justicier : L’Ultime Combat / Death Wish V : The Face of Death » (1994)

© Sidonis Calysta 2020
Vingt ans après le premier volet, sept après l’avant-dernier, un cinquième Death Wish voyait le jour. Alors que Charles Bronson était quasiment à la retraite, après un magnifique baroud d’honneur dans The Indian Runner de Sean Penn, le voilà qui reprenait du service pour ce qui allait être sa dernière apparition sur grand-écran. Plus de Cannon Group mais toujours Menahem Golan (il aurait songé à réaliser le film lui-même) pour diligenter la chose via son autre société de production, la 21st Century Film Corporation. La genèse de ce Death Wish V, est en soit un feuilleton aussi aberrant que significatif, traduisant le cynisme et l’opportunisme en vigueur au moment de lancer le projet. D’une part, le film n’a pas du tout été pensé pour faire partie de la saga, il s’agit d’une banale série B criminelle qu’il a été jugé bon d’affilier à la franchise afin de capitaliser dessus. De plus, Bronson a eu la liberté d’imposer sans résistance face à lui, des envies telles que celles de rendre son personnage plus sympathique et moins violent. D’autre part, la réalisation qui devait initialement revenir à Steve Carver (Œil pour Œil et Dent pour Dent avec Chuck Norris), avant que ce dernier n’abandonne en raison d’une énième baisse de budget, a été confiée à un obscur tâcheron. En effet, le scénario atterrit entre les mains d’un certain Allan A. Goldstein, réalisateur plutôt familier de la télévision et très éloigné du cinéma d’action. Surpris par la proposition, il accepte et s’attelle à des réécriture pour rapprocher davantage le matériau de ses affinités personnelles (comprendre, rajouter des éléments de comédies). Ce retitrage in extremis a permis au film une sortie dans les salles américaines, là où partout ailleurs il fut limité à une exploitation vidéo. À la retraite, Paul Kersey (Charles Bronson) est professeur dans une université et vit le parfait amour avec Olivia (Lesley-Anne Down). Lorsque son ex-mari débarque et la défigure, Kersey retient sa colère. Mais le jour où Olivia est assassinée, le justicier reprend du service…

© Sidonis Calysta 2020
Au regard d’une production aussi ouvertement opportuniste, pas facile d’espérer un miracle, mais de là à imaginer un navet aussi improbable qu’irrécupérable… On découvre un Paul Kersey pantouflard, inactif près d’une moitié de long-métrage, quand il n’apparaît pas tout simplement comme un personnage secondaire dans le récit. Charles Bronson, soixante-dix ans passés, fait peine à voir, pâtissant d’une absence de regard coupable, égaré dans un projet indigne, répondant à peine au professionnalisme de standards télévisuels. Visuellement laid, plat, dépourvu d’idées, parsemé de dialogues répétitifs et affligeants : le film est à la fois hors sujet avec la franchise au sein de laquelle il serait serait censé s’inscrire et totalement absurde lorsqu’il dévoile de maigres partis-pris. On constate notamment, effaré, des tentatives de scènes de comédies d’un goût douteux, en plus de systématiquement tomber à côté, et une imagerie enfantine qui tendrait involontairement vers une improbable version adulte de Maman, j’ai raté l’avion. Par exemple, le protagoniste tue en empoisonnant une pâtisserie ou en plaçant une bombe à l’intérieur un ballon téléguidé, tandis qu’il se sert pour la première fois d’une arme à feu dans une chambre d’enfant. Outre, le caractère grotesque de ces choix, ils accentuent l’idée d’un opus édulcoré, dont la relative violence ne parvient qu’à tutoyer le grotesque. Inutile de commenter des séquences d’actions molles, dont l’usage fréquent de ralentis balourds ne fait qu’intensifier la dimension ridicule. En vingt ans, Death Wish, sera passé du thriller tortueux interrogeant les dérives de son époque, à la série B plus ou moins efficace avant de s’achever sinistrement sur ce Justicier : l’Ultime combat, impossible, déconnecté de toute problématique éventuelle et surtout très éprouvant à visionner. Cet échec sans appel n’aura pas totalement dissuadé Menahem Golan d’arrêter les frais, puisqu’un Death Wish VI : The New Vigilante fut envisagé. Néanmoins, le revers justifié rencontré par ce dernier opus, couplé à la faillite peu après sa sortie de la 21st Century Film Corporation annihileront tout espoir de concrétisation. Charles Bronson n’apparaîtra plus qu’à la télévision, notamment à travers la trilogie Family of Cops (titrée à dessein dans l’hexagone pour les volets deux et trois : Le justicier braque la mafia et Le justicier reprend les armes). Au cours des années 2000, l’idée d’un remake de l’opus initial apparaît régulièrement, d’abord entre les mains de Sylverster Stallone en 2006 puis en 2012 celles de Joe Carnahan. C’est finalement Eli Roth qui s’en chargera en 2018, avec Bruce Willis dans le rôle de Paul Kersey.
Les deux films bénéficient de copies haute-définition de qualité, et ne comportent pour seul supplément leurs bandes-annonces respectives. À noter que Death Wish V n’est disponible qu’en version française.
Retrouvez les articles consacrés aux volets précédents :
– Un Justicier dans la ville / Death Wish
– Un Justicier dans la ville 2 / Death Wish II
– Le Justicier de New-York / Death Wish 3
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).