
© Arte
Excellente initiative d’Arte que d’exhumer Abigail Lesley Is Back in Town de Joe Sarno l’un des papes de la sex-ploitation US des années 70. Hasard de la publication, elle coïncide à quelques semaines près avec la redécouverte des Jean-Marie Pallardy, permettant ainsi de comparer deux approches radicalement différentes du genre pendant la même période. Car si Pallardy aborde la chair essentiellement dans la joie et la bonne humeur, point de gaudriole chez Joe Sarno chez qui le sexe rimerait plutôt avec vide sentimental et frustration.
Le parcours de Joseph Sarno est suffisamment original pour être rappelé car c’est pendant la deuxième guerre mondiale qu’il quitte son New Jersey natal pour apprendre à filmer en Suède où il est envoyé dans l’armée au service cinéma. Sa carrière ne cessera par la suite de naviguer entre la Suède et les USA. Refusant de servir le cinéma officiel, à son retour au pays, il se lancera dans le cinéma sexy, puis purement érotique, avant de passer le cap du pornographique ; quelques muses émailleront ses œuvres les plus marquantes : côté beauté scandinave citons les très belles Marie Forsa (Veil of blood) et Marie Liljedahl (Inga et sa suite), la future héroïne d’Eugénie de Franco puis Rebecca Brooke pour les Etats Unis (La Priscillia d’Abigail Lesley Is Back in Town )

© Arte
Il manque sans doute à Joe Sarno l’invention stylistique et l’intellectualisation fascinante d’un Radley Metzger pour atteindre le statut de grand cinéaste. Il ne fournira en effet jamais d’œuvres de la trempe d’un The Image ou d’un The liquerish quartet, mais la qualité de mise en scène et du montage ainsi que sa maîtrise de l’espace lui confère une importance particulière au sein du cinéma d’exploitation et en font un auteur singulier. Avec un sens de la durée et des cadrages quasiment bergmanien, il conçoit parfois des plans d’une grande force symbolique, superbement photographiés, telle cette vision d’une héroïne pleurant dans une chambre rouge, ou encore cette même jeune femme perdue dans l’immensité d’une plage.
Contrairement aux œuvres de Pallardy, dans Abigail Lesley Is Back in Town le charnel, loin de constituer un objet joyeux de libération, devient un pur défouloir de la monotonie existentielle, du conformisme bourgeois et de l’emprise sociale. Les pitoyables personnages d’Abigail Lesley Is Back in Town ressemblent à des animaux malheureux, à l’affût du prétexte qui les sortira de leur cage et libérera leurs pulsions. « Abigail est revenue », la nouvelle a vite fait le tour de Point Bay la petite ville typique bercée par le ragot et le préjugé collectif. Chacun évoque le retour de la scandaleuse en un mélange de fascination et de répulsion, miroir de ce qu’ils fustigent et de leurs rêves secrets, bref, un révélateur des tares cachées sous la sérénité bourgeoise. Abigail Lesley Is Back in Town constituerait l’accouplement hybride de Théorème avec le soap opera, et dont les figures imposées tiennent beaucoup plus de l’esthétique hardcore des années 70s que que d’un érotisme subtil et délicat : le visuel et l’attitude, rappellent nettement plus le cinéma pornographique, tel un Gorge profonde qui aurait tronqué son cadrage en évitant les plans explicites. Mêmes thèmes, mêmes mimiques de la part d’acteurs dont certains – tels Jamie Gillis – deviendront des figures célèbres du X américain; les scènes s’enchaînent inlassablement dans des équations sexuelles quasi mathématiques – 1, 2, 3, 4 personnes – et un évident plaisir à envoyer valser les tabous : échangisme, partouzes, inceste, tout le monde fait indistinctement l’amour avec tout le monde… Bref rien de très folichon dans ces séquences qui nous confinent dans des intérieurs pavillonnaires miteux, éclairés par une lumière blafarde dans des dominantes orangées.

© Arte
Et pourtant, la forme du plan séquence éloigne clairement du pur X ; la prise de son direct accentue la sensation de cinéma vérité, la vision répétitive finissant par générer le malaise. Est-ce volontaire, si derrière ce sexe mécanique, cette surconsommation, où l’on parle plaisir sans le ressentir perce une curieuse tristesse, comme un désespoir de l’absence de bonheur ? Ces séquences ne font que souligner la misère sexuelle d’une vie aseptisée et sans idéal et le mirage de la libération par le corps. Abigail se fait le catalyseur de cette prise de conscience. Détail amusant, Abigail porte le même nom que l’héroïne des Sorcières de Salem et si l’ardeur de l’héroïne de Sarno n’aura pas les même conséquences dramatiques qu’à Salem, son Abigail à lui se contentant d’enflammer la libido de ses habitants, il n’empêche qu’elle partage avec le personnage de Miller son incroyable pouvoir de suggestion sur la foule, entraînant sur son sillage tous les habitants, en se faisant le révélateur de leurs frustrations, n’attendant qu’un prétexte pour libérer leurs pulsions rentrées. Abigail est une capitaliste du sexe, une sur-consommatrice qui fait voler en éclat le microcosme social, révélant les travers de chacun, tel un interrupteur qui allumerait les instincts et qui au-delà même de l’escalade sexuelle les libère d’un incommensurable ennui. Sarno évoque également de manière sous jacente le fossé entre les conditions et le mépris des castes supérieures, en particulier à travers le très émouvant personnage d’Alice Anne (le portrait qu’en fait Sarno est plein de compassion) , la modeste pêcheuse, celle qui a toujours les mains qui puent le poisson, et rejetée par tous … sauf Abigail qui établit un jeu dans lequel tous sont égaux : elle brise les interdits, explose les conventions et les strates sociales.

© Arte
Sarno est un cinéaste qui prône l’indépendance féminine. Aussi ses « desperate housewives » espèrent prendre le dessus sur des mâles dominants tous plus lamentables les uns que les autres – qu’ils soient adultères, ou playboys stupides – en n’employant que leur fonction d’étalon. Elles se leurrent en croyant s’affranchir de la domination masculine par la liberté sexuelle. Rien d’étonnant à ce que Sarno ait une propension à multiplier les scènes saphiques car elles finissent par y trouver plus leur compte entre elles. Etrangement sentimental derrière sa vulgarité, sous cet entremêlement débridé des corps Sarno montre l’incapacité à se rapprocher réellement de l’autre, l’incapacité d’aimer. Les deux personnages incapables de s’avouer leurs sentiments mais se rencontrant timidement, régulièrement sur le bord de mer – rares moments d’échappatoires poétiques du film – ne parviendront à s’embrasser qu’à la faveur d’une orgie. Même la nymphomane légendaire emploie ses talents dans le but de finir par approcher celle qu’elle aime secrètement.

© Arte
Au milieu de cette animalité généralisée émerge une sorte d’âme pure, comme une dernière trace de fragilité et de candeur. En effet, Priscilla, la femme perdue, trompée, toujours craintive, offre à Abigail Leslie is back is town ses vrais moments érotiques et de grâce, les seuls dans lesquels le charnel devient enfin beau. Et finalement son innocence fascine au point que tous s’essaient à la corrompre et l’entraîner de leur côté. Ce sera pourtant de la bouche de la tentatrice elle même que s’échappera la réponse la plus juste à la supplique de Priscilla quant à son désir de libérer pour devenir « libre comme elle ». « Te libérer, Ça n’est pas forcément ce qu’il te faut » rétorque Abigail. L’aura de Rebecca Brooke (l’héroïne de The image) insuffle une réelle tension érotique par sa présence au point de créer un contraste, une véritable dichotomie esthétique à l’intérieur même du film. Elle seule semble exprimer des émotions vraies : le rire, les pleurs ou le plaisir. Au milieu de ce vide sentimental et existentiel, de ce désenchantement général que dissimule un déchaînement des sens presque mortifère elle ose le retour à la vie, affirmant son altérité en sortant du cercle social qui l’aliénait. Elle rompt avec la règle communautaire en devenant la femme qui trouve, enfin, le courage de fuir.
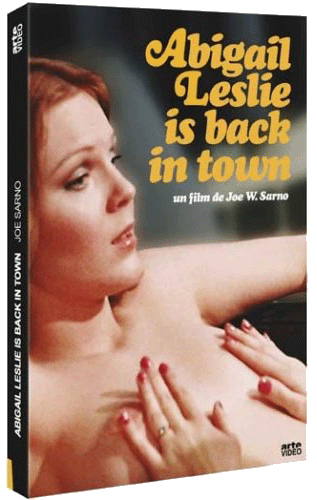
Si la copie est tout simplement splendide, c’est le calme plat niveau bonus. En sus de la bande annonce, le mini entretien avec Joe Sarno et sa femme Peggy aurait plutôt tendance à lui porter préjudice qu’à le mettre en valeur. En effet, apprendre que Rebecca Brooke adorait faire l’amour, qu’elle cousait bien et faisait bien la cuisine n’est peut-être pas le meilleur moyen de saisir toute la singularité d’une oeuvre. Bienheureusement, le très intéressant livret est plus consistant, permettant quant à lui de saisir son parcours et de le resituer dans son contexte socio-culturel.
Abigail Lesley Is back in Town (USA, 1975) de Joseph W. Sarno, avec Rebecca Brooke, Jennifer Jordan, Eric Edwards, Jamie Gillis
Edité par Arte
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).







