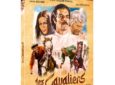La mutation que connaît le cinéma américain à la fin des années 60 ainsi que l’avènement de nouveaux auteurs réunis sous la dénomination Nouvel Hollywood (Francis Ford Coppola, Michael Cimino, Martin Scorsese, s’il est encore nécessaire de les nommer), poussent certains vétérans à s’adapter. Parmi eux, John Frankenheimer, cinéaste de studio ayant fait ses armes à la télévision lorsque cette-ci était encore balbutiante, prototype parfait d’artisan solide aussi à l’aise dans le drame que dans l’action pure, excellent technicien et directeur d’acteurs. Visionnaire, il fut l’un des précurseurs du thriller paranoïaque post-Watergate qui connut son essor durant les années 70, avec le glaçant Seconds – L’Opération diabolique. En 1969, après avoir signé Les Parachutistes arrivent avec Burt Lancaster – son comédien fétiche qu’il fera tourner pas moins de cinq fois – il s’empare d’un script signé Alvin Sargent, scénariste hétéroclite de L’Homme sauvage de Robert Mulligan, Bobby Deerfield de Sydney Pollack, mais également des Spider-Man 2 et 3 de Sam Raimi. Le Pays de la violence conte donc l’histoire du shérif Henry Tawes (Gregory Peck dans un rôle initialement prévu pour Gene Hackman), dont la vie morne et routinière est chamboulée par sa rencontre avec Alma McCain (Tuesday Weld). Seule ombre au tableau, la jeune femme est la fille du plus gros trafiquant d’alcool du Tennessee. Mésestimé ou mal compris, le long-métrage traîne depuis lors une réputation peu flatteuse (certains considèrent qu’il s’agit purement et simplement du plus mauvais film de Peck). À l’occasion de la sortie du combo Blu-Ray/ DVD édité par Sidonis-Calysta, il est grand temps de mettre à mal ces critiques, pour la plupart injustifiées.

(© Sidonis Calysta 2020)
Tawes est introduit seul, en uniforme, accoudé à sa voiture de fonction, tournant le dos aux spectateurs, il fait face à un lac, au loin, un barrage lui tient lieu d’horizon. Visiblement las et usé, il sort de sa rêverie pour répondre à un appel banal de sa femme qui lui demande de faire des courses en rentrant. En un plan extrêmement pictural (Caspar David Friedrich et ses silhouettes pensives face à l’immensité de la nature ne sont pas loin), Frankenheimer synthétise toute la mélancolie inhérente au personnage. Dans son interview présente en bonus, Thierry Frémaux (délégué général du Festival de Cannes et directeur de l’Institut Lumière) regrette pourtant que Gene Hackman n’ait pas endossé le rôle en lieu et place de Gregory Peck, pointant du doigt l’allure trop aristocrate, trop distinguée de ce dernier. Si l’acteur du Procès Paradine n’est effectivement pas le choix le plus évident pour incarner un shérif de l’Amérique profonde, il lui apporte une vraie dignité, au sein d’un récit centré sur l’ennui et le vide existentiel d’un homme en crise. Quinqua presque exsangue, son quotidien se partage entre un travail assez peu excitant (faire abattre un arbre à la demande d’un propriétaire terrien), bien loin du cliché du flic redneck à la gâchette facile, et une vie familiale monotone. Son couple bat de l’aile, son père est atteint de sénilité, et l’affection qu’il porte à sa fille ne lui redonne pas le sourire pour autant. Personnage d’antihéros typique du cinéma états-unien de cette période, il reflète les obsessions du réalisateur, qualifié de « cinéaste de l’aliénation moderne » par Jean-Baptiste Thoret dans son commentaire audio. C’est une simple rencontre lors d’un banal contrôle de routine qui va lui faire croiser la route de celle qui va brusquement bouleverser son existence : Alma McCain. Interprété par l’excellente Tuesday Weld (dont la filmographie compte également Le Solitaire, À la recherche de Mr. Goodbar et Il Était une fois en Amérique, excusez du peu) elle incarne un probable nouveau départ pour le shérif en même temps qu’un dilemme moral pour ce dernier, différence d’âge oblige. Au cœur d’une intrigue classique d’homme de loi tiraillé entre son devoir et son amour, le metteur en scène porte son attention sur les détails, les gestes, plus que sur l’enquête, assez peu rythmée il faut bien l’avouer. Entre deux descentes dans une distillerie clandestine, la traditionnelle collaboration tendue avec un agent du FBI et les soupçons de son propre adjoint, c’est lors de moments intimes que le protagoniste révèle ses failles et touche par son spleen. Lorsqu’il tente de faire bonne figure devant sa femme qui essaye désespérément de lui rappeler leur passion éteinte, il dévoile une ambiguïté et une douleur non feinte. Parfois un seul plan sur un regard peut révéler les tourments intérieurs, ainsi le patriarche McCain découvre l’idylle secrète en un regard, et l’épouse trompée comprend ce qui se trame lorsque, seule dans son lit, elle entend une voiture qui démarre. Une démarche anti-spectaculaire qui trouve son paroxysme lors d’une superbe séquence dans un drive-in qui synthétise en un montage parallèle, l’infinie tristesse d’Henry et la joie insouciante de sa jeune maîtresse. Avant qu’un terrible retournement de situation accentue la dimension fataliste en enfermant le héros au milieu des spectres de sa mémoire, pétri de regrets et de remords, ce dernier plonge Alma dans son propre passé en lui faisant visiter la maison de son enfance, faisant ainsi jaillir un élément fondamental du long-métrage : son ancrage dans un époque indéfinie, figée et immuable.

(© Sidonis Calysta 2020)
Bien que contemporain, le décor du Pays de la violence (titre français assez peu judicieux que Frémaux attribue à Bertrand Tavernier, alors attaché de presse, pour l’anecdote) semble hors du temps. Loin des polars urbains qui ne tarderont pas à fleurir (Serpico, French Connection…), l’action se situe au sein d’une Amérique rurale, presque abandonnée (une centrale électrique déserte, un cimetière d’épaves de voitures). Faisant montre d’une veine naturaliste de bon aloi, le cinéaste filme en gros plans les habitants, souvent des vieillards au regard absent, choix qui trouve son acmé lors du final bouleversant, jouant de la surimpression pour unir le protagoniste à son lieu de vie. Cette ancienne ville du Tennessee renvoie immanquablement à l’époque des pionniers, donnant à l’ensemble des relents de western. Ainsi, lorsque Henry fait visiter le commissariat à Alma, on constate que le tribunal est au cœur du même bâtiment, la justice est rendue dans les locaux de la police. Au mur est accroché un portrait de John Fitzgerald Kennedy, pourtant assassiné sept ans auparavant, renforçant cette sensation de temporalité suspendue, comme si le pays avait stoppé sa course lors de ce jour de novembre 1963. Un détail à priori anodin, qui en dit long sur l’œuvre de John Frankenheimer : proche de Robert, frère du président décédé, il avait lui-même réalisé ses spots de campagne avant que ce dernier ne soit abattu à son tour. Comme le précise Jean-Baptiste Thoret, suite à ce tragique événement de 1968, le cinéma de l’auteur du Prisonnier d’Alcatraz devient bien plus sombre et désenchanté, à l’image du présent long-métrage. La famille McCain n’est pas sans rappeler les hors-la-loi de l’Ouest sauvage (mêlée à un banal trafic d’alcool frelaté) avec son chef de clan bourru et raciste, et son fils se rêvant en héritier prêt à prendre le flambeau sous les yeux (pas si innocents) de sa jeune sœur. Le réalisateur s’amuse d’ailleurs à cadrer le géniteur et son rejeton sur un même plan, nets là où le reste du cadre est flou, comme il le fait avec l’agent fédéral et l’adjoint du shérif, créant alors deux entités bicéphales unies pour troubler la vie du héros. Le père de ce dernier se révèle également prisonnier d’un passé sont il ne peut s’échapper, frappé de démence il ressasse encore et toujours le même événement traumatique. Pour accompagner cette Americana emplie de laissés-pour-compte, de désœuvrés, Johnny Cash signe une bande originale (la seule de sa carrière) accompagnant les mésaventures du personnage de Gregory Peck, à la manière d’un chœur antique, soulignant chacun de ses états d’âme. Délesté de tout score instrumental, seules les chansons de l’artiste accompagnent les images mélancoliques de la tentative de renaissance d’un homme au bout du rouleau. Par son double sens, le titre principal, I Walk The Line (composé en 1956 mais auquel Cash a ajouté un couplet pour l’occasion), résume à lui seul son dilemme, à la fois d’une droiture éthique sans failles et soumis à la tentation de vivre libre, loin des carcans, dans un monde où les frontières entre le Bien et le Mal, le légal et l’illégal se brouillent.

(© Sidonis Calysta 2020)
La sortie en combo Blu-Ray / DVD du Pays de la violence dans une superbe remasterisation HD chez Sidonis-Calysta, est l’occasion de réévaluer ce long-métrage sous-estimé dans la filmographie de John Frankenheimer. Comprenant de nombreux bonus, notamment deux clips de Johnny Cash et un making of d’époque, cette édition rend justice à un film atypique, véritable point de jonction entre le savoir-faire d’un réalisateur populaire, au sens noble du terme, et les évolutions thématiques du Nouvel Hollywood.
Disponible en Digibook Blu-Ray et DVD chez Sidonis-Calysta.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).