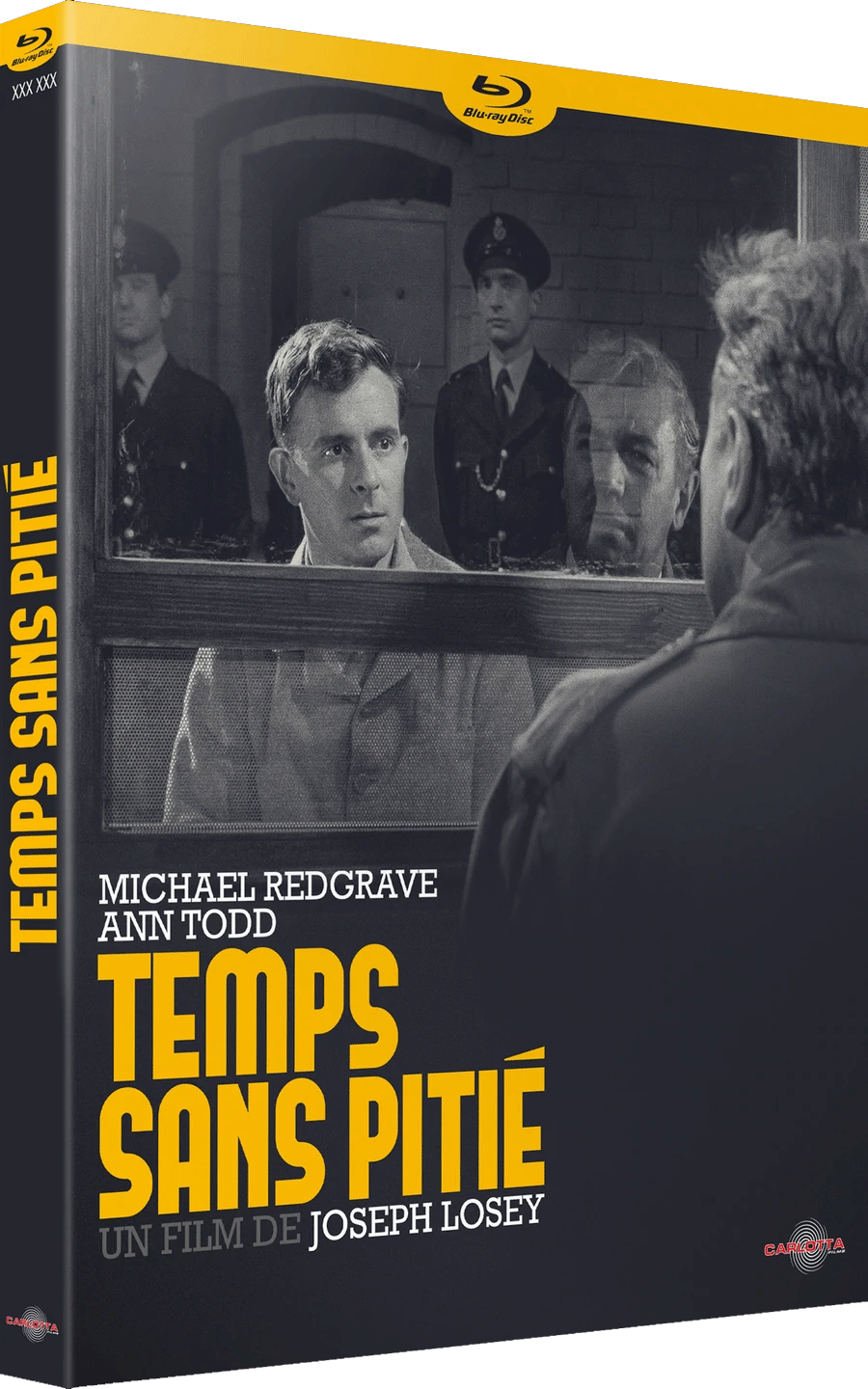Vingt-quatre ans avant de réaliser Monsieur Klein, Joseph Losey a perdu son nom. En 1957, avec Temps sans pitié, il le retrouve. En effet, membre du Parti Communiste Américain, il s’exile en Angleterre et signe trois films sous pseudonyme dont un en Italie. L’idée de l’identité enfin reconquise n’est pas anodine pour un film qui, polanskien avant l’heure, parle justement de dépossession, de suspicion, du poids du passé, et des heures qui filent. Le sujet tient en quelques lignes. Un jeune homme, Alec, est injustement accusé du crime de sa maîtresse. David, père absent et ex-alcoolique, qu’il n’a pas vu depuis des années, arrive à Londres vingt-quatre heures avant son exécution, vingt-quatre heures pour prouver son innocence. Démarre alors une course contre la montre insensée où les rouages du destin semblent se liguer contre Alec et son père. D’emblée Losey se débarrasse de quelques stéréotypes et attentes du suspense policier et notamment de la question de la culpabilité d’Alec puisque la séquence inaugurale du meurtre dévoile le visage de l’assassin : Robert Stanford, un riche industriel amateur de voitures que nous voyons évoluer dans toute son abjection, son mépris de classe, sa misogynie.
Nous guettons en vain la faille qui le trahira. Losey et son scénariste Ben Barzman (qui lui aussi a fui en Angleterre pour les mêmes raisons que Losey) font d’ailleurs preuve d’un certain sadisme vis-à-vis du spectateur, qui subit douloureusement le spectacle du coupable paradant sans risque, insultant sa femme et quelques autres. Nous savons, nous regardons le mal en pleine possession de ses moyens, libre. Si le suspense de Temps sans Pitié est d’une efficacité redoutable, pour Losey, l’intérêt est ailleurs, le genre étant un prétexte pour étudier les tréfonds de l’âme humaine, de la conscience, Les vertiges de la psychanalyse tels qu’il les exploitera dans Cérémonie Secrète sont encore loin, mais Losey s’avère dès ses premières œuvres un cinéaste de l’intériorité, bien moins captivé par l’illustration du film noir et ses archétypes que par les déchirants rapports filiaux et ses ressorts. David, le père alcoolique, a passé sa vie à délaisser son fils, à l’oublier…. une vie à le perdre. Son visage exprime la culpabilité et l’espoir du rachat, tandis qu’Alec le rejette, miné par l’absence d’amour, la rancœur de ce manque et la peur de mourir. L’étreinte, qui sera peut-être la dernière, avec Alec en pleurs, est bouleversante.
Déjà son M, réalisé avant son exil, poursuivait la réflexion langienne sur la relativité du bien et du mal et la mettait à jour à l’aune de sa propre époque. Il étudiait les dysfonctionnements schizophrènes d’une société contaminée – de celle qui crée ses propres monstres et cherche à les exterminer – où le fou criminel suscitait bien plus d’empathie que ceux qui cherchaient à le détruire.
Avec Temps sans Pitié, il pousse plus loin son investigation sur les rapports qu’entretient l’individu avec la collectivité. Si le spectacle de l’imposture sonne régulièrement comme un aveu de Losey et de son scénariste, artistes persécutés, c’est probablement dans cette vision d’un homme pourchassé qu’il trahit le plus le trauma du maccarthysme. Face à lui, ses congénères ne sont – à quelques rares exceptions près – que lâcheté ou délation quand il ne s’agit pas purement et simplement de fureur du lynchage. Losey partage ces thèmes avec Fritz Lang, notamment sur M le Maudit ou Fury. Alors qu’Alec a un pied dans la tombe, face à cette méprise, le système judiciaire apparaît comme totalement incapable, inique, poursuivant la procédure. Et l’individu est acculé à utiliser des méthodes illégales voire suicidaires pour tenter de faire triompher la vérité. Créer apparaît alors plus que jamais pour Losey comme un outil rebelle, et un splendide exutoire de sa propre impuissance. En cette société désolidarisée et suspicieuse, un sentiment d’absurdité domine : est suspect puis reconnu coupable celui qui ne parvient pas à trouver la preuve de son innocence. La zone d’ombre comme condamnation, ça vous rappelle quelque chose ? A revoir Temps sans pitié, bien que désenchantés de la permanence de l’espèce humaine – rien ne change–, nous sommes frappés par l’intelligence et l’actualité du propos.
Ici, le pouvoir de l’argent définit la justice, et l’homme d’affaires possède le pouvoir de tuer, d’accuser, et d’asseoir une réputation immaculée. En germe, sommeille déjà dans Temps sans pitié le portrait de cette imposture de classe tel qu’il explosera dans ses collaborations avec Pinter que ce soit dans The Servant et Accident. L’heure n’est pas encore à l’observation acide et ironique, mais le sentiment de lutte des classes est déjà là.
Dans Temps sans pitié tout est affaire de « temps ». Son titre résonne d’emblée comme une formidable mise en abîme de la gestion de sa durée, 85mn, moins d’une heure trente pour en embrasser 24, mettre en scène son intrigue, 85 minutes pour rétablir la vérité, le temps de vivre, le temps de mourir, un temps qui court et que l’on poursuit en vain. Le temps inexorable, inflexible, jamais interrompu.
Dans cet impressionnant dispositif symbolique digne du Bergman des Fraises sauvages, les montres sont omniprésentes, les cadrans s’affichent outrageusement quel que soit le décor, les tics-tacs agressent les oreilles, les aiguilles tournent. Et que dire de l’appartement de cette vieille folle peuplé de réveils qui ne cessent de sonner en un assourdissant vacarme, venant rappeler à David que le délai est presque écoulé ? Même la vision de Robert Stanford filant à toute allure dans sa voiture de course souligne ces secondes accélérées. Le temps c’est avant tout pour Losey, celui perdu et irrattrapable d’un père et son fils mesurant les années disparues. Le réseau métaphorique sert moins le suspense diabolique et la course contre la montre que le tragique des rapports humains où tout semble accompli, où il est déjà trop tard. Dans son agencement d’un rythme essoufflant, Losey traduit in fine le temps humain, existentiel, celui des liens rompus, brisés par le destin (1). » nous n’avons plus le temps » disent régulièrement les personnages. Si la peine de mort y est dénoncée clairement, Losey jamais didactique, plonge son film dans l’intime métaphysique.
Le cinéaste installe un climat d’entre deux, entre le suspense haletant et l’effacement des contours de la réalité. Etourdissante et survoltée au point d’accélérer notre pouls, sa mise en scène s’avère toujours en recherche de stylisation et ce dès la première séquence du meurtre où la bande-son ne laisse que les bruits d’objets qui tombent et la musique stridente, offrant à notre vue les cris muets de la victime. Ses striures fantasmatiques conduisent l’atmosphère vers la perte des repères. Est-ce la panique ou le monde qui se brouille ? Le cerveau de David envahi par l’alcool trouve comme rime visuelle des nappes de brume dignes du smog londonien de Jack L’éventreur. Losey courtise l’onirisme et renvoie aussi aux brouillards mentaux de Fritz Lang dans Le secret derrière la porte. Quelle ironie : David n’avance jamais aussi bien dans son enquête que lorsqu’il est saoul, se laissant pénétrer, tel un voyant, par l’inspiration presque surnaturelle de ses visions, pas très loin de la reconstruction traumatique hitchockienne de La Maison du Dr Edwards ou de Marnie. L’inconscient, le fantasme et le rêve font resurgir la mémoire de ses ténèbres.
La copie proposée proposée est très belle et joliment restaurée. L’édition Carlotta propose en bonus un bel entretien de 21 mn avec Michel Ciment, le spécialiste français de Losey qui analyse toujours avec pertinence son oeuvre et recontextualise Temps Sans Pitié dans la carrière de Losey notamment en rappelant ses démêlés avec le Maccarthysme.
Pour l’édition Powerhouse, parmi les quelques bonus proposés, The John Player Lecture with Joseph Losey (1973, 80 mins), est un inestimable documentaire audio permettant d’entendre une conversation de 80 minutes de 1973 entre Losey et le critique Dilys Powell au London’s National Film Theatre tout en visionnant le film. Le commentaire audio de Neil Sinyard co-auteur du livre British Cinema in the 1950s: A Celebration viendra compléter cette écoute. Dans The Sins of the Father (2019, 16 mins), le réalisateur et fils de Joseph Losey revient à son tour sur Time Without Pity. Enfin, ultime petit supplément (et curiosité), Horlicks: Steven Turner (1960, 1 min), un spot publicitaire de Losey réalisé pour une boisson au lait malté. le livret de 40 pages présente beaucoup d’articles intéressants. Un texte de Robert Murphy analyse le film. Dans un entretien de 1967 avec Tom Milne, Joseph Losey évoque le film. Très instructif est également l’article de Jeff Billington revenant sur le conflit qui opposa deux groupes de cinéphiles français lors de la sortie du film : les MacMahonistes et Les Cahiers du cinéma, les MacMahonistes voyant Time Without Pity comme un chef d’oeuvre tandis que Les Cahiers du cinéma boudait Joseph Losey, ce dernier ne rentrant pas dans leur théorie de politique des auteurs. On ne s’étonnera évidemment de voir le jeune Bertrand Tavernier totalement conquis par le film. Incontestablement, le temps a donné raison au Temps sans pitié . C’est un chef d’oeuvre.
___________________
(1) Bertrand Tavernier étant un admirateur du film de Losey, nous revient à l’esprit, L’horloger de Saint Paul, son adaptation de L’Horloger d’Everton de Simenon transposée à Lyon. Philippe Noiret y incarne un paisible horloger voyant sa vie basculer lorsque son fils est accusé du meurtre d’un vigile. La connotation symbolique de sa profession conduit elle aussi à compter les heures et à étudier les mécaniques du temps.
Combo Blu-Ray / DVD édités par Carlotta (France) ou Powerhouse films (Royaume uni, avec sous-titres en anglais uniquement.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).