Une vague nouvelle, oeuvres complètes de Kijû Yoshida – partie 1 (60-64)

© Carlotta
Ne mâchons pas nos mots, la sortie chez Carlotta de l’intégrale Yoshida (2 coffrets ce mois-ci et un autre dans le courant de l’année), en parallèle avec la rétrospective du Centre Georges Pompidou constitue un événement dvd, un événement culturel, un événement tout court à la mesure du choc que procure la découverte de ce maître. Soyons francs, nous ne connaissions de Kijû (Yoshishige) Yoshida que deux de ses films, et c’est une sensation très riche et très étrange que celle d’entrer brusquement en contact avec la totalité d’une œuvre aussi dense, aussi rigoureuse, aussi exigeante et personnelle.
Ce réalisateur est sans doute le représentant le plus caractéristique de la nouvelle vague japonaise des années 60 dans laquelle oeuvrèrent également Oshima – on retrouve un intérêt particulier pour la réalité sociale de son époque et en particulier pour la jeunesse désœuvrée – et Teshigahara – qui partage avec lui un goût pour le clair obscur, une certaine géométrie des plans, des lignes, des volumes qui témoigne d’une fascination pour l’esthétique urbaine. Antonioni dont Yoshida est l’admirateur n’est parfois pas loin, dans cette poétisation de la ville en formes abstraites. Yoshida un cinéaste tout à la fois politique et littéraire (et beaucoup plus expérimental à partir d’Eros + Massacre).

© Carlotta
On comprend aisément pourquoi on le considérait comme le plus intellectuel des cinéastes, tant la caméra semble pour lui l’équivalent de l’encre pour l’écrivain. Le cinéaste travaille l’image comme une page, élaborant ses intrigues comme des romans d’apprentissage dans lesquels les héros deviennent les révélateurs de sa vision du monde. Rien d’étonnant à ce que Yoshida puise manifestement son inspiration dans la littérature occidentale. Il y a en effet beaucoup du roman français du 19e Siècle dans la première partie de son œuvre que présente le premier coffret de Carlotta intitulé « Une vague nouvelle ». Il s’y distingue immédiatement par un style qui mêle le réalisme social, le cinéma psychologique, dans un climat à la fois idéaliste et pessimiste.

© Carlotta
Son premier film, Bon à rien (1960) témoigne d’emblée de son intérêt pour une réalité contemporaine dont le cinéma fait peu de cas à l’époque. A travers ce personnage de mauvais garçon, partagé entre ses aspirations individuelles et sa dépendance au groupe, Yoshida dresse le portrait des laissés-pour-compte d’une société fermée, déchirée et livrée à la loi du plus fort, qui ne concède jamais aux humbles leur place, même lorsqu’ils côtoient les plus riches. Bon à rien souligne la désillusion du Japon de l’après guerre avec l’émergence des formes modernes d’oppression sociale, fondée sur la toute puissance d’une oligarchie économique. Yoshida affirme dès cette première œuvre sa capacité à créer des personnages féminins extrêmement forts qui s’affranchissent des anciens carcans, avec une énergie beaucoup plus rigoureuse que celle des hommes. La soumission aux normes semble avoir résolument changé de camp. la toute puissance économie dominante. Il s’intéresse déjà à l’incommunicabilité des sexes dans laquelle non-dits et sentiments refoulés interdisent la compréhension et le rapprochement des êtres et aboutissent fatalement à l’échec. Tiraillés entre l’ancien et le nouveau Japon, entre nostalgie et rejets, fascination et répulsion, espoirs et déception, les héros semblent incapables de se trouver un statut et une identité, bref, d’accéder à une certaine forme de bonheur.
On peut dire que Yoshida n’y est pas allé de main morte, lorsque la Shôchiku lui demande, en 1960, de réaliser un film sur la jeunesse. Il était alors assistant de Kinoshita, cette proposition lui permît de réaliser son premier long métrage. Son scénario fut fortement porté par la satire sociale, mais qu’importe, les Studios avaient besoin de sang neuf. La jeunesse qu’il y décrit n’est pas des plus belles, elle est plutôt ridiculisée, réduite à l’ennui et à des attractions futiles. Mais Yoshida se réserve de tout penchant manichéen, puisqu’il critique aussi, avec beaucoup d’acidité, le non sens de la vie de salarié bien rangé, et celui de la vie de couple marié, réduisant l’homme au plaisir d’une bière fraîche à son retour du travail et l’épouse aux tâches ménagères et au simple plaisir d’acheter un réfrigérateur. De tous les côtés, la critique fusionne, et ce sans la moindre concession, le personnage à travers lequel Yoshida exprime de l’espoir ne tiendra pas la route.
Déjà, une énergie insaisissable rendue possible grâce à une mise en scène allégée, une caméra mobile, beaucoup d’extérieurs (signes de renouveau par rapport au cinéma plus classique de studio, inspirés par la Nouvelle Vague française notamment). Déjà là, une direction d’acteur précise, je découvre avec vif intérêt l’acteur Masahiro Tsugawa (que l’on retrouvera dans La Fin d’une douce nuit), et je revoie avec grand plaisir Yûsuke Kawazu, qui crevait déjà l’écran dans Conte cruel de la jeunesse de Nagisa Oshima. Déjà dans ce film, une belle maîtrise du cadrage et de la photographie. Je voudrais prendre chaque image du film pour en faire des tableaux photographiques.

© Carlotta
Le sang séché (1961) prend plus l’apparence d’une satire cinglante de son pays dont la charge rappelle parfois La dolce Vita de Fellini. Dans ce récit de la récupération médiatique de la tentative de suicide d’un employé licencié, comme acte ultime de protestation, Yoshida s’attaque de front à la soumission de l’âme japonaise qui asservit l’individu à la loi collective et le dissout dans la masse. Déjà perce le procès d’un certain capitalisme, du règne de l’argent et des mass médias. Le patriotisme supposé du sacrifice emblématique à la nation dans la plus pure tradition maître-esclave qui régnait dans l’Empire du Soleil levant y est tout autant ridiculisé que l’obsession nippone du suicide, comme une antithèse à la position d’un Mishima. D’une virulence étonnante, Le sang séché confine parfois au cynisme et se clôt de manière aussi brutale qu’il a commencé.
Pour son deuxième film, Yoshida ne calme pas son désir d’expression personnelle et engagée. Il se dégage de cette œuvre une froideur sèche générale, due à l’absence d’amour. Lorsqu’il semble y avoir de l’amour, il n’est que faux, pas partagé. Chaque personnage est voué à la solitude la plus dure. Le dicton qui dit que l’homme est un loup pour l’homme est ici rudement illustré, avec aucune once d’espoir, Yoshida peint la grande noirceur de la société japonaise de l’époque, où la manipulation et le paraître sont maîtres. Yoshida, à propos de ce film, a dit vouloir “faire de l’humanisme si répandu une véritable supercherie”. Indéniablement c’est réussi !

Yoshida traite à nouveau de l’infirmité des sentiments dans la superbe fable cruelle qu’est La fin d’une douce nuit (1961). S’il se réclame ici de l’influence du Rouge et Le noir et de Julien Sorel, c’est encore plus du côté de Balzac qu’il faudrait se pencher ; la symbolique du titre pourrait sonner comme un écho à Illusions perdues. Son héros évoque quant à lui un Rastignac dont la quête d’ambition aboutirait à l’enfer et le rêve d’ascension sociale à une chute de plus en plus vertigineuse. Avec une noire ironie, Yoshida aborde l’ambition pour celui qui n’est rien d’accéder à une condition supérieure par la seule séduction dont l’espoir obstiné de parvenir se révèle une folle illusion puisque la règle immuable du « à chacun sa place » l’emporte une fois de plus. Les rapports homme/femme de La Fin d’une douce nuit à nouveau très étranges, oscillent entre l’attirance et la répulsion, l’impossibilité d’aveu des sentiments, dans un jeu qui n’est pas sans rappeler Les liaisons dangereuses : cependant subsiste toujours l’écrasante pression des rapports de force socio-politiques qui régissent les corps et les esprits, qui génère le chaos quand les fantasmes d’ascension se heurtent aux sentiments.
Ici, tout se paye. Le héros peut littéralement vendre sa jeune amie, un vieil homme d’affaire acheter la tendresse d’une jeune femme pour tromper son ennui, la fille d’un patron de grand magasin s’offrir un gigolo en la personne du jeune homme aux abois. Au-delà de ces turpitudes, se distingue encore une âme féminine forte et pure ; Yoshida esquisse subtilement une foule de nuances de sentiments insoupçonnés. L’inconstance n’empêche pas de perdre de vue le véritable amour et de se sentir brusquement captivé par le parfum des cheveux d’une femme qui fait oublier pendant quelques instants l’appétit de la revanche sociale et pécuniaire. Plus le héros s’enferme, plus la photo du film s’assombrit. Apparaît déjà un symbole récurrent que l’on retrouvera par la suite : le grillage sur lequel s’accroche les personnages, et qui, en premier ou en arrière plan, rappelle toujours les limites de leur libre arbitre et de l’emprise du destin qui finit toujours par les enfermer.
Pour rebondir sur l’idée du symbole d’enfermement, je noterai celui que représentent la grande roue et les tours de moto. Lorsque Jirô Tezuka est énervé, il se défoule en moto sur un piste circulaire sur laquelle il fait des cercles répétitifs, à toute allure. Comme un hamster sur sa roue, qui court sans avoir conscience de l’absurdité de son action, enfermé dans une cage. De même lorsqu’à la fin du film, dans la plus grande déception personnelle (échec de son ambition sociale), il s’enferme dans la cabine d’une grande roue (trop petite pour lui), répétant le même mouvement circulaire, parfait reflet d’un jeune animal excité tournant en rond dans sa cage.
Ce film est la dernière commande que va lui faire la Shôchiku. Ses films, comme ceux de Oshima, sont jugés trop dangereux – parce que trop personnels et politiques. Privés de la liberté dont ils ont pu jouir auparavant, Oshima se retire de la Shôchiku et Yoshida reste un an sans tourner.

© Carlotta
La source Thermale d’Akitsu (1962) apparaît comme l’immanquable au sein des indispensables. Dans cette histoire d’amour bouleversante Yoshida peaufine son style, en une maîtrise formelle qui laisse apparaître toute la singularité de son génie. L’apparition de la couleur constitue incontestablement une transition esthétique qui lui permet d’expérimenter un sens du cadrage et de la mise en scène étonnants. Mariko Okada apparaît pour la première fois chez Yoshida avant de devenir son égérie : elle illumine tout le film de sa beauté à travers ce sublime personnage d’héroïne qui sacrifie sa vie entière à un amour, ou à une image de l’amour, tandis que la conquête de l’indépendance féminine devient une prison. Il est d’ailleurs curieux de constater à quel point on se rapproche de certaines figures tragiques d’Henry James ou Edith Wharton chez qui celles qui croient se libérer s’enferment dans leur condition et leur destin. Certes l’œuvre de Yoshida accorde aux deux sexes des rapports d’égal à égal, dans lesquels la femme, face à des hommes falots, incertains et timorés, se présentent comme la seule source de vie, d’énergie, de décision, bref d’espoir. Cependant son altruisme et son dévouement à l’autre la condamne à nouveau au statut de victime. Car si elle se libère de sa condition subalterne en s’affranchissant de la norme collective, c’est pour se vouer cette fois-ci volontairement au sacrifice qui la conduit à sa perte.
Cette histoire d’amour a la particularité de se dérouler sur quatorze années, pendant lesquelles les deux héros ne se verront que quatre ou cinq fois. Elle, sera l’éternelle amoureuse. Lui n’aura jamais le courage d’aimer. « J’ai l’impression d’avoir passé ma vie à te voir partir » affirmera t-elle. Le thème de l’absence se fait leitmotiv et partant, celui du retour et de son attente, retour du héros vers la source thermale, retour aux sources. Yoshida ne filme que les moments partagés de ceux qui ne se verront quasiment pas, le reste n’étant qu’ellipse ; il les observe, avec le ravage progressif du temps, au rythme des changements de saisons. Chaque nouvelle rencontre se fait plus douloureuse, la force du personnage de Shinko palilant toujours la faiblesse de l’autre, vivant leur amour pour deux.
A nouveau Yoshida, emploie la figure emblématique du grillage à mesure que les personnages s’enferrent dans leur destin. L’expérimentation formelle sert intégralement la traduction de la sensibilité et de la tragédie humaine ; encadrements en diagonales, scènes perçues derrière des vitres, art des encoignures de portes et des lumières qui percent, le cinéaste multiplie les variations sur les rapports de l’homme à l’espace et sur les changements de points de vue. L’individu fait corps avec le lieu, à l’unisson du spectateur qui parvient lui aussi à éprouver les mêmes sensations et à ressentir la menace du monde. Avec une caméra toujours extrêmement mobile, les travellings latéraux suivent les personnages dans leurs mouvements, leurs courses, leurs essoufflements et épouse leurs errances.
Dans ce chef d’œuvre Yoshida restitue la sensualité des gestes. Les éclairs de beauté frappent au détour d’une nuque ou d’un dos, et le tracé d’un visage à demi dissimulé suffit à saisir l’essence même de la féminité, comme les estampes japonaises excellent à le faire.

© Carlotta
Il s’agit-là de la première adaptation de ce cinéaste qui a toujours préféré travailler sur ses propres scénarios. C’est Mariko Okada (grande actrice, muse et épouse du cinéaste) elle-même qui est venue à lui avec insistance et force de conviction, le roman en main. C’est elle qui tenait à cette adaptation, elle s’est même chargée de la production et des costumes. Yoshida accepte, à condition qu’il puisse l’adapter “à sa façon”, qu’il puisse y exprimer son regard personnel. Comme Mariko Okada avait déjà beaucoup d’admiration pour le cinéaste, son accord ne fut pas difficile à obtenir.
Magnifiques sont ces paysages, ces décors, cruelles sont ces ellipses temporelles, fascinante est cette actrice (qui en était déjà à son 100e film…!), intenses sont ces mouvements rapprochés sur la peau, le visage, les mains des personnages pour un film qui laisse des traces indélébiles.

© Carlotta
Avec 18 jeunes gens à l’appel de l’orage (1963), Yoshida confirme plus que jamais son engagement politique et social à travers ce portrait de jeunes gens situés au plus bas de l’échelle sociale et embauchés dans des entreprises de fabrications de bateaux, qui vivent dans des baraquements, vestiges de l’occupation américaine.
Paradoxalement, c’est à travers le réalisme et la noirceur de cette vision contemporaine que Yoshida laisse apparaître le plus d’espoir, car le superbe 18 jeunes gens à l’appel de l’orage raconte l’apprentissage de l’autre, de la haine et du mépris de la classe inférieure au désir de la voir sortir la tête de l’eau où elle s’enfonçait et à accéder à la dignité. Cette foi en l’émergence d’une solidarité qui brisera les barrières entre les hommes fait probablement de 18 jeunes gens à l’appel de l’orage un film ouvertement marxiste. Elément inédit chez Yoshida, les héros y parviennent enfin à donner une réalité à leur amour, et l’homme de dépasser sa simple fonction sexuelle et sociale pour apprendre à être devenir l’acteur d’un destin individuel. La description urbaine nocturne y trahit ses premières abstractions antonioniennes et tout en créant un pendant à La rue de la honte, renforcé par la musique stridente qui accompagne les images.
Toute la violence de cette jeunesse ouvrière utilisée et exploitée par la société industrielle est rendue à la fois belle et ignoble, grâce à une mise en scène, des cadrages et une photographie précis et imposants. Un film unique, qui ne restera que quatre jours à l’affiche, retiré par la suite pour son trop grand engagement politique.

© Carlotta
Avec Évasion du Japon (1964), Yoshida poursuit le tournant amorcé avec La source thermale. Il s’empare du cinéma de genre pour mieux le détruire, et transforme le film policier en schéma d’anti-héroïsme absolu dans lequel l’action n’est qu’un constant mouvement de fuite. Évasion du Japon parachève les recherches formelles amorcées avec La source. Yoshida présente cette œuvre comme « Un film d’action qui s’oppose à l’idée d’action ». En effet, Évasion du japon exprime la détresse de l’homme qui, malgré son intention de rester étranger aux entreprises dont il est le témoin se retrouve malgré lui dans un engrenage inéluctable, et doit subir les conséquences des méfaits d’autrui jusqu’à le contraindre lui-même à la violence. Une fois encore, la force de caractère et l’abnégation des femmes tranche avec la médiocrité et la bassesse masculine. C’est encore l’occasion pour Yoshida de nous offrir un portrait poignant d’héroïne. Évasion du japon confirme cette étonnante place de la faiblesse/fragilité masculine dans le cinéma de Yoshida, qui devient presque un élément de séduction pour la femme, qui se sent le devoir d’aider et de sauver son partenaire… et peut-être de se révéler, en affirmer son identité par l’énergie de celle qu’on voulait toujours réduire à sa place de servante. Évasion du Japon marque un tournant dans l’œuvre du réalisateur par son évolution esthétique, par l’attention plus fouillée qu’il porte à la psychologie de ses personnages, en un regard de plus en plus précis et attendri.
Cette œuvre noirissime constitue en quelque sorte l’apogée de la première période de Yoshida et ouvre la voie à une autre forme d’inspiration. Entre la musique agressive de Takemitsu et les coups de pinceau qui ouvrent et ferment le film, on entre dans une phase qui s’ouvre de plus en plus à l’expérimentation. Le cinéaste y manie les couleurs vives comme un peintre, joue avec les formes, et la géométrie l’espace et son intérêt pour l’abstraction s’amplifie. Le ton rageur et violent exprime le rictus du désespoir tandis que le titre traduit l’impossibilité du salut et une question insoluble : comment un japonais peut-il échapper au Japon ? Évasion du japon est un film d’action passive, dans lequel l’ultime but ne réside dans la force de s’insurger mais l’espoir illusoire de s’enfuir.
Les œuvres de Yoshida présentées dans ce premier coffret témoignent d’une qualité de mise en scène époustouflante et laisse présager la splendeur des années qui suivent. A la fois concerné par les problèmes de son pays et désenchanté, sans jamais alourdir la narration et le romanesque de ces destins brisés, Yoshida s’affirme comme un immense cinéaste des vaincus.
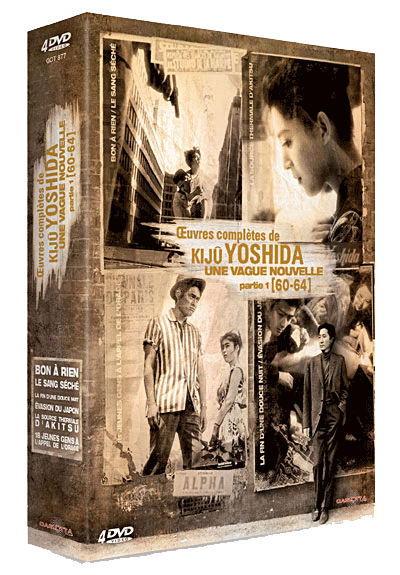
A noter un travail technique (image, son) de Carlotta tout à fait remarquable, restituant parfaitement les univers formels propres à chaque film. En prime, une présentation des films par Yoshida lui-même, et un entretien avec Mariko Okada à propos de La Source thermale d’Akitsu.
Une vague nouvelle, oeuvres complètes de Kijû Yoshida – partie 1 (60-64)
Bon à rien
Rokudenashi – 1960 – 88mn – nb
Avec Masahiro Tsugawa, Hiruzu Takachiho, Yûsuke Kawazu, Junichirô Yamashita
Le Sang séché
Chi wa kawaiteiru – 1960 – 87mn – nb
Avec Keiji Sada, Shinichirô Mikami, Mari Yoshimura, Kaneko Iwasaki
La Fin d’une douce nuit
Amai yoru no hate – 1961 – 85mn – nb
Avec Masahiro Tsugawa, Michiko Saga, Teruyo Yamagami, Hiroko Sugita
La Source thermale d’Akitsu
Akitsu onsen – 1962 – 112mn – coul.
Avec Mariko Okada, Hiroyuki Nagato, Sumiko Hidaka, Jûkichi Uno
18 Jeunes gens à l’appel de l’orage
Arashi o yobu juhachi-nin – 1963 – 108mn – nb
Avec Tamotsu Hayakawa, Yoshiko Kayama, Gannosuke Ashiya, Yôko Mihara
Évasion du Japon
Nihon dashutsu – 1964 – 93mn – coul.
Avec Yasushi Suzuki, Miyuki Kuwano, Kyôsuke Machida, Ryôhei Uchida
Coffret édité par Carlotta, sortie le 9 avril 2008.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).







