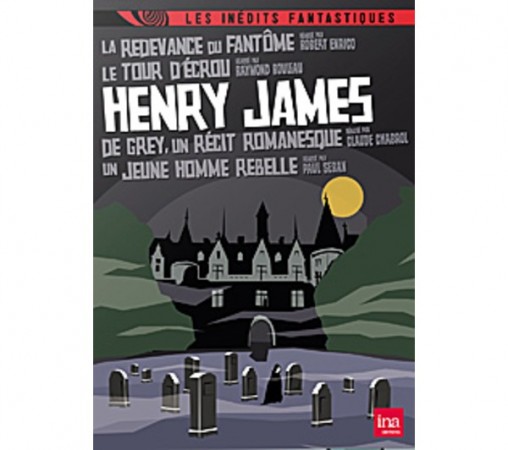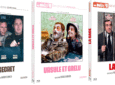De grey (© INA)
Après nous avoir gratifié de quelques unes des plus belles découvertes de l’année, L’INA clôt 2012 en beauté avec trois nouveaux titres des Inédits fantastiques.
L’adaptation par Armand Lanoux de La peau de Chagrin de Balzac cerne à merveille tous les enjeux philosophiques de l’argument fantastique. C’est donc dans le Paris de la Monarchie de juillet qu’évolue Raphaël de Valentin, prototype de héros romantique, désespéré et plongé dans le marasme de ses jours d’ennui, partagé entre sa soif de vie et ses pulsions suicidaires. Le téléfilm de Michel Favart traduit cette atmosphère de troubles où la légèreté de l’être n’est qu’à quelques pas de la mort. Ce milieu d’intellectuels oisifs, narcissiques et protestataires est celui des contemporains de Balzac. A la même époque, pas très loin de la Bataille d’Hernani, de la défense de Victor Hugo contre la critique bourgeoise, les jeunes poètes pleuraient et se suicidaient en cascade. Le héros appartient à cette race, brûlant la vie par les deux bouts pour lui trouver un sens.
La Peau de Chagrin (© INA)
C’est au moment d’en finir que, pénétrant chez un vieil antiquaire, il découvre cette peau de chagrin susceptible d’exaucer tous ces désirs, lui qui croyait ne plus en avoir aucun, mais volant les années à mesure qu’elle rétrécit, à chaque souhait. L’approche de l’œuvre est passionnante car tout autant littéraire qu’historique et philosophique. Avant la psychanalyse et aux prémisses de la médecine psychiatrique, c’était à la phrénologie, à la physiognomonie et au magnétisme que croyait Balzac. Mais il est particulièrement frappant de constater que la métaphore fantastique trahit parfaitement tous les symptômes de la dépression. Formidable œuvre sur le mal de vivre et la quête d’un bonheur dont l’existence est une grande inconnue, La peau de chagrin évoque aussi la vie quotidienne de jeunes aristocrates privilégiés dont le narcissisme confine à la perte d’identité. La vision d’Armand Lanoux rend parfaitement compte de toute la dimension schopenhauerienne du livre. Le héros écrit un essai sur le désir, lui-même avide de désirs jusqu’à qu’il s’aperçoive qu’il ne s’agit que d’un leurre, que chaque désir réalisé ne fait qu’en appeler un autre, épuisant l’âme jusqu’à la mort. « Toute ma force est tendue vers un seul désir, ne plus en avoir ». Ainsi rate-t-il la vie et le bonheur simple qui s’offrait à lui, préférant se laisser vampiriser par l’inaccessible et capricieuse Foedara (superbe Catriona McColl, un an avant L’au-delà de Lucio Fulci) qu’accepter l’amour simple de Pauline, s’en apercevant trop tard. On soulignera la qualité formelle de cette Peau de chagrin et tout particulièrement sa photo mordorée et toute en clair obscur ; les décors parisiens nocturnes, souvent peints, participent à l’atmosphère fantomatique et morbide. Malgré son classicisme et son interprétation assez théâtrale, voilà une adaptation proche de la perfection qui donne envie de se replonger illico dans les pages balzaciennes. « Les hommes sans âme, une femme sans cœur, voilà mon histoire ».
L’exercice était difficile. Pour l’adaptation de l’inadaptable Métamorphose, en moins de 5 minutes, Jean-Daniel Verhaeghe (le réalisateur du très étrange et très beau L’araignée d’eau d’après Marcel Bealu) plante l’argument et le décor et s’en sort plutôt bien. Le parti pris de la caméra subjective – et en sépia – pour exprimer le point de vue du héros est d’autant plus intéressant qu’il constitue une belle correspondance à la narration à la première personne de l’auteur. On ne verra en effet jamais Gregor Samsa, mais la mise en scène privilégie la perception du héros de sa propre désagrégation, la voix frêle de Samy Frey étant un choix particulièrement judicieux pour exprimer la douleur de ce doux héros sombrant dans le vertige de l’anéantissement et du rejet.
La métamorphose (© INA)
Verhaeghe n’élude pas l’absurdité comique et l’approche satirique de l’œuvre, soulignée par l’intervention d’intertitres de cinéma muet reprenant des phrases du livre. Il n’évite en revanche pas l’archétype caricatural de la représentation de la petite bourgeoisie médiocre enfermée dans un conformisme dévastateur, Julien Guillomar et Madeleine Robinson s’en donnant visiblement à cœur joie d’incarner ces deux prototypes familiaux et sociaux dérangés par l’intervention de l’extraordinaire et du honteux au sein d’un cadre si bien ordonné. Bref, la férocité sarcastique et farcesque vampirise parfois la noirceur. La forme est très limitée par cette image vidéo typique de la télé des années 80, mais La métamorphose reste une adaptation tout à fait honorable de la fable géniale de Kafka.
Le coffret Henry James comprend quatre adaptations de l’auteur américain dont le célèbre et très attendu La Redevance du fantôme de Robert Enrico. Avant d’être le cinéaste estampillé « qualité française à césars» que l’on connaît, le cinéaste du Vieux Fusil avait démarré sa carrière de manière plus singulière dans des adaptations particulièrement réussies de deux grands nouvellistes américains ayant vécu rigoureusement – à quelques années près – à la même période : Ambrose Bierce (1842-1913) et Henry James (1843-1916). En 1962, les trois remarquables adaptations des nouvelles du recueil « Morts violentes » de Bierce, mêlant son inspiration fantastique à ses souvenirs des horreurs de la guerre de sécession, firent forte impression, Enrico recevant la palme d’or du court métrage pour « La rivière du hibou » en 1964. (Les deux autres étant Chickamauga et L’Oiseau-moqueur. La trilogie de 95 minutes reprendra le titre original du recueil de Bierce Au Cœur de la vie). Danss l’élégante et atmosphérique Redevance du fantôme Enrico réitère avec James ce qu’il avait réussi avec Bierce, au point que, bien que sensée se dérouler à Cambridge, son climat rappelle celui du Mid-Ouest de La Rivière du Hibou (qui faut-il le rappeler, fut tourné dans les Cévennes). Ici, Boston sera reconstitué à La Rochelle et le Massachusetts prendra les traits du Marais Poitevin. Enrico très influencé par le fantastique italien des années 60 fait baigner sa photo dans un noir et blanc mystérieux proche de celui d’un Bava sur le masque du démon ou plus encore d’un Margheriti sur Danse Macabre. La redevance du fantôme raconte la mésaventure d’un étudiant acceptant de se rendre service à un vieil homme malade et de se rendre dans sa maison, hantée par le fantôme de sa fille, dont il a causé la mort et à qui il doit désormais donner chaque trimestre un loyer. Mais les apparences sont trompeuses, réel et surnaturel pouvant parfois s’interchanger… à l’infini.
Tout en suggestion, Enrico distille le doute cher à James. La musique de François de Roubaix fait le reste, y ajoute son soupçon de mélancolie, et la seule présence de Marie Laforêt, séduisant fantôme aux yeux d’or suffit à créer l’hypothèse du fantastique : créature de l’au-delà ou vivante, peu importe ; son visage exprime l’irréalité et la brume du rêve à lui tout seul. Certaines jeunes femmes au cœur frémissant font aussi de très beaux fantômes. Très fidèle à la délicatesse de James, La redevance du fantôme à la saveur du conte ironique. Enrico maintient le spectateur dans l’expectative, et même lorsqu’il feint de lui fournir la réponse, c’est pour mieux lui soustraire l’instant d’après…
Suzanne Flon dans Le Tour d’Ecrou et Marie Laforêt dans La redevance du fantôme (© INA)
Difficile de passer après Les Innocents de Jack Clayton quand on se décide à adapter Le Tour d’Ecrou ; fatalement la lecture qu’en fait Raymond Rouleau, qui prend le contrepied du fantastique quasiment comme un devoir de refus supporte difficilement la comparaison et cet effacement de l’ambiguïté de genre du chef d’œuvre de James frustre et gêne. Bien que tout à fait français dans sa démarche, ce parti pris de réalisme fait aussi le charme de ce Tour d’Ecrou. En effet Paule de Beaumont et Jean Kerchbron choisissent d’éliminer au maximum l’élément surnaturel et spectral de l’œuvre, faisant du personnage d’Elizabeth Giddens une jeune femme engoncée dans ses convenances et névrosée qui reporterait toute sa frustration sur les enfants à travers ses fantasmes de couple fantôme, exerçant sa psychose jusqu’à la destruction. Pure hallucination, donc ? Cette éventualité était présente chez James, mais exprimée de façon plus délicate, là où le téléfilm décide d’offrir des semblants de « réponses ». Si la double interprétation générait l’angoisse chez James, ici la peur est aussi éludée au profit de l’étude du vertige psychologique. Jouée de manière convaincante par Suzanne Flon, Elizabeth Giddens suscite tour à tour la compassion et la perplexité, accompagnée de ses spectres blancs, muets et tristes prenant les traits de Robert Hossein et Marie Christine Barrault. Ce Tour d’Ecrou, malgré son aspect quelque peu conservateur reste intéressant lorsqu’on se remémore l’histoire d’Alice James, la sœur névrosée d’Henry qui passa une bonne partie de sa vie entre les mains de la médecine psychiatrique victorienne. Henry, fit interdire la publication de son journal par peur qu’il nuise à sa réputation. L’homme était un peu moins glorieux que l’écrivain et si la vision qu’offre Rouleau manque un peu de la poésie de l’imaginaire, elle a le mérite de se rapprocher d’une réalité plus prosaïque et sordide.
Tout ceci commence comme un conte. Il y a bien longtemps, à l’époque ou TF1 était encore une chaîne digne de ce nom, en 1976 les téléspectateurs purent voir les « Nouvelles d’Henry James » soit 5 adaptations de l’auteur américain. Deux nous sont proposées dans ce coffret et l’on espère vraiment la sortie d’un deuxième tant les deux moyens métrages présents ici sont de qualité. A quand, donc L’auteur de Beltraffio réalisé par Tony Scott, Les raisons de Georgina par Volker Schlöndorff et Le banc de la désolation par Claude Chabrol ? Complétons avec Ce que savait Morgan adapté par Marguerite Duras (Luc Béraud, 1974) et nous tenons notre volume 2.
Catherine Jourdan dans De Grey et Matthieu Carrière dans Un jeune homme rebelle (© INA)
Revoir Fantômas nous a rappelé combien les œuvres de Claude Chabrol pour la télévision valaient bien mieux qu’un simple travail de commande. Le très beau De Grey vient le confirmer. Comme pour mieux s’accorder au destin de ses personnages, la photo s’assombrit progressivement, jusqu’à ne laisser apparaître que les vêtements et les visages des héros perdus dans les ténèbres nocturnes. Les robes blanche ou rouge, les habits moirés brillent dans l’obscurité, leur obscurité. De Grey est une magnifique histoire de malédiction familiale – moins une histoire d’amour qu’une triste rêverie sur le l’amour – qui se transmet de père en fils depuis plus d’un siècle, chaque homme ne pouvant vivre la passion première sans que les jeunes femmes ne passent de vie à trépas. Subtilité du fantastique, primauté de l’interrogation, drame existentiel et métaphore du sentiment beau et destructeur, tout l’univers de James y est finement saisi. Et puis, il y a l’irréelle, la fascinante et regrettée Catherine Jourdan qui dès sa première apparition, autant créature que femme, traverse l’œuvre de sa présence angélique et fantomatique. Elle crée à elle seule le fantastique, ce climat d’osmose et de frontières.
Il se passe quasiment la même alchimie avec Mathieu Carrière dans Un Jeune homme rebelle, poignante et sobre transposition d’Owen Wingrave. De son regard naît le mystère, le gouffre et la détresse. Il est le climat d’Owen Wingrave. Le jeune homme, refuse d’embrasser la carrière militaire qu’on lui destinait. Il se révolte, et le rebelle en plus d’être déshérité et montré du doigt comme un lâche. Marginalisé, il devra ainsi prouver son courage dans une société où tout n’est qu’apparence, où la bravoure rime avec l’ambition et la caste. Mais le combat est inégal. Le spectre qui hante la demeure depuis des siècles s’accorde à celui des conventions, venant laver la faute du fils indigne, empêchant la honte qui allait s’abattre sur la famille. Toute la mécanique subversive de James pour lequel tout le dispositif surnaturel est prétexte au procès d’une société transparaît dans la manifestation de l’imaginaire. Le poids des conventions n’a jamais été aussi palpable, évident que dans Owen Wingrave. Non, l’opprobre ne tombera pas sur les Wingrave. Owen s’est racheté, il meurt en faisant acte de vaillance. La nuit, terrifiante, sera son champ d’honneur.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).











 Dvd édités par l’INA
Dvd édités par l’INA