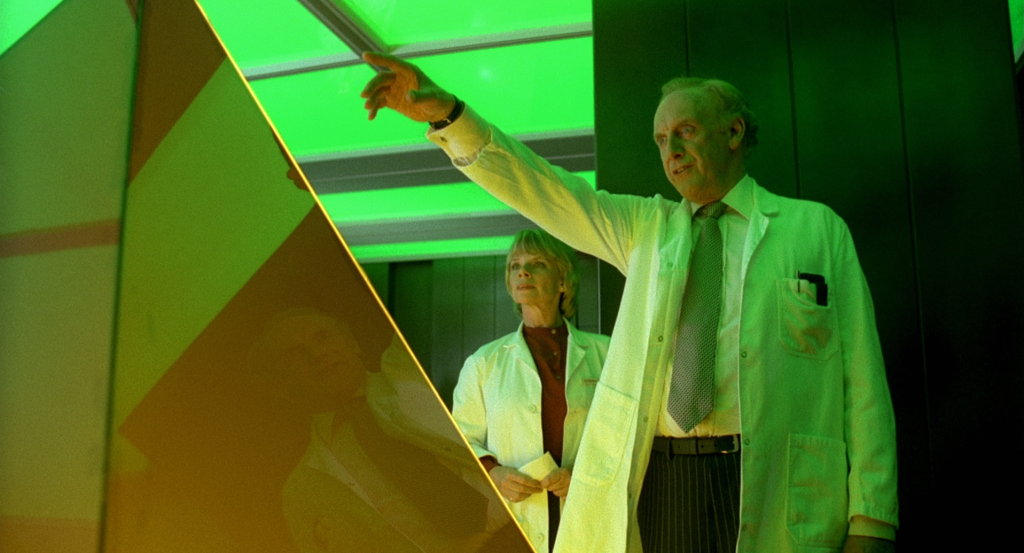Parmi ceux qui n’ont pas découvert Britannia Hospital à sa sortie en 1982, beaucoup ont été néanmoins marqués par son affiche et ses photos d’exploitation montrant un Malcolm McDowell à moitié nu, se débattant parmi les médecins, les mordant, le corps couturé façon monstre de Frankenstein. Une scène qui renvoyait à un autre Malcolm McDowell mordant un membre du personnel soignant dans Orange Mécanique. Beaucoup – dont moi – ont imaginé le film à partir de ces photogrammes provoquant l’humeur hésitante entre la peur et le rire. Finalement le fantasme s’avère très proche de la réalité pour cette terrifiante farce politique.
Le « Britannia Hospital » commémore son anniversaire, tandis qu’un nouveau service doit être inauguré par la famille royale. Mais la révolution guette dehors comme dedans. Les grévistes bloquent les entrées, empêchant les docteurs d’y pénétrer, les cuisiniers ont décidé d’arrêter d’offrir des repas de luxe aux patients privilégiés, un dictateur africain a installé ses quartiers avec sa famille et ses gardes, admis comme hôte d’exception… Quant au chirurgien de renom devant profiter de l’occasion pour présenter une invention révolutionnaire, il n’est rien d’autre qu’un savant complètement illuminé mais avide d’être suivi par les médias, prêt à décapiter ses patients pour créer un homme parfait au cerveau dominant…
Le thème du « dominant » oui, constitue bel et bien le fil rouge de Britannia Hospital qui stigmatise d’abord une société construite autour de rapports de forces, puis un monde gouverné par l‘argent et les institutions, enfin une planète où aujourd’hui les 26 plus riches détiennent autant d’argent que la moitié de l’humanité. Dans cet hôpital, les plus nantis se promènent tranquillement, en villégiature, pas vraiment malades, attendant d’être servis, ravis du logement et de la nourriture de luxe qui leur sont proposés avant de s’indigner de voir arriver une simple orange, de hurler quand la contestation annonce la fin des privilèges dans cet hôtel quatre étoiles. En quelques minutes, Lindsay Anderson règle leur compte aux classes bourgeoises, de vieux nantis qui persistent à asseoir leurs acquis jusqu’à la fin des temps, comme les « immortels » de Zardoz. Les patients lambda servent quant à eux volontiers de cobayes à quelques chirurgiens cyniques pour pratiquer l’expérimentation, la vivisection. Lors d’une séquence hallucinante et désopilante, le docteur s’aperçoit que la tête qu’il avait coupée (Alan Bates en head-guest star !) et réservée pour son opération est en train de pourrir et qu’il va donc lui falloir tout simplement la prendre sur un autre être vivant. Oui, très bien, cet autre anonyme fera aussi bien l’affaire.
Si indéniablement Lindsay Anderson appartient à la même Angleterre que Ken Loach, l’approche de son cinéma est radicalement différente. A la vision de Loach qui traite des sujets de société dans un réalisme social frontal, Anderson préfère la satire débordante, une vitalité ironique sans frein qui lui permet d’être plus violent encore, plus agressif dans sa charge lorsque l’humour noir et l’exagération portent la dénonciation. L’Angleterre thatchérienne, Loach et lui l’expulsent avec la même intensité, mais curieusement on est plutôt frappé par le nihilisme de Britannia Hospital que par son esprit de lutte, comme si quelle que soit la colère, tout était fichu d’avance. De fait, Britannia Hospital est une gigantesque comédie du chaos qui respire la fin du monde, comme en témoigne une dernière scène ouvrant une fenêtre sur l’apocalypse : l’échec politique et social se répand pour évoquer littéralement la mort de l’espèce.
Lindsay Anderson divise la société et le monde – c’est-à-dire son espace clos – en groupes distincts, comme en témoigne le générique de fin qui classe la distribution en « l’administration », « les médecins », « le personnel médical », « la famille royale », « les syndicats », « les grévistes radicaux »… Il procédait déjà de la même manière dans If… avec les « whips », les « crusaders » et le personnel du collège.
 Anderson est indéniablement le cinéaste des états de siège. Britannia Hospital pourrait d’ailleurs se lire comme une forme de remake inversé de If… Alors que la rébellion s’installait à l’intérieur du collège anglais, ici ce sont les dominants qui se réfugient à l’intérieur de l’hôpital tandis que la colère gronde dehors et menace de les envahir : manifestations, actes de terrorisme. Rien ne va plus. Protégés ? Par pour longtemps, à moins qu’ils parviennent à contenir l’insurrection en poursuivant la manipulation des masses. Lindsay Anderson et son scénariste les rassemblent tous dans ce microcosme symbolique pour mieux les observer s’ébattre, la commémoration étant un formidable prétexte pour qu’ils se retrouvent tous au même endroit. Rien d’étonnant à ce que cet édifice qui fête ses 500 ans se nomme le Britannia, car c’est in fine la totalité de la Grande-Bretagne que contient ce seul bâtiment.
Anderson est indéniablement le cinéaste des états de siège. Britannia Hospital pourrait d’ailleurs se lire comme une forme de remake inversé de If… Alors que la rébellion s’installait à l’intérieur du collège anglais, ici ce sont les dominants qui se réfugient à l’intérieur de l’hôpital tandis que la colère gronde dehors et menace de les envahir : manifestations, actes de terrorisme. Rien ne va plus. Protégés ? Par pour longtemps, à moins qu’ils parviennent à contenir l’insurrection en poursuivant la manipulation des masses. Lindsay Anderson et son scénariste les rassemblent tous dans ce microcosme symbolique pour mieux les observer s’ébattre, la commémoration étant un formidable prétexte pour qu’ils se retrouvent tous au même endroit. Rien d’étonnant à ce que cet édifice qui fête ses 500 ans se nomme le Britannia, car c’est in fine la totalité de la Grande-Bretagne que contient ce seul bâtiment.
Le cinéaste commence évidemment par dénoncer une médecine à double vitesse, qui laisse mourir les pauvres et chouchoute ceux qui ont les moyens de payer, mais sa colère s’étend vers le pouvoir en général, celui de son pays et celui d’un monde auquel il ne croit plus. Dans sa force parabolique, difficile de ne pas penser à Boorman et à la manière dont il évoquait la lutte des classes dans Zardoz ou Leo The Last. Mais là où Boorman garde un certain espoir, on a la sensation que pour Anderson l’apocalypse est là. Tout est terminé, ils ont gagné. Il reste alors le pouvoir du persiflage ravageur et sans illusion, un peu le même que celui de Stanley Kubrick dans Orange Mécanique (qui rappelons-le est un film extrêmement drôle). L’anarchie généralisée envahit vite la forme, la narration s’éparpillant, s’échappant, fuyant en ruisseaux de colère non canalisée, comme si Anderson ne cherchait plus à se maitriser mais à se libérer d’un poids. Le rire noir et tranchant trahit un réel sentiment d’urgence. La séquence atrocement drôle et absurde qui ouvre le film, tout à fait significative, offre le symptôme d’un système malade. Un vieillard mourant que les ambulanciers avaient déjà bien du mal à faire rentrer compte tenu des événements, agonise dans le hall : pour les infirmières, c’était l’heure de la pause-déjeuner.
Participer à une attaque si violente des institutions, à cette dénonciation carnavalesque d’une mascarade universelle tient de l’acte de solidarité et d’engagement. Aussi reconnaîtra-t-on un certain nombre de gueules du cinéma anglais des années 70-80, qu’il est impossible de ne pas identifier à la contestation anti-thatcherienne de Britannia Hospital, un film comme un bras d’honneur. Leonard Rossiter (Barry Lyndon, 2001), Graham Crowden (dans le rôle du professeur fou, vu déjà dans deux autres paraboles politiques Oh Lucky Man de Anderson et Leo The Last de Boorman) ou encore Jill Benett, Joan Plowright et Peter Jeffrey. Tous jouent le jeu de l’incarnation de ces figures métaphoriques de l’oppression avec jubilation. Quel étonnement également de voir Mark Hamill à mille lieues de Star Wars, coincé dans son camion de surveillance et fumant de l’herbe au lieu de scruter le moniteur. Et bien entendu Malcolm McDowell, l’acteur fétiche du cinéaste est là, dans son éternel rôle de Mick Travis entamé avec If…. et poursuivi dans O Lucky Man ! Il s’agit bien moins de constituer une vraie trilogie – car on ne reprend jamais franchement Mick là où on l’avait laissé pour suivre la suite de ses aventures – que de montrer à travers ce héros symbolique, en le déplaçant à travers les époques, l’évolution d’une société. Et si cette fois son rôle paraît secondaire, il n’en demeure pas moins le pivot du film, le poussant dans son acmé et sa folie.
Dans ce mélange des genres réjouissant, l’intervention du fantastique et de la SF tient lieu d’apogée, en ce concept d’un être humain parfait qui imposerait l’intelligence et éliminerait les contingences du corps. Absurdité, l’intelligence humaine est le plus gros danger de l’humanité. Face aux dictateurs victorieux, à une famille royale ridicule et fort bien installée et même des syndicalistes à qui il suffit de promettre une place de choix pour calmer le jeu, il n’y a plus grand-chose à faire. L’espèce n’a plus qu’à crever. Exubérant et hystérique, Britannia Hospital n’a rien perdu de sa force. Il est même plus que jamais d’actualité. On est toujours surpris en revoyant ce type de brûlot de se remémorer combien il y a plusieurs décennies la fin était déjà proche. Triste pour le monde, réjouissant pour l’art.
La copie du blu-ray Powerhouse est impeccable issue d’un très beau master HD. Parmi les suppléments proposés, un Interview BEHP avec Lindsay Anderson de 117 minutes (1991), document d’archive audio, organisé à l’occasion d’un projet du British Entertainment History en conversation avec Alan Lawson et Norman Swallow. Dans Healthy Reputation (2020, 21 mins) et Biles Apart (2020, 9 mins) les acteurs Robin Askwith et Brian Pettifer se souviennent du film et de leur amitié avec le cinéaste. Le monteur Michael Ellis dans A Cut Above (2020, 11 mins) décrit également le processus de création du film. Deux bandes annonces complètent les bonus. Enfin, le livret de 40 pages livre une belle analyse de Peter Cowie, un interview de Lindsay Anderson et des extraits de son journal, un témoignage du scénariste David Sherwin et le traditionnel choix de réception critique. Une superbe édition pour un film qu’il est indispensable de (re)découvrir, non seulement pour sa réussite mais pour le miroir qu’il continue de nous tendre sur notre monde et notre époque.
Combo Blu-Ray / DVD édité par Powerhouse films
Les films possèdent des sous-titres en anglais uniquement.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).