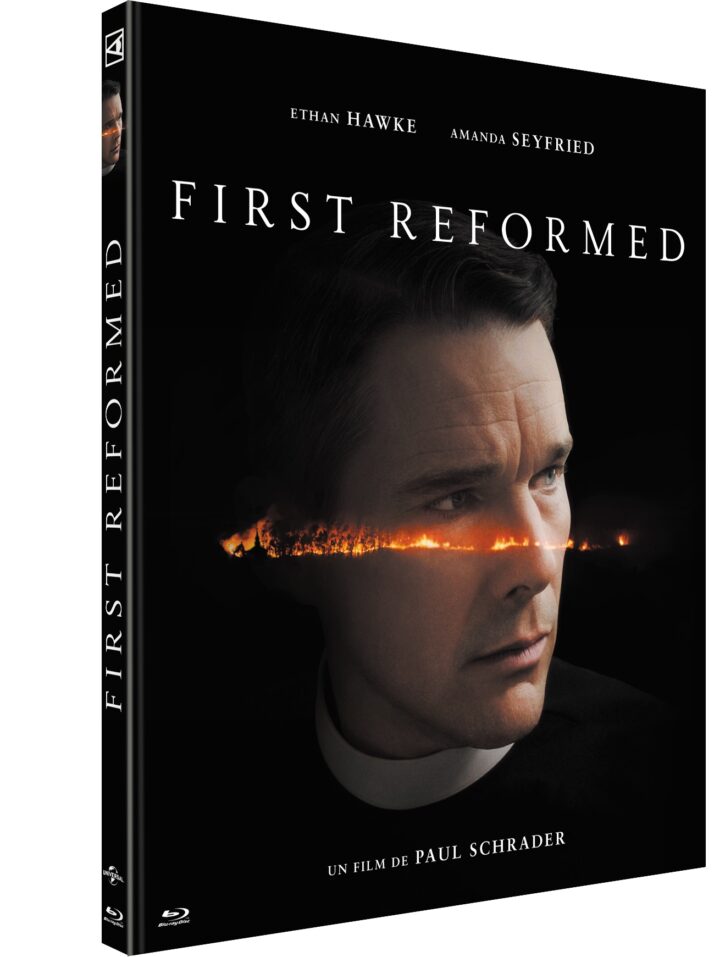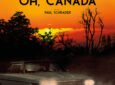En 2019, pour la première fois de sa carrière, Paul Schrader est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario original grâce à First Reformed, son vingt-et-unième long-métrage (en quarante ans d’exercice). Une attention symbolique au goût de revanche non négligeable à l’égard d’un cinéaste alors septuagénaire dont le parcours riche et accidenté demeure encore trop méconnu et sous-évalué. Protagoniste phare du Nouvel Hollywood en sa qualité d’auteur du script de Taxi Driver de Martin Scorsese ou dans une moindre mesure celui d’Obsession de Brian De Palma, sa trajectoire de réalisateur le rattache davantage à la décennie suivante, les années 80. En atteste son seul succès véritable, American Gigolo, emblème esthétique de la période produit par Jerry Bruckheimer, soutenu par la bande-originale de Blondie (Call Me fut enregistrée pour le film) et Giorgio Moroder, ayant propulsé Richard Gere au rang de star. Malentendu fondateur et œuvre cheval de Troie, dissimulant ses références européennes pointues (le dialogue final repris quasiment au mot près sur celui de Pickpocket de Robert Bresson, plans citant explicitement Une Femme mariée de Jean-Luc Godard…) derrière un écrin léché et immédiatement accrocheur. D’abord critique au Los Angeles Free Press, Cinema et essayiste le temps d’un manifeste Le Style transcendantal au cinéma : Ozu, Bresson, Dreyer (publié en 1972, traduit en France en 2022 !), Schrader n’a jamais fait mystère de ses idéaux filmiques. Son itinéraire entre réussites passionnantes (Hardcore, Mishima, Light Sleeper…) et déceptions, peut se lire comme une quête inassouvie consistant à parvenir à s’inscrire dans le sillage de ses sources d’inspiration, conjuguer intentions profondes et réalité du système de production. Le caractère foncièrement chaotique, inégal et non linéaire de sa filmographie traduit une résilience et une abnégation à toute épreuve. En 2017, après une quinzaine d’années de déconvenues critiques, artistiques et commerciales qui se sont accumulées, la présentation de First Reformed à la Mostra s’accompagne de la rumeur d’un retour en force inattendu. Scepticisme et curiosité sont de mise, tant depuis Affliction (1997) et Auto Focus (2002), on oublie volontairement Forever Mine (1999), le metteur en scène a enchaîné les désillusions humiliantes. Entre dépossessions de ses projets, Dominion sa préquelle de L’Exorciste, réécrite par Alexi Hawley et reshootée par Renny Harlin (10% de ses images sont conservées) ou La Sentinelle qu’il appellera à boycotter en amont de sa sortie avec le soutien de son acteur principal Nicolas Cage, resucées poussives (The Walker) et des tentatives prometteuses sous-produites (The Canyons écrit par Bret Easton Ellis), il peine à trouver un second souffle.

Copyright L’Atelier d’Images 2023
Las des aventures bancales ou contre-nature, le cinéaste a un sursaut d’exaltation à la suite d’une projection d’Ida et d’un échange avec Pawel Pawlikowski. Fasciné et intrigué à plus d’un titre, du format 1.33 (qu’il reprendra à son compte), l’économie budgétaire très faible n’entravant en rien une mise en scène millimétrée et exigeante, jusqu’à l’expérience ascétique épousant le point de son protagoniste, il envisage First Reformed dans des conditions similaires. Tourné en vingt jours et pour moins de quatre millions de dollars, il peut ainsi librement revenir à ses fondamentaux, sans renier ses principes et ambitions. Le récit s’intéresse à Ernst Toller (Ethan Hawke), révérend dans la première Église réformée de l’Etat de New York, sur le point de célébrer ses 250 ans. Cet ancien aumônier militaire ravagé par la mort de son fils, en proie à des problèmes avec l’alcool et en pleine crise spirituelle, rencontre un jeune couple au sein de sa paroisse. Michael (Philip Ettinger) et son épouse Mary (Amanda Seyfried), enceinte de leur premier enfant. Cette dernière s’inquiète des convictions politiques et morales de son mari, exacerbées par la naissance à venir de leur enfant. Toller devient son confident en même temps qu’il découvre les secrets de son institution religieuse financée par un groupe privé en charge de la cérémonie à venir… Si le long-métrage a les honneurs du grand-écran dans les salles américaines au mois de mai 2018, dans nos contrées hexagonales, il faudra patienter près d’un an après son passage à Venise afin de pouvoir vérifier ces « on-dit ». L’exploitation négligée se fait uniquement en DVD et VOD, à la défaveur d’un piteux retitrage, Sur le chemin de la rédemption. Peu importe, sa découverte impose un constat dithyrambique et sans appel : le film est immense. Une réussite inespérée et imprévisible, à ranger immédiatement à la fois parmi les plus grandes créations de son auteur, mais aussi à classer aux sommets de la décennie 2010, toutes origines cinématographiques confondues. Une résurrection artistique saluée globalement à l’unanimité, dont l’aura va demeurer confidentielle en raison de sa faible diffusion. Fin 2021, sa réalisation suivante, The Card Counter, structurellement assez proche, confirme une pleine possession de ses moyens et une inspiration retrouvée. Quelques mois auparavant, L’Atelier d’images, avait inscrit First Reformed au sein de son line-up annuel, laissant présager, une édition française enfin à la hauteur, avec en prime, la reprise du titre original et une copie haute-définition. Une initiative au long cours, qui se concrétise définitivement en juin 2023, en parallèle à la sortie au cinéma du nouvel opus de Paul Schrader, Master Gardener. Le timing se révèle involontairement parfait, au moment de célébrer et disséquer la renaissance tardive d’un artiste essentiel par son acte fondateur.

Copyright L’Atelier d’Images 2023
« Il y a un personnage qui revient souvent dans mes scénarios et mes films. Décrivons-le ainsi : un homme assis seul dans une chambre, portant un masque et attendant que quelque chose advienne, que la vie se manifeste… Ce masque, c’est son métier, mais qu’il soit chauffeur de taxi, gigolo, dealer ou prêtre, c’est le même type qui est en dessous. Il est comme un mort attendant d’être enfin vivant. Chacun trouve sa manière d’y parvenir. » (1)
Écriture manuscrite en guise de police, titre mis entre guillemets, First Reformed affiche une sobriété presque désuète pour son générique avant de dévoiler ses premières images. L’obscurité dissimule partiellement les détails à l’écran, la paroisse, théâtre de l’action à venir, est visible au loin. La caméra se rapproche tandis que les crédits défilent, l’horizon s’éclaircit. Le bâtiment placé au centre du cadre et en contre-plongée signifiante, surplombe le champ. Deux chemins apparaissent, l’un à gauche, l’autre à droite, l’appareil avance néanmoins tout droit, sans tenir compte de ces possibilités. Il affirme ainsi une parfaite conscience de la direction à emprunter. Quelques plans de coupes achèvent de délimiter et situer l’espace, un panneau descriptif précise quant à lui l’histoire du lieu. Un raccord à la fois doux et brutal, nous fait pénétrer de l’extérieur vers l’intérieur, et même l’intériorité du protagoniste Ernst Toller (un patronyme emprunté à un dramaturge, écrivain et poète allemand proche du mouvement anarchiste). Le silence laisse place à sa voix-off, sobre et précise, expliquant sa démarche : la rédaction d’un journal intime, sur papier et un an durant. Les mots sont assurés, chacun semble précis, pesé et sous-pesé. Deux termes retiennent particulièrement l’attention, « impitoyable » et « expérience », promesse d’un refus de toute forme de concession et d’une proposition atypique. Est-ce l’antihéros ou le cinéaste qui s’exprime à cet instant ? La confusion et l’ambiguïté sont à n’en pas douter délibérées. Début d’un dialogue à plusieurs couches, entre le narrateur et ses auditeurs (spectateurs), Paul Schrader et ses référents (les allusions à Journal d’un curé de campagne de Georges Bernanos, adapté par Robert Bresson et Les Communiants d’Ingmar Bergman ne sont pas cachées), l’époque et le passé, le contemporain et la tradition. La rigueur et la rigidité manifestes de l’ensemble, couplées à une lenteur assumée, un texte sublime et verbeux, situé immédiatement First Reformed en rupture face aux tendances hollywoodiennes en vigueur. Son humeur inquiète et pourtant en parfaite santé dans son expression, lui permet pourtant, derrière ce langage potentiellement difficile de prime abord, d’évoquer frontalement l’état d’un monde peu reluisant. Chaque élément, qu’il soit visuel ou sonore, est incarné par une croyance profonde et puissante en l’image, aussi minimale et épurée soit-elle. Tout en étant stylistiquement aux antipodes d’un Terrence Malick (période post The Tree of Life), se dégage ici un désir similaire de toucher l’universel en approchant l’intimité du personnage, créer une proximité invisible avec lui, pour ensuite révéler l’amplitude d’un dessein philosophique et spirituel. Malick et Schrader se retrouvent à travers une influence commune, Le Miroir d’Andreï Tarkovski, ainsi qu’un rapport si non critique, interrogatif vis-à-vis de leurs foi et de leurs fondamentaux. Le dépouillement schraderien vise la transcendance, il appelle de ses vœux, un idéal cinématographique formulé près de cinquante ans auparavant. Le film, revanchard et apaisé, observe un individu seul et vulnérable face à une réalité définie qu’il comprend trop bien. Il remet en cause les dogmes (religieux) et héritage (familial) dont il est prisonnier, afin d’être en phase avec ses valeurs internes. Grand leitmotiv de son auteur, l’homme passif, décide de devenir actif par la violence et modifier le cours de sa trajectoire.

Copyright L’Atelier d’Images 2023
Récit de mort et de résurrection, First Reformed creuse des obsessions ici éprouvées vers une perspective nouvelle, le tableau d’un monde déliquescent où la lueur est infime. L’Église, rouage à part entière de sociétés et lobbys cyniques, intéressés par leur seul profit, s’est détournée de sa prétendue mission. Proche des puissants, elle a depuis longtemps délaissés les innocents, âmes errantes et sans repères au sein d’un univers où le salut est difficile d’accès. Cette liberté et virulence de ton, inconfortables et assurées marquent l’affranchissement d’un réalisateur lui-même arrivé à un point de non retour. Radical, pertinent et politiquement incorrect, le discours s’appuie sur une cohérence et incarnation totales. Le cinéaste peut compter dans son entreprise sur la qualité de son casting, à commencer par Ethan Hawke, grand acteur à la filmographie elle aussi accidentée, qui donne esprit et chair à ce héros endolori, rongé et abîmé, il livre la performance la plus fiévreuse et intense de sa carrière. Face à lui, Amanda Seyfried dans un registre attentif et sensible, prouve qu’elle mérite mieux que l’image d’actrice qui lui a hâtivement été collée. La justesse de leur jeu et leur alchimie (incertaine sur le papier) amorcent des ruptures graphiques sidérantes et parenthèses charnelles empruntes d’onirisme. Derrière son austérité et exigence, se cache une œuvre sur la brèche, prête à lâcher prise à tout moment, à s’extraire de ses oripeaux, comme ses personnages de leurs conditions. Une séquence charnière exprime pleinement cette dimension, les deux corps, collés l’un à l’autre, se mettent à léviter ensemble. Scène de transe et de fusion, à la lisière du fantastique où l’arrière-plan observe des visions cosmiques progressivement rattrapées par la noirceur crue du réel. L’inaccessible et l’infini côtoient la proximité et le concret, le scénariste méticuleux s’abandonne au metteur en scène émancipé, il sort brutalement et majestueusement de sa zone de confort. Paul Schrader réussit ainsi le mariage délicat de l’épure et du lyrisme, de la stylisation minimale et totale, sans jamais s’éloigner de son antihéros, ni fragiliser son discours. Son film, théorique et viscéral, remue et sonde les tripes d’une individualité malmenée et au bord du gouffre. Le protagoniste trouve deux échappatoires en guise de voie de salut, l’amour (une conviction héritée de Pickpocket, que l’auteur ne cesse de retravailler depuis ses débuts) et la croyance (au sens large). Un dernier point ouvert et allégorique, il n’est pas question de religion, mais d’aspirations plus vastes, qu’il s’agisse de spiritualité, d’art, de politique ou d’une cause plus spécifique à défendre, le propos se distingue par son ouverture et son universalité. La passion est une nécessité afin de survivre et de disposer des ressources suffisantes au moment d’affronter un monde malade et déréglé. Cette crise de foi, fait également écho à l’histoire personnelle et l’éducation rigoureusement calviniste qu’a reçu Schrader. Vectrice de tourments et d’interrogations, véritable moteur artistique, cette facette traverse et alimente inlassablement son œuvre. Toller, à l’instar de Travis Bickle autrefois, constitue un avatar exacerbé et ambivalent, d’un homme lucide et entier qui au meilleur de sa forme, saisit mieux que quiconque dans le paysage contemporain l’état de tension d’une société fracturée.

Copyright L’Atelier d’Images 2023
Renaissance et avènement, déclinaison et modernisation d’une matrice identifiable, qui atteint ici son point d’acmé et osons le dire, de perfection, First Reformed se révèle aussi bouleversant qu’impétueux. Il établit un dialogue à bâtons rompus avec un spectateur qu’il interroge les yeux dans les yeux, sans filtre et sans états d’âme. Obsédant et inoubliable, il acta le retour sur le devant de la scène de son cinéaste, qui a depuis confirmé avec ses deux longs-métrages suivants : The Card Counter et Master Gardener. Ces trois opus forment désormais une passionnante trilogie, explorant les névroses d’une Amérique contemporaine hantée par ses démons et incapable de faire son inventaire. La copie superbe proposée par l’Atelier d’images rend justice à ce chef d’œuvre indispensable. Elle s’accompagne de suppléments de qualité. Deux bonus intéressants, enregistrés avant la sortie de The Card Counter, en compagnie de Laurent Vachaud, (critique, essayiste et scénariste). Un entretien autour du film qui passe en revue les différentes facettes de la carrière de Schrader ainsi qu’une analyse deux séquences clés, celle de la lévitation et le final. Au sujet de la première, il évoque un état de communication sensorielle avant de révéler une anecdote excitante. Le cinéaste bloquait à l’écriture et trouva la solution une réflexion formelle, lorsqu’il se demanda comment Tarkovski aurait procédé en pareille situation. Quant à la seconde, outre rappeler la dimension symbolique (le fil de fer renvoie au martyr de Saint Sébastien) et la rupture esthétique (la caméra tournoyante), il point du doigt un détail retors et interrogé la nature même des images : relèvent-elles du réel ou de l’hallucination ? Ultime document et non des moindres, la « Leçon de scénario » délivrée par Paul Schrader en janvier 2020 au Forum des images, un exercice de plus de 90 minutes absolument indispensable. L’auteur évoque sa « philosophie’ d’écriture, son rapport à la métaphore et dissèque son mode fonctionnement avec limpidité et désir de transmission. À noter que l’édition, collector et numérotée (limitée à 1500 exemplaires) contient également un livret de 28 pages constitué d’archives personnelles du réalisateur sur le film.
(1) Extrait d’une interview de Paul Schrader par Marcos Uzal publiée dans Libération le 3 janvier 2020
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).