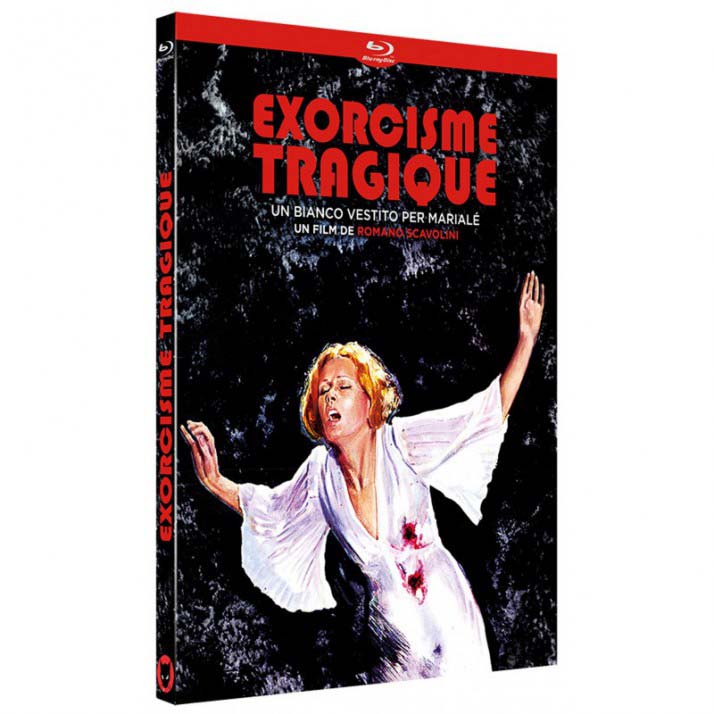A l’occasion de la sortie d’Exorcisme tragique de Romano Scavolini, re-up de ma chronique …
Il est des cinéastes condamnés à ne rester en mémoire pour un seul film au mépris du reste de leur filmographie. Aussi le nom de Romano Scavolini est-il éternellement associé à son Cauchemar à Daytona Beach, slasher particulièrement sordide surfant sur le Maniac de Lustig, loin d’être son meilleur film, même s’il distille un malaise poisseux durable. C’est donc effacer tout un pan de la carrière du cinéaste que de le réduire à Nightmare, oublier son éclectisme qui, du drame à l’épouvante en passant par le documentaire est marqué du sceau de la conscience politique révolutionnaire et de l’éclatement formel, à l’instar de certaines oeuvres de Giulio Questi. Cela saute aux yeux des ses premières œuvres A mosca cieca (1966), Ecce Homo (1967). Alzate l’architrave carpenteri (1967) ou encore La prova generale (1968), interdit pour blasphème, violence et insulte au drapeau. Aussi, lorsque Scavolini illustre le genre, il ne peut s’empêcher de lui imposer des distorsions esthétiques et idéologiques.
C’est exactement ce qui se produit avec Un bianco vestito per mariale qui s’apparente a un giallo tout ce qu’il y a de classique. Sa première séquence en respecte les codes à la lettre, introduisant l’élément traumatique dont on pressent qu’il sera la clé de l’intrigue. La petite Mariale assiste à la mort de la mère et de l’amant, abattus sous ses yeux par le père jaloux avant que celui-ci ne se suicide. Tout y est, le leitmotiv musical entêtant, le montage ultra-découpé, le symbolisme du blanc immaculé de la robe de la mère tachée de sang. Quelques années plus tard, on retrouve une Mariale devenue femme, enfermée dans son château avec un mari au regard sombre et un majordome un peu louche. Comme ses riches héritières à qui on verse du poison pour les tuer à petit feu, on oblige Mariale à prendre quotidiennement ces médicaments. Que cache cette étrange habitude ? Et pourquoi des invités ont tous été invités dans ce château alors que personne ne semble au courant ? Le décor est installé. Le mystère est instantané et l’on peut dire que Scavolini excelle à l’épaissir et à le maintenir jusqu’au bout.
Un bianco vestito per mariale respecte moins les conventions qu’il en a l’air, son film déployant un jeu de reflets pour un monde de faux semblants. Avec ses personnages en huit-clôt et son tueur qui rode, Mariale tient d’ailleurs plus du slasher que du giallo. Scavolini se joue un peu des genres comme en témoigne une fin qui hésite entre la révélation et le mélodrame. C’est un peu Les dix petits nègres glissant vers la tragédie grecque. Empruntant cette même voie du mélodrame et de la résolution aux résonances psychanalytiques, il est fort probable que De Palma s’en soit souvenu pour la fin de son magnifique Obsession, qui reprend à l’identique cette idée du reflux traumatique et de la voix de la petite fille émergeant du corps de la femme pour s’écrier « papa », de façon aussi troublante.
Si le giallo est par excellence le genre de l’inquiétante étrangeté Scavolini installe d’emblée un climat purement fantastique. Fidèle à ce fétichisme baroque, cet amour des vieux objets inhérent au genre, le cinéaste tire magnifiquement parti de son cadre, ce manoir immense et décrépi tout aussi fascinant dans ses parties désaffectées, ses pièces désertes que son décorum, ses accessoires : statue recouverte d’un drap, visages d’angelots que la caméra effleure, ou mannequins empoussiérés au grenier. De fait Un bianco vestito per mariale ressemble à une errance infinie qui voit déambuler ses personnages, monter et descendre, s’évanouir littéralement dans les pièces.
Le jardin en friche où le temps semble être arrêté dans le passé, où pousse une végétation triste et indomptée, en rappelle quelques autres comme celui d’une Vierge chez les morts-vivants de Franco ou de Lisa et Le diable de Bava. Parfois Scavolini puise son inspiration dans la nature morte, comme cette table emplie de mets et de carcasses. Son goût pour l’insolite et le déliquescent éclate dès l’après générique lorsqu’au milieu d’une pièce peuplée d’animaux exotiques, un singe dans sa cage dévore un oiseau devant les yeux du majordome contemplant le spectacle. Joli prélude au futur enfermement des protagonistes et à la sauvagerie animale qui s’emparera d’eux.
Scavolini a le don pour aspirer le quotidien et le teinter d’absurde en le décalant dans l’imaginaire. Dès qu’ils pénètrent dans ce jardin sauvage, la grille se referme sur une autre dimension dans laquelle chacun se dévoilera tel qu’il est. Dans Un bianco vestito per mariale règne un condensé de refoulé pour lequel on devine rapidement que charmant séjour deviendra le libérateur. Le chaos guette. Ses élans anarchistes transparaissent dans la composition de ses personnages, nouveaux riches décadents représentants d’une élite sociale à défaut d’intellectuelle. Il s’amuse avec ses caractères et leur typologie, sans s’embarrasser de subtilité dans leur exposition. La névrotique épouvantée, le petit playboy banal, l’homme d’affaires aux allures de producteur véreux… Le cadre se fait le catalyseur de la réalité de chacun, et lorsqu’ils trouvent des déguisements aux greniers, les maquillages et les travestissements font tomber le masque social. L’époux dominateur et raciste converti en ballerine inverse alors les rapports de genres en exhibant l’homosexualité qu’il rentrait, tandis que sa femme danse presque nue affublée d’une corne de rhinocéros, godemichet sauvage accroché à la ceinture. Le miroir des convenances brisés, la nature humaine retourne à son aspect primitif. A ce titre l’échange de réplique des deux connaissances est symptomatique de l’ironie politique du cinéaste. « Bonjour poète » lance l’un avec un sourire méprisant. « Bonjour prêteur » réplique l’autre.
Parmi tous ses invités, seul le poète garde jusqu’au bout toute sa dignité.
Une fête morbide et costumée commence, un festin digne de La Barrique d’amontillado. Il est drôle que l’un des horribles titres français « Les monstres se mettent à table » soit finalement assez fidèle aux caractères décrits et à l’ironie du cinéaste. Comme le constatent les personnages, leur aventure ressemble à une mascarade et fait d’eux les participants d’un carnaval à la Ensor. Le spectacle de ces pantins, de ces humains risibles et pathétiques pris dans une spirale pulsionnelle fusionne la frayeur et le grotesque. Et la fête de sombrer dans une ambiance folle, déréglée, orgiaque. Scavolini n’oublie d’ailleurs pas les archétypes érotiques du cinéma d’exploitation, mais les hystérise ou les détourne: la classique scène saphique devient étrangement attendrissante, comme un moment de consolation des amies dans les bras l’une de l’autre, nues certes.
Le monde est bel et bien un théâtre et les personnages les tristes acteurs d’une pièce dont il ne maitrise pas les actes, et dont le metteur en scène ne leur apparaît qu’au moment de leur mort. La caméra subjective épousant le point de vue du tueur – autre convention du genre – se fait le miroir de leur ultime épouvante.
Au fil de l’évolution de ses héros dans les couloirs aux peintures écaillées ou de leur égarement dans son jardin, le rêve envahit l’écran et c’est avec un malin plaisir que le cinéaste métamorphose le réel en univers de fantasme et d’hallucination dans lequel on a plus prise. Si la très belle musique est de Fiorenzo Carpi difficile de ne pas entendre régulièrement la patte de Bruno Nicolai, avec sa basse tantôt lugubre, tantôt métallique qui participe pleinement de la matière anxiogène et de la chorégraphie de ces marionnettes avalées dans le décor. Niveau distribution, les acteurs s’offrant au gouffre de l’ambiguïté, semant le doute de bout en bout quant à leur vrai visage. C’est d’autant plus jubilatoire lorsque connaissant les rôles auxquels ils sont habitués on se prend au jeu des hypothèses. On se perd dans le regard bleuté de d’Ida Galli (Evelyn Stewart) énigmatique à souhait, aussi fascinante que dans le jardin des délices ou Una farfalla con le ali insanguinate. Ivan Rassimov, si habitué au rôles troubles ou de monstres pervers ( Toutes les couleurs du vice, l’Etrange vice de Mrs Wardth) y paraît trop gentil pour ne pas être inquiétant. Assez loin de son rôle dans la Baie Sanglante, le parfait Luigi Pistilli qui retrouve Rassimov après le formidable film de Martino Ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé la même année, y incarne quant à lui cet ombrageux châtelain dont on se dit qu’il dissimule bien des secrets.
Un bianco vestito per mariale ne serait rien sans la beauté de son rythme somnambule, ce sentiment de flottement (brumeux, vaporeux) et sa photo souvent bleutée signée Scavolini lui-même, dominée par les lueurs de nuits tombantes. Le grand angle vient déformer les expressions pour en faire des figures grimaçantes, et épouser leur sensation de perte de repères, aspirés par la sensation du cauchemar, que la perception se désagrège en brouillard. Les personnages descendent un escalier avec à la main un chandelier, leurs ombres chinoises se détachant sur le mur. S’y révèle un vrai plaisir de l’allusion picturale, entre gothique des soirs d’orages et expressionnisme.
La beauté précieuse de Un bianco vestito per mariale est celle des frontières, de la propension à feindre l’appartenance au genre pour mieux s’en échapper, le décliner et divaguer. Entre ses saillies poétiques, sa propension à la satire et son respect pour les codes, Romano Scavolini enfante d’un objet filmique unique, une rêverie surréaliste au clair de lune.
Le superbe master proposé par Le Chat qui fume est le même que le Camera Obscura. Jamais nous n’aurions imaginé redécouvrir Un bianco vestito per mariale dans de telles conditions. Les couleurs sont chatoyantes, mettant parfaitement en valeur toute la subtilité des couleurs voulues par Scavolini, de son bleu clair à son rouge vif. Belle piste sonore italienne sous-titrée français.
Là où l’édition française se distingue particulièrement de la précédente, c’est dans ses suppléments.
Tout d’abord, l’interview de 52 minutes d’Ida Galli, magnifique, dépasse tout ce qu’on pourrait attendre des entretiens avec les actrices de l’époque, souvent intéressants mais parfois trop anecdotiques, et répondant essentiellement à notre pulsion nostalgique, ce plaisir de voir « ce qu’elles sont devenues ». On leur demande parfois de s’exprimer lors qu’elles n’ont peut-être pas forcément grand chose à dire. Ici, bien au contraire, Ida Galli est bouleversante lorsqu’elle raconte sa carrière avec une modestie confondante, une spontanéité qui émeut. Elle évoque sa rencontre avec le 7e Art, la manière dont elle préféra toujours la vie au cinéma, sa rencontre avec Fellini, Visconti, Bava, Fulci, Lenzi. Nous voyageons avec elles dans ses souvenirs, lorsqu’elle se remémore la jeune femme qu’elle fut, conviée presque par hasard à pénétrer dans le monde du cinéma, et à qui presque aucun des cinéastes ne réclamait d’audition avant de la faire tourner. Comme il est beau de l’entendre dire que « le cinéma l’aima plus qu’elle ne l’aima », et qu’il vint la soutenir dans des périodes difficiles de sa vie. Elle rappelle sa collaboration avec Agosti pour Le Jardin des délices qu’elle considère comme l’un de ses plus beaux films (on est d’accord). Jamais elle ne montre la moindre ironie, ni le moindre mépris vis-à-vis du genre, évoquant tout autant son admiration pour Visconti que son plaisir à tourner avec Fulci. Des regrets également, et l’arrêt de sa carrière d’actrice au moment où tout une période du cinéma s’éteignait… Un moment fort, rare, superbe, qui mériterait à lui seul l’achat de cette édition.
L’entretien avec Jean-François Rauger constitue un parfait complément de l’interview de l’actrice, en particulier lorsqu’il analyse un cinéma italien qui ne créait pas de fossé entre genre populaire et cinéma plus élitiste, rappelant à cet effet que ce fut Mario Serandrei le monteur de Mario Bava sur Le masque du démon qui proposa à Visconti pour désigner son cinéma le terme de « néo-réalisme ». Cette porosité entre les styles de cinéma constitue selon lui le génie même du cinéma italien, avant que l’ère Berlusconi ne vienne le détruire. Concernant le film en lui même qu’il intègre à un sous-genre « 10 petits nègres » du giallo, il le définit comme une forme de prototype parfait du genre qui entremêle trivial et sublime, beauté et décadence, qui rend trivial l’aristocratie et sublime le trivial. Comme d’habitude avec Rauger, en quelques mots il parvient à définir l’essence même de ce qui fait cette singularité précieuse d’un genre et d’une période, ce qui le rend définitivement majeur et indispensable.
Je n’aurai pas la prétention de m’étendre sur le bonus audio d’Olivier Rossignot puisque c’est moi, mais je me suis intéressé à la dimension idéologique de Scavolini et j’ai tenté d’exprimer en quoi « Exorcisme tragique » est une oeuvre particulièrement belle et étrange tout en se rattachant à une tradition du genre. Espérons que j’y sois parvenu.
Le Chat qui fume propose régulièrement, comme un clin d’oeil, la version VHS du film, et c’est également le cas ici. Si l’on excepte quelques bandes annonces des futures sortie de l’éditeur, les autres bonus étaient déjà présents sur l’édition allemande.
L’entretien avec Romano Scavolini est d’autant plus intéressant que le cinéaste porte un point de vue extrêmement précis et critique sur son oeuvre. Il ne fait pas partie de ces cinéastes au culte tardif à la Lenzi se prenant au jeu de la reconnaissance de leur génie mais définit son oeuvre – y compris ses films de genre – comme « ésotérique et cryptée ». Ancien docker, il rappelle son entrée dans le cinéma, et le fait qu’il n’aie jamais désiré être cinéaste. Tout le portait pour vers le cinéma expérimental et politique comme en témoigne ce qu’il appelle sa première trilogie composée de A mosca cieca (1966), Entonce (1967) et La prova generale (1968) qu’il considère comme étant l’essence de son cinéma, un cinéma lié à une histoire de rébellion individuelle sur un point de vue révolutionnaire. Il évoque pour La prova generale un langage cinématographique fragmentaire, comme une archéologie de moments trouvés. Sa prédilection pour un style plus documentaire s’illustre dans ses dernières oeuvres dont L’apocalisse delle scimmie, une trilogie entamée en 2012 qu’il essaie toujours d’achever. Concernant Un bianco vestito per mariale il raconte comment après l’échec de Amore e morte nel giardino degli dei (1972) réalisé par son frère Sauro et dont il assura la direction photo, on lui proposa un film qui lui permettrait de régler ses dettes. Le script d’origine était horrible – avec son gore et ses chambres des tortures ; Romano Scavolini, le réécrivit, y mit sa patte, en changea totalement la nature. Il se souvient avoir dit un jour qu’il aurait voulu rayer le film de sa filmographie, mais le résultat lui paraît maintenant créatif autant dans sa recherche formelle (il explique tout son travail sur la couleur, les éclairages, les expositions spécifiques à la pellicule choisie) que sa symbolique psychanalytique.
En plus des bandes-annonces, parmi les quelques scènes supplémentaires sans bande son, la plus impressionnante reste la séquence intégrale du singe dévorant l’oiseau et de ces autres animaux exotiques dont la symbolique et le parallélisme très forts renvoient directement au regard d’entomologiste de Bava dans La Baie Sanglante. Deux cinéastes qui utilisent le genre pour offrir un regard tranchant sur l’espèce humaine.
Romano Scavolini – « Un bianco vestito per mariale » (Italie, 1972) de Romano Scavolini avec Ida Galli, Luigi Pistilli, Ivan Rassimov, Combo Blu-Ray / DVD édité par Le Chat qui fume
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).