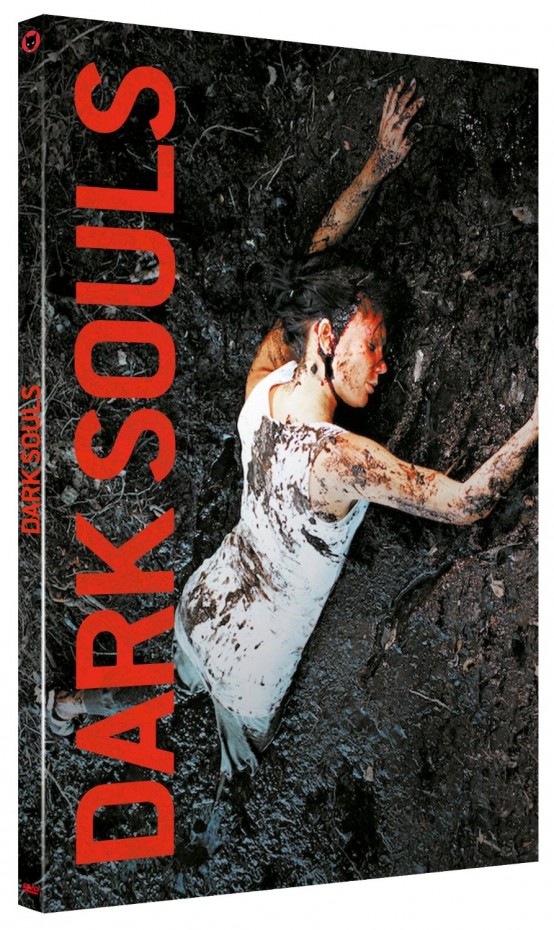 Dark Souls (France/Norvège, 2010) de César Ducasse et Mathieu Peteul avec Morten Rudå, Kyrre Haugen Sydness, Ida Elise Broch. DVD édité par Le Chat qui fume.
Dark Souls (France/Norvège, 2010) de César Ducasse et Mathieu Peteul avec Morten Rudå, Kyrre Haugen Sydness, Ida Elise Broch. DVD édité par Le Chat qui fume.
Norvège, un matin calme, une jeune femme se fait agresser en pleine nature par un inconnu au visage dissimulé, qui lui perce le crâne à la perceuse. C’est bien son cadavre qui est ramené à la morgue. Comment expliquer alors qu’elle vienne faire irruption chez son père, Morten, le visage hagard, avant de laisser écouler de sa bouche un curieux liquide noirâtre ? Alors que d’autres jeunes femmes subissant les mêmes agressions présentent les mêmes symptômes, face à la police décontenancée, Morten commence son enquête.
Soyons francs, Dark Souls a beau ne pas être franchement raté, il n’est pas non plus une réussite flagrante, la faute à son humour parfois involontaire, sa maladresse déconcertante et sa fâcheuse tendance à se perdre pour aller nulle part. Son amateurisme saute d’abord aux yeux : curieux sens de l’action et du rythme, gaucherie dans sa gestion du suspense et de la tension, acteurs sensés terrifiés mais qui prête souvent à rire… Avec son psychopathe dans son uniforme orange et son masque anti-pollution agressant de charmantes jeunes femmes à coup de perceuse le pas mal assuré on craint que Dark Souls ne vienne ressusciter le cinéma de Norbert Moutier. Bienheureusement, la suite vient nous détromper, Dark Souls installant progressivement son petit charme par sa modestie même, cet éloge du système D, du film artisanal fait avec rien du tout. Les auteurs confessent dans les suppléments avec candeur qu’ils écrivaient le scénario au fur et à mesure du tournage, et que ce n’est que progressivement qu’ils se convainquirent qu’il y aurait peut-être moyen d’en faire un long métrage.
Le décor insuffle à Dark Souls son climat d’étrangeté glaçante ; une bonne part de la fascination qu’il exerce tient à ces horizons brumeux : une ville norvégienne industrialisée et déprimante, avec ses fumées d’usine, qui rappelle parfois le Danemark de Vinterberg et des personnages aux visages tout aussi perdus qui déteignent avec originalité des stéréotypes habituels du cinéma de genre. La détérioration tragique de son héroïne plus morte que vive, crachant sa substance comme de la bile et semblant se vider de son corps a quelque chose d’étrangement émouvant, dérangeant. On songe alors à ce qu’avait fait Andrew Parkinson avec son superbe I Zombie, journal filmé d’un jeune homme contaminé et confronté à la dégradation de son corps. César Ducasse et Mathieu Perel en profitent pour y glisser un petit message écolo qui a moins pour effet d’apporter une allusion contemporaine que de rappeler d’anciennes amours (cf Let sleeping Corpses Lie) à l’époque où le cinéma d’horreur tendait au spectateur le reflet des peurs sociétales, de la pollution à la guerre bactériologique.
Enfin, quand le scénario prend un tour totalement abracadabrant dans sa dernière partie c’est non sans une certaine jubilation qu’on se croit revenu au temps des Chapeau Melon et bottes de cuir, version noir et blanc, les zombhydrocarbures de Perel-Ducasse ravivant le lointain souvenir d’autres cybernautes. Malgré ses nombreux défauts, l’atmosphère et la spontanéité de la démarche finissent par l’emporter. L’invasion peut commencer… (O.R)
__________________________________________________________________
Quand Le Chat qui fume édite un dvd il le peaufine toujours. Réalisé en 2010 et resté inédit jusqu’à ce jour, Dark Souls ne fait pas exception à la règle avec son lot de scènes supplémentaires, son interview attendrissante et sans fard des réalisateurs, des courts métrages, son making of ainsi que le début alternatif et un film 8mm totalement énigmatique.
Palo Alto (USA, 2013) de Gia Coppola, avec Emma Roberts, James Franco, Jack Kilmer et Nat Wolff, Blu Ray et DVD édités par Pathé
Premier film de Gia Coppola, nièce de Sofia et petit fille de Francis, Palo Alto, s’attache aux pas de quelques lycéens, April, Fred, Teddy, au travers de leurs états d’âmes et de leurs expériences souvent difficiles. Honnêtement, l’idée d’un film de plus sur l’adolescence réalisé par une autre Coppola incitait à la méfiance, fleurant bon le parrainage opportuniste. De fait, il est difficile de faire abstraction des références familiales dès les premières images qui ramènent l’ambiance ouatée et mélancolique à la Virgin Suicides mais également le pessimisme générationnel de Bling Ring, sans la radicalité esthétique, la distance, l’inconfortable neutralité de celle-ci. Si Gia cite également Rusty James, Palo Alto n’a ni la fureur, ni le formalisme. Il échappe pourtant à la sensation de mimétisme et de déjà vu grâce à l’approche très spontanée et délicate de Gia Coppola, focalisée sur ses personnages et leur destin. Contrairement à son père retranscrivant le regard de Susan.E.Hinton sur une jeunesse désespérée, c’est à l’écriture d’un homme que Gia Coppola va s’intéresser, en adaptant les nouvelles fortement teintées d’autobiographie de James Franco, qui connaît Gia depuis longtemps. Attiré par l’oeuvre photographique de la jeune fille – un univers entre un réalisme à la Nan Goldin et une fantasmagorie un peu Disney – il voulait que ce soit elle qui prenne le projet à bras le corps.
Palo Alto baigne dans un climat de contemplation sensorielle et attendrie. Avec un vrai sens de l’ellipse, Gia Coppola ne s’appesantit jamais, privilégie pudeur et légèreté feinte – celle qui dissimule les tourments les plus enfouis. Les minutes se diluent, glissent à la manière des skateboards du « Paranoïd Park » de Gus Van Sant. Elles s’étirent dans une temporalité du vide, vacante, temporalité de la mue, de la définition de soi. Le filtre réconfortant des tons pastels épouse, la mélancolie de l’indécision devant l’inconnu, comme une métamorphose réparatrice pour la cinéaste, qui de son propre aveu garde un souvenir désagréables du lycée. Car si le traitement est feutré, si Gia prend soin de ses protagonistes, en tournant ces scènes à hauteur d’ados, c’est pour mieux évoquer la douleur profonde et rentrée d’un âge qui nous jette sans filet dans les premières tentatives amoureuses et vers les premiers échecs.
Sous le vernis des apparences de ces gueules d’anges d’une classe sociale privilégiée éclate la radicalité des expériences, des fêtes trop alcoolisées à la conduite suicidaire, en passant par la tournante évoquée par son responsable, entre la fierté virile et le péché dont on veut se décharger. Palo Alto fait le portrait d’une jeunesse désorientée où les adultes n’ont pas le beau rôle, brillant par leur irresponsabilité, leur absence ou leur infantilisme. La figure parentale n’est pas épargnée : April est mal accompagnée, entre un père alcoolo qui joue aux écrivains maudits et une mère (Jacqui Getty, mère de Gia) rompue à la chirurgie esthétique qui cache son absence dans une complicité artificielle avec sa fille. Et que dire de ce prof de gym (Incarné par James Franco lui-même) incapable de résister à l’attirance de ses jeunes élèves, et leur avouant sa flamme comme un amant éploré ?
Palo Alto présente – une figure récurrente dans nombre de teen-movies qui illustre cette cette vérité d’un âge qui doit faire le deuil des modèles et faire l’apprentissage de sa solitude. Si les jeunes acteurs sont parfaits, Emma Robert et Jack Kilmer (autre fils de…) en tête, les personnages ne subissent pas un traitement égal. Sans doute parce que Gia Coppola se retrouve beaucoup plus dans son personnage féminin, April, la peinture des doutes et de l’évolution de sa sensibilité amoureuse frappe par son authenticité. En revanche les crises traversées par le duo masculin paraissent plus archétypiques et binaires : rédemption pour l’un, autodestruction pour l’autre.
Ces maladresses se creusent dans une fin un peu décevante dans laquelle le doute s’évanouit avec le jour. Faussement ouvert, la conclusion déteint avec le pessimisme de l’ensemble. L’issue des destins faute d’être vraiment scellée n’en est pas moins prévisible et un brin moralisatrice dans les horizons qui se profilent. Voilà pourquoi ce joli Palo Alto manque de ce petit quelque chose qui pourrait faire de lui un grand film sur l’adolescence. On peut espérer que la chrysalide, avec un peu de chair et de maturité devienne un beau papillon. Patience. (A.D)
__________________________________________________________________
Réalisé par Jacqui Getty elle-même, le « behind the scenes » de Palo Alto prend la forme d’un making-off intime montrant à quel point le cinéma est chez les Coppola définitivement une histoire de famille. Dans ce cocon protecteur gravitent amis et parents proche,s entre le fils de Val Kilmer, un James Franco très présent sur le plateau et une mère nounou/ange gardien qui assure l’intendance et la conception de cet intéressant journal intime, laissant un sentiment partagé : parfois émouvant, parfois agaçant dans cette sensation de cercle fermé auto-congratulateur. Le climat naturellement spontané de Palo Alto, paraît alors découler directement de ce climat de confiance du tournage.
M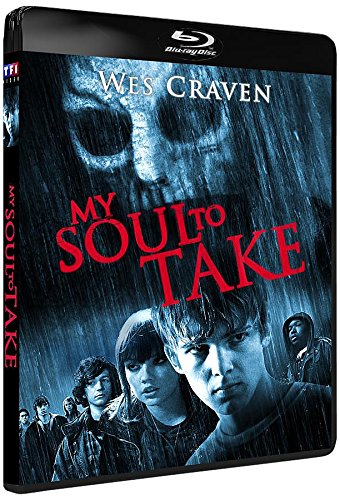 y soul to take (USA, 2010) de Wes Craven, avec Max Thieriot, John Magaro, Emily Meade, Denzel Whitaker – Blu Ray et dvd édités par TF1 Vidéo.
y soul to take (USA, 2010) de Wes Craven, avec Max Thieriot, John Magaro, Emily Meade, Denzel Whitaker – Blu Ray et dvd édités par TF1 Vidéo.
Lapidé par la critique et boudé par le public, My Soul to take rejoint le rang des oeuvres incomprises. Il faut dire que nous avions nous aussi un peu enterré le Wes Craven post-Scream, celui ci ayant laissé filer sa carrière sur les chemins de l’opportunisme et de la roublardise, oubliant le formidable modeste artisan qu’il avait été avant de rentrer à Hollywood. Le second degré et le jump-scare ont tué la peur au cinéma et indubitablement Craven et Williamson y sont pour quelque chose. Voir Craven jouer sur tous les tableaux avait fini par le rendre peu sympathique, courtisant d’un côté la vanité cinéphile à coup de références et de mise en abyme et de l’autre, la candeur d’un public juvénile ignorant des classiques, croyant que ce spectacle qui lui était dédié était novateur…. Un jeu de dupes en somme, qui n’allait pas également sans un certain mépris pour sa jeunesse nourrie au pop-corn. La surprise est d’autant plus de taille avec My Soul to take, que tout laissait présager un n-ième slasher, tentative pour un Craven en perte de vitesse de renouer avec le succès, comme en témoigne son argument très simple.
16 ans ce sont écoulés depuis cette nuit de terreur où le psychopathe schizophrène Abel Plenkov fut abattu par la police après avoir assassiné sa femme enceinte On ne retrouva jamais son corps. La légende dit qu’en cette date d’anniversaire qu’à leur seizième anniversaire les sept adolescents nés le même jour périront des mains. Ce jour est arrivé. Adam, que tous appellent Bug, jeune homme bizarre et tourmenté, est l’un d’entre eux.
Première surprise, My Soul to Take est une œuvre dont Craven peut intégralement revendiquer la paternité, puisqu’il en assure l’écriture. Il exploite les fantasmes d’une adolescence qui joue avec ses peurs pour enfouir et exorciser des phobies plus profondes. Les frayeurs au coin du feu, outil de communication pour rallier la tribu déguisent à peine un mal de vivre que le cinéaste enfouit habilement sous les archétypes. Le conte d’épouvante, l’attirance de l’imaginaire se mue ici en trauma persistant. Dans My Soul to take, la mort relie – comme un acte originel – les adolescents entre eux. Elle sert d’étendard symbolique à leur naissance. Elle crée et soude le groupe.
Au lieu de livrer des jeunes-types en pâture à un meurtrier, avec quelques jokes à la clé, Craven choisit des héros tous plus fissurés les uns que les autres. Hanté par la schizophrénie My Soul to take se révèle être le film le plus noir du cinéaste. De fait la déception pour l’amateur du genre est évidente. Craven n’entend pas mener un slasher parmi d’autres, intimant à My soul to take un rythme curieusement distant, peu trépidant, étrange et flottant. Il comporte des moments à la beauté déconcertante, comme cette séquence où les deux amis face à face se muent en miroir de l’autre. L’identité du tueur n’intéresse pas Craven : qu’ils soient victimes ou meurtriers, ils inspirent à Craven la même compassion, comme capables de passer à l’acte contre l’autre ou contre eux-mêmes.
Si le scénario n’échappe pas à la certaine confusion, c’est surtout qu’il épouse l’esprit torturé d’Adam qui « feint d’être un héros » et « feint d’être bon » et dont on ne distingue jamais la vraie nature. Même Même le happy end semble ici dénué d’espoir.
Outre les références bibliques (le criminel originel qui s’appelle Abel, le héros Adam) et les prières à un Dieu protecteur, toute la dimension morbide de My Soul to take, auquel se réfère d’ailleurs le titre, éclate dans le leit motiv du condor, résurgence des mythes amérindiens, cet oiseau gardien des âmes auquel s’identifie Bug. « Je suis le condor. Le Gardien des âmes. Je mange mort pour le petit déjeuner. Je vis dans une maison de sang et je l’accepte » Ce retour du totem apporte une poésie insoupçonnée au scénario, nourrissant sa dimension fantastique et brumeuse, et renvoie directement au magnifique L’Emprise des ténèbres dans lequel Craven à travers le vaudou haïtien exploitait tout sa rapport au gouffre de l’inconscient.
My Soul to take est quasiment dénué d’humour. Le rire ne sert plus d’échappatoire à la peur. Désormais, Craven ne se moque plus, posant à nouveau un regard attendri et mélancolique sur ses adolescents. My Soul to take parle donc d’une malédiction, le genre de tare qui se transmet de génération en génération, d’anxiété sociale laissée par les parents à leurs ados. Cette cellule familiale dissimulant son parfum corrompu, ses névroses et sa démission parentale sous les traits de l’Amérique idéale, a toujours été au centre du meilleur de l’œuvre de Craven. Qu’on se souvienne des ados d’Elm Street expiant les fautes de leurs géniteurs, et voyant revenir sous la forme de Freddy, le plus méchant des croquemitaines, l’assassin d’enfants éliminé par les adultes qui voulaient se faire justice eux-mêmes. Toute la dimension politique de Craven est une nouvelle fois là, vision d’une société contaminée par un Mal qui circule et substance fuyant des parents vers leurs enfants. Régulièrement en observant le regard désenchanté des futures victimes, on se surprend à penser que la mort est peut-être ce qui peut leur arriver de mieux. Si Craven privilégie l’ellipse, les meurtres n’ont pas le graphisme et l’inventivité espérée, ils s’attachent surtout à la tristesse de leurs expressions avant de s’éteindre. En employant une nouvelle fois le genre comme métaphore, avec ce film intime et dépressif, son meilleur depuis People under the stairs, Craven évoque rien de moins qu’une humanité condamnée à donner naissance à de nouvelles générations sous anxiolytiques. Une vraie malédiction. (O.R)
__________________________________________________________________
On ne conseillera pas vraiment la version relief, sans grand intérêt de My Soul to take, converti en post production pour profiter de la vague des films en 3D. Rien à dire sur la qualité d’image. Les scènes supplémentaires proposées n’ont pour une fois rien d’anecdotiques et creusent un peu plus le sillon dépressif et tourmenté du film, accentuant la tristesse et la hantise de ses protagonistes. On comprend en revanche que deux séquences aient été évacuées du montage final, la présence de la voix du tueur sur le téléphone renvoyant trop directement à Scream. Pour compléter les bonus, les traditionnels making off et interviews, ainsi que les commentaires audio de Wes Craven et des acteurs. Une belle édition qui, on l’espère, redonnera sa chance à My Soul to Take.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).







