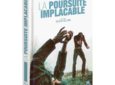Si l’histoire du cinéma a retenu Sergio Leone comme le maître d’œuvre de ce que l’on a appelé (avec beaucoup de mépris) le « western spaghetti », deux autres Sergio, plus discrets, ont contribué à la grandeur et à la diversité du genre. D’un côté Corbucci, qui occupe une place importante dans le cœur des cinéphiles grâce au nihiliste Le Grand Silence (1968), et bien évidemment, au culte Django (1966) avec son héros mutique et supplicié. De l’autre, Sergio Solima, spécialiste du cinéma d’espionnage durant les années 60 avec les aventures de l’Agente 3S3 (contrefaçon italienne de James Bond), qui apporta une importante pierre à l’édifice en tournant une trilogie de westerns politiques et engagés à la fin de la décennie. Elle se compose de Colorado en 1966 (également édité par Wild Side), du Dernier Face à Face en 1967 (sorti en France sous le titre d’Il Était Une Fois en Arizona) et enfin, de Saludos Hombre (1968), dans lequel Tomás Milián reprend son personnage de Cuchillo, qu’il interprétait dans Colorado, face à Lee Van Cleef. Faccia a Faccia (dans la langue de Dante), deuxième volet de ce triptyque, est donc enfin disponible dans sa version director’s cut, jusqu’alors inédite dans l’hexagone, accompagné d’un livre de 80 pages signé Alain Petit, riche en anecdotes et en secrets de tournage. Le film suit le parcours de Brad Fletcher (impressionnant Gian Maria Volontè), professeur introverti de Boston, qui, suite à de graves problèmes de santé, est obligé de s’exiler au Texas où il est pris en otage par Solomon « Beauregard » Bennet (interprété par Milián), un bandit charismatique et recherché. Les deux hommes vont se lier d’amitié et Fletcher va peu à peu prendre goût à la vie de hors-la-loi…

© Wild Side
Pour son précédent film, Colorado, Sollima s’était initialement emparé d’une histoire originale de Franco Solinas narrant la traque d’un contrebandier par un carabinier dans l’Italie contemporaine. Le western transalpin ayant le vent en poupe, il adapta le script afin de le situer dans l’Ouest sauvage. Fort de cette expérience, il va, à travers ce Dernier Face à Face, reprendre tous les codes du genre (duel au beau milieu d’une rue déserte, chasseur de primes impitoyable, le tout, accompagné de la composition de l’inévitable Ennio Morricone) afin de les amener sur le terrain de la pure charge politique et de la satire sociale. Fidèle à la maxime de John Ford selon laquelle « le personnage le plus important d’un western, c’est le paysage », il utilise le format scope et cadre la plupart du temps en plans larges, ses personnages comme perdus au milieu de décors de nature hostile, écrasés sous un soleil de plomb. En nommant les membres du gang de Beauregard par des patronymes antiques ou bibliques (Aaron, Zacharie, Jason…) et en donnant un souffle épique à certaines séquences (à l’image de cette chevauchée d’une cinquantaine de cavaliers au milieu de dunes de sable), le réalisateur embrasse la dimension mythologique de son récit. Ici, le concept romantique de « frontière » comme source de tous les possibles, cher au western classique, n’est plus qu’une utopie qui a fait son temps, un lointain souvenir, que le réalisateur met en scène à travers le village multiculturel de Pierres de Feu, composé d’anciens pionniers (le personnage de Rusty, véritable légende vivante) et de rebuts de la civilisation galopante (bandits, Indiens, vieillards, prostituées…) ayant trouvé un havre de paix loin du nouvel idéal américain, vivant ainsi en autarcie, à l’écart de toute loi. Le montage nerveux fait s’enchaîner rapidement les séquences, passant ainsi d’un décor à un autre, d’une situation à une autre, créant un sentiment de chaos ou aboutissant parfois à un décalage comique, comme lors de cette scène où la traque d’un malfrat, dont la tête a été mise à prix, est réglée en deux plans très courts. Contrairement aux films de Sergio Leone, les scènes de violence, bien que marquantes, sont ici assez rares (peu de coups de feu tirés) et le cinéaste préfère se concentrer sur d’excellents dialogues, servant le propos d’une manière souvent ironique (à l’image de Brad déclarant d’un air totalement détaché :« dans ce pays, il est très difficile de distinguer l’instinct de survie de l’abus de pouvoir » au sujet de la chasse au lapin à laquelle Beauregard tente de l’initier).

© Wild Side
Si la violence ne possède pas une dimension cathartique ou vengeresse (comme dans Il Était une Fois dans l’Ouest, par exemple), elle est pourtant omniprésente et inévitable, comme inhérente à l’être humain. Elle est même inaugurale, le film s’ouvrant sur un écran noir accompagné d’un bruit de coup de feu. Le générique qui suit, pop et coloré (probable référence à celui du Bon la Brute et le Truand), ne masque pas pour autant la brutalité qui couve déjà. La société n’est qu’un trompe-l’œil qui camoufle, en vain, les pulsions brutales et primaires de l’Homme. À cet égard, la ville de Purgatory, où se déroule une partie du long-métrage, est une métaphore de l’Amérique, dissimulant la violence de sa création, de sa genèse (la guerre de Sécession, la bataille de Gettysburg et le massacre des Indiens sont d’ailleurs évoqués à de nombreuses reprises) derrière les atours de la civilisation. Lors d’un plan ironique, le cinéaste filme le shérif de la bourgade, alors à deux doigts de basculer dans le chaos, en train de se recoiffer devant son miroir, comme pour sauver vainement les apparences plutôt que de se presser afin d’empêcher le bain de sang. Le carnage qui s’ensuit devenant un véritable divertissement pour les notables de la ville, assistant à la fusillade bien à l’abri depuis leurs balcons, jouissant du spectacle de la mort sans avoir à y participer. Pour ne pas se salir les mains, la police emploie même des criminels afin de faire ses basses œuvres, comme au sein de la Pinkerton, véritable milice privée dont les membres tentent de moraliser, ou tout du moins de légaliser, leurs exactions. Le personnage de Siringo (chasseur de primes affilié à cette agence et interprété par William Berger) est ainsi présenté derrière des barreaux, comme le mérite le meurtrier qu’il est, dialoguant avec le shérif, avant qu’un mouvement de caméra dévoile qu’il est libre d’entrer et de sortir à sa guise. La même hypocrisie est mise en avant chez le Yankee Fletcher lorsque celui-ci déclare, lors d’un dîner, s’être engagé dans l’armée afin de mettre fin à l’esclavage alors qu’autour de lui, des serviteurs Noirs remplissent son assiette. Si Sergio Leone développe dans ses films une théorie marxiste (la société capitaliste pervertissant l’âme humaine), Sollima, lui, se pose en pur anarchiste, renvoyant dos-à-dos le capitalisme et le communisme : tout type de gouvernement visant à restreindre les libertés de l’Homme, niant ses individualités, polissant son instinct. Ainsi, quand le timide professeur, prend la tête du village de Pierres de Feu, il cherche à imposer sa propre vision de la civilisation, faisant de cet îlot vivant jusqu’alors dans une sorte d’autogestion, une société stalinienne dont il est le dictateur, il fait voler en éclat ses grands principes et ses idéaux de justice. Le pouvoir, quel qu’il soit, corrompt les Hommes. Il déclare ainsi : « La violence individuelle est un crime. La violence de masse, c’est l’Histoire » comme une volonté de « barbarie civilisée » car allant dans le sens des lois qu’il impose. Brad Fletcher est la figure centrale du film, il semble dès le départ gangrené par cette haine intérieure, comme dans ce plan jouant sur les apparences où, à l’abri dans sa salle de classe, il regarde son reflet dans un vitrail de couleur rouge sang.

© Wild Side
Le personnage interprété par Gian Maria Volontè est le symbole même de la violence que peut générer la frustration. Sensé, pacifiste et humaniste, il enseigne à ses élèves les valeurs de la société américaine naissante, et semble humble, réservé voire timide avec les femmes (il n’ose pas faire le premier pas quand il croise sa collègue dont il est secrètement amoureux). Il est diminué physiquement et mentalement, méprisé par sa hiérarchie, le proviseur lui déclarant ainsi : « ce pays aime les Hommes qui se battent. Celui qui refuse de se battre, est un perdant ». Presque malgré lui, il va découvrir, au contact de son ravisseur (avec lequel il tisse une relation à l’ambiguïté sexuelle évidente), le plaisir de vivre loin de toute règle, de tout cloisonnement, faisant de lui une véritable bombe à retardement à force de refouler ses pulsions. À l’image de cette scène où il utilise une arme pour la première fois, et en éprouve du plaisir, dont l’écho se retrouve dans une séquence ultérieure où il tire face caméra, braquant de son revolver le spectateur (référence évidente au Vol du Grand Rapide, western matriciel de 1903). Devenu un héros après avoir sauvé la vie du bandit lors d’un duel (les enfants racontant même son histoire, comme une légende), il se « libère » de son carcan moral et se rétablit ainsi physiquement, comme par magie. L’homme opère sa mutation, sous le regard méfiant de Beauregard (très bon Tomás Milián, et ce malgré une perruque… originale). Si ce dernier est un hors-la-loi, anarchiste véritable n’aspirant qu’à jouir de tous les plaisirs de la vie sans entrave, le professeur, lui, s’affranchit de l’autorité afin de mieux l’exercer à son tour. En découle un renversement ironique des valeurs, le criminel égoïste devenant une figure positive, là où l’intellectuel progressiste et moralisateur revêt le costume de monstre, de réel danger. Sa tyrannie prend aussi la forme d’une vengeance envers tous ceux qui l’ont un jour humilié. Les femmes en premier lieu, comme lorsqu’il n’hésite pas à brutaliser une jeune fille qui se refuse à lui. Mais aussi les autres hommes plus puissants que lui, plus forts, qu’il va soumettre avec l’aide d’une armée personnelle composée de tortionnaires. Devenu un véritable tyran pour son « peuple », il n’en demeure pas moins faible et lâche, faisant faire le sale boulot à ses hommes de main. Lors d’une ultime séquence, Sollima revient au fondement originel du western avec ces figures se détachant sur fond de paysage désertique, décor apocalyptique et désespéré, comme si la civilisation n’existait plus (mais a-t-elle seulement existé ?). Si la société rêvée de Fletcher n’hésite pas à littéralement sacrifier ses propres enfants pour continuer à avancer, dans une fuite en avant perpétuelle (symbolisée par l’exode de cette caravane de pèlerins), le film ne s’enferme pas pour autant dans un nihilisme absolu et inéluctable. Le salut venant parfois de simples attentions, de petits gestes ou de mots, comme un banal « non » adressé à la face de celui qui vous asservit.

© Wild Side
© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).