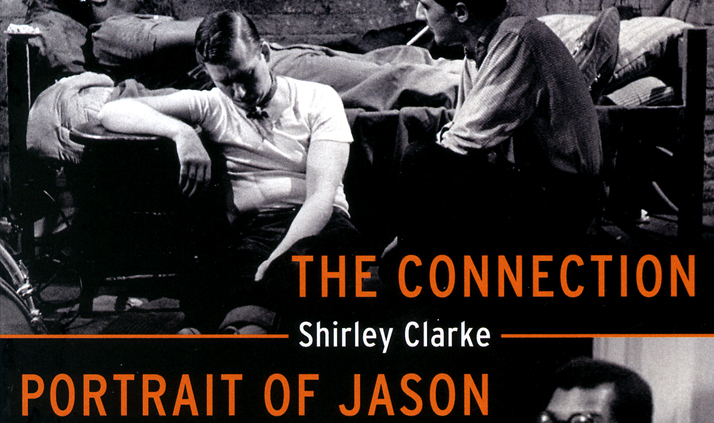Potemkine édite en DVD les premier et troisième longs métrages de la cinéaste américaine Shirley Clarke (1919-1997) avec en supplément trois courts métrages – « Bullfight » (1955), « Butterfly » (1967) et « Trans » (1978) – des films qui enjambent trois décennies d’une carrière intermittente. Fortement remarquée avec ses premiers courts et « The Connection », qui fit scandale en 1961, Clarke ne réalisera que autres longs métrages : « The Cool World » en 1964, « Portrait of Jason » en 1967, et bien plus tard en 1985, un dernier film avec « Ornette : Made in America », un documentaire sur le saxophoniste de Jazz, Ornette Coleman. Dans l’intermède, la cinéaste, faute de trouver des financements, développera le travail de la vidéo, renouant avec l’enregistrement de danses pratiqué à ses débuts, continuant ses courts métrages dans ce médium, et menant à partir de 1975, une carrière d’enseignante à l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles).
Malgré sa brièveté, Clarke a laissé une œuvre fondamentale, faisant se croiser les expérimentations artistiques d’avant-garde avec les réalités sociales – le statut des noirs et des marginaux au sein de l’Amérique des années 60 – le tout dans une forme cinématographique inédite, qui mêlait le cinéma-vérité et le faux documentaire. Oubliée des histoires du cinéma, restée longtemps invisible, son œuvre connaît aujourd’hui une réhabilitation méritée, qui a été entamée en 2012 grâce aux travaux de restauration du distributeur indépendant américain Milestone. Cette première édition française d’une partie de sa filmographie est donc un évènement, d’autant plus que le boitier de 2 DVDs contient un chef-d’œuvre indiscutable : le documentaire « Portrait of Jason ».
« The Connection » (1961) est l’adaptation d’une pièce de théâtre écrite par Jack Gelber et montée par le Living Theater en 1959. Jim Dunn, un jeune réalisateur arrogant, s’est introduit chez une poignée de toxicomanes par l’entremise de son assistant, dans l’espoir de réaliser le documentaire sensationnel qui le consacrera. En contrepartie d’une dose d’héroïne, Dunn obtient l’autorisation de filmer le petit groupe, essentiellement composé de musiciens de jazz, tous réunis dans le loft new-yorkais insalubre de l’un d’eux, Leach, qui tente de donner le change sur son propre manque en s’agaçant de celui des autres. Dans l’attente du dealer qui n’arrive jamais, tous somnolent, se montrant incapable de toute activité, même musicale, et se prêtant de mauvaise grâce aux injonctions de la caméra. Quand « Brother Cowboy », le dealer noir, survient en fin de journée, il est suivi malgré lui par une vieille dame évangéliste qu’il a abusée, se faisant passer pour un prêcheur afin d’échapper aux policiers. Dès lors, à tour de rôle, chacun s’emploie à entretenir la candeur de cette bigote sénile, transformant les allées et venues dans la salle de bains en pieuses confessions…
Le premier long métrage de Shirley Clarke est une parodie, volontairement appuyée, du cinéma-vérité en vogue dans les années 60. En arrière-plan, il y a la caricature du réalisateur, emblème du pouvoir blanc, exploiteur cynique et artiste bourgeois, adepte comme son public d’un frisson sans menace. Malicieusement, Clarke compose son casting de manière équilibrée : le quartet de musiciens noirs avec un saxophoniste blanc, versus son envers rigoureusement complémentaire, les trois junkies blancs et le larron noir avachi sur le sofa. Le summum de l’exagération est atteint lorsque la réalisatrice fait apparaître le couple improbable du dealer, prénommé « Cowboy », et revêtu intégralement de blanc, avec la vieille repentie habillée en noir, métaphore comique d’une hypocrisie devenue aveugle. Ironiquement, il n’y a qu’au bas de la société que l’équité raciale semble se réaliser, dans une marginalité certes peu glorieuse, mais fédératrice.
Clarke, qui est une ancienne danseuse, signe avec son film une sorte de tour de force chorégraphique qui donne l’illusion de la continuité et de l’expérience en temps réel par un jeu de raccords très enlevés et voyants. Plus qu’un faux documentaire qui chercherait l’hyperréalisme (regards caméra, panoramiques brusques…), comme on se plait souvent de le présenter à tort, « The Connection » est un « documenteur » avant l’heure, qui célèbre avec un humour iconoclaste et parfois ouvertement burlesque, la puissance de la mise en scène avec moult effets de distanciation, une théâtralité en huis clos, et des effets de frontalité, tous clairement affirmés. Pour autant, la réalité documentaire s’infiltre clairement dans la représentation : celle du quartet de jazz du pianiste Freedie Redd, à dominante afro-américaine, faux acteurs et véritables musiciens ; ou celle de Carl Lee, qui fût le compagnon de Shirley Clarke, et son initiateur à l’héroïne.
« Portrait Of Jason » (1967) traite sensiblement des mêmes thèmes mais sous l’angle documentaire, et dans un grand dénuement de moyens qui n’est pas étranger à la puissance émotionnelle et à la radicalité formelle du film. Clarke invite Jason Holliday, qui se présente comme un artiste de cabaret, une nuit de l’hiver 1966, dans l’appartement qu’elle occupe au Chelsea Hotel, pour qu’il se livre face à la caméra à une longue confidence autobiographique. L’homme, un noir gay, très extraverti, raconte avec truculence des épisodes de sa vie qui sont en partie démentis par l’assistance ; il s’effondre puis se ressaisit sans discontinuer de boire et de fumer ; révèle un parcours fait d’abus exercés ou subis, et une survie dans la prostitution oscillant entre le luxe et la crasse. La performance, réalisée d’une traite, relève du stand-up théâtral. On y éprouve l’usure produite par la durée, le relâchement progressif de « l’acteur » et de cette vie « mise en récit », pour ressentir finalement les mêmes ambivalences vis-à-vis du personnage que ses amis – il est tour à tour grandiose, attendrissant ou abject. Les réactions des derniers sont préservés sur la bande son : ils pestent leur agacement et interpellent Jason pour le recadrer.
Disposant d’une caméra 16mm que le caméraman doit recharger toutes les dix minutes en pellicule, Clarke décide d’enregistrer le son en continu, comblant l’image par un écran noir, avant de faire réapparaître Jason à l’écran. Le jeu sur le point et le flou, en amorce ou en fin de chaque plan-séquence, ajouté à ce découpage imposé, signifie la présence d’un opérateur derrière la caméra, d’un éditeur et d’une post-production. Il participe autant d’un effet de mise à distance, démentant l’illusion d’objectivité, prétendue par le cinéma-vérité, que d’une interrogation permanente du sujet filmé : un être complexe et insaisissable, toujours en situation de représentation. De part et d’autre de l’objectif, réalité et manipulation ne cessent de se frictionner dans un régime in-dissocié, mais sans passer comme pour « The Connection » par une construction et une écriture factices. En ce sens, le film, qui est à la fois expérimental avec sa structure apparente et documentaire, paraît bien moins « daté » que les artifices appuyés de « The Connection » ou que le théâtre underground « naturaliste » que ce premier film dépeint.
Les courts-métrages en suppléments, se rattachent davantage au cinéma expérimental et aux filmages des chorégraphies, prolongeant dans le cinéma l’ancienne activité de danseuse de Shirley Clarke.
« Bullfight », son troisième court-métrage de 1955, met en scène Anna Sokolow, la célèbre chorégraphe américaine et membre fondatrice de l’Actor’s Studio, qui exécute une danse inspirée de la tauromachie en endossant simultanément, et de plus en plus confusément, le rôle du toréador et du taureau dans une suite de mouvements hiératiques et de mimes douloureux. Le film est un collage d’images et de mise en scènes : stock-shot de corridas, plans de la chorégraphe filmée dans le public d’une arène, et projections dansées, plus abstraites et mentales, donnant peut-être une équivalence du spectacle « vécu » par Anna Sokolow.
A l’autre bout, « Trans » en 1978, une chorégraphie de Marion Scott pour une danseuse solo, renoue avec la danse filmée, mais avec l’appui de la vidéo et les effets spéciaux de David Cort – solarisation de la danseuse en négatif ; « flammes » lumineuses engendrées par les mouvements qui persistent comme des traces aériennes ou aqueuses, en avatars contemporains des chronophotographies ou des danses serpentines de Loïe Fuller.
Entre, en 1967, Shirley Clarke se met en scène avec sa fille Wendy dans « Butterfly ». Cette dernière, alors âgée d’une vingtaine d’années cosigne le court métrage. Le film se fait l’écho d’une génération qui a grandi en tenaille, prise entre l’insouciance pop et le conflit catastrophique du Vietnam. La comptine, toute en surimpressions bigarrées, est biffée de croix et de papillons anguleux grattés à même la pellicule, tandis que la bande son vire de la berceuse aux pleurs d’enfants, avec ça et là, le bruit intempestif des mitrailleuses.
La musique, présente avec le Jazz dans « The Connection » et plusieurs de ses longs métrages, mais aussi tacitement dans le rythme du montage, les changements de plans, ou simplement dans l’élocution des sujets, s’affirme dans ces courts-métrages : par le travail de la bande sonore dans « Butterfly », ou par une collaboration avec Morton Subotnick, pionnier de la musique électronique, pour « Trans ». D’une certaine manière, Shirley Clarke aura œuvré avec beaucoup de liberté et d’humour à une synthèse des arts, du cinéma, des mouvements culturels et sociaux de son époque, se réalisant indifféremment dans la fiction, le documentaire ou le cinéma expérimental, sans compromission ni orthodoxie. Elle en aura payé le prix : la marginalité, la difficulté à tourner et un quasi oubli… enfin réparé.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).