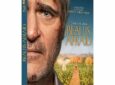Fut un temps pas si lointain, le cinéma d’horreur américain, hormis quelques exceptions notables (Rob Zombie, James Wan, Eli Roth), était bien en peine pour titiller la curiosité des cinéphiles, se résumant caricaturalement à une abondance de remakes (rarement surprenants), à un débauchage de cinéastes étrangers connaissant diverses fortunes lors de leurs exils respectifs et à une tendance peu fructueuse au found foutage, dans la foulée de Paranormal Activity. La décennie précédente, l’immense succès de Scream, outre remettre Wes Craven sur le devant de la scène, relançait le slasher tout en impulsant malgré lui une mode « méta » où la référence finissait par devenir l’essence même des films, davantage que leurs identités propres, limitant grandement l’émergence de nouveaux talents et d’œuvres importantes. On sentait depuis peu un frémissement ; établissons désormais un constat : nous vivons l’une des périodes les plus riches et stimulantes pour le cinéma d’épouvante yankee. Deux sociétés de production peuvent revendiquer un rôle déterminant dans cette bascule, Blumhouse Productions d’une part, particulièrement pour ses deux collaborations avec Jordan Peele, Get Out et Us, mais surtout une structure créée en 2012 et baptisée A24, dont l’excellent catalogue laisse sans voix. On leur doit notamment les révélations de Robert Eggers (The VVitch et son film à venir, The Lightouse), de David Robert Mitchell (It Follows et Under The Silver Lake) et enfin de Trey Edward Shults (Krisha et It Comes at Night).
L’année dernière, sans crier gare arrivait sur les écrans du monde entier Hérédité, premier long-métrage d’un cinéaste qui avait déjà plusieurs courts-métrages à son actif, Ari Aster. Il présente une relecture magistrale du film de possession sous forme de drame familial. Interprété par des acteurs en état de transe (Toni Colette y trouvait le rôle de sa vie), il est servi par une mise en scène virtuose n’hésitant pas à aller à contre-courant des styles dominants (durée des plans, des séquences refusant une efficacité bâtarde, effets réduits au minimum, partage équitable entre violence psychologique et graphique…). Avant même la sortie de cet acte fondateur, une deuxième réalisation était déjà sur les rails, laquelle allait être tournée dès juillet 2018. Un été après, voici venu le moment de nous pencher sur le tant attendu Midsommar. Dani (Florence Pugh) et Christian (Jack Reynor) sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival se déroulant dans un village suédois isolé qui n’a lieu qu’une fois tous les 90 ans. Ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante…

Copyright © 2019 Déjà Le Web
À la faveur d’un impressionnant prologue (déjà en soi un chef d’œuvre en la matière), Midsommar semble s’inscrire dans la droite lignée de son prédécesseur Hérédité. On retrouve une même approche du genre sur un mode très intime, soit un drame familial d’autant plus douloureux que mis en exergue par des sentiments rudes et violents, le deuil devenant le ressort d’une épouvante cathartique. À la tristesse s’ajoute une gestion de l’espace très polanskienne, claustration aussi captivante qu’irrespirable. Pourtant, un autre prélude plane à travers cette séquence sèche et stylisée, celui d’un pur film d’horreur bergmanien, le mal-aimé Antichrist. Ari Aster ne cache pas que l’origine de son scénario vient d’une rupture amoureuse marquante, d’une situation qu’il a lui-même expérimentée. Si ces quelques similitudes créent continuité et cohérence dans le travail du réalisateur, ce dernier affirme un désir de les tordre, d’emmener son long-métrage hors des attentes, aussi bien celles qu’il a inconsciemment nourries que celles qu’il s’est plu à sciemment façonner. La première rupture sera visuelle, la nuit laissant place au jour, l’obscurité à la lumière, plongeant les personnages et spectateurs dans un univers déconcertant, fascinant et angoissant.
À l’image de ce décor protéiforme, plusieurs tonalités coexistent en harmonie. L’omniprésence d’une dimension humoristique inattendue, loin d’apaiser ou de désamorcer des situations, les rend plus déstabilisantes car elles sont volontairement troublées. La nature même de cet humour est amorcée comme un leurre, lorsque sont évoquées les envies de partouze du groupe d’amis de Christian, nous rappelant le souvenir du premier Hostel et sa teneur potache… Grossière erreur : il s’agit pour Ari Aster de métamorphoser le clin d’œil en trompe-l’œil, en mimant le stéréotype – la caricature des copains stupides, l’arrivée en territoire exotique et hostile, etc. – pour mieux l’anéantir. Midsommar se construit sur un mode grinçant et pince-sans-rire, hérité d’un cinéma nordique plus proche de Ruben Östlund que de Keenen Ivory Wayans, contrastant tout en l’amplifiant le cauchemar mis en scène. Traitement singulier appliqué à un postulat constituant un lieu commun du cinéma d’horreur – un groupe de jeunes américains en vacances dans un pays inconnu – détourné et emmené vers la satire, dessinant en creux le portrait d’une Amérique universitaire connectée et peu estimable, où règnent individualisme exacerbé et attitudes profondément irrespectueuses.

Copyright © 2019 Déjà Le Web
Un égoïsme délibérément mis en opposition avec un collectif soudé, une communauté qui sous ses apparats simples et gentils se révélera progressivement monstrueuse. Midsommar ne cherche pas l’effroi à proprement parler. L’horreur émane autant de la nature de certaines de ses images que de la banalité palpable à travers les réactions neutres d’une majorité de personnages, au moment d’assister à des situations réellement choquantes. Le village et ses habitants sont observés de manière factuelle, ethnologique, avant qu’un glissement s’opère subrepticement. Approche à la lisière du documentaire – liée aux recherches d’Ari Aster sur le sujet – nous faisant accepter les rites presque en temps réel, tel un éventail exhaustif des traditions populaires – y compris dans l’authenticité des danses et chants folkloriques – avant que l’on prenne conscience, tel un réveil à l’intérieur d’un rêve, que le spectacle déroulé devant nos yeux est terrible…. Mais terrible pour qui ? Et où désormais placer le curseur de la normalité ? Le réalisateur se joue de la fascination du public occidental pour les contrées et mondes inconnus, nous familiarise avec un point de vue afin de mieux le mettre à mal et l’interroger par la suite, testant ainsi notre propre capacité à adapter notre œil à l’image en fonction de son traitement : sommes-nous prêts à accepter ou non l’inacceptable ? Cette façon de faire vaciller et évoluer notre regard au sein du long-métrage va de pair avec un désir d’altérer de l’intérieur du récit la perception de ses héros, allant jusqu’à faire coexister des impressions contraires au sein d’un même plan, unifiées par une mise en scène souveraine. Le rythme lent se confronte aux climax qui tutoient l’irrationnel et la transcendance, comme en témoignent ces hypnotiques séquences de danse, gigantesques chorégraphies primitives.
Ari Aster expulse le spectateur de sa zone de confort, l’égare vers la transe. Il courtise le cosmique, jusqu’à en devenir étourdissant. Au sein de cet oxymore filmique paroxystique, le sentiment de malaise domine le paysage, tandis que persiste la fascination pour sa beauté inouïe. Dans son contraste entre un soleil total et une nuit disparue annoncée dès son titre, la perte de pied du protagoniste, sa peinture d’une réalité s’évanouissant sans crier gare, où le cauchemar s’invite sans prévenir, où réalité et fantastique ne font qu’un, Midsommar est une version 2019 et diurne de L’heure du Loup, ou du moins une brillante relecture. Plus surprenant (et tout aussi audacieux), un mouvement permanent se dessinant entre l’élégiaque malickien et le funèbre. Souvent en décalage avec l’image, la bande originale (1) signée Bobby Krlic (alias The Haxan Cloak) épouse ce va-et-vient. Entre Gustav Malher et Krzysztof Penderecki, elle fait souvent office de contrepoint inquiétant au panthéisme ou de lyrique au théâtre de la cruauté. Le calme introspectif s’installe avant que nous assaillent des violons agressifs et les tourments ; les premiers arpèges à la harpe évoquent le conte de fée, avant de s’éteindre instantanément dans les ténèbres. La dualité du long-métrage, le fusionnement du méditatif et du primitif, de l’ironie dévastatrice et du tragique pur est contenue dans ces notes, complétée par un travail sonore – au sens large – dément, tour à tour immersif et répulsif, maintenant tous les sens en éveil. L’idée d’oxymore s’exprime jusque dans la multiplicité des sous-textes jalonnant l’œuvre, nous laissant dans un état de questionnement ininterrompu, en prise avec nos propres contradictions : dépourvus de repères, le doute triomphant, dans l’incapacité de choisir entre le Bien et le Mal aux contours effacés. Les valeurs chrétiennes qui bien malgré nous dominent notre éducation se sont évaporées. Le cinéma de genre s’apparente ici à un voyage métaphysique (2). A l’instar du Stanley Kubrick de Shining et d’Eyes Wide Shut, Ari Aster dissémine les détails prémonitoires, laisse les questions ouvertes comme autant de zones d’ombre, et offre des connexions thématiques évidentes, de l’éclatement de la cellule familiale à celui du couple.

Au-delà de ces considérations stylistiques et théoriques, Ari Aster propose un magnifique portrait de femme prenant parfaitement le pouls du climat actuel, tout en l’inscrivant dans une histoire intemporelle. On découvre une héroïne en deuil, fragilisée, dont on partage immédiatement peine et douleur, comme un nécessaire point d’accroche, d’entrée dans le récit. 2h20 durant, on observe à travers elle et d’un même élan, sa descente et sa renaissance, sa libération et son embrigadement, son affranchissement et son aliénation, sa lucidité et sa folie. Extraordinaire représentation de la dépression et formidable film d’horreur, Midsommar maintient son double niveau de lecture jusqu’au bout. Chaque épisode tangible compose également la manifestation symbolique de la psyché de son personnage principal. Dani se retrouve à rompre avec les normes sociétales (et chrétiennes, car le fait que son compagnon s’appelle Christian n’a rien d’une coïncidence) qui lui sont imposées dans un univers désormais tenu par d’autres codes plus flous. Sa reconstruction cathartique prend l’allure exacerbée et extrapolée (telle une flamboyante hyperbole) du mouvement #MeToo, y compris dans la violence des réactions qui en découlent et les châtiments qui peuvent être infligés.
L’explosion pulsionnelle collective devient le miroir d’une déflagration intime libératrice, sans rien ôter des doutes persistants précédemment évoqués et des inaltérables zones d’ambiguïtés. Dans le rôle de ce passionnant protagoniste, on retrouve Florence Pugh, comédienne révélée il y a deux ans dans Lady Macbeth (The Young Lady pour l’exploitation française), qui confirme par sa prestation hallucinante les espoirs placés en elle, autant que les talents de directeur d’acteurs de son metteur en scène. Le contraste entre un visage innocent, des traits purs, une allure inoffensive et les situations auxquelles elle est confrontée traduisent une fois de plus l’oxymore sur lequel le film construit son unité, quand une implication totale, un abandon littéral, hissent instantanément Dani au rang des grandes héroïnes tragiques du genre, comme le fut Rosemary ou Helen dans Candyman. Entrez dans la cérémonie : Midsommar fait bien mieux que tenir ses promesses, on en ressort extatique avec la ferme conviction d’avoir, en à peine plus d’un an, assisté a minima à la naissance d’un grand cinéaste.
_________________
(1) La b.o. a été éditée par les éditions Milan
(2) Il est d’ailleurs impossible que le choix de Björn Andrésen – qui incarna le jeune Tadzio de Mort à Venise (1971) – soit fortuit pour Ari Aster. Celui qui symbolisa la jeunesse pour Luchino Visconti, fascinant de sa suprême beauté adolescente un Dirk Bogarde vieillissant, devient l’emblème du dernier âge dans Midsommar. Ce vertigineux effet de miroir renvoie de manière troublante à la genèse du personnage créé par Thomas Mann. L’écrivain le décrivait ainsi à Visconti en 1951: « L’histoire est essentiellement une histoire de mort, mort considérée comme une force de séduction et d’immortalité, une histoire sur le désir de la mort […] Ce que je voulais raconter à l’origine n’avait rien d’homosexuel ; c’était l’histoire du dernier amour de Goethe à soixante-dix ans, pour une jeune fille de Marienbad : un histoire méchante, belle, grotesque et dérangeante qui est devenue La Mort à Venise. » (Merci à Michèle Collery pour nous avoir rappelé les mots de Mann)
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).