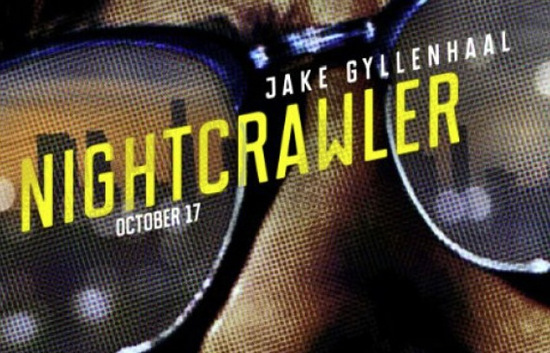J’étais branché sur la radio de la police en intraveineuse. Mon appareil était ma vie et l’amour de ma vie. Ma lampe d’Aladin. Je commençais ma tournée vers Minuit (…) » Weegee by Weegee, 1961
Nightcrawler, titre original plus complexe pour le public français que le simple Night call, qui ne fait en apparence qu’évoquer l’élément déclencheur du mouvement, ces messages-radio de la police de Los Angeles qui rythment l’intrigue du premier long-métrage de Dan Gilroy. Une des traductions possibles de Crawler , c’est « lèche-bottes ». Tandis qu’un Kerb crawler, c’est un personnage qui accoste les prostituées en voiture. Un titre qui garde son mystère, mais qui sied bien à la nage en eaux troubles de son protagoniste, le poisseux Louie Bloom.
Ou l’américain base devenu sociopathe, un grand malade avec des accès de folie furieuse et ce, dès la scène nocturne liminaire.
Lou est surtout un modèle de personnalité antisociale telle que la définit Howard Gluss « l’Antisocial est également le candidat idéal pour faire naître des vocations parce qu’il n’a pas ou peu de considération pour la vérité »1. Dans le scénario des frères Gilroy (Jason Bourne : l’héritage, écrit à quatre mains mais réalisé par l’autre, Tony), son caractère se trouve enrichi d’un fort narcissisme (« on trouve aussi chez lui un manque perceptible d’empathie et le sentiment que tout lui est du »1). Il en résulte un portrait de personnage retors qui n’arrive jamais à être attachant.
Nous voilà embarqués dans un faux road movie, un film de bagnole qui pratique le surplace urbain et nocturne, collés au pare-choc de ce prédateur d’un nouveau genre. Pas en mode Fast and furious ni Bellflower, mais dans une trajectoire sinueuse et reptilienne le long des grands axes de la cité californienne. Son métier de reporter à sensation n’est pas une grande nouveauté thématique, mais la manière non conformiste qu’il a de le pratiquer et la régression quasi physiologique qui l’accompagne, sa « dévolution », lui donnent une toute autre dimension et élèvent immédiatement cette série B à un rang supérieur.
Un succès du en premier lieu à la création de Jake Gyllenhaal. Amaigri, voûté, regard halluciné, un sourire enjôleur encore plus effrayant et surtout une démarche à faire pâlir Darwin, qui tient à la fois du rapace (le vautour ramassé sur lui-même) et des grands fauves (sa façon de se mouvoir sur la pointe des pieds et son goût pour l’ombre). Film où apparaissent les stigmates dunaturalisme selon Deleuze « Les personnages y sont comme des bêtes, l’homme de salon un oiseau de proie, l’amant un bouc, le pauvre, une hyène. Non pas qu’il en aient la forme ou le comportement, mais leurs actes sont préalables à toute différenciation de l’homme et de l’animal. Ce sont des bêtes humaines »2. Enfin, c’est jusqu’à son costume ringard, type marginal des 70’s et à cette veine qui gonfle sur sa tempe, qui achèvent de le transformer en « extra-terrestre », tel que le définit son assistant-stagiaire, exploité jusqu’à l’os.
Portrait d’un être profondément animal, voleur et embrouilleur. De la matière (grillage, cuivre, fonte) à l’image, en passant par la relation sentimentale, avec lui tout est acte de prédation, son culot faisant office de connaissance quand son ignorance de la peur lui donne une longueur d’avance sur ses adversaire ou concurrents. Mais ce qui frappe par-dessus tout, c’est son absence de sens moral. Lou balaie les obstacles d’un revers de la main comme d’autres écrasent un nuisible. En ce sens, il est un vrai « serial reporter », un rapporteur en série d’images choc. Un prolo âpre au gain qui se rêve en géant.
L’intrigue s’installe vite, pas de fioritures, à la manière de cetype prêt à tuer pour trouver un boulot. Désœuvré, Lou est attiré sur les lieux d’un accident par cette bonne vieille pulsion scopique. Il se tient là en mode somnambule, présence éthérée, quand du brouillard de sa non-existence, surgit pour le secouer ce chevalier des temps modernes : le reporter d’investigation free-lance. Bardé de sa caméra voyeuse, il dévore le réel avant de déféquer ses images-pulsion pour de l’argent facile. Comme l’insecte carnassier, notre Louie Bloom agite ses antennes et quelques questions innocentes plus tard, il peut passer à la mise en pratique de son plan : la conquête d’un nouveau milieu. D’abord, il mimétise: coiffure cool en bord de plage pour faucher un vélo branché. Un tour de chauffe pour le gros coup, le hold-up permanent du passage de la vie à trépas.
Le scénario, centré sur l’itinéraire de ce nouveau roi de l’information-déchet contient deux phases, « passive » et active, qui résument à peu près le rapport de Lou à l’image.
Dans une démarche un brin anthropologique, la première partie du récit de Nightcrawler suit tranquillement les pas du débutant. Elle détaille les méthodes, l’acquisition du matériel, l’éducation autodidacte par vampirisation. Carburant de cette épopée, le fric, dispensé par la manne bienveillante du département de l’information d’une télé locale. Mais le temps a coulé depuis les grands films des seventies sur les médias. Network rejoint Vidéodrome, sous cet oeil brillant qui luit dans le sombre faciès ingrat de Louie Bloom…
Pourtant ces équivalents yankees de nos JRI (Journalistes Reporters Image) sont les descendants d’un illustre prédécesseur, Weegee qui fut le premier photographe à utiliser les messages radios de la police, pour fixer pour la postérité, les meurtres et accidents de la nuit américaine. « Cet ouvrier de l’ « industrie de la nouvelle » met en scène un désordre structurel, en utilisant des formes qui sont elles-mêmes, des décantations socio-historiques »3. Précurseur mais aussi dans un geste terminal, fossoyeur d’un genre qui fit les beaux jours des tabloïdes. Guidé par son amour pour sa ville et son époque, ses détournements de pubs transfigurent ses clichés en de véritables expériences sémantiques annonçant le Pop art.
Aujourd’hui, extirpées de leur contexte et exhibées cliniquement à tous les regards, les images de faits divers ainsi banalisées par l’audiovisuel, sont la monnaie d’échange de transactions louches, au fond de bureaux de chaînes de troisième zone. Une télé locale qui ne peut vivre que grâce à leur exploitation et en entretenant l’insécurité de la classe moyenne. Seul un personnage secondaire fait appel à l’éthique journalistique. Un raseur timoré qu’on a remisé au service twitter de la chaîne (le réseau social, considéré ici comme une « réduction » de l’Information, loin des intrigues de cour reluisantes de Zoe Barnes dans House of cards ). Et la conscience professionnelle s’efface devant la LA woman Nina Romina (Rene Russo) au sourire carnassier. Une nouvelle Faye Dunaway, plus douce et ridée, presque humanisée par des ambitions limitées à sa seule survie. Mais ses dents ne sont pas encore assez émoussées. Et dans la jungle de l’info à sensation, l’arrivée d’un nouveau pourvoyeur en viande froide excite les appétits.
Mais quelqu’un vient vers moi en courant, il a peur de ne pas arriver à temps. C’est un confrère, un pauvre bougre saturé de chagrin et de remords. […] Il veut se mettre à mes genoux. Il me dit comme Brengues : “Regarde ! Regarde !”… Il me supplie : “Tu diras tout ! Tout ! Pour que ça change un peu…” (Albert Londres, Au bagne, 1923)
La position morale par rapport à la violence va devenir de plus en plus préoccupante au cours de la seconde partie, avec toujours en point d’orgue, les commentaires de la « direction de l’Information » de la chaîne. Les appréciations de Nina déterminent la valeur marchande des images, selon leur pouvoir de fascination ou leur degré de pénibilité, avec en valeur ajoutée, le montage adéquat, pragmatique, répétitif, la « signature » du média. Quant aux protestations de ses collaborateurs, elles font écho dans la forme, à celles de l’ethnologue dans Cannibal holocaust. Il y a simplement eu « glissement » de la profession, pour qui la sauvagerie brute de l’image doit aujourd’hui être nécessairement doublée d’une réécriture en post production (minimalisme funèbre des bandeaux, hypocrisie des pixellisations), destinée à produire du discours idéologique, larvé mais assumé, là où les petits maîtres du bis italien se cachaient derrière leur fantasme peu ragoûtant du « primitif ». Night call dénonce le lavage de cerveau appliqué à la population et les clivages sociaux inamovibles qu’elle reconduit, comme gravés dans le bitume bouillant des avenues où commencent les ghettos. Pression de la production ou plutôt refus d’appuyer un texte trop politique, le scénario nomme juste ce qui est le cœur du problème : les bulletins d’infos servent à monopoliser l’attention des spectateurs (le médium est toujours le message !), pour pouvoir leur vendre des spots de pub, autrement plus juteux que les reportages les plus efficaces.
Le « tout dire » d’Albert Londres s’est transformé en tout montrer, la réaction émotionnelle du spectateur se substituant à la réflexion, l’injonction à la pensée. Ce sont pourtant les plus grandes plumes américaines qui appliquèrent au journalisme les règles de la dramaturgie, mettant leur style à contribution pour captiver le public afin de mieux le concerner. Et si infirmant la possibilité d’une objectivité, Cendrars écrivait alors « Il faut se moquer de la vérité comme de la vraisemblance, exagérer ou diminuer, ne pas tenir qu’un fil mais tout un écheveau et bien embrouillé »4, le filon qu’exploite son descendant dégénéré Louie Bloom a aujourd’hui la consistance d’un de ses cheveux gras.
La seconde phase voit passer notre anti-héros du stade de cameraman à celui de metteur en scène (il organise désormais le tournage). La narration dépouillée et rectiligne des frères Gilroy nous rappelle que la mort et le crime sont toujours le meilleur des fonds de commerce et que dans la logique capitaliste, l’argent appelle l’argent. L’apprentissage cède la place à un récit d’ascension sociale, mais sur le versant obscur, celui des ambitions mesquines et du délit d’esthétique. Car Lou ne capture pas seulement la douleur du réel sans un tremblement, il aspire toute sa vénéneuse beauté. Vénal et incapable de se projeter plus avant que le rendement immédiat d’une apothéose létale, le début d’intrigue qu’il met en lumière, ne trouve pas plus d’écho en lui que la vraie réalité des « beaux » quartiers dans les JT. Lou reste obsédé par le tout-image. Critique de scénariste ou simple redéfinition de la fonction du cinéaste ?

Sans verser dans le cynisme et toujours en s’attachant aux gestes, en devenant aussi claire que Lou a le regard perçant, la mise en scène de Dan Gilroy nous plonge dans ces nuits glauques, dont les aubes ont la couleur des victoires à la Pyrrhus. Il réalise son premier film à l’âge de 55 ans, d’où la maturité du projet. Il ne craint pas de placer ses marques dans les pas du plus grand cinéaste américain de sa génération, Michael Mann. Il en garde un peu le tempo, beaucoup la distance et surtout le travail photographique, celui de Robert Elswitt (oscarisé pour There will be blood) rendant hommage à celui de Dion Beebe, l’homme qui avec Collateral a changé la face du cinéma américain.Donnant ses lettres de noblesse au cinéma numérique et filmant comme jamais Los. Angeles, entre ombre et lumière, grands aplats bruns et surbrillances hypnotiques. Une « reconfiguration de la nuit californienne »5 selon Vincent Malausa…
Mais la couleur vive de Night call doit plus aux expérimentations fauvistes de Miami vice, voire à l’acuité d’un Benoit Debie dans Enter the void. Les lumières de LA inondent l’écran, la chaleur des tons et la profondeur des contrastes luttant contre la grisaille télévisuelle. Plus vraiment avant-garde, mais décrassant tout de même la cornée.
Avec sa clarté et son grand angle, Gilroy vise lui aussi l’immersion du spectateur, sans abandonner son objectivité, dès lors que ses personnages la fuient eux de plus en plus.
Le décorum du film (son artificialité achève d’en faire un Monde originaire selon les critères de Deleuze) et son déroulement s’opposent aussi à un des films événement de ces dernières années, le Drive de Nicolas Winding Refn. Avec sa voiture pétaradante, Lou nous ramène au driver au blouson blanc, démystifiant ici le psychopathe de la route. Manière aussi de se démarquer de la complaisance pour la violence de Refn et d’une partie du cinéma contemporain, enfermé dans ses mondes virtuels. Pourtant, c’est la même équipe à la production qui vient se racheter une conduite avec Night call. Si les meurtres et accidents sont le plus souvent laissés hors champ, ils sont aussi filtrés et revus par tous les écrans dont l’ultime est le téléviseur de Lou, sur lequel il regarde avec une autosatisfaction non feinte les résultats de ses pérégrinations nocturnes. La télé-miroir renvoie notre Mr Hyde du journalisme à sa «création». Il est traversé par le flux des images, sans que jamais conscience ne puisse éclore sous son crâne. Il y a donc un déficit de point de vue critique au profit d’un auto-conditionnement du filmeur.
Seule la fusillade finale et la poursuite débridée entre ces « Riders on the storm » ont droit à une représentation en forme de morceau de bravoure. Ainsi Night call s’encanaille-t-il en flirtant avec le cinéma d’exploitation vintage, remplissant peut-être son cahier des charges mais sans perdre de vue l’objet de son étude. Jamais l’objet filmique de Lou n’est saisi de face ou de trop près, au contraire du sujet lui-même ou de son assistant, que la mise en scène accompagne au feu. En entomologiste, Gilroy applique ses principes à son personnage, le laissant se dévoiler peu à peu sous les traits émaciés de Gyllenhaal. On peut le voir progresser dans son « Art », faire corps avec sa caméra, comme avec une arme. Logique puisque son instinct de l’image tient de celui d’un chasseur à sang froid. Il ne fait pas un panoramique, il suit une piste. Et ses longs plans séquence flairent l’odeur du sang. Pour cet amateur, la dramaturgie de l’instant-vérité est dictée par un mouvement d’attraction-réaction. En se professionnalisant, Lou devient un loup pour l’homme. «Kerb crawler», il racole le sujet. Il pourrait être de ces belligérants dans le jeu de massacre orchestré par Aja dans Horns (la course au scoop.y devient un pugilat puis une boucherie), si son caractère d’antisocial ne l’éloignait pas du troupeau.
Le plan d’ensemble permet à l’inverse d’incruster le reporter dans la réalité, dans un milieu professionnel, de mesurer son implication dans l’organisation de la scène (du crime et du film) et de l’observer dans les situations à risque, bref de nous montrer pleinement la fabrication du fait divers par un faussaire de la télévision d’aujourd’hui. Par contre, on subit de plein fouet les relations interpersonnelles du personnage…Son absence de considération pour les humains, sa vision de l’entreprenariat et la politique sociale qui en découle nous sonnent comme de vraies agressions en plan serré.
Night call s’avère être un bon cours de déontologie. Manipuler l’image et les acteurs n’est que le premier échelon de toute mise en scène. Cet « appel de la nuit » inspiré, exprime le vide métaphysique dans lequel flottent ces images et où s’ébattent leurs auteurs comme un ban de sauriens, chasseurs de prime dans une ville incroyablement fantôme. Dans ces traques nocturnes interminables, la cité des anges n’a jamais autant ressemblé à un tombeau, aussi pharaonique soit-il. Particulièrement ces quartiers aisés où les reporters font leur beurre.
La bande sonore préfère se taire, à l’affût des appels radio ou des détonations claquant sur l’immense tissu urbain, avec toujours en fond, le chant lointain des sirènes de la LAPD. Pas en complice car elle enregistre surtout la solitude qui remplit tout le paysage de Night call. Cette sobriété du sound design répond aux grands espaces et au regard, parfois éteint et transparent, de Jake Gyllenhaal. La mélancolie qui se dégage de l’ensemble constitue la partie commune la plus flagrante avec l’œuvre de Mann.
Ainsi les effets chocs et les scènes à faire nous sont presque toutes épargnées.
Dans la séquence la plus en tension, Lou manque d’être confronté aux meurtriers. C’est un des rares moments où l’empathie fonctionne. D’abord parce que l’objet du délit reste hors champ. « Si le champ est la dimension et la mesure spatiale du cadrage, le hors champ est sa mesure temporelle, et pas seulement de façon figurée : c’est dans le temps que se déploient les effets du hors champ »6 . Après l’attente, parce qu’ensuite, sur le théâtre des opérations, on ne le quitte jamais d’une semelle. Un doute s’instaure, on lui trouve presque une sorte de courage, ou au moins, une tendance suicidaire. Et si Lou était un vrai détective, un nouveau Fuller qui immortalise le visage occulté de la ville-lumière ? Mais non, son cinéma est juste obscène, son geste criminel, sa profondeur de champ, un point de fuite. Quant à son style, ce n’est que de la technique rudimentaire, privée de sa moitié «pas vue» de fiction, d’un passé et de son futur. «Car cadrer, c’est avant tout exclure»7…
L’image finale consacre les noces de Nina et Lou, quelques antennes enfoncées dans le cœur d’une immense lune qui baigne la cité des anges de ses ondes malveillantes.
Même si le discours manque parfois (volontairement) de substance, Night call le compense aisément par la profondeur de ses personnages et les compositions explicites de ses plans. Gilroy garde le cap jusqu’au bout, sans éviter une certaine théâtralité en fin de climax, fruit de ce qui tient lieu de pensée filmique au Peeping Tom Louie Bloom. L’homme «qui apprend vite grâce à internet», lui qu’on a cru artiste parce qu’il recherche le meilleur angle, n’est rien d’autre qu’un médium enténébré, un médiocre un peu benêt, qui bâtit son empire de misère sur du vide. Sur les ruines de ce qu’on appelait autrefois l’Information.
__________________________
1: Psychologie des personnages, Howard M.GLUSS, Ph.D.-Scott EDWARD SMITH, 2006 Dixit ed.
2 : L’image-mouvement, Gilles DELEUZE, 1983
3 : Art, politique et fonction sociale : crime et châtiment dans l’œuvre du photographe nord- américain Weegee, Séminaire du 28 novembre 2012, Présentation de l’exposé de Marcos Fabris, HAR, univ Paris 10
4 : Bourlinguer, Blaise CENDRARS, 1948 Denoël, cité par Arthur BERNARD dans « Blaise Cendrars ou le Je du reporter », Dans Initiales n°24 « Reportage » http://www.initiales.org/visuels/pdf/Reportage-int.pdf
5- La nuit rayonne, présentation de l’entretien avec Dion Beebe par Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma n°702, juillet/août 2014
6-L’œil interminable, Jacques AUMONT, La Différence 2007, cité par Jean-Baptiste THORET dans « Hors-champ », in Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction d’Antoine DE BAECQUE et Philippe CHEVALLIER, puf 2012
7-« Hors-champ », Jean-Baptiste THORET, in Dictionnaire de la pensée du cinéma, sous la direction d’Antoine DE BAECQUE et Philippe CHEVALLIER, puf 2012
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).