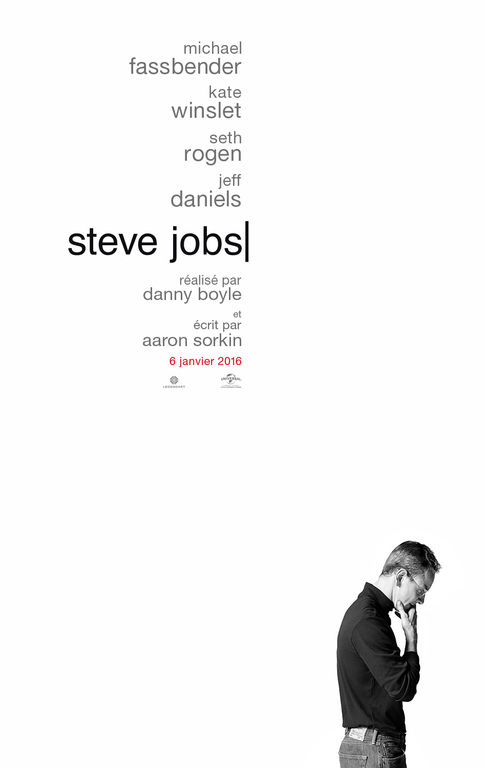Du héros des imbéciles au portefeuille trop garni qui ont couru fleurir sa tombe de leur iPad, il y a d’abord eu le versant sucre : Jobs, le biopic avec des-vrais-morceaux-de-garage-iconique-et-de-postiches dedans, où un Ashton Kutcher à la recherche de son Golden Gobe poussait vice et pilosité jusqu’à la maigreur finale du cancer.
Confondant de nullité par sa trop tranquille sagesse alignant les étapes du self-made-man comme on enfile les perles, ce biopic par excellence, condensé wikipedia vite vu, vite oublié, finissait tranquillement sa carrière dans la voie de garage d’où sortait le premier Apple, en égrenant sa digestion facile de film raté mais rythmé sur les vols longs courriers des compagnies aériennes.
Et puis il y a eu le bruissement du versant nord, le diamant noir de tout cinéphile fébrile : Fincher+Sorkin, dreamteam de The Social Network, à nouveau réunie pour écrire la suite de nos mythologies technologiques, où les demi-dieux se débattent dans la solitude et les circuits de l’information.
- It’s a dirty Jobs, but somebody got to do it.
Enfin. Ca, c’était avant. Montagnes russes et émotions: différends artistiques et grosses colères plus tard, David quitte le navire en conchiant gaiement Hollywood et en emportant Christian Bale avec lui. Sony flippe un peu, confie le bébé malformé à Danny Boyle, aka Mr Caféine, puis la patate chaude toute entière à Universal, qui réussit in extremis à débaucher Michael Fassbender. On souffle un peu, on le sort aux Etats-Unis, et, histoire de prendre un dernier coup sur la nuque, on le retire discrètement des écrans au bout de quinze jours, faute de spectateurs.
C’est dire si le film du jour est un naufragé, mal-aimé et mal né, à la manière de son héros principal, abandonné par ses parents, adopté, rendu (le détail a son importance), puis adopté à nouveau. Pour être aimé ?
- He.lo.I.’M.Mac.in.tosh.

Dans le meilleur de son écriture, il prend le contre-pied global du biopic, genre malade par excellence, en concentrant l’histoire de l’homme autour de trois pôles : les quelques dizaines de minutes précédant l’entrée en scène du monstre (il faut voir Fassbender, brillant et la mâchoire prognathe du carnassier, toutes dents dehors) pour trois bascules clefs de l’histoire Apple : la présentation du Macintosh, en 1984, celle du NeXT en 1988, vengeance prétendument stratège à la suite de son limogeage, et le retour en grâce de la marque, iMac en 1998, dont le film suit le flux temporel d’un monde qui s’accélère en les représentant respectivement en 16, 35mm et numérique.
Cette intelligence théâtrale de réduire le regard à une succession de blocs de présents absolus, se déroulant en temps réel, est la vraie belle idée du film. Dans le fond, dans un geste quasi méta, il n’est même que cela : mettre en « scènes », d’une manière presque conceptuelle, pour espérer que le micro d’un être puisse créer par rebond, dissensions et tensions, la métonymie d’un paysage flou du macro.
C’est, nous dit Sorkin, le moment où peuvent se dévoiler le produit et les êtres : sa relation compliquée mais fidèle avec son assistante, Joanna Hoffman (la toujours très grande Kate Winslet), son humiliation-tendresse envers Woz (Seth Rogen), sa confrontation tendue avec John Sculley (Jeff Daniels), lors du moment éprouvant de son limogeage d’Apple, etc etc.
Film froid, entomologiste, et bouillant de tension : à la manière d’une expérimentation en boites de Petri, profiter de cette acme pour en prendre le pouls, suivre et dévoiler les tensions sous-jacentes, les faire s’échapper, analyser progressivement l’échiquier relationnel et ses frémissements, autour du cœur noir du créateur. Lui coller au train, au cœur du cyclone.
Flux d’informations ininterrompu, discussions de couloirs au pas de course, ping pong verbal élégant et rythmique : la méthode, aujourd’hui éprouvée et brillante, qui faisait le bonheur d’A la maison blanche ou de la sublime mais mal-aimée « Studio 60 » (qui se concentrait déjà sur le off d’une tension, à savoir l’écriture hebdomadaire d’un simili SNL), trouve un mariage merveilleux avec la narration hachée (qui a dit épileptique ?) de Boyle, et l’excellente BO du film, donnant la sensation dans l’expérience du spectateur d’être tout à la fois acteur et suiveur de cette « distorsion de réalité » reprochée à Jobs, comme si le personnage était tout à la fois ce qu’on en découvre et fuyant, dévoilé par les mots et protégé par leur rythme.
- Lisa Lisa, Sad Lisa Lisa

Damnation, purgatoire et grâce : le vrai drame du film, dans le fond, est de ne pas être que cela, et de charger la barque pour raccrocher les deux mamelles insupportables de l’épopée biographique : l’informationnel (il faut lâcher du micro-clins-d’œil biographique à tout va, quitte à user du « tu te souviens, quand nous étions dans le garage » ou séquences souvenirs en surimpression) et un besoin compulsif, sans doute très américain, de raccrocher le self-made-man au mythe.
Et pour réaliser sa mutation d’hybris, expliciter l’être humain par la résilience et la blessure originelle.
« Je mettrai de la musique dans ta poche, des centaines de chansons, parce que je ne peux plus te voir avec ce walkman » (nous non plus, d’ailleurs, tant la ficelle est grosse depuis une heure) : dans cette simplification unilatérale, le film se tire une balle dans le pied. Il n’est plus observation entomologiste, mais discours asséné. Plus bouillonnement nerveux, mais classement, explication, rationalisation.
C’est le noyau pourri de la pomme, qui polarise petit à petit l’enjeu du récit autour de la question de la paternité et de la filiation, qu’elle soit subie (l’abandon par ses parents), voulue (le génie accouchant de machine…) ou transmise involontairement (…parce qu’il est incapable d’aimer sa propre fille).
- You had ONE Jobs.

Quitte à faire feu de tout bois, quitte à distordre la réalité (quid de ses autres enfants, qu’il a élevé ?), quitte à polariser l’ensemble du film autour de cette cicatrice à cautériser, grand raout de discours intime de parking et sourire de la fille retrouvée hors champ à la clef, dans la plus pure tradition du héros solitaire et buriné par la souffrance.
A la différence du brillantissime The Social Network, dont le parcours intime de fêlure ne trouvait jamais résolution mais n’existait que comme moteur par la bande (au point de laisser son héros au sommet dans la solitude la plus absolue du F5, une solitude d’ailleurs sans mots), user du sentimentalisme comme d’un violon, d’un argument simplificateur du monde, qui n’explique rien de plus que son caractère de merde, et sans doute en rien sa création.
« je VEUX un système fermé ». Après l’abandon, le pouvoir et la maitrise enfin retrouvées : ouf, rien ne dépasse. Objet malade du même défaut que son personnage principal.
A trop vouloir transmettre, basculer : retour dans le sucre, rentrer dans le moule, bonjour Hollywood et s’effondrer.
Pomme-Z, Pomme-Q.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).