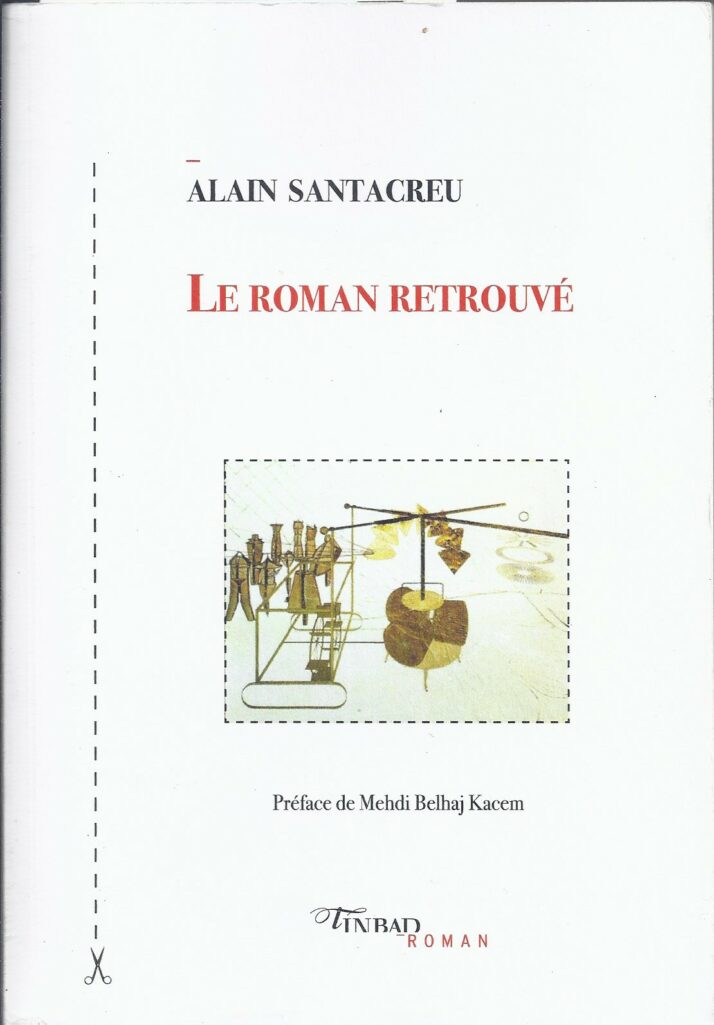A bien des égards, Le Roman retrouvé d’Alain Santacreu est un livre monstrueux. Pas au sens de difforme ou laid mais bel et bien celui qui évoque quelque chose d’énorme, d’excessif. L’histoire du roman est déjà, en elle-même, rocambolesque.
En 2017, l’auteur publie chez un petit éditeur, Alexipharmaque, une œuvre intitulée Opera Palas. Sauf que la maison d’édition dépose le bilan et que le livre disparaît presque aussitôt. Mais Caroline Hoctan, également écrivaine, contacte Santacreu pour lui dire que son roman a survécu et a laissé quelques traces, y compris dans sa mémoire de lectrice. Elle lui propose alors un entretien qui vient à la fois compléter et parachever Opera Palas tout en lui offrant une véritable renaissance sous ce titre de Roman retrouvé.
Il faudrait d’ailleurs s’entendre d’abord sur le terme même de « roman » tant Santacreu met à mal l’idée classique qu’on peut s’en faire. Dans une belle préface, Mehdi Belhaj Kacem évoque à ce propos l’invention d’un véritable genre à part entière : « le picaresque métaphysico-politique ». Et il est vrai que le livre offre au lecteur une curieuse sensation : celle d’avancer constamment dans un récit foisonnant, qui embrasse toutes les strates de l’histoire de l’humanité ; de la tradition judaïque et chrétienne à Manuel Valls, des cathares jusqu’à la Guerre d’Espagne en passant par la révolte des marins de Kronstadt en 1921 contre le pouvoir bolchevique… Mais ces aventures picaresques offrent également la sensation d’un mouvement contraint, d’un récit qui fait du surplace, à l’instar d’une sorte de partie d’échecs disputée avec le lecteur et qui permet à l’auteur de creuser ses idées, de les développer, de jouer du paradoxe et de la provocation pour faire dériver son « roman » vers l’essai philosophique, le traité politique (la création d’une espèce de gnose anarchiste) et la réflexion historique.
Le livre est construit, entre autres, autour de deux piliers essentiels : d’un côté, Le Grand Verre de Duchamp qui offre à l’auteur le modèle d’une « machine célibataire » dans laquelle il peut s’effacer et inventer une forme d’écriture assez unique. De l’autre, l’idée selon Orwell qui veut que l’Histoire s’est arrêtée en Espagne en 1936. Ce qui arrive ensuite est, pour Alain Santacreu, l’ère de la « fiction », d’un mensonge savamment entretenu par le Capital et le système économico-médiatique :
« En 1936, en Espagne, l’idéologie libérale et tout son système techno-industriel fut mis en péril par le mouvement populaire impulsé par les anarchistes. En quelques mois, cette révolution sociale, à partir des collectivisations agricoles et industrielles, renversa la structure économique du capitalisme et menaça d’enrayer le mécanisme de l’État que dirigeait le Front populaire. La lutte antifasciste contre le franquisme ne fut qu’un leurre idéologique, inventé par les communistes et les libéraux, pour éradiquer cette menace. Le système réagit au danger quand il se sent attaqué sur des valeurs incompatibles avec les siennes »
En s’engageant dans cette voie, Alain Santacreu prend le risque d’essuyer le qualificatif infamant de « complotiste » et d’être accusé de développer des théories parfois fumeuses, s’appuyant sur des sources contestables. Mais l’auteur s’explique dans la partie « entretien », en soulignant qu’il cherche avant tout à engager un dialogue avec son lecteur : « le lecteur zélé accepte la mise en danger d’une lecture cathartique qui l’amène à oser se regarder lire. ». En ce sens, la partie d’échecs comme métaphore qui court tout au long du roman vaut aussi pour le « duel » qui voit s’affronter l’auteur et le lecteur.
D’autre part, il ne s’agit jamais d’asséner une « vérité » au lecteur mais, au contraire, de se détacher d’une littérature qui souligne, qui affirme et qui se fait porte-parole de la voix de l’auteur. A cette vision idéologique de la littérature, Santacreu oppose une « contrelittérature » qui offre un espace de réflexion au lecteur. Dans Le Roman retrouvé, ce processus passe par l’effacement progressif du « je » de l’auteur (dans les premiers chapitres) au profit d’une voix narratrice « faisant le récit au passé de l’action métapolitique de Julius Wood et décrivant différentes périodes historiques » avant le retour de la première personne du singulier. Cette structure circulaire, « spiralée » comme l’écrit Santacreu, offre au lecteur un curieux va-et-vient entre des personnages qui sont et ne sont pas l’auteur. A l’inverse d’une autobiographie, l’écrivain entend écrire une « autothanatographie » : le narrateur tue l’auteur et ouvre des gouffres dans lesquels peut se nicher l’écriture. Tandis que le « je » apparaît comme une création fictive, romanesque qui paraît endosser la partie « biographique » du livre, c’est un personnage de journaliste fictif, Julius Wood, qui s’insinue au cœur de l’Histoire, dialoguant avec Duchamp, Orwell ou le pape Jean-Paul II. Il est le fil « romanesque » qui entend recoudre le tissu déchiré de l’Histoire, relier Barcelone et Auschwitz, notre modernité aux origines de notre civilisation judéo-chrétienne.
Cette construction à la fois très rigoureuse (là encore, l’auteur s’appuie sur de nombreuses références et s’inspire notamment de Raymond Abellio) et vagabonde puisque le livre semble s’écrire au fil de la pensée, par associations et étincelles provoquées par la confrontation des concepts, peut s’avérer parfois déconcertante.
Pour un lecteur peu familier avec les références (historiques, philosophiques, religieuses, mystiques, politiques…) qui abondent dans Le Roman retrouvé, le risque est grand de se retrouver la tête sous l’eau, à deux doigts de la noyade. Mais la richesse de ce grand maelstrom permet également de maintenir un intérêt constant et d’un tirer des réflexions stimulantes.
Déconcertante également car l’auteur ne vise pas à asséner une pensée homogène mais joue la carte de la dissonance, des stridences comme il l’explique lui-même dans son entretien :
« Le roman se construit sur une série d’antagonismes. J’en citerais quelques-un : Le masculin et le féminin, la cabale de la puissance et la cabale de l’amour, le bolchevisme stalinien et le slavophilisme de Khomiakov, le sionisme de Buber et le sionisme de Jabotinsky, l’individu et la communauté, le nationalisme politique et le nationalisme de l’intériorité, l’éros et l’agapé ; sans oublier le couplage scandaleux entre l’anarchiste Buenavenutura Durruti et le fasciste José Antonio Primo de Rivera. »
Ces oppositions permettent à ce récit heurté et tumultueux d’épouser les contours d’une pensée dialectique qui ne cherche pas à résoudre les contradictions mais à imprégner les mots d’une rare puissance hétérogène.
En lisant Le Roman retrouvé, le lecteur ressentira dans sa propre chair de multiples émotions contradictoires que les angles saillants du livre provoquent : la fascination, l’agacement, l’enthousiasme, le scepticisme, l’adhésion…
Mais nulle doute qu’il aura aussi conscience d’avoir vécu une expérience littéraire aussi intense qu’unique.
***
Le Roman Retrouvé (2024) d’Alain Santacreu
Préface de Mehdi Belhaj Kacem
Éditions Tinbad, 2024
ISBN : 979-10-96415-66-3
362 pages – 25€
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).