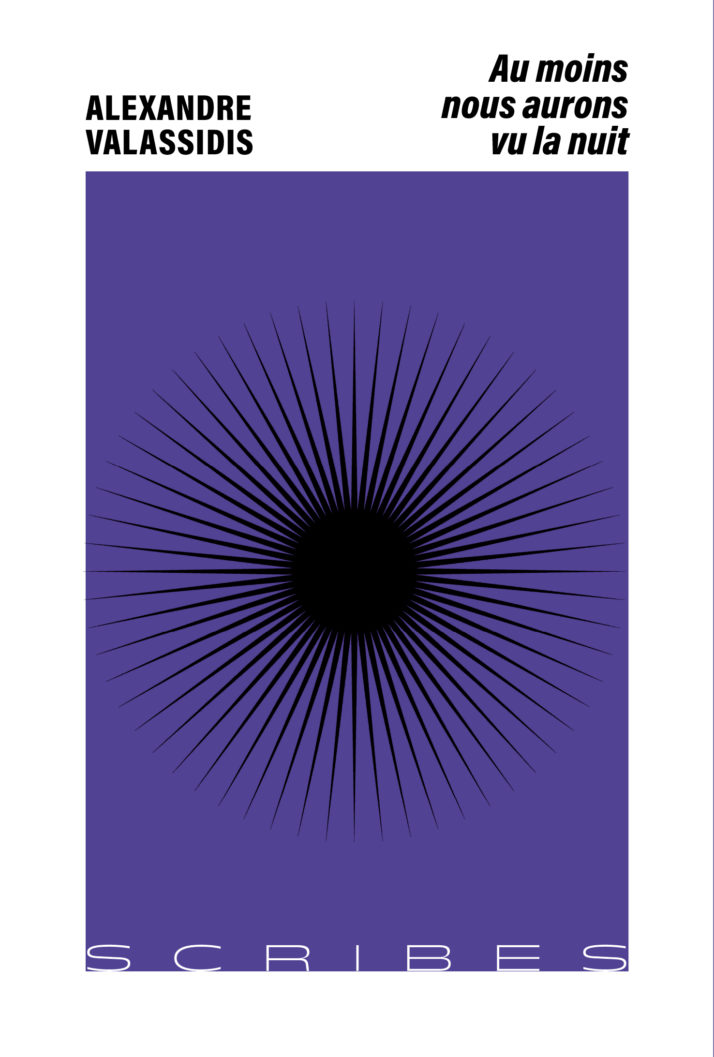C’est l’été. Barres d’immeubles et ennui. Le narrateur voit Dylan (ou croit le voir) disparaitre brusquement, à l’arrière d’une voiture. Dylan, ce drôle de garçon. Dylan, le mystérieux, qui reçoit des lettres d’une anglaise dont il fut l’amant, sauf s’il mentait. Dylan, qui se cache parfois. Dylan, qui le poussera vers la noirceur. Dylan, qui accompagna ses nuits et dont l’amitié si forte va peu à peu contaminer le cœur du narrateur, et inquiéter de son silence.
Il essaye, aujourd’hui, de comprendre.
« Au moins nous aurons vu la nuit », dit le titre plein d’amertume d’Alexandre Valassidis, déjà auteur de plusieurs ouvrages de poésie sous le pseudonyme de Louis Adran, et première publication d’un nouveau label, Scribes, dirigé par Clément Ribes (dont nous avions déjà apprécié la finesse chez Bourgois), qui se veut défricheur de nouvelles formes pour raconter, des « gestes » d’écriture.
On pourrait en effet longuement discuter des personnages, de la violence du milieu social qu’ils décrivent par métonymie, de l’incroyable capacité à témoigner au fond des marges, qu’elles soient géographiques (la ville est loin, seules ses lumieres restent), sociales (les zonards dans les banlieues cossues) ou intimes (amitié ? Amour ?). Évoquer le mystère et la brume qui nappent ce court récit, comme le gris qui envahit cet été, et que rien ne viendra jamais éclater. Parler de sa tension et de sa revisite des archétypes de récits, jusqu’au film noir.
Mais ce qu’il faut souligner, ici, au cœur de cette rentrée bien trop roborative, c’est à quel point la forme est ici au cœur du récit, de sa mécanique et de la profonde émotion qu’il suscite : des phrases courtes. Dix mots tout au mieux. Perpétuellement terminées par un point définitif.
Dans leurs urgences hoquetantes, prises entre le fait de se lancer et se briser, elles créent pour le lecteur le sentiment inexplicable de mots qui s’arrêteraient en plein vol.
« Tout juillet, ca n’avait été que ca. Cette odeur de naufrage, partout. De fond de cale. Qui dégoulinait des façades. Ruisselait des gouttières et stagnait dans les avaloirs. Qui imprégnait les vêtements. Les gestes aussi. Puis passait les portes pour pénétrer dans la cour des immeubles. Pour grimper à l’intérieur des grandes cages d’escalier et parvenir jusqu’aux appartements. Dans l’intimité des gens, pour ainsi dire. Dans la plus courte discussion. Se glissant entre les mots échangés. Dans le plus petit interstice. Qu’il s’agisse de phrases insignifiantes ou de secrets. »
Hachées comme une mémoire qui cahote.
Comme s’il manquait un bout de la phrase, comme si le texte, en son sein, recréait cette disparition.
Mais quelle disparition ?
- Des phrases insignifiantes et des secrets.
Car dans cette impossibilité à saisir, Alexandre Valassidis tisse, doucement, un étrange évitement du sens : plus le récit progresse, plus les êtres se vident, devenant figure (l’acteur) voire mythes (l’incroyante séquence de la chambre) ou Pythie (« Volez tout, parce qu’après il n’y a plus rien »).
« D’une certaine façon, tout semblait être à sa juste place. Ni bonne ni mauvaise. Mais juste. […] Le fait que Dylan soit devant moi, je me disais que ca avait dû être écrit quelque part. Dans un carnet, peut-être. Comme un script. »
Par la simple grâce des mots et du rythme, le mystère initial devient celui non de ce qui est dit, mais du texte tout entier. A travers sa mue, la lente disparition des personnages vers les figures, quelque chose se fige, quelque chose qui progressivement transformerait les possibles de l’amitié en fatum. Le ressassement y apparait alors comme un abri, comme ces failles entre deux immeubles où Dylan venait se refugier, comme une manière de continuer à dire, mais dire quoi ?
Dire quelque chose de l’absurde, quelque chose surtout de cette brume, et il faut alors se couler dans le Staccato de sa musique, ressentir ses silences pour progressivement, non faire la lumière sur le roman, mais au contraire, se glisser dans ses anfractuosités comme à travers le trou d’un grillage (celui la même qui géographiquement permet de quitter la cité). Fuir, mais peut-être vers rien.
« Là-dessus non plus, je n’avais pas voulu mettre trop de mots. Et pas par paresse. Mais parce que j’avais senti que ca devait rester comme ca. Je veux dire quelque chose de silencieux. Où il y aurait un espace très blanc à la place des mots. »
Duras laisse place à Beckett, et peu à peu, il n’y a plus rien. Volez tout.
- Grandir.
On ne révèlera pas volontairement ce vers quoi évolue le livre et ses personnages jusqu’à devenir profondément bouleversant. Dans ce vide apparaît alors le sens douloureux de ses phrases courtes. Quelque chose de l’ordre du regret. Quelque chose de brisé. Ses anfractuosités deviennent des plaies d’amour.
Quelque chose qui ne pouvait pas se dire, ou trop se dire.
La scène est nue : cette nuit qu’ils auront vu aura été celle de l’intime, peut-être de ce temps instable de l’adolescence, qu’il aura été si violent et si doux de partager avec eux, cahotant dans les regrets, et peut-être, au fond, mourant dans le silence d’un immense chagrin.
« Comme s’il avait neigé de la tristesse. »
Editions Gallimard, label SCRIBES, 128 pages, 15.50 euros. En libraire.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).