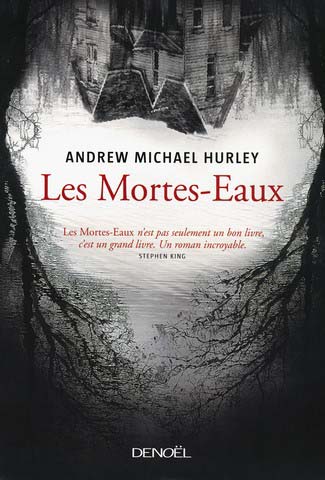« Ce n’est pas une question de foi. Il s’agit plutôt de savoir quand il faut admettre une défaite. » (p.298)
Il y a un parfum de vieille bâtisse, de marais et d’abandon décrépi, dans le premier roman de l’anglais Andrew Michael Hurley, Les mortes-eaux, paru ces jours chez Denoël.
Passé la sempiternelle citation de Stephen King (dont on finit par se demander si l’adoubement ne se monnaye pas systématiquement comme une marque déposée) s’ouvre alors une superbe ambiance aqueuse, grisâtre, et qui brasse les images anglaises pour mieux les détourner : pluie, grisaille, église castratrice et drôle de manoirs sont au programme.
Bienvenue dans le nord de l’Angleterre, à « The Loney » (le titre original du livre), « cet étrange nulle part entre deux rivières », « un bout de côte anglaise, sauvage et inutile » (p.12), que la marée isole deux fois par jour, et qu’elle semble isoler du temps, tant rien ne semble y changer, pèlerinage après pèlerinage aux jours de Paques pour la petite communauté qui gravite autour de la famille Smith. Aux confessions succèdent les prières, pour Pabsent et Momon, Mr et Mrs Belderboss et Miss Bunce, jouant tous à qui-qu-est-le-plus-pieux dans la pluie grise où perce mal le soleil.
« mon frère »
Au cœur de cette communauté et du dispositif narratif, il y Andrew, ou Hanny, le frère de notre narrateur, avec qui il s’échappe dès que possible pour jouer dans les bunkers et un peu trop près de la forêt.
Ne communiquant que par geste ou hurlement, rappelant par instants le Benjy Compson de Le Bruit et la Fureur de Faulkner -et le roman, bien que britannique, doit beaucoup dans ses thèmes à cette littérature sudiste -, c’est le personnage le plus touchant, attardé mental et cœur pur dont la potentielle guérison l’unique raison de ce pèlerinage.
C’est en tout cas ce qu’espère Momon en lui faisant boire, parfois par la violence, de l’eau bénite du sanctuaire, le forçant à ployer sur ses genoux par contrition, serrant elle-même les poings jusqu’au sang dans ses prières. Tout est excusable s’il vient à guérir : car la foi n’aura pas été vaine et il sera la preuve de l’existence d’un Dieu.
Ainsi convaincra-t-elle par l’action de grâce les bouseux du coin, étrangement menaçants et athées, dont la communauté découvrira au fil des jours de drôle de totem écorchés et blasphématoires pas très loin de la sorcellerie.
« Je crois que tu as peur ». (p.299)
Le miracle surviendra pour Hanny, nous dit-on dès les toutes premières pages. Mais par qui ? Les croyants et leur communauté de grenouilles de bénitiers extrémiste et obtue ? Ou les sorciers animistes et athées ?
C’est cette lutte entre « ceux qui croyaient au ciel, et ceux qui n’y croyaient pas », entre le Ciel et les puissances de la Terre que conte le roman, à travers sa galerie de trognes proche de la fable ou du conte. Une opposition frontale de deux cercles clos, façon Les Chiens de paille de Peckinpah ou Deliverance, de Boorman. Un choc d’une rencontre entre la civilisation et une forme brutale d’état de nature.
Si la violence est ici beaucoup plus sourde, et que la force laisse place à une pensée, la référence cinématographique n’est pas innocente (Danny Boyle vient d’ailleurs d’acquérir les droits du roman), tant « Les mortes eaux » lorgne du côté d’une littérature d’action et d’images, préférant la création d’une ambiance et de « scènes » plutôt que s’attarder sur de longs monologues psychologiques.
Et s’il réussit avec succès dans la création d’un décor inoubliable, vaporeux et hors du temps sur cette lande oubliée sans doute de Dieu, difficile de ne pas, une fois la dernière page refermée, souffrir de la pauvreté globale de l’univers : une pièce un peu mystérieuse dans la maison, un signe animiste et trois rencontres de totem d’antéchrist ne font pas un frisson, et le roman, ne prenant pas le pli d’accumuler le mystère, finit par donner des signes certains de longueurs.
Plus impardonnable sans doute, on regrette que Hurley, dans sa résolution assez vague, ne choisisse pas le parti de l’indécision (tel « Rosemary’s baby » auquel on songe beaucoup) mais celui de l’horreur, transformant ce qui était un agréable roman sur la croyance et ses limites en une simple narration de genre. Dommage, car dans sa capacité à poétiser un lieu plutôt anonyme et hors des sentiers battus, dans son trait pour caractériser à peu de mots des personnages et dans son questionnement initial, il y avait matière à très grand roman plutôt qu’à banale anecdote.
Editions Denoel, 383 pages, 21,80 euros. En librairie depuis le 2 Mai 2016.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).