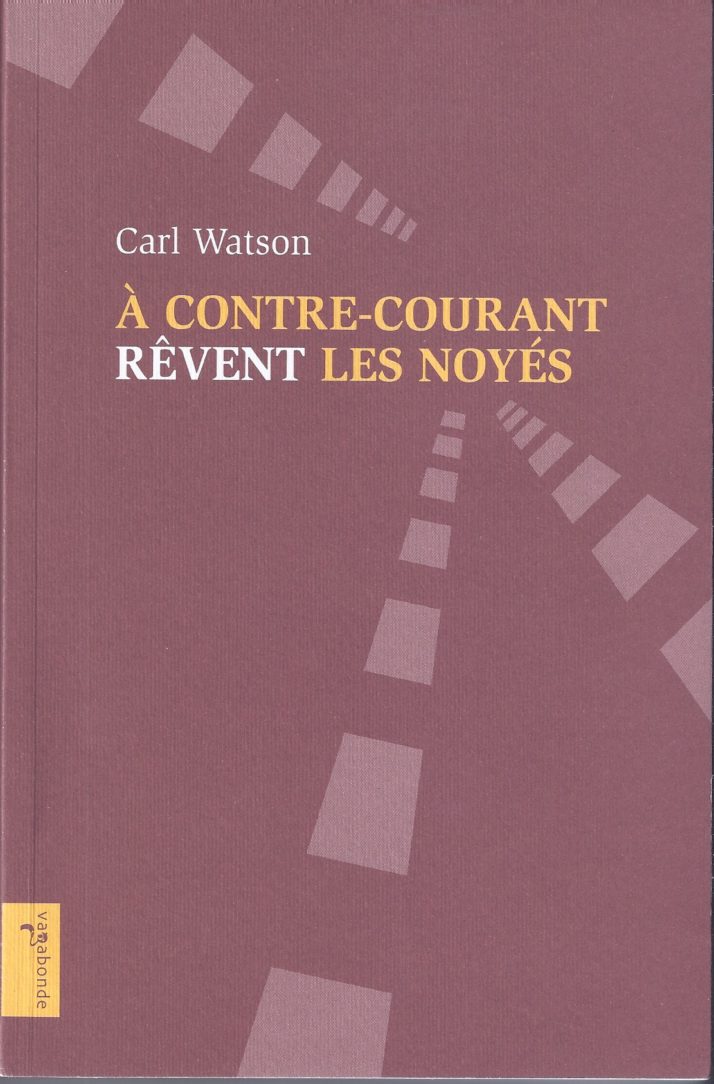Bien que l’action d’ A contre-courant rêvent les noyés débute en 1974, le récit de Carl Watson nous parle évidemment du monde d’aujourd’hui. 1974, c’est le début de la fin : le reflux des utopies, les désillusions après les grands espoirs des années 60, la mélancolie qui gagne lorsqu’on commence à compter les morts au champ de bataille (Hendrix, Morisson, Janis Joplin…). Carl Watson reprend les choses où les avaient laissées ses grands prédécesseurs : Kerouac, Ginsberg et toute la Beat Generation. Comme eux, Frank Payne et Tanya McCoy prennent la route, traversent les Etats-Unis et rêvent à une vie plus authentique, loin de la routine du quotidien et des conformismes sociaux.
Mais nulle trace de romantisme chez l’auteur qui nous prévient d’emblée : « Il ne s’agissait pas cependant d’une histoire d’amour destinée à traverser les âges. Je ne suis même pas certain que ce fût réellement une histoire d’amour, ni d’ailleurs que les histoires d’amour soient autre chose que des modèles de l’oppression émotionnelle, des murs de béton édifiés dans nos têtes par de petits romantiques sadiques pour y fracasser nos âmes comme des sacs de jouets cassés. »
Si un sentiment de révolte prédomine chez les personnages, il est très rapidement dilué dans une nouvelle conscience qu’il n’y a désormais plus d’ailleurs possible. Frank et Tanya bougent beaucoup dans le roman : Los Angeles, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Portland… et pourtant, leur trajectoire s’apparente à un voyage immobile. Jouant sur le caractère fragmenté d’une chronique où se succèdent les saynètes au gré des rencontres des personnages, Carl Watson parvient à suggérer avec force ce sentiment de surplace (les mêmes personnages semblent ressurgir régulièrement en dépit des années passées) et d’emprisonnement qui envahit Frank et Tanya. Le déroulé de la narration rend parfaitement cette impression d’engluement dans l’espace et le temps. Comme chez Lynch, le lecteur fait l’expérience d’une perception élastique des durées. Frank semble, à un moment donné, se laisser gagner par une sorte d’apathie, se perdre dans le brouillard et émerge des années plus tard (on est alors au début des années 80) sans que les choses aient évolué.
A contre-courant rêvent les noyés est un grand roman sur le désenchantement du monde et la perte des illusions. Ce que saisit avec une rare acuité Carl Watson, c’est ce moment où quelque chose bascule, où la « contre-culture » se laisse engloutir par le mercantilisme :
« Selon moi, il s’agissait de faux « produits culturels » présentés comme « authentiques » afin de simuler une réalité bidon dont le seul but était de vendre des annonces publicitaires d’une sous-culture artificielle à ceux qui possédaient les mêmes livres et qui, dans leur communion extatique, se croyaient supérieurs aux autres. La classe ouvrière était oubliée depuis longtemps ; la gauche avait évolué vers le pire : ce n’était plus que de la pose ; le gauchisme était devenu une mode. »
A l’horizon se profilait alors le monde dans lequel nous vivons actuellement : celui de l’uniformisation, des flux d’images, de la communication… Ce dont prennent conscience Frank et Tanya, c’est de l’impossibilité d’échapper désormais à cette unification. Car en optant pour un mode de vie marginal, ils ne font que singer les grands aînés et se conforment eux aussi à une image déjà prédéfinie. Thierry Marignac, qui s’est chargé de la traduction du livre, parle à ce propos « d’identités factices ingénument fortifiées par la perte de leurs illusions ».
Le parcours du couple permet de mesurer la généralisation de cette falsification du Réel puisqu’il se confronte à divers groupes sociaux, des drogués de Los Angeles jusqu’aux quartiers tenus par des gangsters à Chicago en passant par les cueilleurs de pommes à Portland (extraordinaire « bloc » dans le récit) et les ex-hippies de San Francisco. Mais « l’ailleurs » n’est plus possible et le monde s’est désenchanté. Lors d’un beau passage, Tanya et Frank passent du temps à scruter d’anciennes cartes géographiques dont la représentation même (loin des cartes « colorées, agressives et saturées de balisages au niveau des frontières » de leur temps) laissait encore entrevoir des zones inexplorées, la possibilité de fuir vers des régions mystérieuses : « Dorénavant, et selon les lois de l’équilibre et du réchauffement funeste de la planète, il est dans la nature des choses qu’elles deviennent toutes semblables au fil du temps. Je savais qu’à un certain moment la différence avait existé. »
Mais pour faire l’expérience de cette altérité, de cette échappatoire vers une illusoire liberté, la route semble désormais mener à une impasse :
« J’émis l’idée que le mythe de la route américaine en tant que métaphore de la liberté était en train de s’estomper, et que la quintessence du récit occidental n’était plus « la route » mais plutôt le mystère, parce que la paranoïa et la tromperie étaient des phénomènes endémiques. »
Carl Watson décrit alors un long processus de déréliction où les grandes figures du passé (symbolisées par la mère de Tanya, passionaria de la « contre-culture ») s’effritent pour laisser place des monades prisonnières de leur monologue intérieur et de leur solitude. L’écrivain se plait à imaginer des rencontres insolites (là encore, on songe parfois à Lynch) avec ces alcooliques hantant des bars paumés et jouant soudainement aux prêcheurs. Le roman navigue constamment entre ces croquis triviaux, insolites, pris sur le vif et de longues interrogations existentielles quant au devenir de l’individu dans un monde unifié et uniformisé.
Mais au bout du compte, ce voyage immobile laisse un goût amer dans la bouche et le sentiment que seuls demeureront les horizons bouchés :
« C’était un avant-goût de ce qu’allait devenir le monde, un passage subtil vers un futur où nous ne vivrions plus dans un tissu commun de destins entrecroisés mais dans un nombre infini de perceptions individuelles, où le conteur de l’histoire était la vedette et où l’opinion de chacun comptait plus que n’importe quelle destinée collective. Il s’agissait d’une maladie de la démocratie : la confession endémique et exponentielle se faisait passer pour de la sagesse, la pose personnelle comme le signe d’appartenance à une communauté… »
***
A contre-courant rêvent les noyés (2012) de Carl Watson
Éditions Vagabonde (2020) – 19,90 €
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Thierry Marignac
Sortie le 6 juin 2020
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).