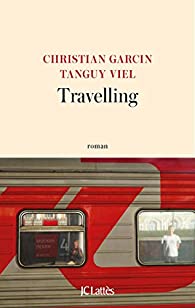En ces temps d’immobilisme forcé où la possibilité de “ceindre la terre” semble d’un coup réduite, on a eu envie de lire Travelling de Christian Garcin et Tanguy Viel ( J-C. Lattès, 2018 ). Les deux écrivains nous y emmènent dans un tour du monde “au ras du sol”: sans avion, sans rupture de continuité. Dans la lenteur.
« Cent jours autour du monde, en 2018, cela relève presque de l’ordinaire, n’était le sédiment d’imaginaire qui tapisse encore la roche profonde de notre conscience collective, mais pour le reste, chacun ressent qu’on tourne autour de la Terre comme aussi bien on prendrait une ligne de tram d’un bout à l’autre, en regardant le ciel défiler au-dessus des nuages. À ceci près que nous, Christian et moi, nous ne prenons pas l’avion » (24).
Ainsi les suivons-nous de Marseille à New York en cargo, de Chicago à Boulder, Colorado, en voiture, des USA au Japon, en cargo encore, du Japon en Chine en ferry, de Chine en Russie en Transsibérien, enfin de Moscou à Paris en autocar, en passant par Auschwitz.
Bien sûr, le tour du monde de l’écrivain, le road trip américain, tout cela a déjà été fait. Les compagnons de voyage en sont bien conscients, qui par ailleurs se méfient de la posture de l’écrivain voyageur :
« La difficulté, lorsqu’un écrivain se met à écrire sur son rapport au voyage et à l’ailleurs, est de savoir naviguer (justement) entre deux écueils: la posture de l’aventurier, et l’ironie. » (15)
Mais ici nulle pose poétique, nulle afféterie, nul exotisme bon marché, pas de roulements d’épaules de baroudeurs autoproclamés. Bien plutôt un “arpentage contemplatif” ( 281) qui, loin de nous exclure, pauvres sédentaires que nous sommes, nous emmène loin avec lui.
La forme se veut à la fois fluide et hétérogène : au fil du périple, les écrivains se succèdent pour livrer chacun ses impressions et réflexions – il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un travail à quatre mains; plutôt d’un relais – mais le récit de voyage linéaire s’interrompt parfois pour faire place à des listes -d’animaux, de chiffres, de proverbes-, à des photos, à des lettres écrites “à un ami français”, et même à un résumé de la coupe du monde. Autant de passages que la mise en pages ou les choix de typographie viennent désigner comme des objets hétérogènes, des inserts venant rompre la narration, tout en l’éclairant d’une lumière nouvelle, documentaire ou drolatique.
C’est toutefois une impression de grande fluidité qui l’emporte. Les écrivains se succèdent harmonieusement et si certains passages sont facilement attribuables à tel ou tel, d’autres semblent juste portés par une voix qu’on n’identifie pas, comme si dans ce continuum, mimétique du voyage, cela aussi se diluait un peu. Ainsi des “lettres à un ami français”, qui ne sont pas signées. On peut bien sûr, moyennement un petit effort, reconnaître le phrasé de Garcin de celui de Viel, l’univers de chacun, mais on a envie de se laisser porter par cette parole qui se fait, elle aussi, voyageuse.
Car c’est bien à une conversation des âmes et des imaginaires que nous sommes ici conviés. Et bien au-delà du ruban de la route ou de la surface de l’océan, c’est la profondeur qui est sondée.
Voyager ainsi, c’est se confronter avant tout au temps. Temps d’une navigation lente qui sans cesse fait passer d’un fuseau horaire à l’autre, temps libre, laissé à la pensée, à la contemplation, et à l’écriture :
« Rien qui viendrait perturber la perfection de notre inemploi du temps. Déjà, nous ne savons même plus quel jour nous sommes. » (54)
C’est d’appréhension du temps qu’il est question encore lorsque une Chine visitée trente ans plus tôt se révèle méconnaissable, ou lorsqu’un village russe proche du lac Baïkal semble au contraire replonger les voyageurs 50 ans en arrière, et donne lieu à de belles pages sur la profondeur :
« (…) il y avait cet adjectif qui insistait, murmurant sans cesse qu’on allait là, oui, dans la Russie profonde.
J’ai beau accueillir l’expression avec toute l’ironie qui convient, il faut lui reconnaître ceci: qu’elle survient en certains lieux et pas en d’autres. »( 233)
« (…) non que je cherche à dessiner ici une Arcadie sibérienne, encore moins un phalanstère fouriériste, mais il arrive que la rusticité matérielle des lieux, le confort suffisant qu’elle procure aussi vite, ait le don d’inquiéter nos usages et nos besoins véritables, plus encore leur inflation technique dans le dernier demi-siècle. Il y a, dans cette histoire de profondeur, quelque chose qui se déplace insensiblement de l’espace vers le temps: comme si les heures d’autocar, en plus de verticaliser l’espace, nous avaient ramenés loin en arrière, en un état préalable de la grande triade “vivre habiter travailler. » (235-236)
Le beau passage sur les noms indiens de lieux américains révèle quant à lui le passé enfoui ou refoulé du pays :
« Malecite Passamquoddy Penobscot
Pennacook Mahican
Nipmuc Nauset
Massachussets Narragansett Pequot
Wampaonag Wappinger Montauk Delaware
[…]
Makan Nutchainuth Squamise » (108-110)
Les noms défilent telle la route, formant un long ruban sur plusieurs pages. Ils réjouissent l’oreille de leurs sonorités inédites mais surtout exhument le cimetière indien sur lequel se sont bâtis les Etats-Unis. C’est ainsi “l’indice de spectralité” – notion reprise à l’écrivain Sébastien Ortiz- du territoire arpenté que sonde le duo voyageur… qui nous emmène, comme logiquement, jusqu’au Stanley Hotel, ce lieu hanté qui servit de cadre au Shining de Stephen King, mais pas à celui de Kubrick, dont les images, pourtant, hantent elles aussi les pages écrite et lues, comme en surimpression.
On l’aura compris : voyager, arpenter, c’est découvrir des strates. Celles du temps mais aussi et surtout celles de l’imaginaire. Nos deux guides sont érudits: leur bagage est fait de lectures et de souvenirs cinématographiques. Dans leur périple, ils convoquent aussi bien Proust, Beckett, Perec, Kafka, Céline que Kubrick, Imamura, Kore Eda, les silhouettes de John Wayne, d’Al Pacino, de Gene Hackman, La mort aux Trousses ou La rose pourpre du Caire, les traités d’ ethnologie ou de chamanisme. Mais nulle cuistrerie chez eux. Il s’agit bien de participer d’une circulation entre les imaginaires, ce que le titre à la fois cinétique et cinématographique annonçait d’emblée.
New-York et les Etats-Unis sont un bel exemple de ce dialogue permanent :
« Les images de la ville et du pays ont été déclinées sous tant de formes, dans tant de documentaires et de fictions, qu’on vient ici pour vérifier: vérifier que la réalité correspond bien aux représentations qu’on en a reçues (…) Et de ce point de vue-là, on est rarement déçu, tant les Etats-Unis prennent soin de correspondre assez parfaitement à leur caricature. » (73)
Avec Shanghai, dans un mouvement presque inverse, il faut se débarrasser des images ou des sons qui font écran pour appréhender la réalité du lieu :
« Shanghai, par exemple, est un nom comme ça pour moi – comme un titre en surveillance à l’affiche d’un cinéma de Broadway, ou bien l’épais rideau d’un théâtre dont on croit connaître à l’avance du sujet, mais vide encore de toute épaisseur sensible.Le nom de Shanghai à mes oreilles est comme ces videurs à l’entrée de certaines boîtes de nuit, laissant filtrer par la porte entrouverte les bruits d’une musique pleine de promesses, mais peu décidés à en autoriser l’entrée. » (195)
Garcin et Viel finissent leur périple en se confrontant aux images terriblement gravées dans les mémoires que suscite la visite d’Auschwitz, lestés des souvenirs de lecture de Levi, Delbo, Calvino et Celan. Beau passage tout en retenue que le récit de cette visite qui “nous demande seulement de garder une réserve d’ombre et de ne jamais préjuger du caractère acquis de la lumière”. (276).
De lumière(s) pourtant il est beaucoup question dans ce livre, qui se clôt sur le mot “photosynthèse”. De lumière, de rêveries, de lectures, dévoilées au gré de ce que Bachelard nomme “l’état fluidique du psychisme imaginant”, de la “curiosité bienveillante” (261) des auteurs. Et bien sûr c’est à une exploration de notre propre bibliothèque intérieure que nous sommes ainsi ramenés, dans un mouvement de grande douceur.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).