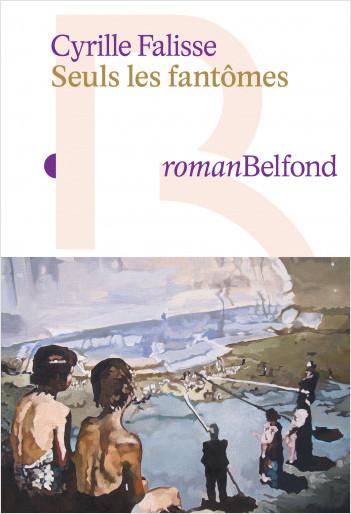Melvile va mal. Depuis son dernier chagrin d’amour, il perd pied. Pris dans les tourments d’une profonde dépression, il tourne en rond, dans son petit appartement, ne parvient plus vraiment à assurer son travail dans le digital. On le soutient, on le supporte, mais les amis comme les collègues commencent à se détourner. Alors, sans avenir autre que le regret, il ressasse, il pleure, il creuse son propre chagrin à coups de souvenirs douloureux.
Une situation intenable, qu’une voisine vient bousculer : elle lui offre la cooptation pour s’inscrire sur un site de rencontres assez exclusif (nous sommes aux bégaiements du web). Il y fait la connaissance d’Alice, aka Tangere. Noli me… : une femme vaporeuse, dont l’identité ne sera jamais éclaircie. Un spectre numérique à travers le miroir des pixels à qui, passé les premières tentatives de séduction, il va confier peu à peu ce et celles qui le hantent pour espérer voir à nouveau la lumière.
Car au fond de la douleur et de la joie de Melvile (que l’on imagine amputé de son « l » comme de sa vie), il y a les femmes. Nombreuses, mais où surnagent trois figures.
L’amour d’enfance (Laetitia), celle des premiers émois sexuels et des troubles de la mue adolescente (Nina), et la mère, amour de toujours (qui galope dans l’existence et contre son cancer). Trois visions de la pureté, trinité de la nostalgie, trois deuils physiques ou métaphoriques. Trois étapes d’une vie.
Ainsi démarre un beau récit introspectif et rétrospectif qui poursuit les ombres tout au long de ses 270 pages de ce premier roman complexe et parfois difficile d’abord que nous livre ici Cyrille Falisse dans « Seuls les fantômes », tout juste paru chez Belfond.
Ce soir, c’est mon tour. C’est à moi de la veiller. Elle est dans le coma depuis trois jours, peut-être quatre. Je ne compte plus. Elle avait déjà été dans le coma quelques jours puis s’était réveillée, pour nous faire croire aux miracles. Maman, tu fais une blague là, c’est pas vrai. Hier, elle a juste tourné la tête en entendant la voix de sa mère. « Arrié, c’est maman, Arrié, je suis là. » Puis le cou gracile, décharné, s’est retourné définitivement et les paupières sur les sclérotiques jaunes se sont refermées. Il a fallu soutenir ma grand-mère. Voir son enfant mourir. Elle avait appris la maladie de maman peu de temps auparavant.
- Nos images. Nos deuils. Nos célébrations.
Par échos de la mémoire, dans un épanchement qui tient autant de la libération que du ressassement, le récit navigue alors dans les époques et les souvenirs, tous retravaillés à l’aune de la noirceur du raconteur : les vacances rêvées avec Laetitia qui ne grandira plus et dont on a caché la disparition, les sorties en pleine montagne avec un grand-père raciste et aimant, le goût des cerises arrachées d’un arbre. Les humiliations, aussi, lors d’une adolescence passée par le harcèlement, ou la figure ambiguë de la mère, qui ne cesse d’aimer sans jamais s’empêcher d’être violente.
On ne saurait dévoiler plus avant ici les images qui apparaissent au fil des pages et des réminiscences, tour à tour touchantes (le complexe de Jeep), émouvante (les premiers émois et le jardin du sud gorgés de fruits), tendres (la relation au grand père), sensuelles (la jeune femme nue au violoncelle). Parfois précises, parfois comme retenues ou éparses (les jalousies de la mère). Les extraire serait leur faire offense, car elles ne valent, au fond, que dans leur articulation, tant cette confession autant que (psych) analyse semble comme rongée d’une obsession. Celle du dire, de la recherche du sentiment juste et de son expression. Comment dire le regret ? comment exprimer avec sincérité la douleur de voir sa mère partir, dans ce qui est la partie la plus bouleversante du roman ? Comment témoigner les émois et le sensuel, entre la chair et les fluides ? Comment articuler le chagrin ?
Maintenant je n’ai plus peur. Tes mots sont
comme une peau. Ce ne sont pas les fantômes
qui dansent, c’est moi qui fais des entrechats pour
lire au-dessus de ton épaule. Pour qui écris-tu,
Melvile ?
- Dire. Pourquoi, pour qui.
Car ces fantômes de silence, le narrateur les poursuit par sa seule arme, sur le forum comme dans la vie : les mots.
Le roman lutte, oscillant de longues phrases ourlées à de brèves rythmiques hachées, de la poésie la plus désincarnée (avec une tentation au romantisme) à un certain goût de la crudité. Du trivial à l’intime en passant par le subconscient (beaux et cruels récits de rêve, sans doute les plus fortes images du récit), Melvile confie, revient, s’acharne, repoussant à l’occasion le lecteur (le premier tiers du livre, usant) ou l’emportant avec lui dans sa gangue de dévastation. Il se brise comme les os de la mère, ou se protège dans la splendeur d’une soirée d’enfance avec Laetitia, pour mieux gonfler de larmes lorsqu’enfin le narrateur retrouve la tombe de la petite qui ne grandira plus.
J’ai passé six ans de ma vie avec une centaine de personnes, filles et garçons, aux côtés desquels j’ai mangé, étudié, ri, dormi même parfois, pris ma douche et pleuré. À certains d’entre eux j’ai confié des choses intimes, l’âge des violences sèches. J’en ai écouté d’autres me dire qui ils devenaient à l’abri d’un auvent, dans l’intimité d’un vestiaire après un cours de sport ou derrière la cloison des toilettes. J’ai vu leur peau d’enfant se durcir et se creuser quand on ne les croyait pas. J’ai parfois pensé qu’ils allaient devenir mes amis. Plusieurs ont disparu. L’horreur frappe au hasard, intoxication au monoxyde de carbone, crash de voiture, suicide, je pense à vous trois souvent. Je me demande si je n’écris pas pour être pardonné de tous ceux à qui j’aurais manqué de respect ou d’attention, ceux dont je me suis moqué, que j’ai imités en forçant le trait pour paraître drôle car c’était mon masque […] Pardon, Simon, d’avoir copié ta démarche et sifflé ta voix si gentille pour la tourner en dérision, pardon, Maud, d’avoir ri quand tu disais que ce qui te faisait le plus peur au monde était la mort de tes parents, tu avais raison. J’écris pour ceux qui ne sont plus là. J’aurais dû passer du temps avec chacun d’entre vous. Je bouffe mes regrets à tous les repas. On m’a vu vous trahir.
Certaines parties du récit sont plus faibles (le personnage de Nina, écrasé forcément par la présence maternelle et la mort de Laetitia) ou plus convenues (le début), et flux de pensée et roman souffrent ponctuellement de leurs propres épanchements et de tics, comme lors de ses multiples références culturelles à la musique ou au cinéma, beaucoup, la faute au passif passionné de l’auteur, sans doute, mais qui ne cessent de repousser les non initiés ou vire à la béquille narrative pop qui réduisent le récit. Ou ces instants où l’auteur se dévoile et soliloque assénant un pensum sur le végétarisme, les pensées sur le monde comme il va ou les phrases aux longues envolées à la frontière du cliché et de la sensiblerie, et l’ensemble aurait peut-être gagné en force en s’évitant ces méandres et incises si irritantes.
Tout ça disparaîtra. On passera notre vie à courir derrière les premières fois, doutant qu’elles aient jamais existé.
Il n’empêche qu’il tisse, mine de rien, et jusqu’à sa conclusion lumineuse et apaisée, une cartographie intime et poignante de nos propres errances, de nos propres souvenirs : de notre mélancolie et notre nostalgie. Une galaxie éteinte de notre propre jeunesse qui a fui et des êtres que l’on n’a pas su adorer, faisant remonter à la surface et parfois dans la même page des sentiments violents et contradictoires par la seule force de la langue et de la confession.
Lorsqu’il touche à l’universel, ce récit de la perte devient celui du pardon. De soi, de tout ce qui a été manqué, de tout ce qui ne sera plus, mais que l’on doit chérir. Il faut apprendre à aimer ses fantômes, voir comme chacun nous aide à grandir. Et les spectres comme les romans nous ouvrent à la lumière et à la vie.
Editions Belfond, 272 pages, 21 euros. En librairie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).