 Patrick Raynaud – 13824 jeux de couleurs de formes et de mots (MeMo )
Patrick Raynaud – 13824 jeux de couleurs de formes et de mots (MeMo )
Revoici le livre de Patrick Raynaud ! Il avait été réalisé dans la jeunesse de l’auteur et publié la première fois en 1972 par Jacques Damase (La Galerie de Varenne).
A l’époque, la description de l’ouvrage était celle-ci : livre à système relié avec une spirale métallique, composé de trois bandes horizontales constituées de vingt-quatre feuillets portant chacun au recto des formes géométriques lithographiées en couleurs et au verso un texte imprimé en noir ; couverture cartonnée noire avec une composition imprimée en couleurs sur le premier plat. Livre ludique destiné aux petits enfants, dans lequel le lecteur peut composer 13.824 figures géométriques et textes différents, en associant les éléments imprimés sur trois séries de 24 feuillets disposées l’une en dessous de l’autre. Tirage unique limité à 1.000 exemplaires non numérotés.
Près de 50 ans plus tard, les éditions MeMo republient ce livre à l’identique, avec le soin amoureux qu’on leur connaît. Un soin éditorial qui, dans cette maison, s’était illustré pour la première fois en 1994 avec la réimpression en fac-similé de l’édition originale de « Cent comptines » (1926) de Pierre Roy. Avec ses dix pastilles de la couverture aquarellées à la main par Christine Morault – cofondatrice de MeMo – opération aquarelle répétée sur les mille exemplaires de l’édition…
La présentation du livre de Patrick Raynaud par MeMo parle de livre-objet, de jeux de couleurs, de formes et de mots (donc), d’abstraction, d’humour et de poésie. Oui, on a changé d’époque. La présentation parle aussi de « calligrammes »… (probablement une erreur, à moins que la définition du mot « calligramme » n’ait changé elle aussi).
On comprend vite que dans ces 13824 jeux, la relation entre les couleurs / formes / mots / est à apprivoiser pour la structurer et l’inventer. Par exemple, si on s’amuse à choisir pour chaque section une seule couleur, on trouve une seule entrée : rouge, bleu, bleu, ce qui nous donne : « un bon café noir / qu’on ne fait jamais briller / devient café au lait /
Si on choisit deux couleurs, on a deux entrées dans la section du haut, une entrée dans la section du milieu, trois entrées dans la section du bas. Soit 2 / 1 / 3. Soit pour la première entrée une forme arrondie en haut (rouge + bleu), une forme rectangulaire au milieu (rouge + bleu), une forme triangulaire en bas (orange + violet). Si on choisit trois couleurs, il faudrait trois pages pour décrire ce qu’il se passe pour la première entrée…
Lire ce livre c’est :
Principe A : travailler l’abstraction (inventer de l’organisation)
Principe B : élaborer son sens esthétique ou le titiller (débusquer des lignes directrices)
Principe C : éprouver le langage (chatouiller les mots)
Principe subsidiaire : jouer
Principe caché : apprendre (s’apprendre dans le monde)
Dans les 70, on écharpait le sérieux, on bousculait l’institutionnel, on s’amusait. Avec ses éditions distantes d’un demi-siècle, 13824 jeux de couleurs de formes et de mots nous restitue la fraîcheur d’un passé révolu, et nous fait faire un grand écart entre deux époques – un si grand écart qu’on se surprend à avoir la nostalgie de ce qui n’est plus à inventer.
P.V.
 Romain Bernard – Jour après jour (De la Martinière Jeunesse)
Romain Bernard – Jour après jour (De la Martinière Jeunesse)
Vous choisissez un décor, vous le dessinez en légère contre-plongée avec un trait bien noir et bien propre. Vous scannez et imprimez le tout sur un papier permettant le travail de la peinture à l’eau. Vous peignez à l’intérieur du contour en aplats de couleurs primaires. Une fois sèche, vous scannez la peinture en haute définition. Avec Photoshop pour faites disparaître le trait noir pour que seules les couleurs restent. Puis vous démultipliez l’original en une quinzaine de calques. Le vrai travail peut commencer : vous concentrez toute votre attention sur la variation des couleurs et la variation des valeurs. Car le nerf du livre est construit sur ces modifications. La gamme des possibles est infinie. Ensuite vous dessinez sur une grande feuille des éléments que vous viendrez ajouter à vos paysages-calques : un oiseau, un tracteur, un train, une cheminée, un entrepôt, une soucoupe volante, un extra-terrestre, un chien. Vous scannez et placez ces éléments aux endroits stratégiques. Vous réglez encore pléthore de petits détails, un reflet de lumière, une fumée de cheminée, une craquelure de glace. Ca a l’air simple mais ce n’est jamais aussi simple qu’on le croit / voit. D’ailleurs, Romain Bernard a peut-être procédé tout à fait différemment.
Ici, dans cet album jeunesse, il est question de temps qui passe, de dégradation naturelle et de dégradation par l’homme. Ca tombe bien, c’est une thématique phare de l’actualité. Mais de dramatisation, point, et c’est tant mieux : dès la moitié du livre on se retrouve plongés dans La Soupe aux choux, extra-terrestres sympathisant avec les humains. S’il y a un peu de mélancolie dans l’album, elle est éco-responsable. S’il y a d’autres affects, ils sont enfouis dans la chlorophylle artificielle des arbres, ou sous un petit pont où coule une rivière. Le choix des couleurs est sans doute lui aussi éco-responsable, mais il ne brille pas par sa biodiversité. Il est au service d’un environnement acide, avec son ciel citronné et ses boules d’arbres en chou-fleur. Tout dans cet album frôle un PH 0, ce qui limite bien les chances de frétillement. Comme si les images avaient été réalisées par un infographiste plutôt que par un illustrateur. Comme si le texte était celui d’un traducteur embêté par la conjugaison de sa narration. Comme si ce livre était le fruit d’une époque dont il faut absolument suivre les codes, au lieu de les réinventer. Bref, voici un gentil album comme il y en a beaucoup, un album qui touchera ou pas, c’est le coeur du petit lecteur qui décidera.
P.V
 Marcel Aymé /May Angeli – L’éléphant (Editions des Eléphants)
Marcel Aymé /May Angeli – L’éléphant (Editions des Eléphants)
On se replonge toujours avec plaisir l’univers singulier et inventif de Marcel Aymé. Avec ce conte écrit en 1935, extrait du recueil « Les contes du chat perché », nous voici à la campagne, peut-être dans une ferme de Franche-Comté, où l’auteur a grandi. Il pleut très fort, les parents des petites filles sont partis à pied rendre visite à l’oncle Alfred. Il pleut tellement que Delphine et Marinette, pour ne pas s’ennuyer, décident de tirer partie du petit déluge : elles décident de revivre en accéléré les aventures du vrai grand Déluge de l’Arche de Noé. Elles convoquent donc dans la maison tous les animaux de la ferme (ou à peu près tous) pour un voyage extraordinaire.
L’auteur du Passe-Muraille a le goût du fantastique, on le sait. Sa manière d’introduire de l’irrationnel dans ses récits pour en observer les conséquences est des plus réjouissantes. Ainsi cette petite poule blanche qui ne doute pas qu’elle va se transformer en éléphant, si elle s’applique et y met tout son cœur. C’est raconté sur un tel ton d’évidence que ça semble parfaitement naturel. Le texte de « L’éléphant » est rythmé par de nombreux dialogues entre les fillettes et les animaux. Les émotions éprouvées sont mises en mots. L’auteur ne manque pas de rappeler, l’air de rien, la durée faramineuse de la traversée de l’Arche de Noé. Il ne dit pas cependant que le Déluge est un récit biblique. Ni qu’il est décidé par Dieu, qui, en constatant la méchanceté et la perversité des hommes, choisit de détruire toute vie sur Terre, « depuis l’homme, jusqu’aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel ». Un seul homme trouvera grâce à ses yeux : Noé. Il est choisi pour survivre et perpétuer sa lignée. Voilà peut-être ce qu’ajouteront les adultes à la lecture de cet album, en classe ou à la maison. Voilà peut-être ce qu’aurait souhaité Marcel Aymé, qu’une histoire soit l’occasion d’en raconter d’autres.
L’album « L’éléphant » est accompagné de gravures sur bois réalisées par May Angeli. Des gravures très illustratives, très fidèles au texte. Avec parfois des tonalités et contrastes heureux, parfois moins. Le dessin de ces gravures, tout comme les couleurs, ont sans doute souhaité exhumer une manière d’illustrer à l’ancienne. A la manière de Gus Bofa ou de Nathalie Parain. Pourquoi pas. On conviendra que c’est replacer Marcel Aymé dans son époque à lui, d’où il n’est jamais vraiment sorti, finalement. Sauf peut-être avec Roland Topor, dix ans après la mort de l’écrivain. Mais peut-on dire que c’était alors une « sortie » d’époque ?… Remettre au goût du jour un auteur mort en 1967, un auteur prépondérant trop mis de côté, en faisant appel à un dessin contemporain, voilà qui serait une idée généreuse.
On peut remercier les Editions des Eléphants de rappeler Marcel Aymé à notre souvenir, un auteur si atypique, trop oublié ou trop ignoré – et pourtant si essentiel à la littérature française.
P.V
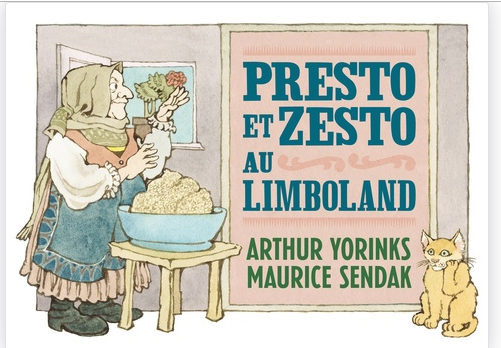 Arthur Yorinks / Maurice Sendak – Presto et Zesto au Limboland (L’Ecole des loisirs)
Arthur Yorinks / Maurice Sendak – Presto et Zesto au Limboland (L’Ecole des loisirs)
Bienvenue dans le désordre extravagant de Limboland, à côté duquel Neverland ressemble à un monastère. Partis se promener tout simplement à la recherche d’un gâteau, les amis Presto et Zesto se retrouvent bien malgré eux transportés et coincés dans ce monde sans queue ni tête. Le délire qui s’en suit laisserait supposer un trip sous LSD tant l’expérience vire à l’absurde, allant de rencontre en rencontre à la recherche du monstre Bumbo qui est le seul du village à posséder le cadeau idéal pour la noce des betteraves : un biniou bien entendu. On peut envisager Presto et Zesto au Limboland comme l’accomplissement d’une expérience surréaliste, pas très éloignée du cadavre exquis, du marabout-bout-de-ficelle, ou de l’écriture automatique. Ici les chèvres sont échevelées et pètent un plomb lorsqu’elles entendent le nom du monstre. Un coupeur de bois brandit sa hache menaçante pour trancher… du pain. La réalité n’a plus de prise, la logique n’a plus cours : le rêve a tout avalé, conquérant. Pas de doute, nous sommes bien dans l’univers du duo Sendak /Yorinks, déjà coupable de l’incroyable Cuisine de Nuit. Dans ce livre au format paysage comme Max et les Maximonstres, Sendak se laisse aller à un joyeux chaos de biquettes plongeant dans l’eau, de paysans aux yeux exorbités, de légumes rieurs et dansants auxquels fait écho la fantaisie infinie de l’aventure. L’univers d’autres illustrateurs n’aurait sans doute jamais vu le jour sans eux, celui de Claude Ponti en tête qui échafaudera lui aussi une planète perdue aux frontières du songe et de l’inquiétude – car elle persiste, en filigrane – du cauchemar.
A l’arrivée, la gestation du livre est presque aussi passionnante que le livre lui-même.
En effet, Arthur Yorinks explique que Presto et Zesto au Limboland aurait très bien pu ne jamais être édité et aura mis 28 ans à voir le jour. En 1990, Sendak composa une dizaine d’images pour les comptines du Rikadla de Janacek, destinées à être projetées lors d’une représentation. Yorinks, effaré que ces magnifiques et folles illustrations ne soient vues qu’une ou deux fois, proposa à Sendak d’en faire un livre. Disposant lors d’une « réunion de travail » les images sur la table, ils laissèrent libre cours à leur imagination délirante, dans une improvisation digne du surréalisme, laissant même les traces de leur indéfectible amitié en nommant leurs héros Presto et Zesto, »deux surnoms ridicules que nous nous étions donnés ». Le récit délirant naquit de ces moments fous, de joie, de plaisir passés à deux. Tout était quasiment terminé, mais chacun partit à ses occupations. Après la mort de Sendak, une amie se souviendra de ce texte, redonnant ainsi à Yorinks l’occasion de le retoucher pour le publier. Sans doute la légèreté, la liberté de ce duo et cette imagination au travail, en direct, explosent plus que jamais dans Presto et Zesto au Limboland. Un espace de liberté totale. Et d’émotion.
O.R
 Tomi Ungerer – Flix (L’Ecole des loisirs)
Tomi Ungerer – Flix (L’Ecole des loisirs)
Tomi Ungerer n’en était pas à une facétie près. Il serait apparemment acquis que « les chiens ne font pas des chats », hum hum… En est-on vraiment sûr ? Dans Flix, album initialement paru en 1997, il arrive bien aux chats de faire des chiens ! M. et Mme Théo La Griffe vont en faire l’insolite expérience. Menant une vie de félins ordinaires, dans leur bel appartement, ils arborent des trophées de souris accrochés au mur, des vases à motifs de rongeurs, une lampe « chat de la liberté », une horloge à moustache, et regardent des films dans lesquels les méchants chiens gangsters sont punis par des super-héros moustachus Quelle surprise, lorsque l’heureux événement tant attendu par Madame s’avère être un petit bouledogue ! Ungerer évacue d’emblée l’idée d’un adultère : il s’agit juste d’un caprice de la nature. Il raconte son histoire d’un petit chien élevé au milieu des chats et avec son humour inimitable tout autant caché dans les dessins qu’exploité dans le verbe, propose une fable virulente sur l’intolérance et la différence. Difficile de ne pas y déceler les traces autobiographiques de son enfance alsacienne (il a 7 ans en 1939) où fleurit la xénophobie, jusqu’à l’horreur. Tout en continuant à s’adresser, lui, à un public enfant, bien que moins contextualisée, sa métaphore animale et ses clins d’œil anthropomorphiques ne sont pas sans rappeler le Maus d’Art Spiegelman. Sur les titres des journaux, on peut lire « monstruosité génétique » ou « parents chats, fils chiens ». Flix va donc grandir dans un monde entre chien et chat, entouré de représentants des deux espèces qui l’aiment tout autant. Il apprend à grimper aux arbres grâce à ses ongles limés en pointes, prend des cours de chien avec un « léger accent chat » et ronronne sous les caresses. Evidemment, ce nouveau vilain petit canard devra faire face au rejet des autres et n’aura pas d’amis, se faisant malmener, insulter. La force du style d’Ungerer tient à cette capacité à faire passer des événements terribles par des dessins charmants et enfantins, soutenus par une phrase dédramatisée qui en désamorce le vrai contenu. Tandis que l’on lit « Personne ne voulait jouer avec lui », le dessin le montre persécuté par des chats lui ayant détruit son vélo, ou lui ayant jeté à la figure une canette de coca. Le destin pourtant sourira à Flix, éduqué dans une école de Clébardville où vivent tous ensemble les afghans, les lévriers, les chows-chows et les pékinois, un équivalent de Chatville et de ses persans, siamois, birmans, somaliens, abyssins… On sent chez Ungerer ce rêve du vivre ensemble, de l’amour entre les peuples. Enfin aimé des chats après en avoir sauvé un, il évitera une mort certaine à une étudiante caniche « Mirzha de la fourrière » qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants… permettant enfin à Ungerer d’affirmer que finalement les chiens aussi font des chats. Flix est du grand Ungerer, dans la veine esthétique du Chapeau magique, un délice qui nous invite à savourer chaque page en y explorant les recoins, transposant le quotidien humain, ses stéréotypes, ses emblèmes dans le monde animal, avec un humour fou. C’est cette ironie poétique, son humanisme provocateur qui nous manque tant depuis sa disparition.
 Christophe Pernaudet / Lauranne Quentric – Et pluie voilà (Rouergue)
Christophe Pernaudet / Lauranne Quentric – Et pluie voilà (Rouergue)
C’est un petit album légèrement mouillé qui retient notre attention dès la couverture : le bleu du nuage blanc est comme montré du doigt par un ciel tranquille. Les noms des auteurs, eux, tombent à pic. On tend les mains pour les recevoir avant qu’ils ne s’écrasent, avant qu’ils ne disparaissent au milieu des gouttelettes d’eau parfumées au citron et à la fraise. En tendant les mains on attrape le livre et là, Ô surprise ! Le livre est sec ! Alors on tourne les pages. Le texte copie derechef la couleur bleue du nuage blanc, un bleu entre cyan et céruléen, tout dépend de l’heure à laquelle on le regarde, tout dépend aussi de Greenwich et de l’opacité des rideaux. On tourne encore une page. Là, le texte devient rouge, on devine qu’il s’est mis en action. Alors on lit. Premier réflexe : comprendre. Ca tombe bien, les épuisettes de grenouilles forment une rigole dans la tête, on rit, on a saisi l’esprit. Après, puisque tout va bien, on embarque pour un tour du monde avec des chats, des fourchettes, des tasses, des pots de chambre, des clous. Le voyage est piquant, il ne coûte pas cher mais il est bien dépaysant. On circule à pied et à contrepied, en trottinette ou en luge, c’est le déluge de découvertes. Sans le vouloir on joue avec les doubles-sens, les métaphores, les têtes à queue. Tout ça rien qu’en regardant la pluie tomber d’un pays à un autre. On joue avec le langage, on s’amuse avec les images. On sort de là rincés de plaisir.
Quand Christophe Pernaudet nous faisait savoir, dans Fictionnaire vermeilleux (Grund, 2014) que la « Diezelle » est un animal de la famille des antilopes qui fonctionne au diesel, à ne pas confondre avec la « Gazelle », qui, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ne fonctionne pas au gaz… Et que le « clafoutu » est un clafouti resté trop longtemps au four… est-ce qu’on ne voit pas tout de suite ce qu’on n’envisagerait plus autrement ? Pas besoin de faire un dessin ? Mais si, justement… Lauranne Quentric réussit l’exercice délicat – il faut le souligner et s’en émouvoir sans retenue – de rendre ses illustrations indispensables à la drôlerie décalée du texte. Elle utilise des formes encrées, tampons ou linogravures, ou découpages numériques, ou papier découpés dont certains transparents. Elle utilise aussi un esprit affuté. Le résultat est sobre et séduisant, barbotant, expressif, juste.
Ainsi,
Au pays de Galles, la pluie fait un peu mal…
Pour cette raison, été comme hiver,
les habitants sortent toujours bien couverts.
L’image représente couteaux et fourchettes tombant du nuage… Eh oui.
Bref, on se surprend à rêver que le duo Pernaudet / Quentric collabore durablement. Mais on sait bien que ce n’est jamais si simple dans le monde de l’édition (on n’est pas nés de la dernière pluie).
P.V.
 Maurice Sendak/ Ruth Krauss – Une maison très spéciale (MeMo )
Maurice Sendak/ Ruth Krauss – Une maison très spéciale (MeMo )
dii-dii-dii oh-h-h
« Liberté » semble être le mot que se sont donné Maurice Sendak et sa fidèle collaboratrice Ruth Krauss pour Une maison très spéciale (1953). Une belle rêverie en perspective dans laquelle un enfant chantonne sa joie de vivre et laisse vagabonder son esprit, dans un décor finalement aussi peu défini qu’une feuille blanche, puisque cette fameuse maison très spéciale n’existe que dans sa tête. Texte et dessins sont ici en totale adéquation : sur un fond orange, le petit garçon déambule dans la page, avec sur son visage, ce mélange d’expressions propres à Sendak entre énormes sourires et sérieux imperturbable de l’enfant aspiré dans le petit théâtre de son imaginaire. Seul élément coloré, sa petite salopette bleutée passe d’une extrémité à l’autre et le vide se comble progressivement, au fur et mesure de ses inventions, le dessin de Sendak imitant celui des bambins sur un tableau noir. Un lion, un lapin, un âne, des écureuils, d’autres habitations, un clown, des singes chanteurs dessinés au feutre noir avec des formes gauches magnifiques, viennent peupler, voire saturer l’espace. Elles métamorphosent la maladresse en art brut et en épure stylisée. Tandis que les créations se chevauchent à l’image, les mots se dénouent, s’enfuient, s’inventent en ribambelles insensées et joyeuses. Les règles de la logique sont anéanties, parce que très honnêtement le petit garçon se fout éperdument du réel, enfoui dans la beauté de ses jeux solitaires ; c’est ce qui est si beau dans « Une maison très spéciale », cette capacité à capter le surréalisme ludique spontané de cet âge, à l’heure où le regard social n’existe pas. Il ne s’agit pas de recréer artificiellement des mots camouflant l’analyse adulte, mais d’être à l’écoute de ce langage si particulier qui invite l’adulte à s’émerveiller, à assister à la naissance de la fantaisie avant qu’elle soit bridée par les conventions et l’intégration au monde. C’est probablement dans cet éloge du non-sens, de l’absence de narration, de la déstructuration du langage ouvrant grand la porte aux onomatopées, que l’œuvre de Ruth Krauss et Maurice Sendak s’avère la plus subversive. Le lion fait irruption, mange les coussins, le lapin joue de la harpe, l’enfant à 4 pattes suit les poulets qui font « cot » « cot ». Tout s’enchevêtre dans un désordre joyeux, sans autre direction que le lâcher prise :
on court on court on entre on sort – on joue houou houhou – on joue à être des poulets on chante un opéra et puis on court on court on court hou hou hou
Même la ponctuation se barre ! Et le dictionnaire de s’évanouir vers d’autres galaxies :
Oh elle est jouste en plein mouillieux de ma tête tête tête
Dans cette dimension, il suffit de penser à une chose pour qu’elle existe, que le signifiant soit prononcé pour que son signifié apparaisse. Et pas seulement les animaux ou les choses. L’écriture aussi, renvoyant aux calligrammes d’Apollinaire, n’autorise aucune interdiction. Tandis que le gamin parle de ses objets spéciaux, apparaissent une chaise au dossier démesuré, un lit à ressorts comme un trampoline, une porte suspendue à laquelle on peut s’accrocher, et le mot « Spécial » vient leur servir de légende.
Très simple en apparence, affranchie de toute contrainte en réalité, Une maison très spéciale ne donne pas seulement une clé pour l’éducation des enfants, il laisse aussi le choix aux adultes de se libérer, de sortir à leur tour dans la rue pour chanter à tue-tête, gambader, partir à la recherche du moi perdu, le plus essentiel, celui de nos années oubliées, écoutant notre beauté intérieure sans se soucier du regard des autres. Dans la forme comme le fond qu’il véhicule, Une Maison très spéciale reste encore, presque 70 ans après sa publication, un livre aussi rebelle que son petit protagoniste, qui a sans doute bien grandi depuis, et qu’on imagine vieux monsieur insoumis et rieur comme l’enfant qu’il était.
ENCORE ENCORE ENCORE ENCORE
ENCORE ENCORE ENCORE ENCORE
Et PERSONNE ne dit stop stop stop
O.R.
Et aussi …
 Max Ducos – Le garçon du Phare (La Sarbacane)
Max Ducos – Le garçon du Phare (La Sarbacane)
Pas facile de grandir : les parents sont partis, et Timothée rêve de partager avec sa grande sœur une histoire, comme depuis toujours. Mais Philippine a grandi, et elle préfère son téléphone portable. De rage, Timothée déchire le dessin qu’il avait préparé pour rêver avec elle… et découvre un phare, peint à même le mur de sa chambre. Il approche sa main, puis se rend compte qu’il peut passer complètement de l’autre côté.
Là, il y découvre un phare, sublime, accroché à un rocher. Et un autre garçon, Morgan, qui vivait sur l’île qu’on aperçoit au loin avant qu’une trahison ne le pousse à l’exil. Sauf que le temps presse : il doit retourner à son île merveilleuse, l’Orléande, avant l’équinoxe suivante, sinon le capitaine du bateau va massacrer les licornes. N’était-ce bien sûr, le Dodécapus qui rôde dans les flots : les deux garçons vont devoir unir leurs forces et profiter de l’ingéniosité de Timothée et du courage de Morgan.
Nouvel ouvrage pour Max Ducos, chez Sarbacane, connu depuis son coup d’essai et de maître Jeu de pistes à Volubilis, promenade au milieu des grands maîtres de l’architecture moderne. D’architecture, dans le fond, il est question aussi ici, avec ce grand phare qui se dresse dès la couverture. C’est lui qui va polariser la rencontre des enfants, et l’imaginaire tout entier du récit, somme toute convenu, et du trait : aux gros plans naïfs des enfants, l’auteur oppose de magnifiques pleines pages architecturales et paysagères, où la gouache magnifie avec précision la beauté de l’eau, du ciel qui explose en taches chaudes, et de ce pic blanc dressé au milieu de l’océan.
On cherche à y arrêter le regard, à sentir le vent, l’eau, la roche, sur cette île du rêve et de l’amitié.
Ces instants de suspension sont ceux qui ouvrent le mieux à l’imaginaire, jusqu’à s’inscrire sur les murs de la chambre de Timothée, comme un espace de rêverie marine, un espace des possibles dans cet ouvrage finalement bien sage.
J.N.S
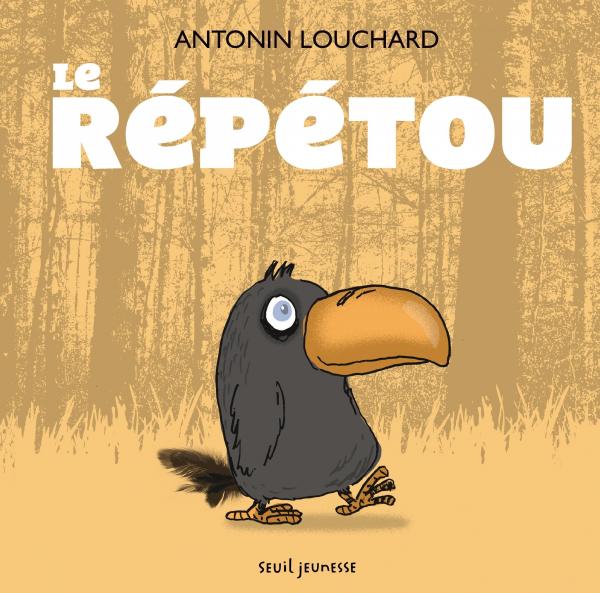 Antonin Louchard – Le répétou (Seuil jeunesse)
Antonin Louchard – Le répétou (Seuil jeunesse)
Une friandise, enfin : vous souvenez-vous ce petit moment agaçant où un camarade de classe, un frère mal embouché ou un grand de l’école s’amusait à répéter tout ce qui sortait de votre bouche (tout ce qui sortait de votre bouche) ? Il y a pire (il y a pire) : certains animaux sont nés ainsi.
De toute la création du Monde, malheur à celui qui croise le Répétou. Car si celui-ci ne fait pas non seulement que répéter tout ce que vous dites (tout ce que vous dites), et qu’il s’amuse pour cela à LE HURLER (LE HURLER), il se trouve que le malheur veuille qu’il soit gravement contagieux (zut).
Dans ce nouvel album du drôlissime Antonin Louchard, on retrouve tout ce qui faisait le sel des précédents opus, de Super Cagoule à Je suis un lion : un trait très bédéesque qui incarne immédiatement le décalage (on retrouvera ici nos amis la poule à cagoule magique et le petit canard vulgaire), une efficacité orale qui rendra la lecture vivante à chaque instant et une effronterie dans les mots qui fera hurler de rire parents comme enfants. Certes, ce n’est pas le meilleur de la série, et la chute est attendue.
Certes, la formule commence à faire son temps. Mais il n’empêche : par son oralité, sa capacité à enseigner aux enfants le second degré, l’humour et l’irrévérence par l’esprit, ce petit album décalé se savoure avec plaisir, qu’importe l’âge.
J.N.S
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).









