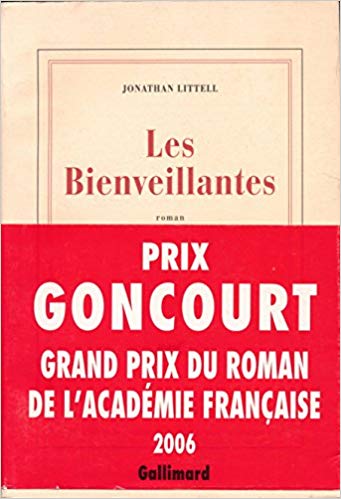A l’heure de la sortie en poche de ce lauréat du Prix Goncourt 2006 il semble important de revenir sur « Les bienveillantes » tant l’œuvre mérite l’attention que cela soit par le projet qu’elle illustre comme par son contenu.
Histoire et contexte particuliers en effet et par là même une tâche monumentale à laquelle Jonathan Littell s’est astreinte : Raconter le quotidien d’un officier SS des premiers jours de la campagne de Russie de 1941 à la chute finale du printemps 45. Aborder à ce titre aussi bien les faits historiques avérés (de la campagne d’Ukraine à Stalingrad, de la Hongrie à Auschwitz) que d’étudier en profondeur les ressorts psychologiques de cet officier (enfin aussi profond que le souhaite le narrateur (belle ironie) puisque le roman se présente sous la forme de souvenirs écrits par la plume même du personnage principal). L’intérêt du livre est en effet dans son intrigue et sa narration meme si certaines ficelles dramatiques sont peut-être un peu trop grosses (la rencontre « amoureuse » par exemple). Du point de vue littéraire, on peut d’ailleurs dire que ce livre n’apporte aucune forme singulière, aucune écriture propre, il est même de ce point de vue assez classique. Sa force vaut avant tout par le fond de l’ouvrage qui emporte tout sur son passage.
Le livre traite à la fois la campagne de Russie et d’une manière générale la guerre à l’Est et du processus d’extermination des juifs (et des autres populations jugées nocives comme les Tsiganes sans parler des populations à « tares » (sic) de type handicapés ou autres). La littérature liée à la Shoah a très souvent été centrée sur les victimes, le livre de Littell lui traite de cette question du point de vue des bourreaux en faisant errer le narrateur officier SS (plutôt bureaucrate que directement lié à l’action militaire) au gré des affectations et des missions dans ses deux funestes domaines d’activités. Ce n’est pas là le premier à le faire mais c’est tout de même un point de vue marginal.
Le premier chapitre (étourdissant) nous apprend d’ores et déjà que ce Dr Maximilien Aue a non seulement survécu à la guerre mais tout autant échappé au sort funeste que son statut d’officier SS aurait du promettre. Vivant en France, aimable vieux chef d’entreprise prospère, époux détaché mais courtois et serviable, il décide finalement de raconter au soir de sa vie son périple durant toutes ces années de guerre à partir de son arrivée en Ukraine à l’automne 41 (l’apogée du règne Hitlérien ?) jusqu’aux décombres du printemps 1945 et le déferlement sur le sol allemand des armées alliées à l’Est comme à l’Ouest.
Ce livre c’est un travail documentaire de titan, une somme de détails creusés jusqu’à la fine frontière entre vraisemblable et véritable.
L’enjeu n’est donc pas de savoir si oui ou non cette crapule en réchappera puisque l’on sait dés la première phrase ou presque que c’est le cas, l’enjeu n’est non plus de connaître le fin mot de l’histoire (ou alors uniquement dans les toutes dernières pages du livre quand voyant la situation narrative et le peu de pages qu’il reste à lire on se demande donc comment cela « finira » tiens oui), la fin dans son ensemble d’ailleurs est relativement bâclée (différents personnages impliqués dans les récits parallèles tout du long du livre qui se retrouvent au fin fond de la Prusse orientale comme à la queue leu leu pour dénouer les derniers fils de l’intrigue en une unité de temps et de lieu… qui laisse pantois et circonspect. On y voit ici une preuve finalement du peu d’intérêt de l’écrivain pour la pure dramaturgie et les ressorts narratifs qui y sont liés. Non, l’enjeu ici est tout autre, Littell s’est focalisé sur le contexte, le vase clos (tant interne qu’externe finalement) et les questionnements que cette période (les actes comme leurs acteurs et/ou témoins) implique à ses yeux
Une obsession sans doute pour lui car on ne s’atèle pas à une telle tâche à la fois dans la construction d’un récit que dans l’amoncellement de documentations sans une sérieuse fixette sur les joyeusetés nazies durant la seconde guerre mondiale et une nécessité quasi-physique sans doute d’évacuer cette obsession sur papier
L’entreprise de coller au plus près à la réalité supposée d’un officier SS durant la campagne de Russie puis l’Endlosung peut étonner et sans doute choquer par son absence de parti pris. Il n’est même pas question de neutralité puisque Littell a choisi la voie du témoignage pur et simple du narrateur décidant bien des années plus tard de coucher sur papier son aventure (on ne peut parler de confession puisqu’il n’y ni repentance ni même conscience finalement d’une « faute »). Le relatif scandale est venu en tous les cas de cette question de rendre compte de la période la plus sombre de toute notre histoire moderne à travers en le narrant du point de vue du bourreau avec le risque d’empathie voire de voyeurisme qui en résultent.
Disons tout d’abord qu’en effet Littell décrit froidement et méthodiquement ce qui a pu se passer de ce côté-ci de l’histoire. Mais cela ne choquera finalement que ceux et celles peu au fait des atrocités commises durant la seconde guerre mondiale. S’il faut un livre pour prendre conscience qu’envoyer près de 6 millions de personnes dans les chambres à gaz n’est pas l’affaire d’un claquement de doigt, s’il faut ce livre pour prendre conscience que « nettoyer » un village pour prévenir toute action de collaboration avec les partisans revient à tuer un à un (ou demi-douzaine par demi-douzaine, voir pour s’en convaincre un épisode parmi les plus poignants de l’ouvrage) ses habitants, s’il faut ce livre enfin pour prendre conscience de ces exactions qui emmenèrent l’homme aux confins de l’inhumanité alors on pourra dire d’une part que c’est tout de même bien triste et d’autre part que le projet de Jonathan Littell n’aura pas été vain.
C’est que par ce livre, c’est le livre des morts qui est ouvert, c’est un livre qui participe même si c’est en filigrane à faire apparaître des hommes, des femmes, des enfants et même des nourrissons derrière ce qui n’est finalement de prime abord qu’une simple série statistique chiffrant les victimes (avant tout civiles mais aussi militaires) du dernier conflit mondial de ce côté-ci du front. Certes il est impossible de lire sans trauma ou nausée tel ou tel passage du livre (le plus souvent d’ailleurs par des simples phrases diluées ça et là au fil du récit : c’est par exemple une description lapidaire de l’intérieur d’une maison d’un village biélorusse, c’est encore un bref coup d’œil dans un fossé ukrainien, c’est toujours un regard échangé avec un juif attendant son tour d’être fusillé, tout cela bouleverse (on se rappelle alors le bref plan bouleversant du « Pianiste » de Polanski avec une petite fille seule qui pleure en tenant une cage d’oiseau ouverte alors qu’on s’affaire à faire monter tout un quartier de Varsovie dans un train) d’autant que ce n’est jamais appuyé et toujours (ou presque) comme un arrière-plan à la scène qui se déroule, l’œil du lecteur se confondant alors avec celui du narrateur (c’est peut-être d’ailleurs cela qui peut indisposer le plus en fait). On voit alors le narrateur, ce Docteur Maximilien Aue comme un « intérimaire du néant » (de l’expression d’Hannah Arendt à propos d’Adolf Eichmann). Pourtant chaque victime portait en elle une souffrance et un calvaire inimaginable ou presque, insupportable sûrement lorsqu’on les additionne ce qui laisse à penser finalement que s’en tenir aux chiffres lourds est sans doute gage de santé mentale et d’équilibre.
L’idée sous-jacente à cette histoire rejoint le concept de « La banalité du mal » cher à Hannah Arendt, concept exposé brièvement lors de son compte-rendu du procès d’Eichmann à Jérusalem puis repris ensuite de manière plus approfondie, cette idée de voir en cet Eichmann, celui-là même qui organisa et rationalisa le transport des déportés juifs vers les camps de la mort à travers toute l’Europe occupée non pas « une figure démoniaque, mais plutôt l’incarnation de « l’absence de pensée » chez l’être humain » (in « Eichmann à Jérusalem »). Les descriptions de Littell aussi bien celle des lignes arrières et de Berlin que celle du front, le récit de la chute progressive du régime également, sont exemplaires dans ce domaine là, on y croise parmi les soldats de la Wehrmacht comme au sein de la SS (et jusqu’au plus haut niveau) certes des personnalités dégénérées ou encore des personnes ambitieuses opportunistes mais aussi et surtout des personnes simplement dépassées par les événements (ce qui n’est pas une excuse puisque le zèle, lui, ne disparaît pas) et s’acquittant de leur tâche avec plus ou moins d’hébétude selon le degré de leur attachement à l’idéal national-socialiste (qui prend au fur et à mesure de la guerre la place dévolue au patriotisme). Ce Maximilien Aue est, quant à lui, un national-socialiste fervent mais contrairement au Eichmann décrit par Hannah Arendt cela ne l’empêche pas de beaucoup penser. Il pense surtout à l’absurde de tout ceci (et non sa vacuité, ce qui n’est pas tout à fait la même chose), aux déchaînements de violence qui lui font horreur sans doute plus parce qu’ils sont l’œuvre de « porcs » et de « mal instruits » que pour leur finalité, ce monde mis « sens dessus dessous » par les nazis et dans lequel il évolue convaincu de ses idéaux et écœuré par le spectacle quotidien de l’histoire en route.
Ces questionnements sur la barbarie, ces réflexions sur le quotidien d’un officier SS en pleine campagne de Russie du coté des Einsatzgruppen ne sont pas l’apanage, bon nombre de ses collègues les ont également (au beau milieu de psychopathes et de brutes ou de véritables carriéristes) et Jonathan Littell se garde bien de faire de ce Dr Aue un officier atypique, ainsi les discussions tant avec sa sœur qu’avec sa courtisane Hélène le dépeignent bien comme un national socialiste fervent et convaincu qui fait face à un discours bien plus critique. Cette subtilité évite (enfin je crois non ?) Toute empathie et remet au contraire la place du narrateur à la lumière de tout un peuple : C’est un idéaliste convaincu du bien fondé de la guerre que l’Allemagne d’Hitler mène, juste un petit peu trop raffiné et subtil pour encaisser tout cela version « tête dans le guidon ». Ainsi, à défaut d’être ou pas un monstre (la question est ouverte, ce livre n’entend pas y répondre) le narrateur participe tout du moins à l’organisation mise en place qui est quant à elle bel et bien monstrueuse.
Ce livre c’est un travail documentaire certes mais au service d’une œuvre littéraire avant tout.
Le cadre et les enjeux posés, il convient alors de se rappeler que c’est un roman que nous avons entre les mains et non un livre documentaire d’historien ou de témoin. C’est une fiction même si, on l’a dit en préambule, Littell n’a finalement que peu d’intérêt pour le fil narratif et dramaturgique de son histoire. Alors en quoi au-delà du rendu plausible et détaillé des événements de cette guerre ce livre fascine et peut se voir comme un roman singulier (au sens premier du terme) ce n’est pas tant pour le fil cousu de fil blanc de l’intrigue ni pour l’écriture presque impersonnelle ou en tous les cas purement fonctionnelle que pour la richesse, la singularité et la profondeur du personnage principal.
L’écrivain philosophe Miguel de Unamuno en parlant plus précisément de Dostoïevski disait :
« En Russie, le roman n’appartient pas á un genre, ce n’est pas de la littérature. C’est une création quelque chose de chair et de sang. Et c’est de l’histoire, histoire créée et pas seulement racontée. » (in « Les Techniques narratives dans Saint Manuel le Bon, Martyr de Unamuno et « Le Grand Inquisiteur » de Dostoïevski » de « L’ International Dostoïevski Society » ©.))
Quand il est question de Dostoïevski en effet il est question, plus que tout autre, de personnages de chair et de sang. Il s’agissait pour lui non pas de rendre compte d’une situation, d’un contexte (comme un écrivain dresserait un « tableau » d’un pays ou d’une époque) mais bel et bien d’aller au cœur des choses, à l’intérieur même et voir ce qui s’y dit et ce qu’il s’y passe. On retrouve chez Littell ce même soin porté à son personnage, cette même profondeur, cette même chair et ce même sang. C’est précisément pour cette typologie Dostoïevskienne du narrateur et personnage principal que ce livre est à mes yeux remarquable.
Notons toutefois que si l’on évoque ici pour ce Dr Maximilien Aue un personnage « à la Dostoïevski » il s’en différencie toutefois dans son rapport à la morale. Chez le grand russe en effet, les personnages les plus forts et les plus remarquables de son œuvre lutent contre eux-mêmes le plus souvent pour s’approcher de la haute morale qu’ils placent au-dessus de tout; cette question est centrale dans l’œuvre de Dostoïevski.
Dans le livre de Littell l’impératif catégorique kantien est certes longuement cité et discuté par le narrateur met celui-ci met sa propre vie et son propre sort (et il n’attend d’ailleurs pas pour cela les toutes dernières pages du livre) bien plus haut que le questionnement de la morale. Celle-ci est citée presque comme à regret, parce qu’il s’agit là d’un homme raffiné et cultivé tout de même et qu’on se pose tout de même quelques questions quand on en se retrouve à quatre pattes à Auschwitz en train de jouer avec le fils de Rudolf Höss, le responsable du camp, tandis qu’on massacre là-bas, derrière la haute haie, dans les baraquements des populations entières d’hommes, de femmes et d’enfants
La conclusion du livre est à ce point exemplaire, non pas tant par les toutes dernières pages qui nous informent comment finalement le narrateur échappera à la nasse dans laquelle pouvait se trouver un officier SS qui se retrouve au beau milieu de l’avancée russe sur les terres prussiennes (le premier chapitre nous l’apprenait déjà) que pour les dernières descriptions des prisonniers « évacués » des camps de concentration pour tant servir de main d’œuvre industrielle (c’est que la guerre n’est pas totalement finie) que pour ne pas laisser de témoins vivants à l’avancée de l’armée rouge et sa découverte des camps. Là il n’est plus question d’hommes et de femmes, juifs certes, mais simplement de « cheptel » et de « troupeau », tant par l’état d’hébétude de ces êtres précipités en enfer et comme hébétés d’être toujours « vivants » que par la masse qu’ils forment ainsi réunis. Lorsque le fil s’accélère et que l’urgence devient simplement de fuir devant l’avancée de l’ennemi et le chaos anarchique qu’elle entraîne alors plus rien d’autre finalement ne compte, ni la tâche qui nous est confiée ni l’amitié ni rien d’autre.
Un autre romancier à évoquer est Brett Eaton Ellis tant l’accumulation (c’est bien simple, chaque personnage est précédé de son grade quand il en possède un tout du long du livre (1400 pages en édition poche, faites le compte). On pense bien évidemment par cet excès procédurière à « American psycho » de Ellis avec une semblable énumération de marques, la meme impression qui au final sclérose et enclave le narrateur dans son monde, pour cela cette avalanche de titres et de grades. Comment mieux rendre compte du primat de la hiérarchie dans une organisation militaire qui plus est étatique et qui plus est totalitaire? Un monde vertical avec les puissants et puis les autres et puis voilà. L’aristocratie vénéneuse du narrateur en est d’ailleurs une autre illustration et une explication de plus peut-être à son activité. Là encore l’idée n’est pas tant de choquer ou de lasser que de rendre compte le plus précisément possible d’une réalité
Ce livre c’est une œuvre littéraire haletante, riche et douée d’une grande puissance évocatrice
Il est évident que la prose accumulative d’horreurs décrites froidement et qui plus est rythmée par l’énoncé méticuleux des grades des personnages allemands rebutera nombre de lecteurs. Ce ne sont pas là d’ailleurs ses seuls bémols.
Ainsi quelques ressorts de l’intrigue semblent un peu tirés par les cheveux pour ne pas dire plus (quelques « retrouvailles » hasardeuses en plein feu qui tombent un tantinet trop vite du ciel, quelques visages historiques toujours dans un coin du décor sans que cela ne semble nécessaire et pertinent (c’est très simple : au-delà du cas de trois d’entre eux qui sont des personnage secondaires du livre on les croise à peu près tous jusqu’au premier d’entre eux, une guerre bien remplie au final pour le narrateur qui en aurait fait peut être un peu trop pour que cela soit absolument crédible). On peut d’ailleurs voir avec un peu de d’ailleurs un petit côté « ForreSS Gump » (vous savez « La vie est une caisse de bouteilles de Schnaps, on ne sait jamais sur qui va tomber la bouteille éventée ») avec le brave Forrest Maximilien qui traverse cinq années de petite et de grande histoire mondiale avec comme seule et unique envie de culbuter sa sœur ou à défaut le vigoureux Oberstumführer qui cite Caton le vieux en donnant le coup de grâce à une vieille ukrainienne édentée. Et bien évidemment lors de sa folle jeunesse parisienne le gentil Maximilien est devenu un grand copain de Brasillach. Encore un peu et c’est lui qui envoyait Rudolf Hess en biplan au-dessus de l’Ecosse et qui initiait Goering aux joies de l’orgie sous morphine…
On peut tout autant se lasser de la longue litanie d’exposés (philosophiques, sociologiques, anthropologiques, linguistiques etc.) qui suintent d’un peu trop près la paraphrase et le copié collé emprunté à un traité scientifique et/ou historique et/ou anthropologique et/ou philosophique semble encore par trop frais.
Mais à défaut d’être un chef d’œuvre le premier roman de Littell est tout de même une œuvre forte et remarquable. Quelques passages sont de véritables tours de force comme le chapitre introductif assez magistral ou encore celui qui rend compte des derniers instants vécus dans un Stalingrad en plein chaos (difficile d’être précis sans en dire trop désolé) par le narrateur qui est tout simplement extraordinaire et l’un des seuls moments peut être de pure grâce littéraire de ce roman. J’ai parlé un peu plus haut des « exposés » pluridisciplinaires successifs au fil des pages qui interloquent quelque peu mais il en est particulièrement un qui en impose et par son contenu et par sa trame, celui qui met en scène une improbable (et pourtant…) session d’un conseil scientifique réunissant experts de la SS et de la Wehrmacht pour déterminer si oui ou non une peuplade du Caucase (nous sommes du côté du Daguestan) a une origine juive ou non (et la question est importante vous l’imaginez bien). S’en suit alors sur une quarantaine de pages les arguments successifs et contradictoires des experts relevant tant de la linguistique que de l’anatomie ou de l’anthropologie en un mélange d’érudition et d’absurde assez dantesque et mémorable. Une double illustration en fait et de l’absurdité surréaliste du quotidien des bourreaux (a contrario de l’absurdité oh combien réelle du côté des victimes) et de la méticulosité avec laquelle Littell a construit son récit en s’obligeant à délier jusqu’au bout tous les fils narratifs et explications qui s’offraient à lui. Cette volonté de tendre vers le vraisemblable et la quasi-exhaustivité de l’entreprise est une véritable épreuve de force brillamment relevée pour qui ne sera pas rebuté par l’écueil de l’accumulation sur lequel par contre Jonathan Littell se vautre allègrement.
Un mot sur un moment particulièrement incongru de ce roman-fleuve (Petit rappel en guise d’avertissement pour les futurs lecteurs : 1400 pages d’abomination et de détails précis de la barbarie en version poche, sans compter le lexique en fin de livre et le tableau des grades allemands!) quand on se retrouve pris d’un fou rire (un vrai de vrai) lors de la brève rencontre du narrateur avec Hitler dans les derniers moments du livre. Oui, vous avez bien lu, « Bienveillantes + Hitler = Fou rire ». On pense alors à Bertold Brecht (si si, c’est qu’on a des lettres) qui disait que « Hitler, malgré tous ses crimes, n’en était pas moins un clown ». On n’a jamais été aussi près avec cet épisode précis.
Ce passage et ce (subtil) décalage entre l’incongruité du propos et le sérieux avec lequel il est relaté par le narrateur nous interroge d’ailleurs de manière pernicieuse. L’espèce de folie inconsciente (c’est cette fois du côté de Gogol que le personnage principal penche) qu’il subodore éclaire d’une toute autre lumière le fil rouge du livre qui est la relation du narrateur tant avec sa sœur jumelle qu’avec sa mère, sans oublier bien au contraire ses conséquences d’ailleurs. On en vient alors se poser une question surréaliste pour ce qui est finalement tout de même un exercice de fiction : et si tout était inventé ? Et si tout ce qu’on vient de lire jusqu’ici n’était que le fruit d’un souvenir formaté et déformé ? Un comble non ? Un véritable tour de force en tous les cas.
En conclusion : German psycho ?
Les bienveillantes » peut se rapprocher du livre « Seul dans Berlin« de Hans Fallada, un récit des années de guerre (récit débutant en juin 40 après la campagne de France) qui narre le quotidien d’un immeuble berlinois avec son lot de nazis convaincus, de trafiquants à la petite semaine, de pauvres hères vivotant tant bien que mal et de famille juive mal en point, un ouvrage sorti tout juste après la guerre et rédigé d’ailleurs en grande partie à l’époque même des faits. Les deux livres dressent l’un et l’autre avec leurs styles et leurs propres enjeux/intrigues un riche tableau de cette sombre période du côté de nos amis allemands (beau tour de force tout de même en passant pour le premier roman du jeune Jonathan Littell que de venir en contrepoint crédible d’un livre écrit tout juste au sortir de la guerre).
« Les bienveillantes » se distingue toutefois en grande partie par son personnage principal, qu’on verrait bien en frère caché Karamazov par exemple, même s’il est peut-être un peu trop beau et trop peu affiné pour être vrai (n’est pas Dostoïevski qui veut). Mais au-delà du blabla littéraire il reste une évocation forte et sourde de massacres perpétrés par l’armée allemande principalement aux confins de l’est de l’Europe. Puisse la mémoire de chaque personne martyrisée et assassinée froidement à cette occasion reposer en paix jusque la fin des temps.
Pour rebondir sur cet aimable marche-pied historique et s’en aller tutoyer le ciel rouge brun quelques lectures conseillées :
D’un point de vue historique, en-dehors du « Eichmann à Jérusalem » d’Hannah Arendt la lecture de « Les bourreaux volontaires d’Hitler » de D.J Goldhagen sous titré « Les allemands ordinaires et l’holocauste ». Pour les motivés citons bien entendu l’ouvrage somme de Raul Hillberg « La destruction des juifs d’Europe ».
Pour la question littéraire le livre de Hans Fallada « Seul dans Berlin » ainsi que celui de Robert Merle « La mort est mon métier ».
Il y en a évidemment d’autres, pour tout conseil de lecture le mode « commentaire » est là pour cela (entre autre).
Compléments d’infos Sur Dostoïevski, merci aux sources suivantes :
http://www.utoronto.ca/tsq/DS/08/155.shtml
http://lunch.free.fr
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).