 Florist, Jellywish (Double Double Whammy)
Florist, Jellywish (Double Double Whammy)
Emmené par la chanteuse, autrice et compositrice Emily Sprague, le quatuor new-yorkais Florist offre avec son cinquième album un modèle de délicatesse frémissante, habitée. Jeu de mots sur le nom, en anglais, de la méduse (jellyfish), Jellywish embrasse le caractère solitaire de l’animal, sa nage perpétuelle rythmée par des battements analogues à ceux du cœur, sa fragilité apparente, mais aussi la force de son venin. Sa brûlure est celle des souvenirs.
« Should anything be pleasure when suffering is everywhere » interroge Levitate, chanson d’ouverture acoustique, dépouillée, qui parvient néanmoins à créer autour d’elle un périmètre à la sécurité fragile. Elle permet surtout à l’esprit de commencer sa déambulation, de corps en corps façon métempsychose (Have Heaven), vers des lieux incertains malgré leur familiarité (Jellyfish). Les frontières entre ce qui appartient à la réalité et ce qui se situe hors de sa perception ne cessent de se brouiller, à la façon d’une image tremblée dont une partie serait fixée dans l’au-delà (« a photograph I will never know », All The Same Light) sans que l’on puisse déterminer si la mort qui revient si souvent dans les textes est ou non symbolique ; la seule certitude est l’empreinte qu’elle laisse dans la mémoire puisque « only the dead survive » (This Was a Gift). Par bouffées brèves, on entrevoit pourtant quelques instantanés d’un quotidien partagé, une sorte de sérénité domestique parfois à portée comme dans Sparkle Song (« you and our dog in the yard/I can’t think of anything better »), même si une forme de désarroi résigné ne tarde jamais à se manifester (Our Hearts in a Room). Gloom Designs, l’ultime chanson, ne débrouille guère l’écheveau : « In my life will I see the day we can be face to face/I was only 22 when I lost you » pose le paradoxe de l’absence et de la présence qui sous-tend un album à la fois dérivant et ancré, dans lequel les repères semblent s’être sinon dissous, du moins érodés. Reste une douceur tenace jusqu’à tenailler, des éclats poétiques (« can you love the cloud just floating around jellyfish no brain but a wish »), un brasillement d’espérance.
 Bob Mould, Here We Go Crazy (Granary Music/BMG)
Bob Mould, Here We Go Crazy (Granary Music/BMG)
À soixante ans passés, Bob Mould dégage toujours la même énergie, la même radicalité nourrie par une rage sourde. Here We Go Crazy, son seizième album solo, sonne comme un classique constellé de chansons aussi directes qu’un uppercut, sonorités acérées, mots inapaisés portés par des mélodies au cordeau. Comment ne pas songer, en écoutant Neanderthal (« Amber and ochre mixed with sweat and cum ») ou When Your Heart Is Broken (« Watch it burn, watch it blaze/Glowing embers, endless days ») aux réalisations de son ancien groupe, Sugar ? Les années cependant laissent leur empreinte ; l’homme demeure combatif mais le regard qu’il porte sur la course folle du monde (« This ugly new astronomy », Here We Go Crazy) n’en est pas moins désabusé. Au souvenir des addictions passées qui se tordent comme autant de spectres (Fur Mink Augurs) s’additionne une conscience plus aiguë de ce que le temps emporte (Lost Or Stolen), des inquiétudes qu’il fait surgir. Elles s’expriment sans fard dans You Need To Shine (« I worry myself sick about the wear and tear and strain ») pour mieux rappeler la nécessité de célébrer chaque instant partagé. Ce titre et les deux qui le suivent (Thread So Thin, Your Side) pour former le trio final parlent d’amour, sans nul doute celui qui lie Mould à son mari ; il semble y avoir trouvé une forme de tranquillité qui n’a pas étouffé ses embrasements.
 Throwing Muses, Moonlight Concessions (Fire Records)
Throwing Muses, Moonlight Concessions (Fire Records)
Inépuisables Throwing Muses, présence familière depuis le milieu des années 1980 malgré un hiatus de quinze ans qui aura au moins eu pour avantage de favoriser l’envol de Kristin Hersh et de la faire reconnaître dès sa première tentative en solo (Hips and Makers, 1994) comme un des talents les plus singuliers du « rock indépendant ». Moonlight Concessions, onzième album du groupe, se révèle concis (à peine une demi-heure), concentré. Si, par le passé, les Muses ont aimé s’affronter aux murs sonores les plus râpeux, l’impression qui domine ici est acoustique, sans aucune tentation pastel. Aiguisées, tendues (South Coast en offre un excellent exemple), les chansons ne se départent jamais d’une certaine noirceur, fût-elle vaporeuse – Theremini et plus encore Sally’s Beauty, qui sonne comme un morceau oublié de This Mortal Coil, viennent rappeler que le groupe fut jadis un des joyaux du label 4AD. Omniprésent, le violoncelle de Pete Harvey tisse un fil à la fois lyrique et nostalgique, quand les textes volontiers elliptiques évoquent la survie (Albatross), l’obsession déroutante dont la voix de Hersh épouse le moindre angle (You’re Clouds). Aucune fioriture dans ces dessins à la pointe sèche, directs et tortueux à la fois, mais un impact émotionnel certain qui installe Moonlight Concessions parmi les meilleurs disques des Throwing Muses.
 Destroyer, Dan’s Boogie (Merge Records)
Destroyer, Dan’s Boogie (Merge Records)
Dan Bejar fait son cinéma. C’est ce qu’on se dit en découvrant le quatorzième album signé par le Canadien sous le nom de Destroyer, plans larges, sonorités luxuriantes, relevant une nouvelle fois le pari de ne pas se répéter. En parlé-chanté la plupart du temps – marque de fabrique –, la voix distille ce mélange inimitable de présence distante, d’ironie chaleureuse, comme si contempler la défaite des mondes extérieur, intérieur, assister à leur craquèlement n’était pas si grave, générait même de la beauté. Une des forces de ce disque est de la débusquer jusque dans les moindres recoins pour mieux irradier l’ensemble. Brève comme l’éclair dans I Materialize, haïku décollé d’un coup par une bourrasque tranchante, elle se fait vagabonde sans autre but qu’elle-même (« You take the night train/And live to see/Another day ») le long des vastes avenues de Cataract Time, bordées par le saxophone de Joseph Shabason, ou contemplation fragile déroulant les versets de The Ignoramus of Love (« The sun mostly rises/A great golden spike through the heart of the world (…) There’s nothing in here, everything’s been burned »). « All my past is littered with ghosts » avouait Sun Meets Snow où s’affrontent jusqu’au chaos froidure et brûlure ; « Women missing » (The Same Thing as Nothing at All), « absent friends » (Hydroplaning Off the Edge of the World), « you’ll never see me again » répété comme un mantra (Bologna, dont Bejar s’absente, confiant le chant à Simone Schmidt), jusqu’à l’évaporation finale de Travel Light : un album troué de part en part dans l’espoir que la lumière l’envahisse.
 Jeanne Cherhal, Jeanne (Éditions Tibia/Décibels Production)
Jeanne Cherhal, Jeanne (Éditions Tibia/Décibels Production)
C’est par le sourire de Jean que Jeanne Cherhal a présenté son septième album, Jeanne. Il ne faut pas croire que cet hommage aussi admiratif qu’amusé à Dujardin résume une réalisation au ton personnel, grave parfois sans jamais être pesant, encore moins sentencieux. On sait la musicienne très attachée à la défense des femmes ; Le Cri des loups épingle les harceleurs avec une ironie dévastatrice, leur mise à distance textuelle permettant de les regarder en face ; Sous les toits image les violences conjugales, l’indifférence qui les entoure. Femme dans toutes ses dimensions, elle pose un regard d’une tendresse infinie sur La Maman et la putain, un qu’on suppose maternel dans Grande est ma chance. Intime, Jeanne l’est à plus d’un titre, une intimité joyeuse, libérée – La Marée célèbre l’arrivée providentielle de la ménopause, La Vie est trop courte dédramatise le recours aux antidépresseurs –, traversée par l’onde du désir dont Cherhal est un des sismographes les plus sensibles. Car il en faut de la finesse pour évoquer les jeux érotiques avec sextoy (Hitachi Magic Wand) ou transmettre la vibration procurée par le désir du corps d’un homme (Foutue) sans tomber dans la trivialité. Point d’orgue jubilatoire, Faut plus qu’on se revoie, cosigné et interprété avec Benjamin Biolay, qui a en outre réalisé tout l’album avec une maestria confondante permettant aux arrangements d’épouser chaque chanson comme un habit bien coupé : ce « quinze ans après » de Brandt Rhapsodie nous emporte dans son élan charnel et rieur. Les mélodies font mouche, mais Cherhal possède aussi un admirable sens du mot, écrit (ses textes, simples mais ciselés, abondent en trouvailles) comme chanté – poids juste, couleur exacte. Écoutez pour vous en convaincre les deux Rodrigues, ouverture et envoi du disque, moments hors du temps dont l’émotion vous submerge, installant ce « dernier paradis » pour longtemps dans votre cœur.
Avant-courrier
 These New Puritans, Bells.
These New Puritans, Bells.
On était sans nouvelles des frères Jack et George Barnett depuis la parution d’Inside The Rose en 2019 dont l’esprit expérimental avait semé quelques critiques en chemin (à la réécoute, le disque se tient toujours à merveille). Six ans plus tard, These New Puritans nous reviennent avec Crooked Wing, à paraître le 23 mai chez Domino. Les deux extraits dévoilés ne laissent deviner aucune inflexion d’un goût pour l’aventure sonore qui a fait quelquefois comparer le duo à Talk Talk. Industrial Love Song, avec la participation de Caroline Polachek, raconte l’histoire de deux grues sur un chantier de construction qui espèrent voir leurs ombres se croiser, seule possibilité pour elles de se manifester leur amour – la musique est aussi fantasmagorique que le sujet. Enfantée par le son de la cloche d’une petite église orthodoxe grecque, Bells se déploie comme un paysage résonnant d’échos scintillant à l’infini – un peu, toutes proportions gardées, à l’image de La Vallée des cloches dans les Miroirs composés par Ravel.
Instant classique
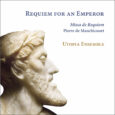 « Requiem for an Emperor » : Pierre de Manchicourt (ca 1510-1564) : Requiem. Œuvres d’Emanuel Adriaenssen (ca 1554-1604), Cornelius Canis (ca 1506-1561), Thomas Crecquillon (ca 1505-ca 1557), Antoine de Févin (ca 1470-ca 1511), Nicolas Gombert (ca 1495-ca 1560), Luis de Narváes (fl. 1526-1549), Nicolas Payen (ca 1512-ca 1559) et Jean Richafort (ca 1480-ca 1547).
« Requiem for an Emperor » : Pierre de Manchicourt (ca 1510-1564) : Requiem. Œuvres d’Emanuel Adriaenssen (ca 1554-1604), Cornelius Canis (ca 1506-1561), Thomas Crecquillon (ca 1505-ca 1557), Antoine de Févin (ca 1470-ca 1511), Nicolas Gombert (ca 1495-ca 1560), Luis de Narváes (fl. 1526-1549), Nicolas Payen (ca 1512-ca 1559) et Jean Richafort (ca 1480-ca 1547).
Utopia Ensemble. Jan Van Outryve (luth). Ramée.
L’histoire est jalonnée de monarques musiciens – Henry VIII, Louis XIII ou Frédéric II constituent des exemples célèbres. Élevé au sein de la cour humaniste de sa tante, Marguerite d’Autriche, Charles Quint (1500-1558) avait, dit-on, acquis assez de maîtrise pour pouvoir prendre part à une exécution polyphonique et pointer les erreurs de ceux qui y trébuchaient. Arrivé en âge de gouverner en 1515, il institua sans tarder sa propre chapelle, la Capilla flamenca. Le programme imaginé par Utopia, ensemble qui est en train de s’établir parmi les meilleurs pour le répertoire renaissant, n’est pas, malgré son titre (« Requiem pour un empereur »), une reconstitution mais une évocation de la thématique du deuil et de la mélancolie dans la première moité du XVIe siècle. La pièce principale est le Requiem composé par Pierre de Manchicourt, directeur de la Capilla, peut-être à la mémoire de son illustre fondateur. Sa grande clarté polyphonique n’a d’égale que sa fluidité mélodique, restituées par Utopia avec une lisibilité, une souplesse exemplaires. Les voix sont impeccables d’intonation (chapeau à la mezzo-soprano Michaela Riener, à la partie très exposée) mais aussi d’incarnation ; à mille lieues des ensembles qui s’aventurent dans ces entrelacs vocaux en regardant leurs chaussures, celui-ci leur insuffle une véritable force vitale sans perdre en intériorité pour autant. Ces qualités portent aussi le Nunc dimittis de Payen, auréolé d’espérance, à un rare degré d’intensité.
Compléments de choix, trois chansons de Gombert viennent rappeler à quelle qualité d’écriture vertigineuse était capable de s’élever ce compositeur à la destinée aussi tourmentée que parfois sa musique : les chromatismes douloureux d’O malheureuse journée, l’abattement qui assiège Mort et Fortune, les frémissements d’Ayme qui vouldra poignent le cœur. Belle idée aussi d’avoir réservé une place au luth toujours éloquent de Jan Van Outryve : pleine de délicatesse, son exécution de la Canción del Emperador imaginée par Narváes laisse entrer assez de silence pour rendre plus saisissant encore le Requiem qu’elle introduit, et Slaepen gaen d’Adriaenssen résonne comme un véritable adieu empli de nostalgie.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

















