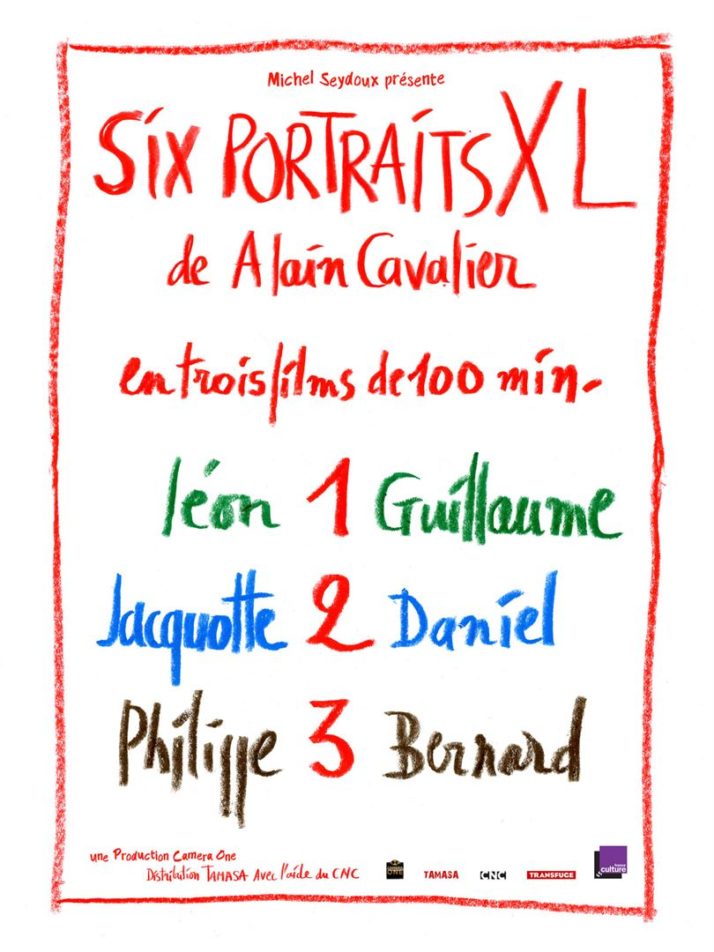Nicolas Saada avait a priori toutes les qualités requises pour nous donner l’envie de l’interviewer. Son premier long-métrage, Espion(s), est une très belle réussite (dont nous nous sommes fait l’écho ici même). Sa cinéphilie est quasi sans limites et sans préjugés (assez rare pour être souligné). Ses connaissances musicales ne sont probablement pas loin d’égaler ses connaissances cinématographiques (il fut pendant des années le maître d’œuvre de l’inégalable Nova fait son cinéma, qui a tant fait pour considérer les bandes originales en tant qu’objets artistiques à part entière). Et puis c’est surtout un homme absolument charmant et passionné.
La preuve ici, maintenant.
Espion(s) est ton premier film. Pourquoi démarrer par un « film de genre » et singulièrement un film d’espionnage ?
Je n’ai pas abordé l’étape du premier film comme ce moment où l’on se raconte intimement. D’autant plus que, mon premier film, je l’avais déjà fait avec Les Parallèles, moyen métrage tourné il y a quatre ans avec déjà Géraldine Pailhas mais aussi Matthieu Amalric, Jonathan Zaccaï, Bernard Verley… Même s’il ne dure que 35 minutes, je le considère vraiment comme un premier film. C’est un film qui a eu beaucoup d’écho et qui m’a permis de me débarrasser des angoisses du premier film. Ensuite, l’espionnage est un genre que j’ai toujours aimé, en accord avec ce qui m’avait ému quand j’étais sur les bancs de la Cinémathèque et que j’allais voir Man Hunt, L’Homme qui en savait trop, Les Trente-neuf marches… tous ces films des années 30-40-50. L’idée n’était pas non plus de faire un hommage, juste de raconter quelque chose qui m’importe et me préoccupe beaucoup, à savoir les rapports entre les gens aujourd’hui, au-delà même des rapports hommes-femmes. Mais je ne voulais pas le traiter en drame psychologique, je voulais que ça puisse naître dans le cadre d’un film de genre. Et l’espionnage m’intéresse car son matériau principal, c’est l’humain. J’aime l’espionnage tendance Le Carré, pas tendance Mission : Impossible 3, même si j’adore ce film, mais c’est dans cette veine humaine que je voulais travailler.
L’espionnage est un genre qui a été pas mal revisité par le cinéma français ces dernières années. Tu n’avais pas peur d’arriver après Agents secrets, Anthony Zimmer, Secret défense… ?
Pas vraiment car ces films ne sont pas du tout sur la même longueur d’ondes que la mienne, y compris visuellement. Je refuse de filmer des 4×4 rutilants noirs. Je refuse de filmer des gadgets. Plein de choses que je n’ai pas envie de filmer et que ces films-là montrent. Je ne suis pas du tout dans cet univers clinquant, « haut de gamme », ça n’est pas du tout ce que je cherchais. J’avais au contraire envie de poser ma petite pierre en faisant un film un peu plus âpre.
Est-ce que c’est la même logique qui te fait refuser les climax un peu faciles, un peu attendus ? Je pense notamment à la scène où Géraldine Pailhas doit récupérer des documents dans le bureau de son mari et où l‘associé syrien de ce dernier surgit…
A partir du moment où une scène a déjà été vue 2 800 fois au cinéma, si toi, tu la fais, tu dois la faire avec un vrai point de vue. Pour moi, l’enjeu de la scène n’est pas que Géraldine réussisse ou pas à voler la clé USB, c’est plutôt qu’elle se rende compte, en le trahissant, que son mari l’aime. D’où le jeu avec le code d’accès à l’ordinateur, qui est son propre prénom. Cette preuve d’amour me sert d’information supplémentaire sur son mari et sur elle-même. Scénaristiquement, cette scène me sert davantage à ça plutôt qu’à jouer la convention, même si je pense qu’on la joue quand même. En tension basse, mais on ne l’esquive pas.
Tes producteurs n’ont jamais fait pression pour que, au contraire, tu « muscles un peu ton jeu » et joues davantage avec les nerfs du spectateur ?
Bien sûr, j’ai eu de la pression de la part des producteurs. Michael Gentile, notamment, craignait que le film soit trop « doux ». Mais j’ai réussi à le convaincre de l’essence même du projet. Cette « douceur dans la tension », elle était déjà dans le scénario. Il n’y a pas eu tromperie : le film que j’ai fait correspond à celui que j’avais écrit. Je n’ai pas cherché à faire du Jason Bourne, mais pas non plus Quelques jours en septembre, de Santiago Amigorena, qui est pour moi un peu trop théorique. Je voulais faire un film qui me ressemble.

Copyright Mars Distribution
Tu as un passé de critique/journaliste de cinéma. Tu te considérais d’ailleurs plutôt critique ou plutôt journaliste ?
Ni l’un ni l’autre, je suis moi. Le journalisme, la critique furent des étapes dans ce que je suis devenu. J’ai fait beaucoup de choses mais sans jamais me laisser complètement absorbé par les endroits où j’étais quand je les faisais. J’ai toujours essayé de me préserver de ça. Je revendique les endroits par où je suis passé, mais je ne m’en sens pas le représentant, le disciple ou le porte-parole. Les Cahiers ont été un moment important de ma vie, j’y étais considéré comme le mec le plus Positif, et vu les réactions respectives des deux revues à mon film, je confirme que j’étais le mec le plus Positif des Cahiers. Aujourd’hui, je réfute l’idée même d’incarner les Cahiers, qui ne sont plus ceux que j’ai connus il y a vingt ans, un lieu ouvert, plutôt sexy et stimulant.
Mais est-ce que ce passé de critique/journaliste facilite les choses auprès des producteurs ou au contraire les complique en décuplant les attentes, par exemple ?
Heureusement pour moi, j’avais fait Les Parallèles, nommé aux Césars sélectionné dans quarante-deux festivals, quatre fois primé… J’arrivais donc avec ce film qui était plus qu’un petit bagage, une vraie expérience de cinéma, même si le tournage n’a duré que douze jours. C’était quand même pour moi un vrai film.
Te définirais-tu comme cinéaste-cinéphile ?
Pour moi, cinéaste-cinéphile, c’est un pléonasme. Dans n’importe quel corps de métier, on doit avoir une connaissance intime de ce que l’on fait. Un cordonnier, un cuisinier, un peintre, un musicien connaissent l’histoire de leur art. Le fait d’être cinéaste-cinéphile devrait être la norme, même si je sais que ça n’est pas forcément le cas. Mais la cinéphilie m’apporte plutôt des solutions que des envies d’hommage. Pour Espion(s), elle m’a aidé à raconter des choses que j’avais envie de raconter et à trouver des solutions pour y arriver. Mais je n’ai pas utilisé ce que je connaissais du cinéma pour faire des clins d’œil, des hommages, des coups de chapeau… c’est pas mon truc.
Un peu comme Truffaut se demandait : « Comment Lubitsch aurait réalisé cette scène » ?
C’est complètement ça. Je me pose toujours cette question du point de vue d’un cinéaste que j’aime par rapport à un genre de scène que lui pourrait ou aurait pu traiter. Je me rends compte aujourd’hui seulement que la première rencontre entre Géraldine et Guillaume vient complètement de La Peau douce, de Truffaut. En revanche, pour la scène du premier dîner, pour éviter de faire du James Bond, je pensais tout le temps aux films d’Ophüls, à leur côté capiteux, comme Madame de…, ou bien Visconti, où l’atmosphère devient tellement oppressante qu’elle met en évidence quelque chose de l’ordre de la pure décadence. J’aime bien cette scène parce qu’on sent davantage la décadence de Peter Burton et de son entourage que l’enjeu de savoir si Guillaume va lui soutirer ou pas les informations. J’aime bien que les scènes aillent jusque là où il ne faudrait qu’elles aillent. De façon à ce que ce ne soit pas une scène de plus, mais une scène qui raconte autre chose.

Copyright Mars Distribution
Comment est née l’idée du film ?
De deux choses. Depuis longtemps, je rêvais de faire mon film d’espionnage à la Hitchcock. Depuis bien avant le 11 septembre 2001, en tout cas. Mais c’est vrai que le 11 septembre a un peu précipité la réalité de l’hypothèse de ce film et l’envie de le faire. Et l’autre envie était de retravailler avec Géraldine Pailhas, que j’aime beaucoup. J’aimais bien l’idée d’avoir Géraldine en tête pour un rôle d’héroïne, ça me plaisait bien.
L’idée vient aussi d’un fait divers, je crois…
Oui, c’est venu de l’histoire des voleurs de bagages de Roissy, que je trouve absolument incroyable. Une histoire qui s’est d’ailleurs répétée à la fin du mixage du film, où on a arrêté un gang qui avait stocké je crois près de 160 000 € d’objets volés, dont beaucoup de parfums.
Tu as écrit le rôle de Claire pour Géraldine Pailhas. Mais comment s’est fait le choix de Guillaume Canet ? Avais-tu un acteur en tête au moment de l’écriture ?
Non. Il y avait un comédien qui aurait pu faire l’affaire mais dont j’ai compris très vite qu’il serait inutile de le lui proposer. Le choix de Guillaume est venu initialement de ma directrice de casting, qui m’avait fait part de l’intérêt de son agent. Quand j’ai rencontré Guillaume, j’ai eu vraiment une sorte de grand coup de foudre pour son charme, son look, pour plein de choses. Et je sentais surtout qu’il était en train de passer du jeune homme à l’homme et que le film pouvait attraper ça, puisque c’est un peu une histoire d’initiation. Je me suis dit qu’il collait parfaitement à ce rôle.
Dans le reste du casting, Archie Panjabi est très impressionnante. Comment l’as-tu découverte ?
Dans Un cœur invaincu de Michael Winterbottom, film vraiment sous-estimé, que je trouve du niveau des films de Paul Greengrass, aussi bien que Vol 93, par exemple, mais que personne n’a eu la curiosité de voir. J’étais justement avec ma directrice de casting qui m’a dit « tu devrais la prendre ». Je me suis dit que ce serait génial de l’avoir mais qu’elle ne ferait jamais mon film. Un premier film d’un jeune réalisateur français, je ne voyais pas comment ça pouvait attirer une actrice qui venait de faire Un cœur invaincu, Une grande année, de Ridley Scott, et The Constant Gardener, de Fernando Meirelles. Je n’étais pas du tout sûr qu’elle accepte. Et la directrice de casting anglaise du film m’a dit qu’Archie était intéressée, je l’ai rencontrée et ça a tout de suite accroché entre nous. J’étais très content qu’elle joue ce rôle car je savais qu’elle apporterait au film une modernité. Une sorte de regard moderne sur ce que l’Angleterre d’aujourd’hui est devenue, un lieu où une partie de la population immigrée veut prendre son destin en main, changer son image et prendre d’assaut les institutions comme les services secrets, la police, la santé, l’éducation… Archie incarne parfaitement ça. Son personnage m’a aussi été inspiré par Stella Rimington, directrice du MI5 entre 92 et 96, qui a divorcé pendant qu’elle dirigeait les services secrets britanniques, dont la vie personnelle était constamment entravée par son travail d’agent. Archie est une actrice douce, attentive, quelqu’un d’extrêmement rassurant sur un plateau. Je l’adore !

Copyright Mars Distribution
Ce qui est intéressant avec son rôle, c’est que l’on sent que le fait qu’elle soit d’origine indo-pakistanaise a une importance mais que le film ne le surligne jamais. Peut-être aussi parce que le scénario n’avait pas été écrit avec cette optique « ethnique »…
En partie, oui, mais je n’ai justement pas voulu réécrire le scénario. Je trouve que ça l’aurait alourdi et ça aurait été une erreur. En revanche, j’ai réécrit la scène du dîner chez les Burton. Parce que quand Malik voit cette femme qui sort avec un Français, ça l’interpelle, ça le trouble. Pas sûr qu’il l’accepte, d’ailleurs. Il trouve que quelque chose ne va pas et c’est pour ça qu’il les met tous les deux sur la sellette.
Pourquoi l’Angleterre ? Le MI5 est-il plus cinégénique que la DST ?
Je suis allé en Angleterre parce que je trouvais ça plus sexy. Je n’ai pas envie de filmer un mec dans une Safrane en train de dire « je vois cinq hommes à la station Châtelet, notre suspect a pris le RER D ». J’entends ça, je meurs de rire. La résolution d’une intrigue à Saint-Quentin-en-Yvelines, je n’aurais pas pu. Je me suis dit qu’il fallait rendre le genre à sa terre natale Et comme, pour moi, le genre, c’est aussi bien James Bond que Le Carré, et que même le registre du genre, c’est la langue anglaise, je savais qu’en tournant le film de genre en langue anglaise, j’aurais même le rythme de langue, plus concis, plus rapide, plus poétique… Et que mon chef opérateur Stéphane Fontaine et moi, on se sentirait plus à l’aise en filmant cette histoire à Londres.
La photo a justement un côté somnambulique…
Oui, une image dense, sombre… On avait le film noir en référence et on voulait surtout s’affranchir de la tendance orange/bleue du cinéma d’espionnage. La tendance orange/ocre a été imposée par Syriana, c’est d’ailleurs assez beau. Mais le reste du temps, c’est très bleu, très Tony Scott. Et moi, je ne voulais pas ces trucs-là, je ne voulais pas de ces images un peu trop chaudes, je trouve. Je voulais une image plus dure, plus froide, menaçante.
Parlons de la musique, évidemment ! Est-ce que tu avais la possibilité de choisir n’importe quel compositeur, en tant que grand spécialiste du genre ?
Il y a eu une première piste avec un groupe français bien connu, qui s’est trouvé vraiment très très proche de faire le film, mais ça n’a pas pu se faire pour des raisons de calendrier. Et j’avais une autre hypothèse, qui était presque impossible, qui était Cliff (Martinez), dont j’admirais le travail depuis toujours, dont j’aimais le côté très climatique. Je me disais que ce serait génial pour le film mais c’était un peu un rêve. Et il se trouve que son agent a aimé le film et qu’il a très vite exprimé le désir de faire le film. On s’est vu à New York, on a travaillé ensemble et ça a été un bonheur.
Lui-même avait déjà un peu travaillé dans le genre espionnage avec Soderbergh…
Il me paraissait idéal pour ce film et je suis très fier parce que c’est son premier film non-américain. Je savais qu’il apporterait une voix anglo-saxonne supplémentaire dans le film. Je cherchais ce mélange de cultures, de genres, d’affects, de styles… Son apport au film a été très important.
La musique est belle mais pas forcément très marquante, elle n’imprègne pas vraiment les esprits après la vision du film…
J’avais très peur d’écraser le film avec la musique. En même temps, je voulais qu’elle soit inoubliable avec le film, indissociable de l’expérience du film, qu’elle agisse sur lui au même titre que la lumière. Dans un rapport au spectateur pas du tout topique mais sobre et indicible.

Copyright Mars Distribution
L’extrait de L’Homme au bras d’or que l’on voit dans une scène à l’hôtel est-il un hommage au rôle de ce film dans l’histoire de la musique au cinéma ? *
Je voulais que ce soit un grand film qui passe à la télé dans cette scène. J’en ai marre de ces scènes de télé où les personnages regardent un jeu vidéo, une émission de télé-réalité ou un clip. Je me suis vite rendu compte qu’il fallait piocher dans le domaine public et dans ce choix très limité, L’Homme au bras d’or était pour le moi le plus intéressant. D’abord parce que je réalise aujourd’hui que Preminger est peut-être le plus grand cinéaste classique américain, plus encore que Hitchcock et Lang. On a le meilleur des deux mondes, avec lui. On a la veine des grands directeurs d’acteurs qu’étaient Nicholas Ray et Kazan, avec la pureté plastique des films d’Hitchcock ou de Fritz Lang. Aujourd’hui, avec ma maturité de cinéphile, et même si Htichcock restera toujours mon modèle, Preminger a été essentiel dans ces dernières années parce qu’il m’a fait comprendre qu’on pouvait être pertinent et élégant en même temps, qu’on n’avait pas à choisir entre l’un et l’autre. Même la présence de L’Homme au bras d’or est importante aussi à cause de Sinatra, que l’on aperçoit aussi sur une photo dans l’un des cafés où va se saouler Guillaume. C’est une de mes idoles.
C’est donc davantage un hommage à Preminger et Sinatra qu’à Bernstein ?
Mais la musique d’Elmer Bernstein pour ce film est géniale et j’avais demandé l’extrait avec la batterie, que je trouve très émouvant, parce que c’est un moment où le personnage de Sinatra n’a plus de rapport aux choses, il est complètement perdu, et ça fait écho au personnage de Guillaume, qui lâche tout.
Tu as toujours été un défenseur du cinéma de genre aux Cahiers, ce qui n’était pas toujours le cas du reste des critiques de la revue. Quel regard portes-tu sur ce cinéma aujourd’hui, as-tu envie de poursuivre dans cette voie comme réalisateur ?
Il y a un truc qui me frappe en France aujourd’hui, c’est que quand on dit cinéma de genre, il faut comprendre soit, films pas très bien financés ou ultra gore, où le tour de force consiste à arracher l’œil d’un mec avec une épingle à nourrice, pour le manger ensuite aux petits oignons dans un chalet abandonné dans la Saône. Ou bien on est dans une espèce de truc rutilant, post-Henri Verneuil, où les commissariats font mille mètres carrés, où il y a des écrans plats dans chaque appartement, où tout le monde se balade en Volvo dernier modèle, et là, on est dans un ridicule un peu Conforama du genre. Moi, je réfute l’un et l’autre. J’aime beaucoup ce que font des réalisateurs comme Greengrass, même si je n’ai absolument pas les moyens de rivaliser avec Espion(s), qui a été tourné en 42 jours, je tiens à le préciser. 42 jours, c’est pas beaucoup, pour un film comme ça. Dans le registre cinéma de genre un peu humain, j’ai été vachement ému quand j’étais jeune par L’Ami américain, de Wenders, qui est un film que j’adore, tout le temps dans le genre et tout le temps personnel. Y’a des flingues, y’a des filles et y’a du cinéma, avec une vraie scène d’assassinat à La Défense, tournée sérieusement, pas comme une parodie. J’ai adoré aussi Tu marcheras sur l’eau, La Vie des autres, The Constant Gardener. Je ressens une proximité avec ces films de genre où l’humain irrigue les situations et les conventions. Je suis très naturellement porté à vouloir faire un deuxième film dans le même genre, mais toujours en travaillant d’abord sur les relations humaines, le genre étant plutôt un arrière-plan venant les enrichir. Actuellement, j’ai une idée en tête, dont je me rends compte qu’elle nécessitera peut-être un arrière-plan fantastique. Ce sera comme une vraie grande histoire d’amour mais avec des enjeux fantastiques et policiers. Si j’aborde un jour le genre fantastique ou horreur, je ne veux surtout pas céder à la tentation facile de la violence gratuite, type tortures, gore, hémoglobine, corps qui explosent… Je veux que la tension soit directement liée à la mise en scène. Mais je pourrais faire une exception pour le feu, que je trouve plus cinématographique, qui vient de Carpenter, Cronenberg… Par ailleurs, j’ai aussi une idée de film d’horreur que j’ai « pitchée » à Dario Argento et ça lui a vachement plu. Et j’aimerais bien l’écrire avec lui !
Un sacré scoop, surtout pour Culturopoing ! De quel(s) cinéaste(s) te sens-tu particulièrement proche aujourd’hui ?
Plein ! Certains sont des amis. Je ne fonctionne pas par bande, davantage par affinités, mes amis cinéastes sont donc très différents : Arnaud Desplechin, Michel Hazanavicius, Jérôme Cornuau, avec qui j’ai écrit Dissonances, un film que j’adore, Wes Anderson, Sofia Coppola, Pierre Salvadori… Je me sens très proche de ce que font Jacques Audiard et Desplechin. J’adore Spielberg, celui de Munich et encore plus celui de La Guerre des Mondes. Je sais, je suis un mec bizarre… J’aime beaucoup Johnnie To. Beaucoup, beaucoup !
Tu vois toujours autant de films !
Je mets un point d’honneur à ne jamais lâcher le fait de voir des films. J’en vois le plus possible, en DVD ou en salle, je ne veux pas me déconnecter du cinéma, j’ai même besoin des films des autres pour avoir envie de faire les miens. Ce que j’attends en allant voir un film en salle, c’est être dans l’admiration. J’aime admirer un cinéaste, être un peu jaloux, parce que ça me donne envie de faire des choses. Je suis très stimulé par le cinéma du passé et du présent, ça me donne envie de continuer. Et ce que j’essaie de me dire, jour après jour, c’est que je ferai toujours tout pour ne pas perdre la flamme qui m’a donné envie de faire des films, de ne pas perdre le sentiment que j’avais quand je gardais un rang à la Cinémathèque pour une bande de copains quand on allait revoir Man Hunt, Ministry of Fear, The Long Voyage Home ou un film de Joseph Lewis, et qu’on allait être sidérés même par quatre minutes du film. J’ai toujours cette envie d’être sidéré par trois minutes d’un film et d’avoir envie d’un seul coup d’en faire un. Je suis toujours dans ce rapport au cinéma. Je n’ai pas envie de faire une carrière, d’être célèbre. J’ai envie d’être bien payé pour ce que je fais mais je ne suis pas dans une soif de reconnaissance par le milieu. Ça me fait plaisir, ça donne un coup de fouet pour continuer, mais ça n’est pas ma quête initiale. Ma quête, c’est de ne pas jamais perdre cette envie de faire des films, ça, c’est important !
* L’Homme au bras d’or (1955) est connu comme l’un des premiers films hollywoodiens avec stars (ici, Frank Sinatra) à avoir utilisé une musique originale, composée par le grand Elmer Bernstein, introduisant des éléments venant directement du jazz (Sinatra y joue le rôle d’un batteur héroïnomane). A travers ce film et d’autres (Le Grand chantage, La Rue chaude…), Bernstein fut d’ailleurs l’un des grands artisans de la popularisation des sonorités jazz à Hollywood. Il est souvent confondu avec Leonard Bernstein, compositeur contemporain et grand chef d’orchestre, qui travailla plus épisodiquement pour le cinéma, mais fut lui aussi très inspiré par le jazz, comme l’illustre son œuvre de loin la plus connue, West Side Story.
Photo Nicolas Saada : Copyright SGP / BESTIMAGE
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).